Comment se construisent les nouvelles connaissances ? La recherche fondamentale en biologie, comment ça se passe ? En quoi consistent les métiers de la recherche ? Comment devient-on chercheur.e ? Chaque semaine, un(e) biologiste nous raconte son quotidien !
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Antoine Bridier-Nahmias, Maître de Conférence à l’UFR de Médecine de l’Université Paris Cité
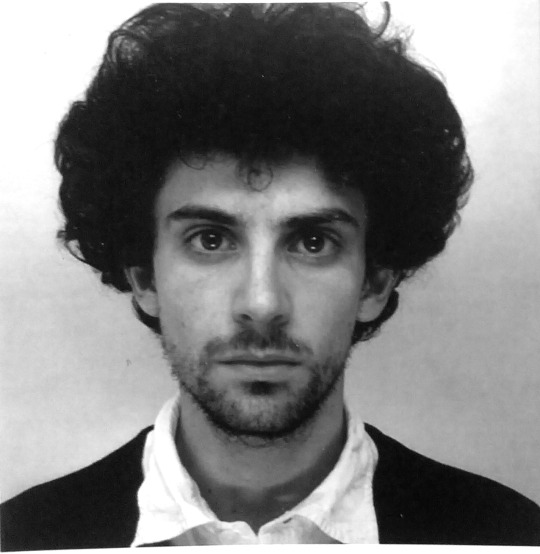
Je suis Antoine Bridier-Nahmias, Maître de Conférence à l’UFR de Médecine de l’Université Paris Cité. Avant cela, j’ai effectué ma licence de Sciences de la Vie et mon master de Biologie Moléculaire et Cellulaire à l’Université Pierre et Marie Curie. J’ai ensuite effectué mes travaux de thèse à partir de 2010 et jusqu’en 2014 dans le laboratoire de Pathologie et Virologie Moléculaire à l’hôpital Saint-Louis avec pour organisme modèle la levure S. cerevisiae et pour but d’étudier l’ADN dit mobile (plus précisément ici un rétrotransposon).
Le laboratoire Génomique, Bioinformatique, et Applications m’a ensuite accueilli pour travailler sur la génomique des maladies psychiatriques et me former aux techniques d’analyses bio-informatiques. En 2016, je suis devenu maître de conférences et j’enseigne entre autres la biochimie aux étudiant de première année de la LAS (Licence Accès Santé) et j’interviens ensuite plus tard dans les cursus de médecine et pharmacie pour des enseignements portés sur la génomique, les techniques d’analyse et l’évolution. Ma recherche porte globalement sur l’évolution des micro-organismes, virus et bactéries avec des modèles comme Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis ou encore le SARS-CoV-2. L’évolution est un trait commun à tout le monde vivant mais ne se produit pas au même rythme chez tout le monde. Elle se compte en années pour les humains par exemple alors que la bactérie E. coli se reproduit dans un tube à essai en moins d’une demie heure. On peut donc observer l’évolution d’une souche pathogène chez un patient infecté quasiment en temps réel !
11 notes
·
View notes
Text
Benoit Gachet, Ingénieur l’unité INSERM U1137 – IAME

Bonjour !
Je m’appelle Benoit Gachet. Après un master de recherche réalisé à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris, j’ai intégré en tant qu’ingénieur l’unité INSERM U1137 – IAME (Infection, Antimicrobials, Modelling, Evolution) en 2018.
Le thème central de mon laboratoire de recherche est la bactérie Escherichia coli. Cette petite bébête est retrouvée de manière commensale (c’est-à-dire naturellement) et abondante dans notre tube digestif. Elle joue un rôle majeur dans de nombreux mécanismes biologiques et biochimiques chez nous autre les Hommes. Malheureusement Escherichia coli n’est pas qu’un ami qui nous veut du bien et certaines souches sont pathogènes pour l’Homme et vont induire des maladies qui vont du simple « dérangement intestinal » jusqu’à la septicémie voire le décès. De plus avec l’utilisation massive des antibiotiques (les antibiotiques, ce n’est plus automatique) il arrive qu’on ne dispose plus de traitement pour soigner des patients ayant une infection à Escherichia coli, c’est ce qu’on appelle une impasse thérapeutique.
C’est là que j’interviens grâce aux différents projets auxquels je participe. Nous essayons, avec mes collègues, de mieux comprendre cette bactérie essentielle pour nous. Mes projets vont de la recherche purement théorique, avec l’étude de l’évolution du génome d’Escherichia coli au cours du temps et dans différentes conditions de culture, jusqu’à des thématiques plus appliquées pour l’Homme avec des études sur l’antibiorésistance de certaines souches.
En dehors du travail, j’aime sortir avec mes amis, aller boire des verres entre collègues mais aussi voyager et suivre le sport de manière générale.
3 notes
·
View notes
Text
Lucile Vigué, Thésarde au laboratoire Infection, Antimicrobials, Modelling, Evolution (IAME)

Je m’appelle Lucile Vigué et je suis en troisième année de thèse au laboratoire Infection, Antimicrobials, Modelling, Evolution (IAME) à Paris. J’ai débuté mes études supérieures par deux années de classes préparatoires Physique-Chimie, à Toulouse, avant d’intégrer l’École polytechnique. J’ai également effectué un stage de recherche au Royaume-Uni et un master de bio-informatique à l’EPFL, en Suisse. C’est à l’École polytechnique que j’ai découvert la théorie de l’évolution. C’est un domaine de la biologie où l’on applique régulièrement des techniques de modélisation issues des mathématiques et de la physique. L’informatique y joue également un rôle clé pour traiter des quantités de données qui ne cessent d’augmenter.
Au quotidien, j’étudie les génomes de dizaines de milliers de souches de la bactérie Escherichia coli pour comprendre les mécanismes lui permettant de s’adapter à son environnement. En effet, des bactéries soumises à un traitement antibiotique peuvent, en seulement quelques générations, acquérir des résistances à celui-ci. Elles y parviennent grâce à deux phénomènes biologiques : la mutation, qui génère de la nouveauté au sein d’une population, et la sélection naturelle qui favorise la propagation des mutations avantageuses. N’importe quelle bactérie dispose d’un gigantesque réservoir de mutations potentielles car son génome code pour des milliers de protéines, chacune composée de centaines d’acides amin��s. Distinguer une mutation qui déstabilise une protéine d’une autre qui la rendra plus fonctionnelle est expérimentalement long et coûteux. Cela devient rapidement impossible lorsque le nombre de mutations ou de combinaisons de mutations à caractériser augmente. Dans le cadre de ma thèse, j’analyse des séquences protéiques à l’aide de modèles statistiques. Ceux-ci me permettent de prédire l’effet d’une mutation ainsi que les interactions entre plusieurs mutations. Ce dernier point est crucial car deux mutations individuellement délétères peuvent devenir bénéfiques en association. J’emploie ces prédictions pour comprendre comment l’espèce Escherichia coli évolue. Je généralise les méthodes que je développe à d’autres organismes, en particulier pour détecter les mutations responsables de maladies génétiques ou de cancers chez l’humain.
Bibliographie
Vigué, Lucile, Giancarlo Croce, Marie Petitjean, Etienne Ruppé, Olivier Tenaillon, and Martin Weigt. “Deciphering Polymorphism in 61,157 Escherichia Coli Genomes via Epistatic Sequence Landscapes.” Nature Communications 13, no. 1 (December 2022): 4030. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31643-3.
Vigué, Lucile, and Adam Eyre-Walker. “The Comparative Population Genetics of Neisseria Meningitidis and Neisseria Gonorrhoeae.” PeerJ 7 (June 27, 2019): e7216. https://doi.org/10.7717/peerj.7216.
Hobson, Claire Amaris, Lucile Vigué, Mélanie Magnan, Benoit Chassaing, Sabrine Naimi, Benoit Gachet, Pauline Claraz, et al. “A Microbiota-Dependent Response to Anticancer Treatment in an In Vitro Human Microbiota Model: A Pilot Study With Hydroxycarbamide and Daunorubicin.” Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 12 (June 1, 2022): 886447. https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.886447.
4 notes
·
View notes
Text
Imane El Meouche, Chargée de recherche INSERM au Laboratoire IAME

Je m’appelle Imane El Meouche. Je suis chargée de recherche INSERM au Laboratoire IAME “Infection, Antimicrobials, Modelling, Evolution”, UMR1137, localisé à la Faculté de Médecine, site Xavier Bichat à Paris. Mon travail se focalise sur les mécanismes de survie des bactéries exposées aux antibiotiques et en particulier sur les phénomènes de résistance et la tolérance chez Escherichia coli.
Cette espèce bactérienne correspond à la principale espèce commensale du microbiote intestinal aérobie mais aussi à l’agent pathogène le plus fréquemment observé en pratique clinique, notamment dans le cadre des infections urinaires.
Je me suis toujours intéressée aux mécanismes de la pathogénicité bactérienne et à l’antibiorésistance. Mon travail de thèse portait sur l’étude du facteur Sigma « SigD » de Clostridium difficile et son implication dans la régulation de l’autolyse, de la mobilité et de la production de deux facteurs majeurs de virulence, les toxines A et B.
Ensuite, je suis partie aux États Unis pour effectuer un stage postdoctoral où j’ai étudié la régulation de l’expression des gènes de résistance aux antibiotiques tels que les pompes à efflux et leurs régulateurs. Les pompes à efflux sont des transporteurs membranaires impliqués dans l’export des antibiotiques et d’autres substances en dehors des cellules bactériennes.
Plus spécifiquement, mon travail a porté sur le régulateur MarA, qui active l’expression des gènes de pompes à efflux, et sur son expression à l’échelle de la cellule unique en prenant comme modèle E. coli. En effet, même au sein d’une population bactérienne ayant le même matériel génétique, des différences phénotypiques dues notamment à l’hétérogénéité de l’expression de gènes émergent. Ceci pourrait potentiellement contribuer à une réponse différente des cellules en présence d’antibiotique et à des échecs thérapeutiques.
Au sein des équipes EVRest et QEM du laboratoire IAME, je travaille avec un groupe d’étudiant(e)s et ingenieur(e)s sur l’identification de nouveaux mécanismes de tolérance et de résistance aux antibiotiques chez E. coli. En effet, la résistance aux antibiotiques, problème de santé publique majeur, a souvent été étudiée sur des souches de laboratoire dans des milieux conditionnés. Notre objectif est l’analyse des déterminants de la non-réponse bactérienne in vitro et in vivo aux antibiotiques, sur des isolats naturels de Escherichia coli dans des contextes plus cliniques comme les infections urinaires, où les récurrences et l’émergence de la résistance aux antibiotiques sont fréquentes.
En dehors de la recherche, je participe à des modules d’enseignement à l’Université de Paris Cité, je suis membre dans le bureau des tuteurs à l’école doctorale BioSPC pour le site de Bichat et j’adore cuisiner des plats libanais.
0 notes
Text
Rémi Gschwind, Chercheu post-doctoral au laboratoire IAME

Hola !
Je m’appelle Rémi GSCHWIND, je suis Post-doc au laboratoire IAME «Infection, Antimicrobials, Modelling, Evolution» à Paris.
Avant d’être Post-doc, j’ai fait de la microbiologie et notamment des thématiques du microbiote ma spécialité en réalisant une thèse sur un sujet brûlant : existe-t-il un microbiote placentaire ? En parallèle, je me suis beaucoup intéressé à la vulgarisation scientifique en animant des conférences pour petits et grands au Palais de la Découverte à Paris. L’une d’entre elle, intitulée « épidémies et compagnie » aurait sans doute été très à la mode aujourd’hui !
Aujourd’hui, je m’intéresse à la résistance aux antibiotiques qui est l’une des dix principales menaces pour la santé publique mondiale selon l’OMS. J’étudie plus précisément le résistome, c’est-à-dire, l’ensemble des gènes de résistance aux antibiotiques que l’on peut trouver dans un échantillon. Pour cela, je travaille avec une technique assez lourde à mettre en place mais extrêmement utile pour caractériser le résistome : la métagénomique fonctionnelle. En effet, elle permet de caractériser des gènes de résistance encore méconnus voire inconnus !
En dehors du labo j’aime les concerts, le sport, la plage et la randonnée.
A bientôt au labo 😊
Rémi
0 notes
Text
Laetitia Cavellini, Ingénieure en techniques biologiques au Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire des Eucaryotes de l’IBPC de Paris

Je m’appelle Laetitia Cavellini. Je suis Ingénieure en techniques biologiques CNRS au Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire des Eucaryotes, localisé à l’institut de Biologie Physico-Chimique à Paris. J'y étudie la dynamique mitochondriale en utilisant la levure Saccharomyces Cerevisiae comme modèle expérimental.
Avant d’être Ingénieure au CNRS, j’ai étudié la biologie moléculaire et la biochimie à Marseille, Nice et Corte où j’ai obtenu un DESS (l’ancêtre du Master Pro). J’ai travaillé en CDD dans plusieurs laboratoires de recherche publics (INRA, GEVES, AFSSA) et privés (AFOCEL et SYNGENTA SEEDS).Actuellement, j'étudie les mitochondries, « la centrale énergétique » de la cellule, et la manière dont elles se rapprochent les unes des autres pour fusionner. Ce processus est essentiel pour la respiration de toutes les cellules, de la levure jusqu’à l’Homme. Si elle ne fonctionne pas correctement chez l’Homme, des maladies dites mitochondriales peuvent apparaître. Depuis une vingtaine d’années, la levure S. cerevisiae s'avère particulièrement pertinente pour modéliser ces maladies mitochondriales. Elle fournit des pistes pour le traitement futur de ces affections, qui touchent 200 nouvelles personnes chaque année en France et engagent le pronostic vital des patients.
Au sein de l’équipe, je m'attache particulièrement à comprendre la fusion des membranes externe et interne de la mitochondrie. Quelles sont les étapes aboutissant à l'ancrage des mitochondries entre elles ? Comment la fusion des membranes externe et interne est-elle coordonnée ?
En dehors de la recherche, je m’intéresse à l’action sociale et à la communication. Je participe à la conception et à la gestion d'activités sociales, culturelles et sportives en tant qu'élue au Conseil d’administration du CAES du CNRS (l'équivalent d’un comité d’entreprise). Correspondante communication CNRS et Sorbonne université, je réalise la communication interne et externe du laboratoire (articles sur le site internet, contenus sur Twitter et Facebook).
0 notes
Text
Julie Finkel, Doctorante au Centre de Biochimie Structurale à Montpellier

Bonjour à toutes et à tous !
Je m’appelle Julie Finkel, je suis doctorante au Centre de Biochimie Structurale à Montpellier.
Avant d’être doctorante en biologie-santé, j’ai d’abord fait un doctorat de Pharmacie à Toulouse (d’ailleurs il me reste encore à soutenir cette première thèse). C’est une filière méconnue qui est pourtant le PARFAIT pont entre les sciences fondamentales et médicales et qui révèle une transdisciplinarité passionnante. A terme, je souhaite rester dans la recherche publique et être enseignant-chercheuse.En dehors de la recherche et du monde de la santé je suis passionnée de vulgarisation/médiation scientifique, de pâtisserie (c’est de la chimie appliquée à la nourriture et au partage alors quoi de mieux ?!), de musique, sport et politique.
Dans la vie de tous les jours, je travaille sur une nanotechnologie qui se nomme les « origamis ADN ». En résumé, je replie de l’ADN comme on replierait une feuille de papier pour en faire la structure de notre choix ! Pourquoi de l’ADN ? Grâce à ses propriétés physico-chimiques épatantes… mais je vous en dirai plus très vite. On peut utiliser cette technologie pour différentes potentielles applications, notamment dans le domaine biomédical.
De mon côté, je travaille sur différents projets dont l’utilisation des ADN origamis comme outil pour étudier la structure de protéines, ou encore pour lutter contre le cancer. Enfin c’est l’objectif ultime, vous verrez que dans la recherche fondamentale on y va petit à petit. Après tout il faut bien commencer quelque part !
Alors… commençons !
0 notes
Text
Guillaume Mestrallet, chercheur postdoctoral au Mount Sinai Hospital en immuno-oncologie
Bonjour à toutes et à tous, je m’appelle Guillaume Mestrallet. Je travaille sur l’immunologie des cancers en post-doctorat au Mount Sinai Hospital de New York.
Tous les tweets de sa semaine juste ici : https://wke.lt/w/s/d7yhHx
Après une formation d’ingénieur et en sciences à AgroParisTech et l’ENS Paris- Saclay, j’ai travaillé pendant ma thèse au CEA sur les propriétés immunitaires des cellules souches de la peau.
A la fin de mon doctorat, nous avons également mené un projet sur l’immunologie du cancer du rein. Ce projet m’a donné envie depuis quelques mois de développer cette thématique sur un autre type de cancer en post-doctorat.
2 notes
·
View notes
Text
Typhaine Brual, doctorante au laboratoire Microbiologie, Adaptation et Pathogénie à Lyon

Hello ! 😃 Je suis Typhaine Brual, doctorante en deuxième année au laboratoire Microbiologie, Adaptation et Pathogénie à Lyon. Ma grande passion est la génétique bactérienne 🧬🤓.
Tous les tweets de la semaine juste ici : https://wke.lt/w/s/wxJ51a
Avec mon équipe, on essaye de décrypter la régulation de la virulence d’une bactérie qui infecte les plantes, Dickeya dadantii. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose, pourtant, avez-vous déjà eu une patate pourrie avec une odeur nauséabonde dans votre filet de pommes de terre 🥔 ? Oui ? Alors vous avez déjà fait connaissance avec ma bactérie 🧫🥰
Celle-ci est très futée car elle arrive à entrer dans les tissus végétaux et à se cacher du système immunitaire des plantes, tout en se multipliant. Une fois en quantité suffisante, notre armée de bactérie se coordonne pour attaquer en même temps, menant à la pourriture de la plante. Vous vous en doutez, les mécanismes de régulation régissant cette infection sont très complexes et au cœur de nos projets de recherche au laboratoire 🔎🔬
Personnellement je travaille sur un régulateur qui se nomme RsmC, une protéine qui inhibe la virulence de ma bactérie. Ce qui est très curieux, c’est que RsmC est capable de réprimer la virulence pendant l’infection, autrement dit lorsque les facteurs de virulence devraient être au max ! 🤔
Avant d’être doctorante, j’ai mis un peu de temps à trouver ce que j’aimais faire. J’ai d’abord tenté médecine, puis les concours paramédicaux… pour finir par tout arrêter et travailler à temps complet en restauration rapide. J’ai ensuite repris une licence de biologie, grâce à laquelle j’ai découvert la microbiologie. Vu que ça me plaisait bien, j’ai continué en troisième année spécialité Microbiologie. Grâce à une matière enseignée par la personne qui deviendra mon directeur de thèse, Erwan Gueguen, j’ai été initiée à la génétique bactérienne. Ce fut un réel élément déclencheur de ma passion qui m’anime encore aujourd’hui !
En dehors de la recherche, je fais du karaté, j’aime le dessin, Metallica, la bière, la burrata, les crêpes et le saucisson (liste non exhaustive, en particulier pour la nourriture).
Cette semaine, je vais vous donner la patate en vous faisant découvrir la fabuleuse vie de Dickeya dadantii ! J’ai super hâte de vous montrez mes techniques de clonage préférées et ce que je fais au quotidien 🤓
On y va ? 😃
0 notes
Text
Léopoldine Taïrou, stagiaire à l'Université de Copenhague en microbiologie environmentale

Je m’appelle Léopoldine Taïrou et je suis en deuxième et dernière année de Master de Sciences de l’environnement à l’Université de Copenhague au Danemark et à l’Université BOKU de Vienne en Autriche (je suis dans un double master). Je suis actuellement en thèse de master à l’université de Copenhague dans la section de Microbiologie du département de Biologie.
Retrouvez toute la semaine de Léopoldine, juste ici : https://wke.lt/w/s/wnhVNe
Une thèse de master est plus ou moins l’équivalent d’un stage de recherche de fin d’études en France. La plus grosse différence selon moi c’est que je ne suis pas payée mais sinon j’ai un statut similaire à celui d’une stagiaire et je mène un projet de recherche sous la supervision d’un tuteur.
En sortant d’un bac scientifique, j’ai fait une licence scientifique interdisciplinaire tournée autour des sciences du vivant en France. Dès le lycée, j’ai été intéressée par le monde de la recherche et cet intérêt c’est vérifié durant ma licence. J’aime particulièrement la recherche en sciences de l’environnement et du climat en partie car il y a souvent une partie sur le terrain pour faire des mesures ou récupérer des échantillons.
Au cours de mon master j’ai eu la possibilité d’acquérir des connaissances techniques en sciences de l’environnement et du climat mais aussi des connaissances en gouvernance de l’environnement, management de l’environnement et écologie sociale. Je n’ai pas d’idée clair et arrêté sur ce que je veux faire après ce master et ça dépendra des opportunités que j’aurais. J’aimerai travailler dans les relations entre la science et les politiques publiques en étudiant les impacts environnementaux des politiques mise en place mais j’envisage également de faire un doctorat pour continuer dans le monde de la recherche. Si je fais un doctorat j’aimerai continuer dans le domaine de ma thèse de master la microbiologie environnementale, c’est-à-dire l’étude de microbes dans l’environnement.
La microbiologie environnementale cherche à répondre à des questions telles que quels sont les microbes dans l’ environnement ? comment diffèrent-ils d’un lieu à l’autre ? quelles caractéristiques reviennent dans des lieux similaires ? comment réagissent-ils aux changements dans leurs environnements ?
Actuellement, je travaille sur l’impact du changement climatique sur les communautés microbiologiques dans les environnements extrêmes et comment ces changements chez les microbes impactent en retour le climat. Beaucoup d’environnement extrêmes sont à la fois fortement touchés par le changement climatique et font partis des plus vulnérables à ce changement car ils possèdent une biodiversité souvent rare et qui survit parfois uniquement dans ces conditions climatiques, géologiques et écologique particulières. Plus précisément, je travaille sur les microbes des sols arctiques au Groenland et comment les microbes de différentes latitudes de l’île réagissent à la sécheresse. L’Arctique est impacté par des changement de précipitations important avec des épisodes pluvieux moins nombreux mais de plus grande ampleur. En été, les sols alternent donc entre périodes sécheresse et période de forte humidité. Les fortes précipitations créées des changements abrupts d’humidité dans le sol ce qui entraîne des conséquences importantes sur les organismes vivants dans les sols. Je m’intéresse à la fois aux changements de composition des communautés de microbe actifs et aux variations de production de CO2 par ces microbes. La production microbiologique de CO2 varie avec l’humidité du sol et impacte le climat en retour car le CO2 fait partie des gaz à effet de sert qui participent au changement climatique.
0 notes
Text
Léa SWISTAK, Doctorante à l'Institut Pasteur

Bonjour !
Je m’appelle Léa Swistak, je suis actuellement Doctorante en 3ème année à l’Institut Pasteur dans l’unité Dynamique des Interactions hôte-pathogène.
Retrouvez toute ma semaine sur Twitter ici : https://wke.lt/w/s/GR-1Cc
J’utilise la cryo-microscopie électronique pour comprendre comment les bactéries intracellulaires infectent les cellules humaines.
0 notes
Text
François Rousset, Post-doctorant au Weizmann Institute of Science en Israël

Je m’appelle François Rousset, je suis post-doctorant au Weizmann Institute of Science en Israël où j’étudie les systèmes antiviraux chez les bactéries. J’ai toujours été intéressé par les sciences et c’est tout naturellement que je me suis tourné vers le monde de la recherche. Après 2 ans de prépa BCPST, j’ai d’abord suivi une formation d’ingénieur à AgroParisTech puis un master de recherche à l’ENS et au Muséum National d’Histoire Naturelle en microbiologie. Mes nombreux stages m’ont finalement conduit à l’Institut Pasteur où j’ai eu la chance de réaliser ma thèse, et je suis maintenant chercheur post-doctoral depuis bientôt un an.
Retrouvez tous ses tweets ici : https://wke.lt/w/s/39Rf0C
Je suis fasciné par le monde invisible des microorganismes et par leur diversité. En particulier, les bactéries sont absolument partout et colonisent presque tous les environnements possibles grâce à de nombreuses adaptations acquises au cours de l’évolution. Malgré tout, les bactéries sont constamment exposées à des épidémies virales depuis des milliards d'années, au point que ces virus (que l'on appelle des phages) représentent l'entité biologique la plus abondante sur Terre. Devant cette menace, les bactéries ont développé de nombreux systèmes antiviraux pour survivre à l'infection. En réponse, les phages essaient constamment de contourner ces systèmes dans un bras de fer interminable. Avec ma casquette de chercheur, j’arrive sur le champ de bataille après des milliards d’années de conflit et j’essaie de décoder ce qui s’y passe. Il y a quelques années, les scientifiques ont commencé à réaliser que le système immunitaire des bactéries est beaucoup plus complexe que ce que l’on pensait auparavant. Notamment, de nouveaux systèmes immunitaires sont désormais découverts chaque année et révèlent des mécanismes évolutifs fascinants. Il est maintenant clair que certains systèmes immunitaires humains ont un ancêtre commun avec ceux des bactéries, montrant ainsi que certains mécanismes antiviraux sont très anciens. Mes projets au labo visent à déchiffrer le mécanisme moléculaire de deux nouveaux types de systèmes immunitaires chez les bactéries en utilisant diverses techniques génétiques et biochimiques.
0 notes
Text
Candice Roux, doctorante en Neurosciences aux laboratoires de PORSOLT (53) et COMETE INSERM/UNICAEN (14)
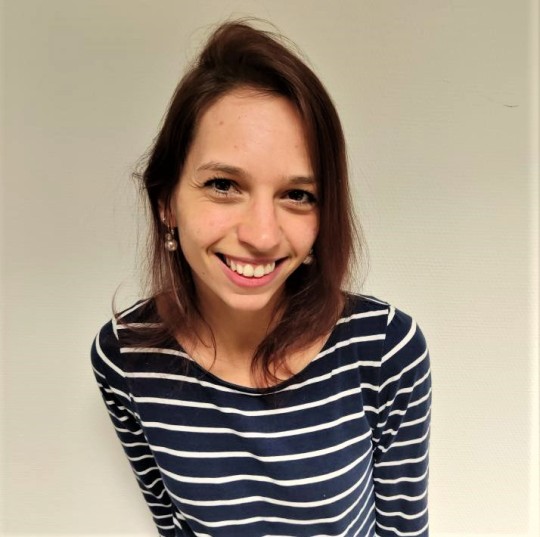
Je m’appelle Candice Roux et je suis doctorante en 3ème année. J’ai la chance de bénéficier d’un financement CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) qui me permet d’exercer mes travaux de thèse dans deux laboratoires. Je trimballe donc ma maison dans ma 207, entre les laboratoires PORSOLT (53) et COMETE INSERM/UNICAEN 1075 (14) où j’étudie les Neurosciences et plus particulièrement….- qu’est-ce que je disais déjà ? …. - Ah oui, et plus particulièrement les troubles de la mémoire.
Tous les tweets de la semaine juste ici : https://wke.lt/w/s/xBmziY
Cet attrait pour les sciences du vivant est né en même temps que l’éveil de ma curiosité (c’est-à-dire plutôt très tôt-peut-être même trop tôt pour certains de mes professeur(e)s de l’époque). Avant de me lancer dans cette aventure scientifique j’ai donc naturellement commencé par un DUT Analyses Biologiques et Biochimiques (53). Grâce à ceux deux années à L’IUT j’ai compris que la biologie animale permettait de répondre à beaucoup de mes interrogations perpétuelles sur entre autres, la machinerie du corps humain. Cette expérience m’a donné l’envie de poursuivre avec une licence en Biologie Cellulaire et Physiologie Animale (29). La suite logique était la réalisation d’un Master Biologie Cellulaire et Moléculaire (35). C’est ainsi que je suis passée de - la petite fille qui entourait tous les jeux où l’on voit des personnes portant une blouse blanche et mélangeant des potions de couleur dans les catalogues de Noël - à bientôt Dr en Neurosciences.
En dehors de la recherche, je sauve des animaux blessés (enfin parfois j’essaye juste), ce qui me vaut l’adorable surnom de Croucrou en référence à la dernière mission sauvetage qui était pour…un pigeon ! Et plus sérieusement je me passionne depuis peu pour la vulgarisation scientifique !
Mes travaux s’intéressent aux troubles de la mémoire qui sont communs à de nombreuses pathologies du système nerveux central. Nous nous intéressons surtout à la réversion de ces troubles de la mémoire par des substances qui agissent notamment sur des sites de fixation spécifiques (récepteurs) de la sérotonine. Oui, c’est bien l’hormone du bonheur, sauf que là, comme on se situe au niveau du cerveau, on parlera de neurotransmetteur, un langage universel … pour les neurones !
Je cherche particulièrement à comprendre les mécanismes d’action d’une molécule connue pour améliorer les performances de mémoire chez l’animal mais aussi chez l’Homme. Ce que l’on sait, c’est qu’elle active certains types (pas tous !) de récepteurs à la sérotonine. En tout cas, tous les jours, après voir activé ces récepteurs, j’harcèle des hippocampes (oui, oui, des hippocampes…) une structure du cerveau impliquée dans la mémoire. Je mesure les réponses électriques des neurones de l’hippocampe (c’est de l’électrophysiologie) et j’évalue des performances de mémoire qui dépendent de cette structure grâce à des tests de comportement.
2 notes
·
View notes
Text
Chloé Baumas, Doctorante en Océanographie microbienne à l'institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) de Marseille

Je m’appelle Chloé Baumas , je suis Doctorante à l'institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) de Marseille, où j'étudie le rôle des bactéries attachées à la neige marine (il s'agit de flocons de matière organiques qui chutent dans l'océan et ressemblent à de la neige) et leur rôle dans la séquestration du CO2 dans l'océan.
Tous les tweets de la semaine juste ici : https://wakelet.com/wake/RnluG7ogYw1-pPKIxrmna
Avant d’être doctorante j’ai toujours étais attirée par les sciences liées à l'océan et c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers l'océanologie. J'ai d'abord suivi une licence sciences de la mer puis un master écologie biologie marine à Marseille.
En parallèle j'ai eu la chance dès mes premières années d'étude de réaliser un premier stage dans la HP-Team du MIO, équipe de Dr. Tamburini. Ils m'ont fait découvrir le monde de l'océanologie microbienne avec une spécialité domaine profond. En effet, avec leur instruments hyperbares et munies de clés plates géantes, ils sont parmi les seuls à être capables d'échantillonner et d'étudier les micro-organismes des profondeurs en reproduisant la pression élevée des environnement abyssaux. Leur passion a été contagieuse et après avoir fait plusieurs stages dans leur équipe, je suis maintenant en thèse avec eux.
Après mon doctorat, j'aimerai continuer par un post-doc en océanographie microbienne et ainsi poursuivre ce que je commence tout juste.
En dehors de la recherche, je plonge, fait de l'aviron et fait partie du comité de l'association JSM3 (Junior Scientist Microbiology Meeting of Marseille), mais je consacre la plupart de mon temps à ma thèse.
Actuellement, dans le cadre de mon travail je m’intéresse à la pompe biologique de carbone. Il s'agit du phénomène par lequel des petites particules produites en surface, dont le Carbone provient de la photosynthèse (et donc de CO2), chutent jusque dans les abysses, piégeant ainsi une énorme quantité de CO2. Pendant la chute des particules, une partie de ce Carbone est utilisé par des bactéries qui vivent accrochées aux particules. Elles l'utilisent pour respirer, ainsi que pour leur biomasse. J'essaye de comprendre qui elles sont, combien elles sont et combien de carbone elles utilisent puisque c'est autant de carbone qui ne pourra pas être piégé loin de notre atmosphère. Pour cela, je suis le parcours des particules depuis la surface jusqu'au fond en prenant en compte bactéries accrochées et la pression qui augmente progressivement.
0 notes
Text
OLAYA RENDUELES, CHARGEE DE RECHERCHE A L’INSTITUT PASTEUR EN MICROBIOLOGIE ET EVOLUTION

Hola !!
Je suis Olaya RENDUELES, chercheuse (CR) CNRS à l’Institut Pasteur au labo de Génomique évolutive de microbes.
Retrouvez tous mes tweets juste là : https://wakelet.com/wake/gvAv1GNpDaAZPrdgQCrqe
Je m’intéresse à l’écologie et évolution bactérienne,et j’utilise comme modèle expérimentale, le genre Klebsiella, des enterobactéries capables de coloniser et subsister dans des environnements très diverses -et adverses-.
Avant d’être CR, j’ai fait une thèse en microbiologie et génétique pour étudier la vie sociale des bactéries au sein des biofilms. Pour mieux comprendre comment la coopération et la compétition évoluait, j’ai fait un premier postdoc très axée théorie évolutive, à l’ETH de Zürich, ou j’ai effectué mes recherches sur Myxococcus xanthus une bactérie prédatrice et motile qui forme des complexes corps fructifères lors des périodes de grande famine, et que l’on peut isoler facilement dans le terreau.
J’ai enfin atterri dans le laboratoire d’Eduardo Rocha pour ajouter une dernière corde à mon arc : la bioinformatique. Ceci m’a permis d’étudier l’évolution des génomes au niveau macroévolutive (sur des très longues périodes de temps).
J’ai ensuite intégré le CNRS en 2017, et actuellement j’ai un petit groupe de recherche à mi-chemin entre la biologie humide et sec à l’Institut Pasteur.
Actuellement, dans le cadre de mon travail j’essaie de comprendre comment une bactérie évolue, réagi à son entourage, s’installe et colonise un environnement, interagit avec les autres microorganismes présents (soit d’autres bactéries, virus, ou éléments du système immunitaire), et éventuellement, essayer de prédire leur évolution. Je m’intéresse aussi à la biodiversité au sein des communautés bactériennes, comment elle est générée et comment elle est maintenue. Je cherche particulièrement à comprendre comment la capsule, la couche la plus externe présente dans nombreuses bactéries, influence l’adaptation à l’environnement, à différents échelles de temps (court, mi- et long terme), car elle impacte directement les interactions sociales, y compris en compétition et le transfert horizontal de gènes.
En dehors de la recherche j‘aime voyager, gouter aux cuisines du monde, et m’occuper de ma petite jungle urbaine. Je suis également catsitteuse à temps partiel, et, pour calmer la mauvaise conscience, je pratique un peu de sport.
1 note
·
View note
Text
PERLE GUARINO-VIGNON, POST-DOCTORANTE DANS L’EQUIPE AGES du “CENTER OF ANTHROPOBIOLOGY AND GENOMICS” DE TOULOUSE

Je suis Perle Guarino-Vignon, post-doctorante dans l’équipe AGES au center fo anthropobiology and genomics of Toulouse, où je reconstruit l’histoire des populations humaines du passé via les génomes anciens.
Retrouvez tous ses tweets ici !
Après 2 ans de prépa BCPST, j’ai été reçue à l’ENS de Lyon en Géologie spécialité Paléontologie. Un premier stage en L3 sur la paléogénétique des hiboux m’a éloignée de ma passion première pour les fossiles pour me jeter dans les bras de l’ADN ancien. Après avoir passé l’agrégation de SVT, j’ai fini mon cursus normalien par un M2 recherche qui s’est clôturé par un stage de recherche de 6 mois avec Céline Bon au Musée de l’Homme sur l’analyse de génomes humaines anciens. Parce que je m’y plaisais bien, je suis restée au Musée et j’ai commencé ma thèse sous la direction d’Evelyne Heyer et de Céline Bon. Pendant ces 3 ans, j’ai étudié les migrations humaines autour de la mer Caspienne par le prisme de l’ADN ancien.
C’est donc dans cette même discipline de l’ADN ancien que je commence mon post-doctorat au CAGT à Toulouse. L’idée est de mieux comprendre l’Histoire des populations humaines (migrations, sélection, changement de régime alimentaire, état de santé) en étudiant l’ADN ancien préservé dans les restes anthropologiques retrouvés par les archéologues. En comparant les génomes fossiles avec ceux des humains vivants actuellement, on comprend mieux les changements qui ont eu lieu au cours du temps. L’obtention d’ADN dans le tarte des dents et dans certains os, permet d’étudier le microbiome orale des anciens humains ainsi que les pathogènes que ces derniers portaient avec eux.
Plus précisément, au cours de mon post-doctorat, je vais m’intéresser à 2 terrains très différents. Tout d’abord, je vais essayer de comprendre l’effet de la colonisation sur les populations Yakuts en Sibérie orientale, grâce à des données génétiques couvrant les 5 derniers siècles. Le 2ème projet s’intéresse aux épisodes de peste du 17ème et du 18ème siècle en France et son impact sur les humains. Pour les 2 projets je vais analyser les génomes humains anciens mais aussi ceux des pathogènes et du microbiote buccal pour dresser un véritable bilan sanitaire de ces populations.
L’ADN ancien me fascine et j’aimerais beaucoup continuer la recherche dans ce domaine. Sinon, réaliser une carrière dans mon autre grande passion, l’ornithologie ne serait pas si mal !
0 notes
Text
DAMIEN GOUTTE-GATTAT, CONSERVATEUR SCIENTIFIQUE POUR FLYBASE AU DEPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET NEUROSCIENCE A L’UNIVERSITE DE CAMBRIDGE

Je suis Damien Goutte-Gatta, conservateur scientifique pour Fly Base au sein du département de physiologie, développement et neurosciences à l’Université de Cambridge, Royaume-Uni.
Toute sa semaine juste ici : https://wakelet.com/wake/xqKL66imTt0vCyOAM20QK
J’ai suivi un cursus de biologie qui s’est terminé par une thèse de doctorat préparée à l’Institut Albert Bonniot (aujourd’hui le Institute for Advanced Biosciences) à Grenoble et consacrée à la structure de la chromatine et aux rôles des variants d’histones. J’ai enchaîné par deux post-doctorats, d’abord à l’Institut Européen de Chimie et Biologie de Bordeaux, où j’ai étudié la réparation de l’ADN et la ségrégation des chromosomes chez la drosophile, puis au Barts Cancer Institute à Londres, où j’ai développé un modèle d’étude des tumeurs cérébrales (toujours chez la drosophile). À l’issue de mon second post-doctorat, j’ai quitté la paillasse pour devenir conservateur scientifique (“biocurator” en V.O.) pour FlyBase, la base de données biologique consacrée aux drosophiles.
Succinctement, le rôle d’un conservateur scientifique est de collecter les données issues de la recherche, de les organiser et de les rendre aisément découvrables et exploitables. Au sein de FlyBase, je m’occupe tout particulièrement des données issues des expériences de séquençage d’ARN sur cellules uniques (“single-cell RNA-seq”). Je participe également au développement d’ontologies anatomiques et cellulaires (des sortes de «dictionnaires » des termes utilisés pour décrire des organes et des types cellulaires), nécessaires à la bonne exploitation de ces données. Un de mes objectifs est de faciliter la comparaison de jeux de données issues d’espèces différentes (par exemple entre la souris et la drosophile) afin d’identifier les similitudes et les divergences entre espèces.
0 notes