Bulletin militant révolutionnaire Analyses et communiqués de l'insurgé sur son site : http://www.insurge.fr Ci-dessous : des documents que nous jugeons utiles de faire connaître sans en partager nécessairement tous les aspects.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Link
Par Michel Husson (publié le 21 août sur le site A l’Encontre) Le système suédois de retraites est celui qui est allé le plus loin – et depuis longtemps – dans la logique des comptes dits notionnels. Même si le système par points proposé pour la France n’en est pas un pur décalque, il se réclame des mêmes principes de contributivité et d’universalité. Le modèle suédois étant par ailleurs paré de tous les mérites, il est éclairant de l’analyser de manière détaillée et d’aller voir l’envers du décor [1].
La loi d’airain des retraites
Les réformes des retraites contiennent souvent une clause cachée, à savoir que la part des retraites dans le revenu national ne doit plus augmenter. L’adoption de cette règle, souvent baptisée soutenabilité financière, entraîne – arithmétiquement – une baisse relative de la pension, dès lors que le nombre de retraités augmente plus vite que celui des actifs (voir annexe pour une démonstration). Dès lors, quel que soit le système de retraites, les réformes ne se distinguent que par le choix des dispositifs adoptés pour faire respecter cette règle générale qui implique un appauvrissement relatif (voire absolu) des retraité·e·s. Plus fondamentalement, il s’agit d’une inversion totale de logique sociale. Un système par répartition pur obéit à une logique des besoins: à partir de normes sur l’âge de la retraite et le taux de remplacement (le rapport entre pension et revenu d’activité) on calcule le montant total des pensions et on en déduit rétroactivement le taux de cotisation. Un système pur de comptes notionnels ou par points fonctionne selon une logique comptable: on se fixe le montant total des pensions, et le taux de remplacement, ou l’âge de la retraite, compatibles avec cette contrainte en découlent. Une autre différence, sur laquelle on reviendra, est que l’on passe d’un système régi par des normes sociales à un autre où l’ajustement est en grande partie le fait de comportements individuels. Dans le cas suédois, la réforme est assez radicale, puisqu’elle se fixe comme objectif une baisse de la part des retraites jusqu’à 7% en 2070. Le graphique ci-dessous illustre cette trajectoire: il fait apparaître un net décrochage avec la mise en oeuvre de la réforme à la fin des années 1990, puis un rebond avec la crise. Ensuite, la courbe devrait reprendre son mouvement à la baisse. Cette courbe est construite à partir de données officielles d’Eurostat et de la Commission européenne pour les prévisions [2]. Si ces dernières sont évidemment soumises à de fortes incertitudes, les projections démographiques à long terme sont en revanche plus fiables. C’est la seconde courbe du graphique qui décrit l’évolution passée et prévue du ratio de dépendance. Ce ratio qui rapporte la population de plus de 65 ans à la population en âge de travailler (20 à 64 ans) augmente à peu près régulièrement, passant de 29% en 1995 à 43% en 2070. La stagnation, voire la baisse de la part des retraites, combinée avec une augmentation du ratio de dépendance conduit mécaniquement à un appauvrissement relatif des retraités. Le taux de remplacement, c’est-à-dire le rapport entre la pension moyenne et le revenu d’activité moyen est programmé pour passer de 50,5% en 2016 à 32,6% en 2070. L’objectif d’une part des retraites constante est en réalité un choix de société et la prouesse de la réforme suédoise est de l’avoir fait passer comme une simple option technique. Mais elle se réclame en même temps d’un long dialogue social qui aurait fait émerger un large consensus.
La longue gestation du consensus néolibéral
Dans les années 1970, le système de retraites suédois était un système par répartition somme toute assez semblable au système français. Il comportait trois niveaux: un minimum vieillesse (la «pension du peuple») régulièrement revalorisé, des retraites publiques, et des retraites complémentaires (fonctionnaires, salariés, cadres). L’ensemble de ce système assurait un taux de remplacement de l’ordre de 75%. C’était un symbole (un «bijou de famille») du modèle social-démocrate construit dans les années 1950. A partir du milieu des années 1980, la nécessité d’une réforme du système fut avancée, avec trois arguments: ralentissement de la croissance, progression des sorties anticipées du marché du travail et augmentation de l’espérance de vie. On pourrait y ajouter le caractère «trop» redistributif du système qui était censé le rendre moins attractif pour les hauts revenus. Après un premier rapport de 1990 jugé trop radical, c’est un groupe de travail parlementaire (où tous les partis disposant de députés étaient représentés) qui se met à la tâche. Les grandes orientations de son rapport sont validées à une large majorité de 85% par le Parlement en juin 1994. La réforme est lancée, autour de deux grands principes. Le premier est de rechercher une plus grande contributivité, autrement dit de resserrer le lien entre la pension et les revenus perçus au cours de la vie professionnelle, et donc de limiter les dispositifs redistributifs. Le second principe est que le coût global des retraites devra évoluer strictement en fonction de la croissance économique, soit en pratique que le taux de cotisation doit être définitivement fixé. La mise en œuvre de la réforme prendra du temps: initialement prévue pour le 1er janvier 1996, la date d’application sera plusieurs fois repoussée jusqu’au 1er janvier 2001. De toute manière, comme c’est le cas dans une réforme systémique, il existe une période de transition durant laquelle le nouveau système se substitue progressivement à l’ancien. Cette réforme est souvent vantée par la logique consensuelle de sa méthode d’élaboration qui supposait de prendre son temps. Mais on pourrait dire que ce temps a surtout servi à traiter les aspects les plus négatifs de la réforme, présentés comme autant de problèmes «techniques» à résoudre. Bien des questions se posaient en effet, comme c’est le cas pour toute réforme «systémique» des retraites: quelle indexation des pensions? Quel partage entre cotisations employeurs et cotisations salariés? Quel traitement des retraites des conjoint(e)s? Quelle validation des périodes de non-activité (éducation des enfants, études, service militaire, chômage, etc.)? Autant de questions que pose le projet de réforme présenté par Jean-Paul Delevoye en France [3]. Dans le cas suédois, la conception de la réforme a pris du temps: c’était le temps nécessaire pour arriver, sur tous ces points, à un consensus néolibéral. C’est presque comme épargner à la banque Le principe fondamental du système est de tendre vers une contributivité parfaite: «une couronne de pension pour une couronne cotisée» explique l’Agence des retraites en charge du système [4], une formule qui évoque celle d’Emmanuel Macron: «pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous». Le document de l’Agence se veut pédagogique: le compte fonctionne «comme l’épargne ordinaire à la banque» car il faut d’emblée installer l’idée d’une responsabilité individuelle. Formellement, la comparaison peut faire illusion: les cotisations sont accumulées dans un livret individuel, et revalorisées. Le compte est «virtuel» – d’où le terme de notionnel – et il est matérialisé par une «Enveloppe Orange» qui est adressée chaque année aux assurés et récapitule l’état de leur compte. Les comptes individuels sont alimentés par les cotisations qui représentent 18,5% du revenu d’activité. 16% sont placés dans l’un des fonds de pension nationaux, et les 2,5% restants – la «prime de retraite» (premium pension) – doivent être investis dans un fonds privé choisi par l’assuré parmi 831 fonds gérés par 103 compagnies ou, par défaut, dans le fonds AP7 Såfa géré par le gouvernement (il capte 36% du total). Par ailleurs, les retraites complémentaires d’entreprise n’ont pas disparu et représentent environ 30% du total des pensions. C’est seulement à partir de 61 ans (et bientôt 64 ans) que l’assuré peut faire valoir ses droits à la retraite (à 65 ans pour le minimum vieillesse). Le capital «accumulé» ou plus exactement le capital comptabilisé en fonction des cotisations lui est alors progressivement restitué sous forme d’une pension mensuelle, et cela pour le reste de sa vie.
La prise en compte de l’espérance de vie
La spécificité d’un système de comptes notionnels par rapport à un système par points est de faire dépendre le calcul de la pension de l’espérance de vie. Elle est en effet calculée en divisant le solde du compte par l’espérance de vie restante. Soit par exemple une personne qui dispose de 2,5 millions de couronnes enregistrés sur son compte et qui prend sa retraite à 65 ans. Le barème établit qu’il lui reste 20 ans à vivre. Cette espérance de vie est réduite à 16,85 années pour prendre en compte les revalorisations à venir (selon un taux de 1,6% par an): sa pension annuelle sera alors de 148 000 couronnes (2,5 millions divisé par 16,85). Le «reste à vivre» est établi selon un barème des espérances de vie associées à chaque classe d’âge, qui ne prend en compte ni le sexe, ni les métiers exercés. Mais, évidemment, les individus ne respectent pas l’espérance de vie de référence qui leur est attribuée. Il arrive même que certains meurent avant la date fixée par le barème et laissent derrière eux des «gains hérités». Ce capital non utilisé n’est pas transmis à leurs héritiers mais à leurs compagnons de cohorte, nés la même année qu’eux: «ceux qui vivent plus longtemps que la moyenne reçoivent plus que la valeur de leur propre épargne-pension», explique le Rapport orange déjà cité, qui précise même que c’est l’un des objectifs du système. Or, il se trouve aussi qu’il existe, en Suède comme en France, de très grandes différences d’espérance de vie selon les catégories professionnelles: «le taux de mortalité avant l’âge de 65 ans diffère considérablement d’une profession à l’autre», note une équipe de chercheurs suédois [5] qui ont également calculé le pourcentage de «survivants», autrement dit de personnes qui continuent à travailler après 65 ans. Le tableau ci-contre présente leurs principaux résultats. Ils sont très tranchés: seuls 41% des salariés de l’industrie travaillent après 65 ans, alors que cette proportion est de plus de 70% pour les chefs d’entreprise et les enseignants. Or, la logique du système implique que partir plus tôt à la retraite conduit à une pension inférieure. Ces deux effets se combinent pour faire que les catégories populaires «contribuent» aux retraites des plus favorisés.
Les retraites reproduisent les inégalités hommes-femmes
La même étude distingue hommes et femmes et fait apparaître la possibilité de transferts en faveur des femmes dans la mesure où elles vivent en général plus longtemps que les hommes. Mais cela n’est pas vrai des catégories ouvrières. Contrairement à une image répandue, la Suède est assez mal placée du point de vue de l’égalité femmes-hommes. La Commission européenne la classe dans le même groupe que la Finlande, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Slovénie ou la Lituanie. Il y a en Suède 2,1 millions de retraités, soit environ 20% de la population totale, et un peu plus de la moitié (52%) de ces retraités sont des femmes. Or 57% d’entre elles reçoivent le minimum vieillesse contre 16% des hommes. Le document officiel dont sont tirés ces chiffres se borne à constater que «c’est le résultat des tendances historiques du marché du travail qui font que la participation des femmes et leurs revenus du travail sont moins élevés [6]». Corriger ces inégalités ne fait pas partie, par essence, d’un tel système de retraites. La Commission européenne élabore un indicateur d’exposition au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE). En 2016, 17% des Suédois de plus de 65 ans sont exposés à ces risques, mais cette proportion est de 22% pour les femmes, contre 11% pour les hommes. A titre de comparaison, cette proportion est en France de 10% et l’écart entre hommes et femmes est plus réduit [7].
Une revalorisation subordonnée à l’équilibre du système
Les sommes accumulées sont revalorisées selon un indice qui progresse comme le revenu d’activité moyen. Le système paraît donc plus favorable qu’une simple indexation sur les prix, comme c’est le cas en France. Mais faut-il encore que le système soit équilibré: «en cas de problèmes de viabilité financière, cependant, le mécanisme d’équilibrage automatique est activé et l’indexation sera réduite jusqu’à ce que la stabilité soit rétablie. Le mécanisme d’équilibrage automatique garantit que le système sera en mesure de financer ses obligations par un taux de contribution fixe et des règles fixes indépendamment de l’évolution démographique ou économique» [8]. Or, la crise a fait décrocher l’index effectif par rapport à l’index théorique et l’écart n’a été réduit qu’en 2018, comme le montre le graphique ci-contre tiré du Rapport orange déjà cité. En 2010, le mécanisme de calcul aurait dû conduire à une baisse de 4,5%. Il a dû être «lissé» mais la baisse a quand même été de 3% [9]. Ce sont donc les retraités qui ont fait les frais de la crise: le lien entre pensions et revenus d’activité a été partiellement rompu et leur pouvoir d’achat a reculé en 2010 et 2011. Cet impact de la crise montre que les pensions constituent la véritable variable d’ajustement. Si par exemple le rendement des fonds ne suffisait pas à assurer le sacro-saint équilibre, alors celui-ci serait mécaniquement rétabli par une baisse des pensions. Telle est la logique profonde du système, à partir du moment où les taux de cotisation sont irrémédiablement fixés.
L’âge de la retraite
Dans un tel système, il n’y a pas de place pour un âge légal de départ à la retraite. L’assuré doit attendre 61 ans pour faire valoir ses droits, et il a jusqu’à 67 ans pour le faire. En pratique, l’âge moyen de départ à la retraite est aujourd’hui de 64,5 ans. Compte tenu de son mode de calcul, le montant de la pension sera d’autant plus élevé que le départ à la retraite sera tardif. La personne citée plus haut en exemple qui partait à la retraite à 65 ans avec une pension annuelle de 148 000 couronnes n’en recevrait que 128 000 si elle l’avait fait à 61 ans, mais 162 000 si elle pouvait attendre d’avoir 67 ans. Mais cette plage (de 61 à 67 ans) peut changer – contrairement au taux de cotisation – même si ce n’est pas automatique. Il faut alors modifier le système de manière «paramétrique», et c’est ce qui a été fait à la fin de 2017. Il a été décidé que l’âge à partir duquel on peut prendre sa retraite passera de 61 à 64 ans à l’horizon 2026; et il sera alors possible de travailler jusqu’à 69 ans. Pour justifier cette réforme, la ministre des Affaires sociales et celui des Marchés financiers – un voisinage significatif – reprennent un argument connu: «Puisque nous vivons plus longtemps, nous devons travailler plus longtemps afin que les pensions continuent à augmenter.» Dans un beau spécimen de novlangue, les ministres affirment que la réforme vise à «renforcer la sécurité des retraités actuels et futurs». [10]
Le prétexte démographique
L’argument démographique, souvent invoqué pour justifier les réformes des retraites, n’est pas très convaincant quand on l’applique à la Suède. Le graphique ci-dessous montre que le ratio de dépendance (défini ici comme le rapport entre la population inactive de plus de 65 ans et les personnes en emploi âgées de 20 à 64 ans) est de 33,8% en 2015, à peu près le même qu’en France où il est de 33,3%. En outre, ce ratio ne devrait progresser que de 11,7 points entre 2015 et 2050, contre 19 points en France et 26 pour l’ensemble de l’Union européenne [11].
Sources: Eurostat, OCDE
Le même graphique fait aussi figurer la part des retraites dans le PIB. En Suède, comme on l’a vu, la réforme a permis de la faire reculer, alors qu’en France cette part est passée de 9,9% à 12,3% entre 1995 et 2015. Ce constat montre qu’une réforme à la suédoise vise plutôt à contenir le poids des retraites dans le revenu national, plutôt que d’accompagner les évolutions démographiques. Cette comparaison avec la France est l’occasion de relativiser l’image de la Suède comme paradis social-démocrate dont il serait bienvenu de s’inspirer. En réalité, cette image est obsolète: la Suède a pris le tournant néolibéral dès la récession de 1974-75, donc plus tôt que la France. A ce décalage près, la part des salaires évolue de manière parallèle dans les deux pays, comme le montre le graphique ci-dessous. La Suède apparaît même comme plus flexible, avec des fluctuations plus marquées autour de la tendance.
Source: Ameco, Commission européenne
Contributivité contre solidarité
La situation relative des retraités suédois n’est pas vraiment enviable. En 2016, leur revenu médian représente 77% du revenu de la population d’âge actif, alors que la moyenne est de 93% pour l’Union européenne. Notons au passage qu’avec un ratio de 102%, la France est moins éloignée de la moyenne européenne que la Suède [12]. Les données de l’OCDE montrent que la Suède est un peu moins «généreuse» que la France, en termes de taux de remplacement. Mais il s’agit de remplacement brut, et le tableau est très différent si l’on considère le taux de remplacement net qui prend en compte les impôts, avant et après la retraite. On constate alors que le taux de remplacement net est nettement plus bas en Suède (54,9%) qu’en France où il est de 74,5%. Autrement dit, le système fiscal suédois n’exerce aucun effet correctif sur un régime de retraites a priori peu généreux.
Une philosophie sociale
Derrière les dispositifs techniques, un système de retraites est toujours sous-tendu par une conception de la vie en société. C’est cette dimension qu’aborde un très éclairant livre d’Anette Nyqvist [13] qui décrit la genèse de la réforme suédoise à partir d’entretiens avec ses protagonistes. On a vu que le projet avait été élaboré au sein d’un groupe de travail parlementaire où tous les partis étaient représentés. Anette Nyqvist s’est entretenue avec la plupart des membres de ce groupe. Elle raconte comment, vingt ans plus tard, ils parlent du système comme d’une œuvre d’art, le qualifiant de «fantastique, génial, élégant, superbe». L’un des deux représentants sociaux-démocrates explique ainsi: «ce qui m’a séduit, en tant qu’économiste, chercheur et ingénieur social (social constructor), c’était la beauté d’un système capable de se réguler de manière parfaitement transparente». Et un député du Parti de gauche (ex-Parti communiste) pouvait faire état, vingt ans plus tard, du même émerveillement esthétique: «ce qui crée la stabilité, du point de vue de l’État, est qu’il existe un lien entre les actifs et les passifs. Le véritable changement, et le plus important, est que nous avons créé un système dont les prestations sont déterminées par ses ressources». C’est paradoxalement un technocrate à l’origine de la réforme qui se montre plus lucide: la stabilité signifie, dit-il, que «tous les risques sont reportés sur les assurés. C’était cela la grande idée». Le quasi-consensus entre l’ensemble des partis représentés au Parlement s’est fait au nom d’une philosophie sociale qui évoque tout à fait celle d’un Emmanuel Macron. La logique arithmétique du système est ainsi un exemple parfait de cette «gouvernance par les nombres», qu’Alain Supiot [14] oppose au gouvernement par les lois. Pour Nyqvist, la mécanique du système de retraites est en parfaite adéquation avec une politique néolibérale fondée sur «l’autonomisation et la responsabilisation des individus». Elle fait notamment référence au livre de Nikolas Rose, Powers of Freedom [15] où ce dernier envisage la possibilité de «gouverner en s’appuyant sur les angoisses et les aspirations “responsables” et “éduquées” des individus et de leurs familles». Chaque individu étant ainsi transformé en «entrepreneur de lui-même», pour reprendre la formule de Michel Foucault [16], l’exercice du pouvoir «consiste à “conduire des conduites” (…) Gouverner, en ce sens, c’est structurer le champ d’action éventuel des autres» [17]. La réforme des retraites est alors un exemple emblématique de la manière dont les «technologies politiques» décrites par Foucault réussissent à reformuler une question éminemment sociale dans le langage de la technique, voire de la simple arithmétique. Dans le cas suédois, la capitalisation obligatoire pour une partie des retraites n’est qu’une assez modeste consolation pour les marchés financiers, mais c’est aussi un instrument éducatif supplémentaire visant à l’intériorisation par les salariés des lois de l’économie. Mais l’essentiel est d’institutionnaliser, et de faire accepter comme naturelle, la loi d’airain selon laquelle la part des retraites dans le revenu national est fixée pour l’éternité. Ensuite, que chacun gère sa destinée. Le recours au gouvernement des nombres évacue ainsi tout débat sur le modèle social et produit des effets clairement idéologiques, puisque, comme l’écrit Rose, «chacun pourra remplir au mieux ses obligations envers sa nation en s’efforçant d’améliorer son propre bien-être économique, celui de sa famille, de son entreprise, ou de son organisation». Comment ne pas penser ici à la formule d’Emmanuel Macron qui, paraphrasant John Kennedy, déclarait lors de ses vœux du nouvel an 2018: «Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dites-vous que vous avez quelque chose à faire pour la Nation.»
La Suède comme pense-bête
Le système suédois présente donc de nombreux effets néfastes peu connus et leur recension peut servir de guide de lecture pour la réforme en gestation en France. Même les économistes de la Commission européenne reconnaissent, dans un document récent, les limites de ce système supposé exemplaire. Certes, ils commencent par célébrer sa résilience: «l’automatisme et la neutralité budgétaire, ainsi que le large soutien politique en faveur de la réforme, ont jusqu’à présent immunisé le système contre les revirements de réforme si courants dans d’autres États membres» [18]. Mais ils émettent quelques réserves assez ravageuses en conclusion de leur examen: «toutefois, les mécanismes d’ajustement garantissant la viabilité budgétaire ont transféré le fardeau financier des variations de la longévité sur les retraités. Alors que les personnes plus aisées pourront compenser une pension publique plus faible par des pensions professionnelles ou privées, les personnes moins bien nanties pourraient voir leur pension chuter en dessous d’un niveau adéquat». Et si la pression publique forçait le gouvernement à prendre des mesures ponctuelles pour ajuster le système, alors «la transparence et la viabilité financière du système, deux des principaux objectifs de la réforme, pourraient être mises en péril». Au-delà des différences techniques entre comptes notionnels (la Suède) et système par points, l’expérience suédoise met en lumière trois principaux problèmes qui sont aussi des aspects de la réforme à surveiller dans le cas français: • Le gel de la part des retraites dans le revenu national sans prise en compte du vieillissement de la population conduit à l’appauvrissement relatif des retraités. • L’individualisation fait obstacle à une redistribution prenant en compte notamment les carrières heurtées, et particulièrement celles des femmes. • Le passage d’un système à prestations définies à un système à cotisations définies est assorti d’un mécanisme aveugle d’ajustement qui reporte les risques sur les retraités, et qui est par nature difficilement réglable à court terme.
_________________________
Annexe
La loi d’airain des retraites
La société est composée de Na d’actifs qui reçoivent un revenu d’activité moyen w, et de Nr retraités qui reçoivent une pension moyenne égale à p.
On suppose que le revenu d’activité augmente au même rythme que la productivité du travail. La part des revenus d’activité dans le PIB est donc constante: Na.w/PIB=e. Le revenu d’activité moyen vaut donc: w=e.PIB/Na
La loi d’airain des retraites impose que la part des retraites dans le PIB soit constante: Nr.p/PIB=k. La pension moyenne vaut donc: p=k.PIB/Nr
La pension exprimée en fonction du revenu d’activité s’écrit alors:
p/w=K.Na/Nr avec K=k/e
En taux de croissance (tx), on a donc: tx(p/w)=–tx(Nr/Na)
Autrement dit, une part des retraites constante implique que toute augmentation du nombre de retraités par rapport au nombre d’actifs entraîne une progression de la pension moyenne inférieure à celle du revenu d’activité moyen. CQFD.
_________________________
Notes [1] L’ensemble des sources consultées sont disponibles sur cette page. [2] European Commission, «The Swedish pension system and pension projections until 2070», Country Fiche for the 2018 Ageing Report. [3] Rapport Delevoye, Pour un système universel de retraite, juillet 2019. [4] Source: Orange Report, Swedish Pensions Agency, 2017. [5] Roland Kadefors et al., «Occupation, gender and work-life exits: a Swedish population study», Ageing & Society 38, 2017. [6] Ministry of Health and Social Affairs, «The Swedish old-age pension system. How the income pension, premium pension and guarantee pension work», May 2017. [7] Source: European Commission, Pension adequacy report, Volume 2, 2018. [8] European Commission, «The Swedish pension system and pension projections until 2070», Country Fiche for the 2018 Ageing Report. [9] Ole Settergren, «La Suède: la réaffirmation et l’aménagement des mécanismes d’ajustement», COR, 2014. [10] AFP, «Sweden to raise earliest retirement age to 64», December 14, 2017. [11] Source: OCDE, Panorama des pensions 2017. [12] European Commission, Pension adequacy report, Volume 1, 2018. [13] Anette Nyqvist, Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System: Opening the Orange Envelope, Palgrave Macmillan, 2016. [14] Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Fayard, 2015. [15] Nicholas Rose, Powers of Freedom. Reframing Political Thought, Cambridge University Press, 1999. [16] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France (1978-1979), Gallimard, 2004. [17] Michel Foucault, «Le sujet et le pouvoir», Dits et écrits, tome IV, Gallimard, 1994. [18] Aspegren Hanna, Durán Jorge, Masselink Maarten, «Pension reform in Sweden: Sustainability and Adequacy of Public Pensions», European Commission, Economic Brief, July 2019. Source : http://alencontre.org/europe/suede/les-beautes-du-modele-suedois-de-retraites.html
0 notes
Link
Entretien paru le 18 juin dans Jacobin en anglais, sous le titre "Tout ce que vous devez savoir sur les manifestations de Hongkong" puis traduit et publié par Alencontre en français. Le gouvernement de Hongkong a tenté de faire adopter à la hâte un projet de loi qui limiterait les libertés civiles. Au lieu de cela, ils ont déclenché un raz-de-marée de protestations, les plus importantes de l’histoire moderne. Le 9 juin 2019, Hongkong a été secoué par une marche d’un million de personnes contre une proposition d’amendement qui permettrait l’extradition de suspects de l’ancienne colonie britannique vers la Chine continentale, de même que vers d’autres pays. Le gouvernement – présidé par Carrie Lam, directrice générale approuvée par Pékin – insiste sur le fait que les dissidents politiques et les activistes ne seraient pas affectés par l’amendement. Mais la mesure a déclenché une tempête de feu, enflammant la colère de la population alors même que le gouvernement s’empressait de la faire adopter en juillet par le parlement. Vendredi dernier [Samedi 15 juin en Chine et en France -note de L'insurgé], après des jours de protestations et d’affrontements avec la police, et au milieu des appels croissants à la grève politique, Carrie Lam a suspendu l’amendement. Samedi 15 juin [Dimanche 16 juin en Chine et en France -note de L'insurgé], quelques heures après le début d’une autre manifestation massive – plus de 2 millions sur une population de 7 millions d’habitants, les manifestant·e·s exigeant le retrait complet de l’amendement et la démission de C. Lam – le gouvernement de Hongkong a présenté des excuses. Pourquoi l’amendement a-t-il suscité une telle indignation? Comment l’héritage du Mouvement des parapluies de 2014, la dernière grande vague de manifestations à Hongkong, a-t-il façonné les manifestations actuelles? Quelles sont les orientations politiques des manifestants? Et quelles sont les perspectives d’avenir des mouvements démocratiques à Hongkong et en Chine? Pour faire la lumière sur toutes ces questions et bien d’autres encore, Kevin Lin, un collaborateur de Jacobin, s’est entretenu avec divers militants et universitaires: Chris Chan, sociologue à l’Université chinoise de Hongkong, étudiant et militant syndical; Lam Chi Leung, socialiste à Hongkong et membre de Left21 [organisation initialement étudiante lancée en 2011-2012]; Chun-Wing Lee, socialiste, membre de Left21 et rédacteur en chef de The Owl, un site Web de gauche à Hongkong; et Au Loong Yu, écrivain et activiste. Lin a également sollicité les commentaires d’Alexa, une militante basée à Hongkong, et membre de la Student Labour Action Coalition, un groupe nettement de gauche dans un lieu où il y en a peu. L’entretien a été quelque peu résumé et légèrement révisé pour plus de clarté.
Les mobilisations
Kevin Lin : Quelle est l’importance de l’amendement d’extradition ? Pourquoi a-t-il suscité tant d’opposition à Hongkong ? ALY : Hongkong a conclu des accords d’extradition avec vingt pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, mais pas avec la Chine continentale. Le camp pro-Pékin, ici à Hongkong et à l’étranger, soutient que puisque Hongkong a des accords d’extradition avec l’Occident, pourquoi ne peut-il pas avoir un accord avec la Chine continentale? Dans le cadre l’accord «un pays, deux systèmes», l’article 8 de la Loi fondamentale stipule que «les lois précédemment en vigueur à Hongkong doivent être maintenues», ce qui signifie que Hongkong est protégé du système juridique chinois. Hongkong, en tant que région spéciale de la Chine, n’a pas le pouvoir et la force nécessaires pour résister à la persécution juridique du gouvernement central chinois si le système juridique de Hongkong n’est pas isolé. La Chine méprise non seulement l’application régulière de la loi, mais aussi l’indépendance judiciaire. Un accord d’extradition entre la Chine et Hongkong sape nécessairement les fondements d’«un pays, deux systèmes». LCL : L’amendement à la loi sur l’extradition a touché le cœur de la plupart des citoyens de Hongkong. Sous le régime du Parti communiste chinois (PCC), les citoyens et citoyennes n’ont souvent pas droit à une procédure régulière, ce qui entraîne régulièrement des condamnations injustifiées. Ceux qui ont critiqué le PCC, ceux qui organisent la veillée de Tiananmen chaque année à Hongkong, ceux qui ont aidé des dissidents chinois, ou même les militants de Hongkong qui ont soutenu des organisations syndicales et d’autres organisations de défense des droits en Chine continentale pourraient être considérés comme «mettant en danger la sécurité nationale» et extradés en Chine continentale. Les citoyens ordinaires craignent que Hongkong ait le statut de n’importe quelle autre ville de Chine continentale, où la liberté des citoyens pourrait être menacée. Les habitants de Hongkong ont le souvenir amer de l’incident du Bookshop Five. Entre octobre et décembre 2015, cinq propriétaires et employés de Causeway Bay Books ont disparu. Ils auraient été arrêtés pour avoir publié des livres sur la vie privée du président chinois Xi Jinping. Ce qui est alarmant, c’est non seulement que cela viole le principe «un pays, deux systèmes», mais aussi que deux des arrestations étaient des arrestations extrajudiciaires. Deux des libraires, Gui Minhai et Lee Bo, ont été enlevés par des agents chinois en Thaïlande et à Hongkong, respectivement. Si le système juridique chinois s’améliorait considérablement, il serait alors possible de discuter d’un accord d’extradition avec la Chine. Mais en réalité, la situation n’a fait qu’empirer. CWL : Le taux de participation a été si élevé parce que même ceux qui peuvent être considérés comme des alliés du gouvernement de Hongkong n’appuient pas le projet de loi d’amendement. Depuis 1997, lorsque Hongkong est tombé entre les mains de Pékin, le gouvernement chinois gouverne Hongkong en forgeant une alliance avec les grands capitalistes et la classe moyenne à Hongkong. Cette stratégie est compréhensible car, en tant que principaux bénéficiaires du développement capitaliste de Hongkong, ils sont enclins à soutenir le statu quo. Mais tout au long de ces vingt-deux années, la jeune classe moyenne, surtout les professions libérales, a exprimé un mécontentement croissant face au gouvernement. Si la crainte que le mode de vie relativement libéral de Hongkong soit menacé en est une des raisons majeures, il est indéniable que la hausse du coût de la vie, en particulier du logement, est un autre facteur. Depuis 2003, le gouvernement chinois a tenté de stabiliser cette alliance en augmentant la valeur des actifs à Hongkong. Les capitaux provenant de la Chine continentale sont l’une des causes de la croissance du marché immobilier et du secteur de la Bourse. Mais cette stratégie gouvernementale s’est clairement retournée contre lui, car il est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes d’acheter leur propre logement. La jeune classe moyenne et les étudiants sont devenus la pierre angulaire des forces de l’opposition à Hongkong. KL : Alexa, tu as assisté aux manifestations. Peux-tu décrire ce que tu as vu ? Qui sont les manifestant·e·s et comment les manifestations sont-elles organisées ? A : Les manifestant·e·s sont composés de gens de tous les milieux sociaux, très motivés et pleins d’espoir. Désormais, il n’y a pas que de jeunes étudiants. Bien qu’il n’y ait pas de leaders [officiels] dans les manifestations, les gens se sont organisés eux-mêmes, principalement par le biais de Facebook, de groupes organisés sur Telegram et de lihkg [un forum en ligne comme reddit]. Ils sont super créatifs, faisant des mimes imitant la propagande pro-Pékin pour faire appel à la génération plus âgée de Hongkong afin d’obtenir son soutien. Ils ont créé des événements du type «groupe de réflexion», des «pique-niques» sur Facebook pour inviter les gens à se rassembler sur le Tamar Park. Certaines personnes ont également créé une page pour appeler les gens à se rendre au MTR [le métro de Hongkong] de même pour des actions. Sur les lieux des manifestations de masse, les gens sont organisés et savent de quelles ressources ils ont besoin. Je pense que tout cela a été appris lors du Mouvement des parapluies en 2014. Le niveau élevé de participation civique et les préoccupations concernant le développement de Hongkong, les droits de l’homme et la primauté du droit sont à leur plus haut niveau depuis 1997. C’est aussi la première fois de ma vie que des gens, pour la plupart silencieux, expriment leur colère contre le gouvernement. Ils sont dégoûtés par ce que la police a fait aux manifestant·e·s pacifiques. De toute évidence, la police a violé les conventions des Nations unies en faisant un usage excessif de la force. KL : Alors que le Front des droits civils de l’homme (une coalition d’organisations de la société civile) a officiellement appelé à la manifestation du 9 juin, le mouvement actuel, comme l’a noté Alexa, semble être horizontal et sans leader. Que pensez-vous de cet aspect des manifestations ? ALY : Bien que le Mouvement des parapluies de 2014 ait été largement spontané, le HKFS (Hong Kong Federation of Students) a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif. Les organisations étudiantes sont maintenant beaucoup plus petites et très fragmentées. Les partis politiques, volontairement ou non, ont également été marginalisés dans la mobilisation. Le Front des droits civils de l’homme a joué un rôle déterminant dans la réalisation des actions du 9 juin et du 12 juin en obtenant les autorisations nécessaires pour marcher et se rassembler en premier lieu. Mais elle n’a tout simplement pas la capacité organisationnelle de mener une désobéissance civile massive. Dans ce mouvement 2019, nous assistons à la poursuite d’une tendance déjà très visible en 2014, à savoir le fort sentiment en faveur des actions décentralisées et sans leader. La révolution de la communication rend la coordination beaucoup plus facile maintenant et l’organisation rigide moins nécessaire. Pourtant, il existe une sorte de fétichisme de la spontanéité chez les jeunes activistes. Beaucoup considèrent simplement l’organisation comme superflue ou nécessairement autoritaire. Même le relativement nouveau Demosist?, fondé et dirigé par Joshua Wong [un militant de vingt-deux ans qui a pris de l’importance pendant la Révolution parapluie], ne semble pas assez attrayant pour les jeunes d’aujourd’hui. Aujourd’hui, n’importe qui peut être un leader temporaire et appeler à des actions radicales sans peser le pour et le contre. Par exemple, le 11 juin, certains petits «localistes» [dans le sens d’autonomie, contre toute centralisation] pro-indépendance ont appelé à une «violence proportionnelle contre le gouvernement» et à ce que les gens s’introduisent par effraction dans l’Assemblée législative et le siège du gouvernement le lendemain pour empêcher le dépôt du projet de loi d’amendement. Finalement, des centaines de jeunes ont tenté d’entrer par effraction dans l’Assemblée législative le 12 juin, malgré le fait que la salle de l’Assemblée législative était alors vide, car il n’y avait pas de réunion du tout. C’est aussi à ce moment que la police a commencé à tirer des balles en caoutchouc, causant des blessures. Les luttes sans leader, aussi grandes soient-elles, sont également moins capables d’avoir des délibérations approfondies avant de prendre des mesures drastiques, et encore moins de lutter contre les provocateurs et les agents des gouvernements de Hongkong et de Pékin. Cela dit, il faut aussi reconnaître que, pour la première fois depuis des décennies, de nombreuses personnes à Hongkong ont accueilli favorablement la tentative controversée de battre en brèche l’édifice législatif KL : Malgré l’affaiblissement des associations d’étudiants universitaires, d’autres nouveaux groupes sont apparus. L’un des groupes de gauche les plus radicaux, la Student Labour Action Coalition, cherche à créer un lien entre les mouvements étudiants et ouvriers et a pris des mesures directes. Pourriez-vous nous parler de votre coalition et de votre participation au mouvement de protestation ? SLAC : Nous sommes une coalition de groupes syndicaux et sociaux et de syndicats concernés fondée en 2017. Nous croyons que les mouvements de travailleurs et d’étudiants ne peuvent être séparés et nous nous concentrons sur l’amélioration des conditions de travail dans les universités en faisant converger les étudiants et les travailleurs. Nous avons soutenu le mouvement de protestation en agissant directement. Le 8 juin, nous nous sommes joints à la Fédération des étudiants en travail social de Hongkong pour marcher dans la rue afin de rallier les citoyens de Hongkong pour participer à la manifestation du lendemain. Nous avons participé à la manifestation avec des étudiants le 9 juin. Après la marche, nous nous sommes joints au piquet de grève et avons rassemblé des appuis pour les actions de grève prévues pour le 12 juin, et nous avons entouré le Conseil législatif. Parce que le Conseil législatif n’est pas démocratique et que la plupart des membres sont des marionnettes du gouvernement de Pékin, nous avons dû encercler le Conseil législatif pour arrêter les réunions. KL : On accuse souvent les puissances étrangères d’instiguer les mouvements sociaux de Hongkong, qu’il s’agisse du Mouvement des parapluies ou des manifestations actuelles. Quelle est votre réponse à de telles accusations ? ALY : Les gouvernements de Pékin et de Hongkong ont déclaré que les manifestations sont financées par le NED (National Endowment for Democracy) américain. Il est vrai que la plupart des partis pan-démocrates [pro-démocratie] ont reçu un financement du NED. Mais il est également indéniable que les grandes manifestations et les affrontements des 9 et 12 juin n’ont pas été appelés par ces partis. Le Front des droits civils de l’homme est une coalition de plus de cinquante organisations, dont la plupart sont des associations civiles et des syndicats. Les principaux partis pan-démocrates en font partie, mais ne constituent qu’une minorité. Le Front a été fondé en 2002, à un moment où les principaux partis pan-démocrates avaient peur de prendre la tête de la mobilisation populaire. C’est précisément à cause de cette histoire que les principaux pan-démocrates n’ont pas été dominants au sein du Front. Sans mentionner le fait que le Front n’a aucune autorité sur les personnes qui participent à leur rassemblement. Souvent, les jeunes font ce qu’ils veulent lorsqu’ils se joignent à nous.
Hongkong depuis le mouvement des parapluies
KL : Nombreux sont ceux qui comparent les manifestations actuelles au Mouvement des parapluies, dans lequel des dizaines de milliers de personnes ont occupé des routes principales pendant soixante-dix-neuf jours pour protester contre le refus du gouvernement chinois d’autoriser le suffrage universel lors de l’élection de la présidence de Hongkong. Cinq ans plus tard, quelle est votre évaluation du Mouvement des parapluies ? CWL : Le Mouvement des parapluies a une histoire très complexe. Avant 2014, les dirigeants des forces d’opposition (les prétendus pan-démocrates) présentes lors des élections étaient des libéraux. Dans la rue, les dirigeants des mouvements sociaux pouvaient être qualifiés comme des personnes qui adoptent des orientations politiques de centre-gauche. Pour simplifier une histoire extrêmement complexe, l’émergence d’un grand nombre de «nouveaux» participant·e·s au mouvement social a dépassé la capacité organisationnelle des partis politiques établis et des organisations/réseaux de mouvements sociaux. Du point de vue de nombreux participants, jeunes et nouveaux, les figures et organisations établies manquaient de légitimité. Nombre d’entre eux ont donc adopté ce que nous appelons le «localisme» et/ou s’opposent à l’idée que l’action collective devrait être dirigée ou coordonnée par des organisations. L’essor du «localisme» et la méfiance à l’égard des organisations, à mon avis, sont les principales conséquences négatives du Mouvement des parapluies. Mais l’expérience d’affronter la police dans les rues en 2014 a clairement renforcé le sentiment de détenir un pouvoir chez de nombreux militants, et de plus en plus de gens sont devenus réceptifs aux actions radicales dans les rues. Sans un tel changement, qui est en partie un héritage du Mouvement des parapluies, les manifestant·e·s n’auraient probablement pas été en mesure d’occuper les zones entourant ce Conseil législatif, ce qui a conduit à l’annulation de sa séance. ALY : Peu après la fin du Mouvement des parapluies, une vague de démoralisation a déferlé sur les jeunes, même si ce sont eux qui ont rendu l’occupation possible. La plupart des organisations non structurées créées par des jeunes au cours des années précédentes se sont effondrées. La Fédération des étudiants de Hongkong (HKFS) a été attaquée, puis prise en charge par des «localistes» xénophobes, avant d’être démantelée par la suite. Et puis le gouvernement a commencé à se venger et à emprisonner beaucoup de militants, ce qui a exacerbé la démoralisation. Grâce au gouvernement de Hongkong, un nouveau cycle de résistance a été relancé, cette fois par une génération encore plus jeune. Pendant une semaine, même des collégiens se sont mobilisés par centaines pour s’opposer au projet de loi sur l’extradition. La génération «Parapluies» représente une rupture avec la génération plus âgée en termes d’identité culturelle: ils sont maintenant plus susceptibles de s’identifier comme Hongkongais que comme Chinois. Et derrière cela se cache le lien émotionnel avec Hongkong qui fait défaut à la génération plus ancienne. Ce qui rend particulière la génération «Parapluies», c’est qu’elle a commencé à développer de tels engagements et qu’elle a été politisée lorsque le gouvernement a refusé sa demande du suffrage universel. Cette année, le projet de loi sur l’extradition en Chine a politisé une génération encore plus jeune. Je me souviens que le dernier jour du Mouvement des parapluies, les gens accrochaient une énorme banderole qui disait: «Nous reviendrons.» Cette prophétie s’est réalisée. KL : Comme le note Au Loong Yu, depuis le Mouvement des parapluies, Hongkong a vu émerger une nouvelle génération de jeunes militant·e·s et leaders. Qui fait partie de cette nouvelle génération de jeunes leaders et quelles sont leurs revendications et stratégies politiques ? ALY : Les partis pan-démocrates ont été discrédités pour leur attitude timide pendant le Mouvement des parapluies. Le vide politique a rapidement été comblé par deux nouvelles forces, à savoir celles qui sont pour l’autodétermination et celles pour l’indépendance. Il s’agit de forces composées principalement de jeunes. Les élections législatives de 2016 ont vu la victoire électorale de cinq nouvelles personnalités en politique, issues des deux courants susmentionnés, aux dépens du camp pan-démocrate, dont Lee Cheuk Yan, le dirigeant du Parti travailliste et de la Confédération des syndicats de Hongkong. Le succès de ces deux derniers courants montre que de nombreux électeurs, en particulier la nouvelle génération, n’acceptent plus la politique trop modérée des pan-démocrates dans leurs rapports avec Pékin. Alors que Yau Wai-ching de Youngspiration et Cheng Chung-tai de Civil Passion sont soit de droite, soit même d’extrême droite, Eddie Chu Hoi Dick, Lau Siu Lai et Nathan Law Kwun-chung (représentant Demosisto) sont légèrement à gauche. La première tendance utilise beaucoup de langage raciste et xénophobe, non seulement contre le PCC, mais contre tous les Chinois. Le programme de Youngspiration exige explicitement que ceux qui ne parlent ni le cantonais ni l’anglais soient exclus de la citoyenneté. (C’est d’autant plus ridicule que de nombreux résidents âgés de Hongkong ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues, mais parlent plutôt le hakka ou le chaochou, deux dialectes.) Ils visent également à empêcher les immigrants chinois du continent de bénéficier des avantages de base à Hongkong. Civic Passion est bien connu pour inciter à la violence contre le peuple chinois. Ce n’est pas un hasard s’ils ont peu d’intérêt à promouvoir les droits du travail et la sécurité sociale en faveur des groupes marginalisés et des minorités. Si ces gens sont radicaux, ils sont, en fait, radicalement conservateurs. L’appel à l’autodétermination de cette dernière aile n’est lié à aucun sentiment anti-chinois. Eddie Chu prétend qu’il est en faveur de l’autodétermination démocratique, qui inclut plutôt qu’exclut le peuple chinois et les autres groupes marginalisés. Leur vision politique est liée à une plate-forme sociale qui intègre les droits du travail, les droits de genre et les droits des minorités. La politique de ces défenseurs de l’autodétermination n’est cependant pas toujours aussi tranchée et pourrait s’adapter aux «localistes» lorsqu’ils seront fortement sollicités par ces derniers. Il faut aussi ajouter la Ligue des sociaux-démocrates à ce camp de partisans de centre-gauche en faveur de l’autodétermination. Ensemble, le camp de centre-gauche a obtenu 15,2 % des voix en 2016. LCL : Depuis le Mouvement des parapluies, le capitalisme du laisser-faire de Hongkong a encore accru la pauvreté et les inégalités économiques. Un citoyen de Hongkong sur cinq, soit 1,38 million, vit sous le seuil de pauvreté. Son coefficient de Gini de 0,539 est supérieur à celui des Etats-Unis et de Singapour. Hongkong a désespérément besoin d’une force socialiste qui s’oppose à la fois à l’autoritarisme et au capitalisme. Mais les individus et les réseaux de Hongkong qui ont des opinions socialistes, tels que Left21 et quelques réseaux socialistes révolutionnaires, sont très faibles et sont dans une situation plus marginale face à la vague des sentiments localistes. KL : Les militants du mouvement social à Hongkong ont joué un rôle crucial dans le soutien des militants chinois de la Chine continentale au cours des dernières décennies, au moins en partie motivés par l’idée que l’avenir démocratique de Hongkong dépendra du développement démocratique de la Chine continentale. Pouvez-vous nous parler de la façon dont les militants de Hongkong ont soutenu les militants en Chine et nous dire si l’évolution politique à Hongkong va porter atteinte à ce soutien ? LCL : Depuis les années 1990, les militants de Hongkong ont toujours soutenu les travailleurs, les droits de l’homme, les droits des femmes, les droits des LGBT et les défenseurs de l’environnement en Chine et ont contribué au développement des mouvements sociaux et de la société civile chinois.
La présentation de la mobilisation à Hongkong sur les réseaux contrôlés en Chine continentale
La liberté civile de Hongkong permet de diffuser les informations et les analyses ayant trait aux mouvements sociaux en Chine, de promouvoir les échanges intellectuels entre les militants de Chine continentale et de Hongkong et d’organiser la solidarité pour la résistance sociale en Chine continentale. De nombreux livres qui ne pouvaient être publiés qu’à Hongkong ont été apportés en Chine continentale, y compris des écrits d’auteurs chinois, tandis que des discussions sur les mouvements sociaux ont également eu lieu à Hongkong. Avec le contrôle politique croissant du gouvernement chinois sur Hongkong, ce rôle risque d’être réduit. Alors que les contradictions sociales de la Chine s’intensifient, le gouvernement chinois sera encore plus vigilant quant à l’influence de Hongkong sur les mouvements sociaux chinois. CWL : L’un des problèmes posés par la montée du «localisme» est que parmi les jeunes militants de Hongkong, soutenir l’activisme en Chine continentale peut n’être plus considéré comme nécessaire. La faction extrême du camp «localiste» soutient même qu’offrir un soutien au mouvement démocratique en Chine continentale est une perte de temps puisque les «Hongkongers» devraient d’abord se soucier des problèmes à Hongkong. Autre fait nouveau inquiétant: en Chine continentale, les médias officiels brossent un tableau selon lequel la plupart, sinon tous les militants de Hongkong sont favorables à l’indépendance de Hongkong ou méprisent la Chine continentale. Bien qu’il soit impossible de savoir ce que la population pense réellement en Chine continentale, ce que nous voyons aujourd’hui sur les réseaux sociaux est que les luttes à Hongkong gagnent peu de sympathie parmi les «Net-citoyens» en Chine continentale. Depuis que la répression en Chine continentale s’est aggravée, les communications et les discussions entre les activités basées à Hongkong et celles basées en Chine continentale sont devenues plus difficiles.
L’avenir
KL : Que pensez-vous du fait que la directrice générale de Hongkong a mis le projet de loi d’extradition en suspens ? Dans quelle mesure s’agit-il d’une victoire ? ALY : Carrie Lam n’a fait que suspendre le projet de loi – elle ne l’a pas retiré, comme l’exigeaient les manifestants. Ce n’est pas une victoire complète, mais c’est quand même une victoire partielle. La suspension temporaire du projet de loi est déjà une grande défaite pour Carrie Lam. Cela donne aussi à l’opposition plus de temps pour consolider le mouvement. Et puisqu’elle a ajouté qu’il n’y a pas de calendrier pour présenter de nouveau le projet de loi, la durée de la suspension ne sera pas brève. Qui plus est, cette année et l’année prochaine sont toutes deux des années d’élections, il est donc improbable qu’elle permette aux partis pro-Pékin de risquer de perdre les élections en présentant à nouveau le projet de loi au cours de ces deux années. Et la troisième année n’est pas idéale non plus parce que c’est la dernière année de son mandat. La tâche de présenter de nouveau le projet de loi, le cas échéant, sera probablement celle du prochain chef de l’exécutif. KL : Quel est donc l’avenir de Hongkong et des mouvements pour la démocratie et la justice économique ? CC : Du Mouvement des parapluies aux manifestations contre l’extradition, les gens acceptent de plus en plus les actions militantes parce qu’ils reconnaissent que les manifestations et les occupations ne peuvent pas aboutir à perturber la production capitaliste. Ce résultat est important pour la gauche: après ces deux mouvements, les gens voient l’importance des grèves et le rôle des syndicats dans les luttes politiques. Pendant le Mouvement des parapluies, seuls quelques dirigeants étudiants ont appelé les syndicats à la grève. Mais pendant le mouvement anti-extradition, des milliers de travailleurs ont demandé à leurs syndicats d’organiser des grèves. Les luttes politiques se poursuivront à Hongkong. Si la jeune génération pouvait s’engager dans des actions sur le lieu de travail, ce serait très important pour la gauche. ALY : La montée en puissance de deux nouveaux courants de jeunes et de la Ligue des sociaux-démocrates, pas si jeune que ça, a subi un coup d’arrêt sérieux lorsque le gouvernement a retiré leur statut à leurs députés [en 2017]. Heureusement, une autre nouvelle génération est en train de se former, et elle prend les choses en main. La mobilisation dans la rue contre le projet de loi sur l’extradition vers la Chine est principalement le fruit de leur travail. Cependant, s’ils ne parviennent pas à développer leur politique dans une direction démocratique de gauche et à surmonter leur fragmentation, ils risquent de ne pas être en mesure de se consolider en une force progressiste forte. Ensuite, l’accent mis sur les actions médiatiques, héritage des pan-démocrates, domine encore largement parmi les jeunes activistes, à tel point que non seulement les efforts d’organisation à long terme sont souvent négligés, mais aussi qu’il existe une indifférence face à la situation désastreuse des travailleurs. Beaucoup de gens demandent maintenant aux travailleurs de faire la grève, mais cela n’a pas été un succès. Ils traitent simplement les travailleurs comme une sorte de «bol de nouilles instantanées»: ce que vous avez à faire se limite à passer une commande et le serveur vous le livrera tout de suite. La trajectoire historique de Hongkong en fait une ville hostile aux valeurs de solidarité, de fraternité et d’égalité de la gauche. Une culture sociale darwinienne, résultat d’une vie de port franc depuis plus de 150 ans, a pénétré la population à tel point qu’il est difficile pour les forces de gauche de s’y développer. Pour y parvenir, les jeunes militants devront commencer à s’attaquer aux problèmes ayant trait aux classes sociales. LCL : En scrutant l’avenir, il apparaît que le contexte politique à Hongkong deviendra plus difficile. La période relativement libérale de 1997 à 2008 a pris fin. Le gouvernement de Hongkong traitera plus sévèrement les mouvements démocratiques et sociaux, en particulier ceux qui insistent sur des actions directes en dehors du Conseil législatif. Le gouvernement de Hongkong se range du côté de la classe capitaliste et des forces conservatrices, qui sont toujours hostiles aux droits du travail, aux droits des femmes, aux droits des LGBT et à la distribution équitable des richesses. La population de Hongkong est soumise à la double oppression du capital bureaucratique chinois et du capital monopolistique de Hongkong. Toute réforme sociale et économique doit faire face à la réalité de ce capitalisme autoritaire. Cependant, après la manifestation anti-OMC (Oganisation mondiale du commerce) en 2005, la grève des travailleurs de la construction en 2007 et la grève des dockers en 2013, un plus grand nombre de militants se sont éloignés des modèles fragmentés de lutte populaires dans les années 199. Ils ont reconnu la nécessité d’une politique de classe pour contester le néolibéralisme. Pour développer cette politique de gauche, nous devons approfondir la discussion autour de questions telles que «qu’est-ce qu’une politique de gauche» et «ce qu’il faut faire», en clarifiant les différences entre la gauche socialiste, le «localisme» d’extrême droite et le nationalisme. Nous avons également besoin d’une large perspective chinoise et d’accroître les échanges avec les mouvements sociaux et les militants de gauche en Chine continentale. Ce n’est qu’en collaborant davantage avec la société civile et les mouvements sociaux chinois qui s’opposent au capitalisme autoritaire de la Chine que la population de Hongkong pourra garantir une véritable démocratie et l’égalité sociale. (Publié sur le site du magazine Jacobin; traduction A l’Encontre) _____ Au Loong Yu est écrivain et activiste. Son dernier livre est intitulé China’s Rise: Strength and Fragility. Chris Chan est professeur agrégé de sociologie à l’Université chinoise de Hongkong et membre fondateur de groupes militants à Hongkong et en Chine continentale. Lam Chi Leung est un militant socialiste basé à Hongkong et membre de Left21, un collectif socialiste. Chun-Wing Lee est socialiste, membre de Left21, et rédacteur en chef de The Owl, un site web de gauche à Hongkong. Alexa est une militante des droits des travailleurs et travailleuses ainsi que des droits humains à Hongkong. La Student Labour Action Coalition est un groupe de militant·e·s étudiants et de syndicats basé à Hongkong. Kevin Lin est un militant syndical et chercheur spécialisé sur la Chine. Source en anglais : https://jacobinmag.com/2019/06/hong-kong-extradition-bill-protest-movement Source en français : http://alencontre.org/laune/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-manifestations-de-hongkong.html
0 notes
Link
Comprendre ce qu’est devenue la révolution syrienne
avec Farouk Mardam-Bey historien, et éditeur franco-syrien (Sindbad/Actes-Sud)
SOIRÉE / DÉBAT
vendredi 21 juin 19 h00
Maison des Passages
44, Rue Saint-Georges, 69005 (M° D Vieux Lyon)
organisée par
Le COLLECTIF LYON-69 AVEC LA RÉVOLUTION POPULAIRE SYRIENNE
CISyLD, Ensemble, NPA, L’insurgé, Union Syndicale Solidaires, Émancipation, UJFP
* Farouk Mardam Bey est co-auteur de l’ouvrage :
"Dans la tête de Bachar al-Assad"
paru en octobre 2018. Ce livre sera disponible à la vente lors de la soirée
* Extrait d’un entretien donné à la revue Contretemps (janvier 2019) par Farouk Mardam Bey : ContreTemps : Après sept ans de répression et de guerre, la révolution syrienne apparaît défaite, et le peuple syrien condamné à rester victime d’une tragédie sans fin… Une fois donnée leur part aux larmes et à la colère, comment résister au désespoir ? Farouk Mardam-Bey : Donnons d’abord leur part, qui devrait être très grande, à la douleur et à la colère. Si la Syrie et les Syriens en sont là, dans cet interminable calvaire, c’est que peu de gens dans le monde, pendant près de huit ans, se sont souciés de leur sort. Ces centaines de milliers de morts, ces dizaines de milliers de disparus, ces millions de réfugiés, ces villes et ces villages ravagés, tout un peuple sacrifié dans le jeu cynique des nations, nous réclament davantage de larmes, et plus encore de colère, et que nous nous efforcions de les faire partager autour de nous. C’est difficile par les temps qui courent, la lassitude ayant gagné les sympathisants de la cause syrienne, mais c’est sans doute le premier moyen de résister au désespoir. La raison raisonnante nous incite en même temps, tout en reconnaissant sans ambages la défaite de la révolution, à comprendre pourquoi et comment elle a pu être défigurée, trahie et finalement vaincue. Autre moyen de résister au désespoir. Qu’est-ce qui revient aux conditions objectives, à la fois locales, régionales et internationales ? Qu’est-ce qui est dû aux erreurs, aux fautes, aux illusions, et plus profondément à la nature des différentes forces engagées dans le processus révolutionnaire ? Sans oublier le surgissement de l’imprévisible, notamment l’irruption de Daech qui a monopolisé depuis 2013 l’attention des chancelleries, des médias et du grand public. Cela dit – et ce n’est en rien une consolation mais une donnée fondamentale à prendre en considération dans toute vision stratégique –, la défaite est aussi celle du régime, isolé au sein même de la « société homogénéisée » qu’il s’est vanté d’avoir créée sous l’aile protectrice de l’Iran et de la Russie. Une société incertaine de son avenir qui dépend d’une improbable entente entre les puissances étrangères présentes sous une forme ou une autre sur le terrain, et frappée de stupeur après la bataille en mesurant l’ampleur du désastre…
(source : http://bit.ly/2KYgckn)
0 notes
Link
Tribune de Soudanais en exil (parue dans Libération, le 12 juin) Le 3 juin, des hommes en armes du régime ont tiré, violé, fouetté, jeté dans le Nil des civils. Le bilan fait état de plus d’une centaine de morts, de centaines de blessés et de centaines de disparus. La contre-révolution est à l’offensive. Il y a urgence à agir, y compris pour la diaspora soudanaise, les citoyens européens, et leurs institutions, dont l’UE. Comme un rayon de lumière au cœur des ténèbres. Comme un coup de tonnerre qui briserait des années de silence. La révolution soudanaise s’est levée pour mettre fin à trente ans de tyrannie, d’oppression et de répression. Pour les Soudanais, les cendres des 3 000 villages incendiés au Darfour par le régime islamiste du dictateur Omar el-Béchir sont encore chaudes. Les cris de douleur des 221 femmes et petites filles violées et torturées dans le village de Tabbit résonnent encore dans tous les esprits. Les millions de personnes déplacées et les réfugiés soudanais en exil n’ont pas oublié les exactions qui les ont séparés de leurs familles, les privant de leurs foyers et de leur pays. Tous ces crimes ont été commis par les «Janjaweeds», les bien nommés «démons à cheval», récemment rebaptisées RSF (forces de soutien rapide), la milice raciste et criminelle dirigée par le général Muhammad Hamdan Daklo qui se fait appeler «Hemetti». Cet homme fut en son temps au service du dictateur déchu ; il sévit aujourd’hui dans les rues de Khartoum et voudrait étendre ses crimes à l’échelle de tout le pays. Pour mettre fin à des décennies de guerres civiles et de terreur, des millions de Soudanais sont descendus dans la rue. Depuis le 19 décembre, les révolutionnaires risquent leur vie pour obtenir une transition démocratique. Leur soulèvement a été pacifique. Après des années de résistance et de protestations, le 11 avril, ils ont fait tomber le dictateur Omar el-Béchir. Mais le monstre a plusieurs têtes. Et à présent, d’autres chefs militaires, les généraux Borhan et Hemetti, essaient de remplacer l’ancien régime par une nouvelle dictature, comme si les millions de Soudanais se réclamant d’un gouvernement civil n’existaient pas. Ils ont d’abord feint de jouer le jeu des négociations avec l’Alliance des forces pour la liberté et le changement qui représentent la population civile. Mais le lundi 3 juin, le masque est tombé. Les miliciens du RSF sous le commandement de Hemetti ont attaqué le sit-in démocratique qui était installé depuis deux mois devant le ministère des Armées pour réclamer la passation du pouvoir aux civils. Ils ont mis le feu aux tentes, brûlant vifs les dormeurs, tirant à balles réelles sur les jeunes qui tenaient les barricades et sur ceux qui essayaient de s’enfuir, fouettant et violant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Rien qu’à Khartoum, ils auraient tué plus d’une centaine de personnes et blessé plus de 500 autres, selon le Comité central des médecins soudanais. Des centaines de personnes sont encore portées disparues. Des cadavres continuent de remonter à la surface du Nil. Ce massacre est une réplique des massacres commis sous le commandement du même général Hemitti dans les villages du Darfour. Depuis une semaine, des millions de Soudanais vivent en état de siège. A Khartoum, les miliciens du RSF s’introduisent dans des maisons au hasard pour agresser et piller les habitants. La résistance pacifique continue. Les Soudanais ont lancé dimanche un grand mouvement de désobéissance civile : grève générale, reconstruction permanente des barricades pour entraver le mouvement des milices, marches pour demander la passation du pouvoir au peuple. Mais même la désobéissance civile est devenue difficile à tenir. Les RSF ont été cherchés certains grévistes jusque dans leur maison pour les forcer à aller travailler. Des employés de banque, des ingénieurs de la compagnie d’électricité et des pilotes d’avion racontent avoir été battus et emmenés de force sur leurs lieux de travail. Et les exactions des miliciens du RSF continuent. L’université de Khartoum – qui fut en 2012 le foyer d’une révolte étouffée dans le sang par le régime d’Omar el-Béchir – a été mise à sac et certains locaux brûlés ce lundi 10 juin. Hemetti, nouvel homme fort de Khartoum est coupable de tous ces crimes. L’Union européenne doit cesser de le reconnaître comme son principal interlocuteur et de lui donner ainsi une légitimité qu’il n’a pas. Nous appelons les citoyens européens à faire pression sur leurs gouvernements et sur l’Union européenne pour qu’ils rompent le silence et agissent. Rester silencieux et continuer à considérer le Conseil militaire de transition comme un partenaire politique après les crimes commis depuis le 3 juin, reviendrait à soutenir des milices militaires qui terrorisent et assassinent des populations civiles pacifiques. Les pays de l’UE doivent faire pression sur l’ONU pour qu’elle déploie rapidement une équipe de surveillance des droits de l’homme chargée d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme commises au Soudan depuis le 3 juin et pour que les commanditaires de ces crimes, y compris le général Hemetti soient traduits en justice. Les pays de l’UE doivent avoir une position plus forte au Conseil de sécurité des Nations unies, car avec le veto de la Chine et de la Russie, l’ONU n’a pas condamné les violences. Les membres de l’UE doivent également faire pression sur les autorités militaires soudanaises pour qu’elles lèvent l’interdiction du service mobile Internet. L’UE doit cesser toute coopération avec le Soudan, à l’exception de l’aide humanitaire qui sauve des vies. Les membres de l’UE doivent respecter la position adoptée le 17 avril par leur haute représentante, Federica Mogherini, qui a déclaré : «Un transfert rapide et ordonné à un organe civil de transition doté du pouvoir décisionnel complet est le seul moyen de garantir la paix au Soudan.»
Signataires soudanais en exil
Moneim Rahama, poète et écrivain Abdelaziz Baraka Sakin, romancier Rachid Saeed Yagoub, porte-parole du SPA Mohamed Alasbatt, ancien porte-parole du SPA Mayada Adil, créatrice de mode Youssif Haliem, écrivain et activiste Omer Omran, philosophe Suhaib Gasmelbari, cinéaste Adil Abdel Rahman, poète Tarig Abu Obida, chanteur Bushra El Fadil, romancier Yahyaa Fadlalla, poète et écrivain Hind El Tahir, chanteuse Ghandi Adam, flûtiste Nouraddeen Youssif, chanteur Hassan Yassin, poète et activiste Abu Zar Abdelbagi, chanteur Ramiz Siraj, musicien Amar Awad Shareef, journaliste Marwa Al Haj, journaliste Hanadi Osman, journaliste Adil El Gassas, écrivain Asia Madani, chanteuse Ibrahim Hamouda, écrivain et producteur Mansour El Souwaim, romancier Shiyar Khaleal, journaliste Islam Zin Alabadeen, peintre Iman Elkhatim Abdallah, avocat Mohamed Elmahdi Abdelwhab, poète et écrivain Emad Abdulla, peintre Mohamed Bushara, peintre Mostafa Siri, journaliste Al Sadiq Al Radi, poète Amal Habbani, journaliste Dr. Albaqir Al Afif, universitaire Rasha Awad, journaliste Mohamed Madani, poète
Signataires européens
Hind Meddeb, cinéaste Mehdi Meddeb, journaliste Barbara Cassin, de l’Académie Française, philosophe Patrick Chamoiseau, écrivain Raphaël Glucksmann, député européen Gaël Faye, écrivain et musicien Arthur H, musicien Abd Al Malik, musicien, écrivain et cinéaste Imhotep pour le groupe IAM Olivier Rolin, écrivain Roshdi Rashed, directeur de recherche émérite au CNRS Jean-Luc Nancy, philosophe Marwan Rashed, historien Abbas Fahdel, cinéaste Valérie Osouf, cinéaste Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde Federica Matta, artiste Sylvie Denoix, chercheuse au CNRS Mathias Enard, écrivain Ali Benmaklouf, philosophe Robert Littell, écrivain Michel Hazavanicius, cinéaste Etienne Balibar, philosophe Reza, photographe Bachar Mar Khalife, musicien Sophie Bessis, historienne Jean-Hubert Martin, historien de l’art Abderrahmane Sissako, cinéaste Hortense Archambault, directrice de la Maison de la Culture de Seine Saint Denis (MC93) Jean-Claude Monod, chercheur en philosophie Veronique Nahoum-Grappe, chercheur en sciences sociales François Dosse, historien Joël Hubrecht, juriste Darline Cothière, directrice de la Maison des Journalistes Ariane Mnouchkine, dramaturge, metteure en scène Ludivine Sagnier, comédienne
Source : https://www.liberation.fr/debats/2019/06/12/soudan-rompre-le-silence_1733285
0 notes
Link
"Le parfum d'Irak" : l'Irak entre 1989 et 2014 en vingt petites vidéo d'animation, de 3 minutes, vue par les yeux d'un enfant né en France de parents irakiens et devenu reporter, Feurat Alani. Par Feurat Alani (histoire) et Leonard Cohen (dessin).
0 notes
Link
Entretien avec Gilbert Achcar conduit par Ashley Smith (publié le 18 mai 2019 sur le site Jacobin; traduction et publication en français par A l’Encontre) Après des années de contre-révolution et d’effusions de sang, le mois dernier des lueurs d’espoir sont apparues au Moyen-Orient. En Algérie et au Soudan, des manifestations de masse ont éclaté défiant les régimes autocratiques des présidents Abdelaziz Bouteflika et Omar al-Bachir. Et à cet égard, les deux mobilisations initiales ont été couronnées de succès: les deux dirigeants ont été démis de leurs fonctions et leurs décennies de règne ont pris fin. Mais les protestations se sont poursuivies, car, comme en Egypte après la révolution de 2011, la structure de base du pouvoir de ces dirigeants reste intacte. Il en va de même pour les conditions matérielles à l’origine des soulèvements: les salaires de misère, le chômage de masse, l’insécurité et l’absence d’avenir pour les jeunes résultant des modèles d’ajustement structurel imposés par le FMI. Ainsi, les forces populaires en Algérie et au Soudan sont dans une position précaire. Le spectre de la contre-révolution menée contre les acteurs du Printemps arabe règne avec force. Mais les manifestants d’aujourd’hui ont tiré les leçons des luttes récentes dans la région et pourraient bénéficier d’une telle vision rétrospective. Pour discuter des dangers et des espoirs de ces développements, Ashley Smith, qui collabore à la revue Jacobin, s’est entretenu avec Gilbert Achcar, qui a beaucoup écrit sur le Printemps arabe et la politique au Moyen-Orient. Ashley Smith (AS): Les soulèvements au Soudan et en Algérie ont ravivé l’espoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord après une longue période de contre-révolution. Que se passe-t-il dans ces deux pays ? Gilbert Achcar (GA): Au Soudan et en Algérie, nous assistons à deux vagues de protestations de masse d’une ampleur comparable à celle des révoltes qui ont éclaté en 2011. A l’époque, on qualifiait ce soulèvement le «printemps arabe». Par conséquent, dans les médias grand public, se sont multipliés les commentaires posant une question: sommes-nous au beau milieu d’un nouveau printemps arabe? En réalité, les soulèvements dans ces deux pays (Algérie et Soudan) sont le produit de ce que j’ai appelé un processus révolutionnaire sur la longue durée qui a commencé en 2011 pour toute la région arabophone. La cause principale en est le blocage social et économique provoqué par la combinaison du néolibéralisme soutenu par le FMI et des systèmes politiques autoritaires pourris qui l’imposent dans tout le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce blocage engendre des problèmes sociaux d’ordre systémique, dont le plus important est l’énorme chômage des jeunes. Le blocage produit de nombreuses autres récriminations, plaintes profondes parmi les populations de la région; ce qui continue de provoquer des soulèvements. Au Soudan, le déclencheur de la révolte a été l’augmentation du prix du pain [de 1 à 3 livres, en décembre 2018] après que l’Etat eut coupé les subventions suite aux exigences du FMI. En Algérie, la cause immédiate est d’ordre politique. Le régime algérien a tenté d’obtenir un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika bien qu’il fût semi-paralysé, suite à une attaque cérébrale, depuis six ans. Cette décision heurta les aspirations démocratiques de la population. Ainsi, encore une fois, les récriminations économiques et politiques sont à l’origine d’une autre vague de révoltes populaires comme celles que nous avons vues en Tunisie, en Egypte, en Libye, au Yémen, au Bahreïn et en Syrie en 2011. Cela confirme qu’il était erroné de considérer ces soulèvements comme un «printemps» qui, tout comme la saison, durerait quelques mois et se terminerait par de simples changements constitutionnels, ou par un échec. En réalité, nous sommes encore au milieu d’un processus révolutionnaire à long terme né de la crise structurelle très profonde de la région. Cela signifie qu’il n’y aura pas de stabilisation de la région arabophone sans un changement radical des conditions sociales, économiques et politiques qui ont produit ce blocage du développement. Tant que cela ne se produira pas, la crise se poursuivra et nous assisterons à plus d’explosions de mobilisations et d’offensives contre-révolutionnaires. Si nous regardons les années qui ont suivi la première vague de soulèvements de 2011 à 2013, nous avons eu six années dominées par la contre-révolution. La contre-révolution a pris diverses formes, mais a conduit soit à la consolidation des anciens régimes, soit à la dégénérescence en guerre civile et au chaos. Les monarchies du Golfe ont repoussé la révolte à Bahreïn très tôt. Le régime syrien a pour l’instant gagné sa brutale campagne contre-révolutionnaire soutenue par l’Iran et la Russie. L’ancien régime est revenu au pouvoir en Egypte avec une politique de brutale vengeance. Et des guerres civiles ont éclaté en Libye et au Yémen entre des forces tout aussi réactionnaires avec l’intervention criminelle du royaume saoudien et des Emirats arabes unis (EAU). Dans le même temps, des volcans sociaux continuent d’éclater dans toute la région parce que les anciens régimes ne peuvent offrir aucune solution aux doléances du peuple. Nous avons donc eu d’importants mouvements sociaux ces dernières années dans toute la région, de la Tunisie – qui a entamé tout le processus de soulèvement en décembre 2010 et qui a connu plusieurs poussées sociales depuis lors – jusqu’au Maroc et en Irak, en passant par le Soudan et la Jordanie et – au-delà des pays arabes – jusqu’en Iran. Cela ne devrait pas nous surprendre. Comme tous les processus révolutionnaires à long terme de l’histoire l’ont montré, il y aura une dialectique de révolution et de contre-révolution tant que les principaux problèmes politiques et économiques n’auront pas été résolus. Sans cela, nous risquons d’avoir de plus en plus de désordres, de chaos et de tragédies. AS: Quelles leçons les militants des nouvelles révoltes au Soudan et en Algérie ont-ils tirées de la première vague de lutte ? GA: Les forces politiques ont tiré deux grandes leçons des expériences passées. On le voit dans leur insistance sur le caractère non-violent du mouvement. Ils sont très soucieux d’éviter de faire quoi que ce soit qui donnerait à l’Etat l’occasion d’utiliser toute la panoplie de ses moyens répressifs contre eux. La première vague de révoltes a été très enthousiaste à ce sujet. Ils ont tous lancé le slogan «silmiyya, silmiyya, silmiyya», qui signifie «pacifique, pacifique», même en Syrie. Tous ont tenté de s’en tenir à des moyens non-violents. La violence a été déclenchée partout, sans exception, par les régimes eux-mêmes. Bien sûr, face à une escalade qualitative de la violence étatique, le mouvement de masse n’a plus que deux options: l’une est d’abandonner la lutte et l’autre de se défendre. Les guerres civiles ont attiré des interventions étrangères de toutes sortes. En Libye, l’intervention étrangère des Etats-Unis et de leurs alliés s’est effectuée en faveur des insurgés dans une tentative de cooptation de leur lutte. Il en résulta que c’est le seul Etat arabe qui s’est complètement effondré à cause de la victoire des insurgés. C’est parce que toute la machine d’Etat était organiquement liée à Mouammar Kadhafi et à sa clique. Sous un autre angle, en Syrie, l’intervention étrangère – principalement de l’Iran, de ses agents, et de la Russie – s’est effectuée en faveur du régime. Elle a permis au régime de Bachar al-Assad de survivre, de commettre de terribles massacres et de détruire des pans entiers du pays. L’ampleur des atrocités a été bien pire en Syrie que dans tout autre pays jusqu’à présent. Même le Yémen vient au deuxième rang pour ce qui est de l’ampleur de la tragédie. Là, l’intervention étrangère est menée par le royaume saoudien et les Emirats arabes unis du côté d’un camp contre-révolutionnaire s’opposant à l’alliance de deux autres forces contre-révolutionnaires. A la lumière de ces tragédies, de nouveaux mouvements de masse se sont montrés extrêmement méfiants à l’égard de ce risque de violences et de guerre civile soutenue par l’étranger. Ils en tiennent donc largement compte. Dans un sens, ce qui est le plus étonnant, c’est que les Algériens et les Soudanais aient commencé leur révolte, tout en ayant à l’esprit les conséquences tragiques qu’ils ont vues dans d’autres pays. Les régimes de toute la région ont utilisé ces résultats tragiques comme un nouvel argument contre-révolutionnaire puissant pour dissuader leurs peuples de se lever. Le régime algérien a explicitement averti le mouvement de masse qu’il risquait un scénario syrien. Mais cela n’a pas suffi à dissuader les gens de descendre dans la rue et se se battre pour leurs aspirations et leurs revendications. La deuxième leçon que les militants soudanais et algériens ont tirée est que le commandement militaire n’est pas un allié. C’est ce qu’ils ont appris de l’expérience de l’Egypte, dont le type d’Etat est le plus semblable au leur. Ces Etats ont en commun le fait que les militaires contrôlent le pouvoir politique. Les forces armées ne sont pas seulement l’épine dorsale répressive de l’Etat, ce qui est commun à tous les Etats, mais le centre de gravité du pouvoir politique. Les Soudanais et les Algériens avaient vu comment l’armée avait destitué le président égyptien Hosni Moubarak en 2011, dans le contexte du soulèvement, pour ensuite rétablir l’ancien ordre à la première occasion. Ainsi, lorsque les militaires ont écarté Bouteflika en Algérie et Bachir au Soudan, le mouvement populaire savait que ce n’était pas suffisant. Il a compris que la destitution du président et de ses acolytes n’était que l’élimination de la pointe de l’iceberg, que la masse de l’iceberg – ce que les gens appellent l’Etat profond –, composée surtout du complexe militaro-sécuritaire, est toujours en place et que tant que le pouvoir reste entre ses mains, le régime ne connaîtra pas sa fin. Même lorsque les militaires ont abandonné le contrôle du chef de l’Etat pendant un an en Egypte, ils préparaient activement leur retour. Et dès qu’ils en ont eu l’occasion, ils ont organisé un coup d’Etat contre le président élu des Frères musulmans, Mohamed Morsi, et sont revenus au pouvoir politique avec le couronnement d’Abdel Fattah al-Sissi. Le régime est tellement autoritaire maintenant qu’il a fait regretter aux Egyptiens le dictateur précédent, Moubarak! Ainsi, les mouvements au Soudan et en Algérie ont tiré la leçon qu’il faut se débarrasser de l’Etat profond. Vous pouvez voir la différence entre la réaction du soulèvement égyptien face à l’écartement par les militaires de Moubarak et la réaction des mouvements soudanais et algériens face à l’expulsion similaire de leurs dictateurs. En Egypte, les gens pensaient que c’était la victoire et quittaient les places après avoir célébré l’événement. Mais en Algérie et au Soudan, les gens disent que ce n’est pas assez et ils continuent à manifester. Ils veulent se débarrasser de tout le régime, pas seulement de quelques personnes au sommet. Se débarrasser du régime, c’est redonner le pouvoir politique à la société civile par des moyens démocratiques, y compris des élections et l’octroi de droits. L’abandon complet du pouvoir par les militaires est ce sur quoi le mouvement populaire insiste dans les deux pays. AS: La Libye semble se dresser en contraste frappant avec les signes d’espoir de l’Algérie et du Soudan. Nous assistons là à une lutte intense entre les factions pour la reconstitution du pouvoir de l’Etat. Que pensez-vous de ce qui se passe là-bas ? GA: La Libye a connu – au lendemain de la chute de Kadhafi, après des décennies de régime totalitaire – une période d’épanouissement démocratique avec l’émergence d’un grand nombre de groupes politiques et d’ONG, le développement de journaux et des élections, qui ont été les premières élections libres dans ce pays et les plus libres que la région ait connues, avec un taux de participation remarquable. Elles ont été remportées par une alliance laïque libérale qui a vaincu les fondamentalistes islamiques. Puis la contre-révolution a commencé avec la rébellion des fondamentalistes contre le gouvernement élu. Au milieu du chaos qui en a résulté, un ancien chef militaire, Khalifa Haftar, a lancé une campagne contre-révolutionnaire pour s’emparer du pouvoir, soutenu par l’Egypte et les EAU. Ses troupes se sont heurtées aux forces fondamentalistes. En Libye, comme en Egypte, en Syrie et dans les autres pays du soulèvement de 2011, il y a eu une dynamique triangulaire avec un pôle révolutionnaire face à deux pôles rivaux contre-révolutionnaires: l’ancien régime et ses opposants fondamentalistes islamiques. Partout, les progressistes sont marginalisés et la situation est dominée par l’affrontement entre les deux pôles contre-révolutionnaires. AS: Ce scénario triangulaire que vous décrivez ne semble pas convenir au Soudan. En quoi est-ce différent ? GA: Au Soudan, le régime de Bachir a en fait combiné les deux pôles contre-révolutionnaires. Il a gouverné par l’armée tout comme les dictatures en Egypte ou en Algérie, mais en étroite collaboration avec les fondamentalistes islamiques. Ces derniers faisaient également partie du régime. C’est pourquoi j’ai parlé de Bachir comme d’une combinaison de Morsi et de Sissi; je l’ai appelé «Morsisi». Le fait que les fondamentalistes islamiques fassent partie du régime les a empêchés de jouer un rôle dans le soulèvement; le peuple se soulevait en fait contre eux. Ils n’étaient donc pas en mesure de détourner le soulèvement comme ils l’ont fait en Egypte, en Tunisie, en Libye, au Yémen et en Syrie. Cette différence est très importante. Elle a façonné la révolte elle-même qui a dû défier les pôles fusionnés de la contre-révolution. Cela a contribué à faire de la manifestation soudanaise la plus progressiste de tous les soulèvements que nous ayons vus dans la région jusqu’ici. C’est la plus avancée en termes d’organisation et de politique. La coalition des groupes qui la dirigent se nomme: Forces de la Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC). Elle comprend à l’origine des associations professionnelles et ouvrières clandestines, des partis politiques de gauche comme le Parti communiste, des mouvements musulmans libéraux, des mouvements armés luttant contre l’oppression ethnique, ainsi que des groupes féministes. Ces forces progressistes ont façonné la politique de la révolte. En particulier, les femmes et les organisations féministes, qui ont joué un rôle de premier plan, ont fait pression pour que les revendications féministes soient incluses dans le programme des FDLC. Ce programme stipule maintenant, par exemple, que le nouveau conseil législatif doit être composé à 40% de femmes. Mais nous ne devons pas sous-estimer les défis auxquels les FDLC s’affrontent. La coalition est placée sous la contrainte d’une lutte acharnée contre les militaires, qui veulent maintenir le pouvoir entre leurs mains et n’accorder que des fonctions subordonnées aux civils. Les FDLC exigent au contraire que le pouvoir souverain soit entièrement entre les mains d’une majorité civile et que les forces armées soient limitées au rôle de défense apolitique qu’elles devraient normalement jouer dans un Etat civil. Ainsi, les révolutionnaires soudanais font face aux militaires, qui sont soutenus par toutes les forces régionales et internationales de la contre-révolution. Le Qatar, le royaume saoudien, les Emirats arabes unis, la Russie et les Etats-Unis soutiennent tous les militaires dans cette lutte acharnée. Ajoutez à cela les fondamentalistes islamiques qui soutiennent naturellement l’armée. Dans cette situation, la principale force du mouvement a été sa capacité à conquérir la base des forces armées et certains officiers subalternes. Jusqu’à présent, cela a dissuadé les militaires de tenter de noyer la révolution dans le sang. Bachir voulait que l’armée écrase le soulèvement, mais ses généraux ont refusé, non pas parce qu’ils sont démocrates ou humanistes, bien sûr, mais parce qu’ils n’étaient pas convaincus que les troupes suivraient leurs ordres. Le commandement militaire savait qu’une partie des soldats et des officiers subalternes sympathisaient avec le soulèvement au point de même utiliser leurs armes pour défendre les manifestants contre les attaques des voyous du régime et de la police politique. La sympathie des troupes pour le mouvement populaire a été déterminante pour amener les généraux à se débarrasser de Bachir. La chose la plus importante à présent est que le mouvement consolide son soutien parmi les officiers de base et les officiers subalternes des forces armées. Le succès ou l’échec de cet effort déterminera tout le sort de la révolution. AS: Pourquoi les forces progressistes soudanaises ont-elles réussi à faire une percée aussi importante par rapport au reste de la région ? GA: La composition politique des FDLC n’est pas très différente de celle des forces progressistes partout dans la région. Mais ailleurs, ces forces progressistes ont été discréditées en prenant parti pour l’un des deux pôles contre-révolutionnaires. Là où les fondamentalistes islamiques étaient dans l’opposition, ils ont réussi à prendre le train en marche et à détourner le mouvement grâce aux moyens de loin supérieurs dont ils disposaient en termes d’organisation, de fonds et de médias. Prenons l’exemple de l’Egypte. C’est là que les Frères musulmans ont détourné la révolte populaire. Ils répandent des illusions sur l’armée en 2011. Au moment du renversement de Moubarak et par la suite, les Frères travaillaient main dans la main avec les militaires. Cela a grandement aidé les militaires à désamorcer le mouvement populaire. Parce que les deux pôles contre-révolutionnaires ont été combinés au Soudan, un espace s’est ouvert pour que les forces progressistes puissent percer par leurs propres moyens. Ce n’est pas entièrement le cas en Algérie. Alors que les forces fondamentalistes islamiques ne jouent aucun rôle visible dans le soulèvement, elles conservent un réseau puissant et peuvent donc jouer un rôle contre-révolutionnaire si l’occasion se présente. De plus, contrairement au Soudan, il n’y a pas de leadership reconnu du soulèvement en Algérie, ce qui rend le mouvement vulnérable aux manipulations politiques. AS: Tout au long de ce processus révolutionnaire, diverses puissances impériales et régionales ont joué un rôle majeur dans les soulèvements. C’était particulièrement vrai après le déclin relatif des Etats-Unis en raison de leur défaite en Irak, qui a donné à tous les autres Etats une plus grande marge de manœuvre pour poursuivre leurs propres intérêts. Aujourd’hui, Trump semble vouloir réaffirmer la puissance américaine en soutenant des alliés comme Israël et l’Arabie saoudite, ainsi qu’en déployant des navires et des bombardiers dans le golfe Persique contre l’Iran. Que fait Trump ? GA: Eh bien, comme pour tout ce qui concerne Trump, sa politique est très grossière (fruste). Ce terme «grossier» (brut) convient particulièrement bien dans ce cas-ci parce que toute sa stratégie, si on peut l’appeler ainsi, est déterminée par le pétrole brut. Il retire donc ses troupes de Syrie parce qu’il n’est pas intéressé à soutenir les guérillas kurdes de gauche et parce que le pays a peu de pétrole. Mais il n’a pas appelé au retrait des troupes américaines d’Irak. En fait, lorsque Trump a visité la base américaine dans ce pays, il a exprimé sa détermination à y rester. L’alibi était le besoin supposé de surveiller l’Iran, mais ce n’est en réalité qu’un prétexte puisque les Etats-Unis ont déjà de nombreuses bases dans tout le Golfe ainsi qu’une technologie sophistiquée pour surveiller l’Iran. Mais, d’une manière typiquement peu diplomatique, Trump avait admis la vraie raison pour laquelle il veut des troupes américaines en Irak: le pétrole. Il a en fait déclaré que le pétrole était le prix que les Etats-Unis auraient dû obtenir comme récompense pour leur invasion et leur occupation de ce pays. Il a dit carrément: «Nous aurions dû prendre le pétrole irakien.» Il est donc extrêmement «grossier» (brut) dans ce double sens. C’est pourquoi il soutient le royaume saoudien et les autres Etats clients de Washington parmi les monarchies pétrolières du Golfe. Il les traite comme des chiens et ils sont d’accord. Même lorsque Trump les insulte ouvertement comme il l’a fait récemment au Wisconsin [en fin avril: en les réduisant au strict statut d’acheteur de matériel militaire et en disant qu’ils ne disposaient de rien d’autre que du «cash»], ils n’ont pas osé protester. Ce ne sont que des vassaux des Etats-Unis qui dépendent de leur seigneur pour leur protection. La même «approche» pétrolière est à l’origine du brusque changement de cap de Trump sur la Libye. Il a changé radicalement la politique américaine qui consistait à soutenir le gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli, en appuyant soudainement Haftar de manière ouverte. Pourquoi? Parce que Haftar contrôle maintenant les champs de pétrole en Libye. C’est la logique de ce que fait Trump – un impérialisme très «brut», déterminé par des intérêts économiques avant tout, sans aucune prétention idéologique sur la démocratie ou les droits de l’homme. A cet égard, comme il le dit ouvertement, il envie les dirigeants autoritaires. De même, sa position agressive contre l’Iran n’est pas seulement pour plaire à son ami d’extrême droite, Netanyahou d’Israël, ni n’obéit à aucune fin démocratique, bien sûr, pas plus que sa position agressive contre le Venezuela. L’accent mis par Trump sur ces deux pays ne peut être dissocié de leurs principales réserves de pétrole. Quoi que l’on pense des régimes des deux pays, il est crucial de contrer les menaces et les gesticulations de l’administration Trump – surtout dans le cas de l’Iran, où le risque de guerre est assez élevé. AS: C’est clair comme de l’eau de roche. Mais que devrait faire la gauche internationale à l’égard du Soudan ? GA: Le besoin le plus urgent est la solidarité avec le soulèvement, qui est dangereusement isolé en ce moment. Il est confronté à un seul camp contre-révolutionnaire soutenu par toutes les puissances impériales et régionales. Dans une telle situation, la solidarité internationale est extrêmement importante. Tout geste de solidarité significatif encouragera et donnera du courage au mouvement soudanais. La clé aux Etats-Unis est de dénoncer le soutien de Trump à l’armée soudanaise, en compagnie de «ses potes» des monarchies pétrolières. Il serait important de contraindre les démocrates, même si ce n’est que pour des raisons électorales, à mettre en question cette politique. C’est urgent, car cela pourrait grandement aider les FDLC à prendre l’avantage dans leur lutte acharnée contre l’armée pour la transition démocratique dans le pays. Le Département d’Etat américain a récemment réclamé une courte période de transition, alors que les révolutionnaires soudanais exigent une période plus longue au cours de laquelle il y aurait des institutions civiles de transition avant la tenue des élections dans le pays. Ils veulent du temps pour développer leurs partis, après des décennies de répression intensive. L’expérience de l’Egypte et de la Tunisie leur a appris que plus les élections ont lieu tôt, plus il est probable que ceux qui ont le plus d’organisation, de ressources et de soutien international gagneront. Dans ces pays, c’étaient les fondamentalistes islamiques. Au Soudan, il s’agirait probablement de forces politiques issues de l’ancien régime, dont les Frères musulmans et les salafistes. Ils disposent de moyens matériels bien supérieurs à ceux des FDLC. Il est donc très important que les forces politiques de gauche aux Etats-Unis se rallient pour soutenir le soulèvement soudanais et appuyer les exigences de ses dirigeants. Cela fait partie intégrante de la reconstruction d’une tradition de solidarité de la gauche internationaliste avec le mouvement mondial des exploité·e·s et des opprimé·e·s. (Entretien publié le 18 mai 2019 sur le site Jacobin; traduction A l’Encontre) Gilbert Achcar est professeur au SOAS (Université de Londres) et auteur de nombreux ouvrages dont Symptômes morbides: La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, 2017. Ashley Smith collabore à de nombreuses publications de gauche aux Etats-Unis. Source : http://alencontre.org/afrique/algerie/le-long-printemps-arabe-et-la-place-actuelle-des-soulevements-en-algerie-et-au-soudan.html
0 notes
Link
Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69
Macron et les États européens « face » aux migrant.e.s :
Leur politique contre nos revendications
Macron déclare vouloir renforcer l’Union européenne et se pose en adversaire des dirigeants les plus nationalistes et xénophobes de l’U.E., tels le Hongrois Viktor Orban ou l’Italien Matteo Salvini. Mais pour ce qui concerne la question migratoire, on a bien du mal à voir la différence. En témoigne la tribune de Macron publiée le 4 mars dans la presse de 28 États européens, qui précise ses projets pour l’Union européenne. Ce sont en particulier des projets sécuritaires : augmenter les dépenses militaires, renforcer les frontières « face aux migrations » (sic) qui sont présentées comme un menace : « je crois, face aux migrations, à une Europe qui protège à la fois ses valeurs et ses frontières ». Pour cela, Macron veut « remettre à plat l’espace Schengen » avec un « contrôle rigoureux des frontières » : « Une police des frontières commune et un office européen de l’asile, des obligations strictes de contrôle », cela « sous l’autorité d’un Conseil européen de sécurité intérieure ». Macron se situe ainsi sur le même terrain que le parti de Marine le Pen : tandis que cette dernière veut « bunkériser » les frontières nationales, Macron préfère bunkériser l’Union européenne. Ce n’est qu’une différence d’échelle : d’ailleurs plusieurs partis d’extrême droite, en Autriche par exemple, sont désormais « européens compatibles », prônant une Europe chrétienne et xénophobe. C’est ce qu’a bien compris Viktor Orban, dont Macron prétend être l’adversaire : « Dans les détails, nous avons bien sûr des divergences de vues, mais ce qui est bien plus important (….) c’est que cette initiative (est) un bon point de départ pour un dialogue sérieux et constructif sur l’avenir de l’Europe ». Face aux « migrations », Macron et le très xénophobe Orban agissent dans le même sens. Le 25 avril, Macron précise : l’« espace Schengen avec les règles des accords de Dublin cela ne marche plus. Pour moi, le deuxième grand combat européen avec le climat, c’est le combat en matière de migration. (…) on doit refonder Schengen quitte à ce que ce soit un Schengen avec moins d’États ». Et il prétend que nous serions « confrontés à des détournements très profonds du regroupement familial comme des migrations liées à l’asile ». Ce mensonge conforte le discours de Le Pen, et justifie la répression, les expulsions qui se poursuivent. Contre leur politique xénophobe et anti sociale, nous réaffirmons : - Liberté de circulation et d’installation ! - Droit au travail ! Mêmes salaires et mêmes droits pour toutes et tous ! - Régularisation de toutes et tous les sans papiers !
Christophe Castaner et Matteo Salvini : mêmes mensonges !
Pour justifier le rejet des migrants, Salvini, ministre italien de l’Intérieur, fournit les pires arguments, dont certains sont qualifiés de « délires » par sa collègue la ministre italienne des armées.
Cela n’empêche pas Castaner de reprendre à son compte (le 5 avril) les mensonges de Salvini, qui prétend que les ONG qui interviennent en mer pour sauver les migrants aident les filières des passeurs. Sans fournir de preuve, Castaner prétend qu’une telle « collusion » est « documentée ».
Rien qu’en Méditerranée centrale, plus de 18 000 personnes sont mortes depuis cinq ans.
« Réfugiés climatiques »
Macron et l’U.E. veulent établir de savantes distinctions entre réfugiés (qu’ils ne protègent guère) et migrants économiques (qu’ils refoulent en général). Mais comment distinguer entre celles et ceux qui fuient les guerres ou la répression, qui fuient la misère ou sont victimes des bouleversements climatiques qui contribuent à la fuite de millions d’êtres humains ? Tous sont victimes de la recherche effrénée du profit, qui détruit les hommes et la nature. Nous voulons : Droit d’asile sans restriction ! Arrêt des expulsions !
L’Agence européenne des gardes frontière (ex Frontex) ou la bunkérisation de l’U.E.
Le 17 avril 2019, le Parlement européen a voté le renforcement de Frontex, avec un corps de garde-frontières et garde-côtes pouvant atteindre 10 000 hommes en 2027, qui s’ajoutera aux 100 000 douaniers nationaux. Elle aura son propre budget pour acquérir notamment des navires et avions.
Frontex aura en particulier la capacité de contrôler, d’aider les pays membres à retenir et expulser les migrants, à intervenir dans les pays tiers, en dehors de l’U.E.
Notre exigence : Suppression de l’Agence européenne des gardes frontières (ex-FRONTEX) !
Les amis locaux de Macron
Le maire de Lyon ? La loi qu’il a fait voter comme ministre de l’Intérieur est en application. Elle rend plus difficile l’accueil et facilite les expulsions.
Le président de la métropole ? De sa responsabilité relève la mise à l’abri et la protection des enfants en danger. Mais elle externalise nombre de ses missions, faisant appel au bénévolat plutôt qu’aux agents professionnels de la Métropole pour prendre en charge ces mineurs.
Et face au manque de places pour scolariser tous les enfants migrants alors que c’est une obligation, on envisage de créer des « sas » d’attente confiés aussi à des associations, hors système scolaire.
La préfecture s’obstine à appliquer le règlement de Dublin avec zèle.
Nous exigeons à l’inverse :
- Prise en charge par la Métropole ou le département de tous les mineurs isolés, des jeunes majeurs, dans le cadre du droit commun de l’aide sociale à l’enfance.
- Scolarisation de tous et toutes dans le cadre de l’Éducation nationale.
- Abrogation des accords de Dublin (obligeant à demander l’asile dans le 1er pays d’enregistrement).
Nous exigeons aussi :
- Fermeture des centres de rétention. Abandon des visio-audiences.
- Arrêt des expulsions des squats et terrains occupés, ouverture des locaux de la Métropole.
- Droit au logement immédiat pour toutes et tous.
- Abrogation de la loi Macron-Collomb, et des lois dites d’immigration choisie.
Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69 : ActForRef, ATTAC 69, CGT Vinatier, CGT-Éduc’Action 69, Union Départementale CGT, Union Départementale CNT, Collectif Agir Migrants, Collectif Amphi Z, Collectif des étudiantEs étrangerEs, Collectif 69 Palestine, Émancipation-69, FSU 69, LDH 69, Migrations Minorités Sexuelles et de Genre, MRAP LYON 1-4 et 3-7-8, RESF-69, Union Syndicale Solidaires 69, Solidaires EtudiantEs, Solidaires Retraités 69, SUD santé sociaux 69, UJFP Lyon, Alternative Libertaire, Coordination des Groupes Anarchistes-Lyon, EELV 69, Ensemble !, France Insoumise Migrations, L’insurgé, Lutte ouvrière, MJCF 69, Nouveau Parti Anticapitaliste, Nouvelle Donne, Parti de Gauche 69, PCF, UPC… Contact :[email protected] lien : fichier en pdf
0 notes
Link
0 notes
Link
Suite à la mobilisation des lycéens du vendredi 30 novembre, l'UNL a appelé à la poursuite de la mobilisation, sur la base de la même plateforme
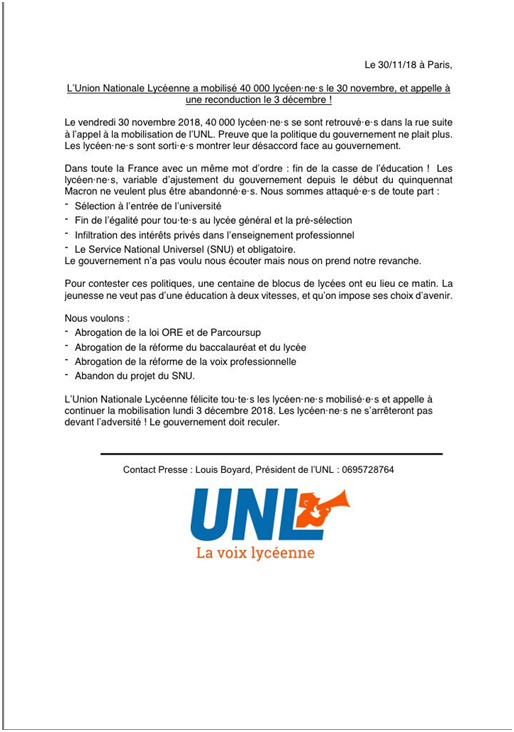
source (compte twitter de l'UNL) :
* appel du 23 novembre pour le 30 novembre ici
* carte des mobilisations du 30 novembre ici
* reconduction pour le lundi 3 décembre ici
0 notes
Link

Par Gérard Noiriel (historien), le 2 novembre 2018
Dans une tribune publiée par le journal Le Monde (20/11/2018), le sociologue Pierre Merle écrit que « le mouvement des « gilets jaunes » rappelle les jacqueries de l’Ancien Régime et des périodes révolutionnaires ». Et il s’interroge: « Les leçons de l’histoire peuvent-elles encore être comprises ? »
Je suis convaincu, moi aussi, qu’une mise en perspective historique de ce mouvement social peut nous aider à le comprendre. C’est la raison pour laquelle le terme de « jacquerie » (utilisé par d’autres commentateurs et notamment par Eric Zemmour, l’historien du Figaro récemment adoubé par France Culture dans l’émission d’Alain Finkielkraut qui illustre parfaitement le titre de son livre sur « la défaite de la pensée ») ne me paraît pas pertinent. Dans mon Histoire populaire de la France, j’ai montré que tous les mouvements sociaux depuis le Moyen Age avaient fait l’objet d’une lutte intense entre les dominants et les dominés à propos de la définition et de la représentation du peuple en lutte. Le mot « jacquerie » a servi à désigner les soulèvements de ces paysans que les élites surnommaient les « jacques », terme méprisant que l’on retrouve dans l’expression « faire le Jacques » (se comporter comme un paysan lourd et stupide).
Le premier grand mouvement social qualifié de « jacquerie » a eu lieu au milieu du XIVe siècle, lorsque les paysans d’Ile de France se sont révoltés conte leurs seigneurs. La source principale qui a alimenté pendant des siècles le regard péjoratif porté sur les soulèvements paysans de cette époque, c’est le récit de Jean Froissart, l’historien des puissants de son temps, rédigé au cours des années 1360 et publié dans ses fameuses Chroniques. Voici comment Froissart présente la lutte de ces paysans : « Lors se assemblèrent et s’en allèrent, sans autre conseil et sans nulles armures, fors que de bâtons ferrés et de couteaux, en la maison d’un chevalier qui près de là demeurait. Si brisèrent la maison et tuèrent le chevalier, la dame et les enfants, petits et grands, et mirent le feu à la maison […]. Ces méchants gens assemblés sans chef et sans armures volaient et brûlaient tout, et tuaient sans pitié et sans merci, ainsi comme chiens enragés. Et avaient fait un roi entre eux qui était, si comme on disait adonc, de Clermont en Beauvoisis, et l’élurent le pire des mauvais ; et ce roi on l’appelait Jacques Bonhomme ».
Ce mépris de classe présentant le chef des Jacques comme « le pire des mauvais » est invalidé par les archives qui montrent que les paysans en lutte se donnèrent pour principal porte-parole Guillaume Carle « bien sachant et bien parlant ». A la même époque, la grande lutte des artisans de Flandre fut emmenée par un tisserand, Pierre de Coninck décrit ainsi dans les Annales de Gand : « Petit de corps et de povre lignage, il avoit tant de paroles et il savoit si bien parler que c’estoit une fine merveille. Et pour cela, les tisserands, les foulons et les tondeurs le croyoient et aimoient tant qu’il ne sût chose dire ou commander qu’ils ne fissent ».
On a là une constante dans l’histoire des mouvements populaires. Pour échapper à la stigmatisation de leur lutte, les révoltés choisissent toujours des leaders « respectables » et capables de dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. D’autres exemples, plus tardifs, confirment l’importance du langage dans l’interprétation des luttes populaires. Par exemple, le soulèvement qui agita tout le Périgord au début du XVIIe siècle fut désigné par les élites comme le soulèvement des « croquants » ; terme que récusèrent les paysans et les artisans en se présentant eux mêmes comme les gens du « commun », Ce fut l’un des points de départ des usages populaires du terme « commune » qui fut repris en 1870-71, à Paris, par les « Communards ».
Les commentateurs qui ont utilisé le mot « jacquerie » pour parler du mouvement des « gilets jaunes » ont voulu mettre l’accent sur un fait incontestable : le caractère spontané et inorganisé de ce conflit social. Même si ce mot est inapproprié, il est vrai qu’il existe malgré tout des points communs entre toutes les grandes révoltes populaires qui se sont succédé au cours du temps. En me fiant aux multiples reportages diffusés par les médias sur les gilets jaunes, j’ai noté plusieurs éléments qui illustrent cette permanence.
Le principal concerne l’objet initial des revendications : le refus des nouvelles taxes sur le carburant. Les luttes antifiscales ont joué un rôle extrêmement important dans l’histoire populaire de la France. Je pense même que le peuple français s’est construit grâce à l’impôt et contre lui. Le fait que le mouvement des gilets jaunes ait été motivé par le refus de nouvelles taxes sur le carburant n’a donc rien de surprenant. Ce type de luttes antifiscales a toujours atteint son paroxysme quand le peuple a eu le sentiment qu’il devait payer sans rien obtenir en échange. Sous l’Ancien Régime, le refus de la dîme fut fréquemment lié au discrédit touchant les curés qui ne remplissaient plus leur mission religieuse, et c’est souvent lorsque les seigneurs n’assuraient plus la protection des paysans que ceux-ci refusèrent de payer de nouvelles charges. Ce n’est donc pas un hasard si le mouvement des gilets jaunes a été particulièrement suivi dans les régions où le retrait des services publics est le plus manifeste. Le sentiment, largement partagé, que l’impôt sert à enrichir la petite caste des ultra-riches, alimente un profond sentiment d’injustice dans les classes populaires.
Ces facteurs économiques constituent donc bien l’une des causes essentielles du mouvement. Néanmoins, il faut éviter de réduire les aspirations du peuple à des revendications uniquement matérielles. L’une des inégalités les plus massives qui pénalisent les classes populaires concerne leur rapport au langage public. Les élites passent leur temps à interpréter dans leur propre langue ce que disent les dominés, en faisant comme s’il s’agissait toujours d’une formulation directe et transparente de leur expérience vécue. Mais la réalité est plus complexe. J’ai montré dans mon livre, en m’appuyant sur des analyses de Pierre Bourdieu, que la Réforme protestante avait fourni aux classes populaires un nouveau langage religieux pour nommer des souffrances qui étaient multiformes. Les paysans et les artisans du XVIe siècle disaient : « J’ai mal à la foi au lieu de dire j’ai mal partout ». Aujourd’hui, les gilets jaunes crient « j’ai mal à la taxe au lieu de dire j’ai mal partout ». Il ne s’agit pas, évidemment, de nier le fait que les questions économiques sont absolument essentielles car elles jouent un rôle déterminant dans la vie quotidienne des classes dominées. Néanmoins, il suffit d’écouter les témoignages des gilets jaunes pour constater la fréquence des propos exprimant un malaise général. Dans l’un des reportages diffusés par BFM-TV, le 17 novembre, le journaliste voulait absolument faire dire à la personne interrogée qu’elle se battait contre les taxes, mais cette militante répétait sans cesse : « on en a ras le cul » , « ras le cul », « ras le bol généralisé ».
« Avoir mal partout » signifie aussi souffrir dans sa dignité. C’est pourquoi la dénonciation du mépris des puissants revient presque toujours dans les grandes luttes populaires et celle des gilets jaunes n’a fait que confirmer la règle. On a entendu un grand nombre de propos exprimant un sentiment d’humiliation, lequel nourrit le fort ressentiment populaire à l’égard d’Emmanuel Macron. « Pour lui, on n’est que de la merde ». Le président de la République voit ainsi revenir en boomerang l’ethnocentrisme de classe que j’ai analysé dans mon livre.
Néanmoins, ces similitudes entre des luttes sociales de différentes époques masquent de profondes différences. Je vais m’y arrêter un moment car elles permettent de comprendre ce qui fait la spécificité du mouvement des gilets jaunes. La première différence avec les « jacqueries » médiévales tient au fait que la grande majorité des individus qui ont participé aux blocages de samedi dernier ne font pas partie des milieux les plus défavorisés de la société. Ils sont issus des milieux modestes et de la petite classe moyenne qui possèdent au moins une voiture. Alors que « la grande jacquerie » de 1358 fut un sursaut désespéré des gueux sur le point de mourir de faim, dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans et la peste noire.
La deuxième différence, et c’est à mes yeux la plus importante, concerne la coordination de l’action. Comment des individus parviennent-ils à se lier entre eux pour participer à une lutte collective ? Voilà une question triviale, sans doute trop banale pour que les commentateurs la prennent au sérieux. Et pourtant elle est fondamentale. A ma connaissance, personne n’a insisté sur ce qui fait réellement la nouveauté des gilets jaunes : à savoir la dimension d’emblée nationale d’un mouvement spontané. Il s’agit en effet d’une protestation qui s’est développée simultanément sur tout le territoire français (y compris les DOM-TOM), mais avec des effectifs localement très faibles. Au total, la journée d’action a réuni moins de 300 000 personnes, ce qui est un score modeste comparé aux grandes manifestations populaires. Mais ce total est la somme des milliers d’actions groupusculaires réparties sur tout le territoire.
Cette caractéristique du mouvement est étroitement liée aux moyens utilisés pour coordonner l’action des acteurs de la lutte. Ce ne sont pas les organisations politiques et syndicales qui l’ont assurée par leurs moyens propres, mais les « réseaux sociaux ». Les nouvelles technologies permettent ainsi de renouer avec des formes anciennes « d’action directe », mais sur une échelle beaucoup plus vaste, car elles relient des individus qui ne se connaissent pas. Facebook, twitter et les smartphones diffusent des messages immédiats (SMS) en remplaçant ainsi la correspondance écrite, notamment les tracts et la presse militante qui étaient jusqu’ici les principaux moyens dont disposaient les organisations pour coordonner l’action collective ; l’instantanéité des échanges restituant en partie la spontanéité des interactions en face à face d’autrefois.
Toutefois les réseau sociaux, à eux seuls, n’auraient jamais pu donner une telle ampleur au mouvement des gilets jaunes. Les journalistes mettent constamment en avant ces « réseaux sociaux » pour masquer le rôle qu’ils jouent eux-mêmes dans la construction de l’action publique. Plus précisément, c’est la complémentarité entre les réseaux sociaux et les chaînes d’information continue qui ont donné à ce mouvement sa dimension d’emblée nationale. Sa popularisation résulte en grande partie de l’intense « propagande » orchestrée par les grands médias dans les jours précédents. Parti de la base, diffusé d’abord au sein de petits réseaux via facebook, l’événement a été immédiatement pris en charge par les grands médias qui ont annoncé son importance avant même qu’il ne se produise. La journée d’action du 17 novembre a été suivie par les chaînes d’information continue dès son commencement, minute par minute, « en direct » (terme qui est devenu désormais un équivalent de communication à distance d’événements en train de se produire). Les journalistes qui incarnent aujourd’hui au plus haut point le populisme (au sens vrai du terme) comme Eric Brunet qui sévit à la fois sur BFM-TV et sur RMC, n’ont pas hésité à endosser publiquement un gilet jaune, se transformant ainsi en porte-parole auto-désigné du peuple en lutte. Voilà pourquoi la chaîne a présenté ce conflit social comme un « mouvement inédit de la majorité silencieuse ».
Une étude qui comparerait la façon dont les médias ont traité la lutte des cheminots au printemps dernier et celle des gilets jaunes serait très instructive. Aucune des journées d’action des cheminots n’a été suivie de façon continue et les téléspectateurs ont été abreuvés de témoignages d’usagers en colère contre les grévistes, alors qu’on a très peu entendu les automobilistes en colère contre les bloqueurs.
Je suis convaincu que le traitement médiatique du mouvement des gilets jaunes illustre l’une des facettes de la nouvelle forme de démocratie dans laquelle nous sommes entrés et que Bernard Manin appelle la « démocratie du public » (cf son livre Principe du gouvernement représentatif, 1995). De même que les électeurs se prononcent en fonction de l’offre politique du moment – et de moins en moins par fidélité à un parti politique – de même les mouvements sociaux éclatent aujourd’hui en fonction d’une conjoncture et d’une actualité précises. Avec le recul du temps, on s’apercevra peut-être que l’ère des partis et des syndicats a correspondu à une période limitée de notre histoire, l’époque où les liens à distance étaient matérialisés par la communication écrite. Avant la Révolution française, un nombre incroyable de révoltes populaires ont éclaté dans le royaume de France, mais elles étaient toujours localisées, car le mode de liaison qui permettait de coordonner l’action des individus en lutte reposait sur des liens directs : la parole, l’interconnaissance, etc. L’Etat royal parvenait toujours à réprimer ces soulèvements parce qu’il contrôlait les moyens d’action à distance. La communication écrite, monopolisée par les « agents du roi », permettait de déplacer les troupes d’un endroit à l’autre pour massacrer les émeutiers.
Dans cette perspective, la Révolution française peut être vue comme un moment tout à fait particulier, car l’ancienne tradition des révoltes locales a pu alors se combiner avec la nouvelle pratique de contestation véhiculée et coordonnée par l’écriture (cf les cahiers de doléances).
L’intégration des classes populaires au sein de l’Etat républicain et la naissance du mouvement ouvrier industriel ont raréfié les révoltes locales et violentes, bien qu’elles n’aient jamais complètement disparu (cf le soulèvement du « Midi rouge » en 1907). La politisation des résistances populaires a permis un encadrement, une discipline, une éducation des militants, mais la contrepartie a été la délégation de pouvoir au profit des leaders des partis et des syndicats. Les mouvements sociaux qui se sont succédé entre les années 1880 et les années 1980 ont abandonné l’espoir d’une prise du pouvoir par la force, mais ils sont souvent parvenus à faire céder les dominants grâce à des grèves avec occupations d’usine, et grâce à de grandes manifestations culminant lors des « marches sur Paris » (« de la Bastille à la Nation »).
L’une des questions que personne n’a encore posée à propos des gilets jaunes est celle-ci : pourquoi des chaînes privées dont le capital appartient à une poignée de milliardaires sont-elles amenées aujourd’hui à encourager ce genre de mouvement populaire ? La comparaison avec les siècles précédents aboutit à une conclusion évidente. Nous vivons dans un monde beaucoup plus pacifique qu’autrefois. Même si la journée des gilets jaunes a fait des victimes, celles-ci n’ont pas été fusillées par les forces de l’ordre. C’est le résultat des accidents causés par les conflits qui ont opposé le peuple bloqueur et le peuple bloqué.
Cette pacification des relations de pouvoir permet aux médias dominants d’utiliser sans risque le registre de la violence pour mobiliser les émotions de leur public car la raison principale de leur soutien au mouvement n’est pas politique mais économique : générer de l’audience en montrant un spectacle. Dès le début de la matinée, BFM-TV a signalé des « incidents », puis a martelé en boucle le drame de cette femme écrasée par une automobiliste refusant d’être bloqué. Avantage subsidiaire pour ces chaînes auxquelles on reproche souvent leur obsession pour les faits divers, les crimes, les affaires de mœurs : en soutenant le mouvement des gilets jaunes, elles ont voulu montrer qu’elles ne négligeaient nullement les questions « sociales ».
Au-delà de ces enjeux économiques, la classe dominante a évidemment intérêt à privilégier un mouvement présenté comme hostile aux syndicats et aux partis. Ce rejet existe en effet chez les gilets jaunes. Même si ce n’est sans doute pas voulu, le choix de la couleur jaune pour symboliser le mouvement (à la place du rouge) et de la Marseillaise (à la place de l’Internationale) rappelle malheureusement la tradition des « jaunes », terme qui a désigné pendant longtemps les syndicats à la solde du patronat. Toutefois, on peut aussi inscrire ce refus de la « récupération » politique dans le prolongement des combats que les classes populaires ont menés, depuis la Révolution française, pour défendre une conception de la citoyenneté fondée sur l’action directe. Les gilets jaunes qui bloquent les routes en refusant toute forme de récupération des partis politiques assument aussi confusément la tradition des Sans-culottes en 1792-93, des citoyens-combattants de février 1848, des Communards de 1870-71 et des anarcho-syndicalistes de la Belle Epoque.
C’est toujours la mise en œuvre de cette citoyenneté populaire qui a permis l’irruption dans l’espace public de porte-parole qui était socialement destinés à rester dans l’ombre. Le mouvement des gilets jaunes a fait émerger un grand nombre de porte-parole de ce type. Ce qui frappe, c’est la diversité de leur profil et notamment le grand nombre de femmes, alors qu’auparavant la fonction de porte-parole était le plus souvent réservée aux hommes. La facilité avec laquelle ces leaders populaires s’expriment aujourd’hui devant les caméras est une conséquence d’une double démocratisation : l’élévation du niveau scolaire et la pénétration des techniques de communication audio-visuelle dans toutes les couches de la société. Cette compétence est complètement niée par les élites aujourd’hui ; ce qui renforce le sentiment de « mépris » au sein du peuple. Alors que les ouvriers représentent encore 20% de la population active, aucun d’entre eux n’est présent aujourd’hui à la Chambre des députés. Il faut avoir en tête cette discrimination massive pour comprendre l’ampleur du rejet populaire de la politique politicienne.
Mais ce genre d’analyse n’effleure même pas « les professionnels de la parole publique » que sont les journalistes des chaînes d’information continue. En diffusant en boucle les propos des manifestants affirmant leur refus d’être « récupérés » par les syndicats et les partis, ils poursuivent leur propre combat pour écarter les corps intermédiaires et pour s’installer eux-mêmes comme les porte-parole légitimes des mouvements populaires. En ce sens, ils cautionnent la politique libérale d’Emmanuel Macron qui vise elle aussi à discréditer les structures collectives que se sont données les classes populaires au cours du temps.
Etant donné le rôle crucial que jouent désormais les grands médias dans la popularisation d’un conflit social, ceux qui les dirigent savent bien qu’ils pourront siffler la fin de la récréation dès qu’ils le jugeront nécessaire, c’est-à-dire dès que l’audimat exigera qu’ils changent de cheval pour rester à la pointe de « l’actualité ». Un tel mouvement est en effet voué à l’échec car ceux qui l’animent sont privés de toute tradition de lutte autonome, de toute expérience militante. S’il monte en puissance, il se heurtera de plus en plus à l’opposition du peuple qui ne veut pas être bloqué et ces conflits seront présentés en boucle sur tous les écrans, ce qui permettra au gouvernement de réprimer les abus avec le soutien de « l’opinion ». L’absence d’un encadrement politique capable de définir une stratégie collective et de nommer le mécontentement populaire dans le langage de la lutte des classes est un autre signe de faiblesse car cela laisse la porte ouverte à toutes les dérives. N’en déplaise aux historiens (ou aux sociologues) qui idéalisent la « culture populaire », le peuple est toujours traversé par des tendances contradictoires et des jeux internes de domination. Au cours de cette journée des gilets jaunes, on a entendu des propos xénophobes, racistes, sexistes et homophobes. Certes, ils étaient très minoritaires, mais il suffit que les médias s’en emparent (comme ils l’ont fait dès le lendemain) pour que tout le mouvement soit discrédité.
L’histoire montre pourtant qu’une lutte populaire n’est jamais complètement vaine, même quand elles est réprimée. Le mouvement des gilets jaunes place les syndicats et les partis de gauche face à leurs responsabilités. Comment s’adapter à la réalité nouvelle que constitue la « démocratie du public » pour faire en sorte que ce type de conflit social – dont on peut prévoir qu’il se reproduira fréquemment – soit intégré dans un combat plus vaste contre les inégalités et l’exploitation ? Telle est l’une des grandes questions à laquelle il faudra qu’ils répondent.
source : https://noiriel.wordpress.com/2018/11/21/les-gilets-jaunes-et-les-lecons-de-lhistoire/
0 notes
Link
Adresse aux dirigeants russes et aux leaders des pays du monde entier
Nous demandons la libération immédiate des deux prisonniers politiques Alexandre Koltchenko et Oleg Sentsov qui se trouvent en danger de mort
Alors que la Coupe du Monde de football va débuter en Russie, près de 70 prisonniers politiques ukrainiens restent incarcérés dans ce pays ainsi que dans la Crimée occupée. Pour attirer l'attention de la communauté internationale aux persécutions politiques perpétrées par le régime du Kremlin, le réalisateur Oleg Sentsov, lui-même emprisonné dans la colonie pénitentiaire au-dessus du cercle polaire, a entamé une grève de la faim illimitée le 14 mai dernier. Selon ses calculs sa mort devrait survenir pendant la Coupe du monde. En signe de solidarité, trois autres prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie et en Crimée l'ont suivi. Parmi eux, le militant anarchiste Alexandre Koltchenko, souffrant d'un déficit de poids (54kg pour ses 190cm de taille !), a du interrompre sa grève de la faim après 8 jours, ses jours restent en danger.
Ils exigent la liberté non pas pour eux-mêmes, mais pour tous et toutes les prisonnier-e-s politiques ukrainien-ne-s détenu-e-s en Russie et en Crimée.
Nous appelons les dirigeants russes et les leaders du monde entier à : * engager les procédures nécessaires à la libération rapide de tous et toutes les prisonnier-e-s ukrainien-e-s poursuivi-e-s pour des raisons politiques en Russie et en Crimée ; * prendre des mesures urgentes pour assurer l'échange de prisonnier-e-s entre la Fédération de Russie et l'Ukraine ; * libérer immédiatement et sans condition Oleg Sentsov et Alexandre Koltchenko. Nous appelons les leaders des pays du monde entier à boycotter la Coupe du monde si les prisonniers politiques ukrainiens ne sont pas libérés.
Venez nombreux nous rejoindre le 13 juin 2018
face à l'ambassade russe, de 18h à 19h,
au 40-50 bd Lannes, 75016 Paris !!!
Collectif KOLTCHENKO : Ligue des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, Groupe de résistance aux répressions en Russie, Ukraine Action, Russie-Libertés, CEDETIM - Initiatives Pour un Autre Monde - Assemblée Européenne des Citoyens, Action antifasciste Paris-Banlieue, Collectif Antifasciste Paris Banlieue, Mémorial 98, Union syndicale Solidaires, CNT-f, CNT-SO, Emancipation, FSU, FSU 03, CGT Correcteurs, SUD éducation, SUD-PTT, Alternative Libertaire, Ensemble ! (membre du Front de gauche), L’Insurgé, NPA, Fédération Anarchiste, Critique sociale. Lien fichier PDF : ici
0 notes
Link
4 pages du Collectif de soutien aux réfugiés et aux migrants Lyon-69 -> lien du pdf : ici
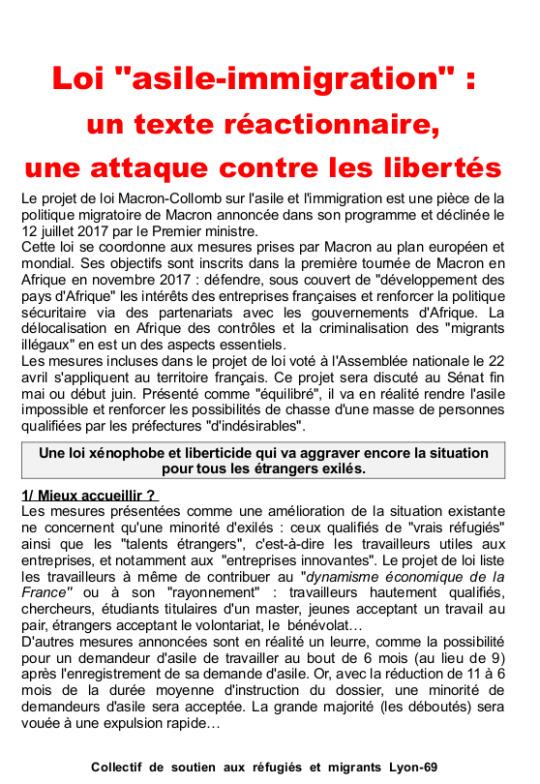
**************************************************************
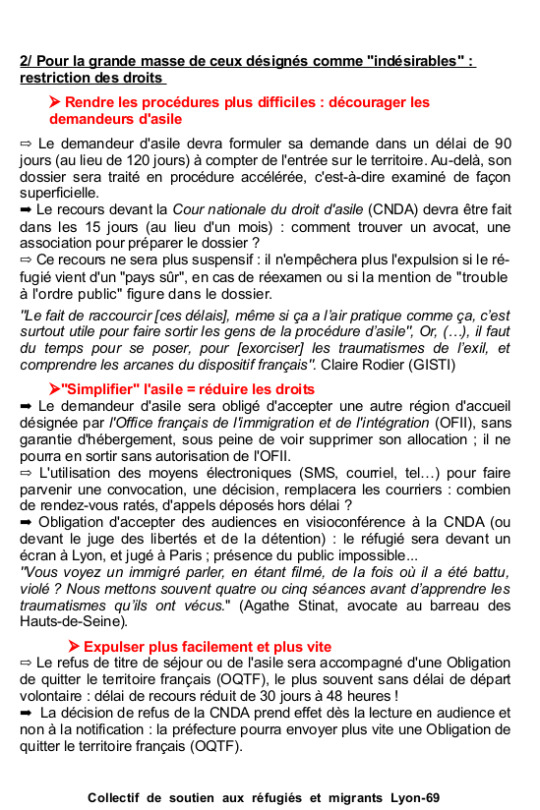
******************************************************************************
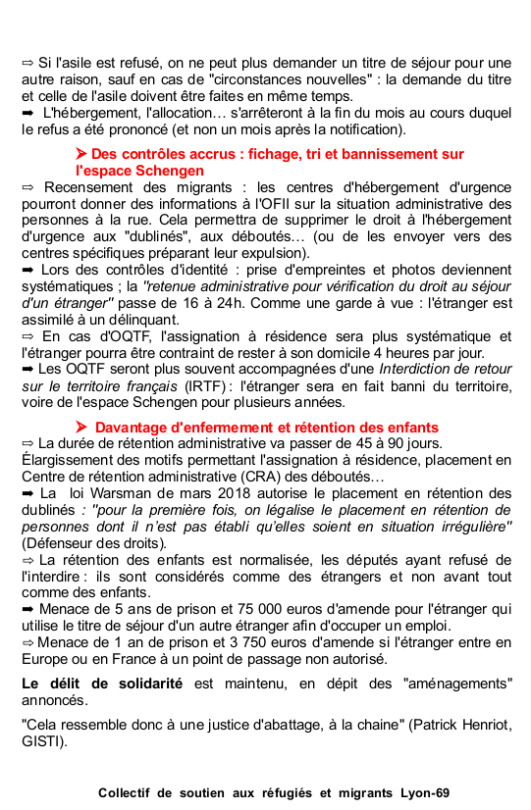
**********************************************************************
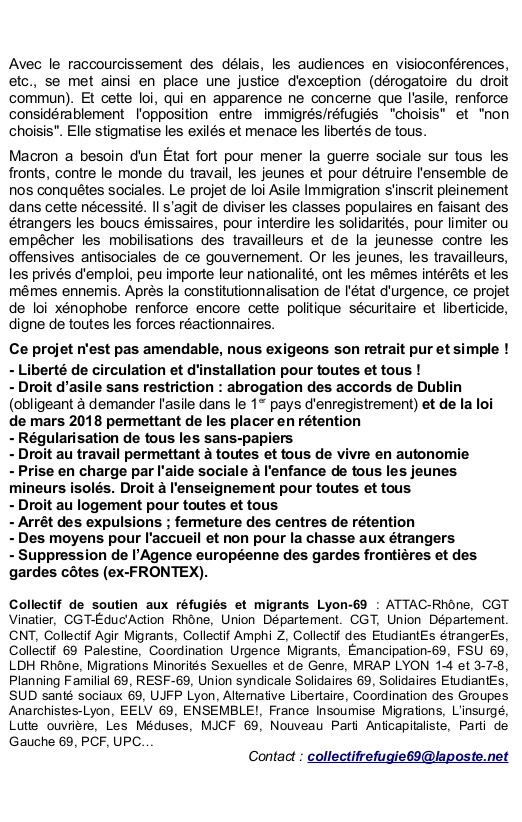
0 notes
Link
Depuis le 20 janvier 2018, l'armée turque intervient dans le canton d'Afrin en Syrie, contre le parti kurde PYD et sa composante militaire le YPG qui contrôlent le canton. Poutine et les Occidentaux ont donné leur accord. Et plus de 70 civils (kurdes, arabes et turkmènes notamment) sont morts depuis le début de l'intervention.
Ce même 20 janvier, les forces armées alliées au régime d'Assad se sont rejointes au niveau de la base Abu Ad Duhur dans la région d'Idlib. Elles ont repris de vastes zones libérées du régime entraînant notamment un déplacement de plus de 320 000 civils (400 000 selon certaine sources).
Quant aux massacres des populations par le régime et ses alliés russe et iranien, ils se poursuivent : à Idlib (destruction d’hôpitaux comme à Maarat al-Noman le 5 février), dans la Ghouta de Damas (gazages au chlore le 1er février, plus de 220 civils tués par bombardement entre le 5 et 8 février, plus de 98 le 19 février alors que le ministre russe Lavrov déclarait « l’expérience acquise à Alep (…) peut être utilisée dans la Ghouta est ») ...
Cette réalité contredit les discours déclamés lors des conférences internationales, à Astana et Sotchi, organisées sous la houlette de la Russie. Poutine, parce qu'il propose de maintenir Assad au pouvoir et de créer des "zones de désescalades" pour assurer la "sécurité" des populations, est présenté par la propagande russe comme "faiseur de paix"... La réalité, c'est la poursuite des bombardements et d'une répression sans nom du peuple syrien, davantage de divisions, et un partage de plus en plus clair entre les puissances étrangères du contrôle du territoire syrien, en utilisant notamment différents groupes armés syriens, en s'échangeant des zones ou en se combattant parfois, en fonctions de leurs intérêts propres et des rapports de forces...
D'un côté, les zones tenues par Assad sont largement contrôlées par les forces russes, iraniennes et associées (comme le Hezbollah). Et le régime, pour combattre ses opposants, utilise Daesh. De l'autre, les zones libérées de Assad et de Daesh constituent globalement deux ensembles. A l'Est de l'Euphrate la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis (et incluant la France) utilise les Forces Démocratiques Syriennes, constituées surtout des YPG. Elle a annoncé, en janvier, s'installer durablement dans cette zone. Quant à la Turquie, elle contrôle fortement la région au nord d'Alep, cherche à investir le canton d'Afrin, et est présente ponctuellement à l'ouest d'Alep, autour d'Idlib. Elle utilise des brigades d'opposants à Assad, de l'ASL notamment, et a fermé ses frontières aux civils syriens. S’ingèrent également dans ce conflit d’autres pays, comme l’Arabie Saoudite et le Qatar, mais également Israël, qui occupe le Golan depuis plusieurs décennies, et qui intensifie ses interventions militaires en Syrie contre l’emprise à ses frontières du Hezbollah et de l’Iran. Toutes ces puissances intervenant en Syrie jouent un rôle contre-révolutionnaire et toutes s'accordent à maintenir au pouvoir Assad qui, avec les forces russes et iraniennes, sont responsables de plus de 93% des civils tués en Syrie depuis 2011.
L'intervention turque fait ressortir des divisions qui existent depuis plusieurs années, ont contribué à ajouter des guerres à la guerre d'Assad contre son propre peuple et à soumettre le peuple syrien aux puissances étrangères. Ces divisions vont à l'encontre des aspirations du peuple syrien qui en 2011 défilait avec des pancartes écrites en arabe et en kurde et criait "le peuple est un". Les manifestations à Afrin contre l'offensive turque, à Idlib contre al-Nosra (début février) montrent la résistance civile contre les politiques oppressives.
Lutter pour l'arrêt de ces guerres contre le peuple syrien, c'est commencer par soutenir partout les revendications qui exigent le départ de tous les fauteurs de guerre :
* La revendication du peuple syrien pour le départ de Assad et la fin de son régime, immédiatement et sans condition, est légitime.
* Arrêt immédiat de tous les bombardements en Syrie ! Départ de toutes les forces armées étrangères de la Syrie : russe, iranienne (et leurs bras armés), turque, américaine, française et israélienne. C'est dans ce cadre que le peuple syrien pourra décider seul de son avenir, et que certains, comme les Kurdes, pourront obtenir durablement satisfaction de leurs revendications spécifiques.
Notre soutien au peuple syrien passe également par les exigences suivantes :
° Levée immédiate de tous les sièges ! ° Libération immédiate de tous les prisonniers politiques !
° Aucune collaboration avec les dictateurs : ni Assad, ni Poutine, ni Khamenei, ni Erdogan !
° Mobilisation internationale pour l'aide humanitaire et l'accueil des réfugiés !
---------
Collectif Avec la Révolution Syrienne : Cedetim, Émancipation, Ensemble, Forum Palestine Citoyenneté, L'insurgé, NPA, UJFP, Union syndicale Solidaires
SOURCE : https://aveclarevolutionsyrienne.blogspot.fr/2018/02/solidarite-avec-le-peuple-syrien-arret.html
Lien : fichier en pdf
0 notes
Link
0 notes
Link
Le 30 juin, l'armée libanaise intervenait dans deux camps de réfugiés syriens dans la région d'Ersal (Liban), au nom de la lutte contre le "terrorisme", faisant plusieurs morts et raflant plus de 350 réfugiés. Quelques jours plus tard des détenus sont rendus morts, leur corps couvert de traces de tortures. Le 10 juillet, le premier ministre libanais déclarait que "L'institution militaire est au-dessus de tout soupçon". Pourtant, les preuves de torture généralisée et d'arrestations arbitraires sont flagrantes : parmi les détenus on trouve des jeunes mineurs et des personnes de plus de 70 ans; plusieurs dizaines de détenus présentent des traces de tortures et ont été privés de boisson et de nourriture pendant plusieurs jours; parmi les détenus décédés sous la torture (plus de 12), on trouve un médecin anesthésiste et une personne handicapée; certains corps sont mutilés.
L'objectif ? Terroriser les réfugiés syriens afin de les forcer à rentrer en Syrie et faire céder l'opposition syrienne face à Assad. Les rafles dans les camps libanais ne sont pas nouvelles, mais c'est la première fois qu'elles sont d'une telle violence. Elle s'inscrit sur fond d'augmentation d'une xénophobie véhiculée par l'Etat libanais et le Hezbollah, un groupe paramilitaire lié à l'Iran, qui intervient en Syrie contre le peuple syrien et en soutien à Assad. En février, le président du Liban, Michel Aoun, avait réaffirmé son soutien à ce groupe. A Ersal, l'armée libanaise a vraisemblablement agit en coopération avec le Hezbollah.
L'exportation au Liban de la violence contre le peuple syrien, qui s'est soulevé pacifiquement en 2011 contre plus de 40 ans de dictature menée par la famille Assad, est encouragée par l'attitude des grandes puissances, notamment des USA et de la France, qui soutiennent de plus en plus ouvertement le régime de Assad et son allié le régime russe. En témoignent la déclaration du secrétaire d’État américain Tillerson "Peut-être qu'ils [les Russes] ont eu la bonne approche, et nous la mauvaise" (le 07 juillet), ou la formation d'un groupe de travail franco-russe de lutte contre Daesh (annoncé par Macron le 29 mai).
Une telle coopération avec le dictateur Poutine est inacceptable. Elle s'inscrit en France dans la lignée de la politique de Hollande qui, en décidant d'intervenir en Syrie en septembre 2015 contre Daesh, actait ce que Macron énoncera cyniquement le 21 juin 2017 « Bachar, ce n’est pas notre ennemi, c’est l’ennemi du peuple syrien. ». Après les attentats du 13 novembre 2015, Hollande avait souhaité une coopération avec Poutine contre le "terrorisme", mais il n'avait pas pu mettre son vœu en pratique. Avec Macron en 2017, c'est chose faite. Dans la même ligne, suite à la rafle à Ersal, la France condamnait "l’attaque qui a visé le 30 juin les forces armées libanaises", leur réitérait son soutien, et expliquait : "Elle restera pleinement engagée aux côtés des autorités libanaises dans la lutte contre le terrorisme." (!)
Enfin, l'agitation par Macron d'une "ligne rouge" que constituerait l'utilisation d'armes chimiques n'a pas empêché le régime d'Assad d'utiliser à nouveau cette arme (début juillet en larguant du chlore dans la Ghouta), et de poursuivre par toutes sortes d'armes son oppression contre le peuple syrien. En parallèle, à Raqqa, la coalition poursuit ses bombardements désastreux : massacres de civils et destructions massives se multiplient. Au sol, les forces kurdes liées au PKK progressent et Daesh recule; mais les conflits entre les forces liées au PKK et celles liées à la révolution syrienne aggravent la situation du peuple syrien. Malgré les bombardements et toutes les violences armées, nombre de civils syriens continuent au quotidien à manifester et à se battre pour leurs droits.
° Soutien aux demandes des familles des victimes et emprisonnés (et de leurs avocats), suite à la rafle d'Ersal au Liban (libération immédiate de tous les prisonniers, droit d’enquête indépendante, droit d'accès aux informations...) !
° Arrêt immédiat de tous les bombardements en Syrie !
° Aucune collaboration avec les dictateurs : ni Assad, ni Poutine ! ° Levée immédiate de tous les sièges ! ° Libération immédiate de tous les prisonniers politiques ! ° Départ de toutes les forces armées étrangères de la Syrie ! ° Mobilisation internationale pour l'aide humanitaire et l'accueil des réfugiés !
Ni Assad, ni Daesh ! C'est au peuple syrien et à lui seul de décider de son avenir. La revendication du peuple syrien pour le départ de Assad et la fin de son régime, immédiatement et sans condition, est légitime.
collectif Avec la Révolution Syrienne (Alternative Libertaire, Cedetim, Émancipation, Ensemble, Forum Palestine Citoyenneté, L’insurgé, Nasskoune, NPA, UJFP, Union syndicale Solidaires)
source : https://aveclarevolutionsyrienhttp://ift.tt/2w1omloite-avec-les-refugies-syriens-au.html
0 notes
Link
Entretien avec Claude Serfati
Dans son très récent ouvrage intitulé Le Militaire. Une histoire française (Ed. Amsterdam, février 2017), Claude Serfati vise à fournir des éléments de réflexion à celles et ceux qui veulent comprendre les fondements du militarisme français et les raisons de son amplification au cours des dernières années. Il décrypte la place du militaire et de l’industrie de l’armement de l’époque de l’impérialisme à aujourd’hui, l’existence continuée de la «Françafrique», et enfin le lien entre le regain militariste et le dispositif sécuritaire déployé sur le territoire depuis les attentats de 2015. Un livre qui doit être lu, alors que les élections françaises saturent les écrans. (Réd. A l’Encontre)
Peux-tu, au-delà de cette brève introduction, nous décrire l’objectif – ou les objectifs – de cet ouvrage?
Claude Serfati: Il est nécessaire d’analyser et de documenter les racines profondes du militarisme français. Son intensification depuis la fin des années 2000 (Libye, Mali, République centrafricaine) frappe beaucoup les observateurs, mais a donné lieu à peu d’explications qui aillent au-delà de celles du type les «guerres du président» (Sarkozy, puis Hollande). Il n’est pas question de nier le rôle des chefs de l’Etat dans le cadre d’institutions de type «bonapartiste» de la Ve République, toutefois leur décision d’aller en guerre ne se réduit pas à une question d’«affects».
Un fait indique l’urgence d’un débat: alors que pour une nation, la décision de faire la guerre est l’acte politique le plus important, il n’existe aucun décompte officiel. C’est un reflet de l’attitude de la société française vis-à-vis du militaire. Certains avancent le chiffre de 111 interventions hors des frontières depuis 1991 (dont 25 en 2015). Les présidents considèrent que le droit de faire la guerre les dispense de rendre des comptes; le Parlement est réduit à un rôle subalterne, et au mieux approbateur sur les questions de défense. Les citoyens et citoyennes sont dépourvus d’ONG pacifistes assez puissantes pour servir de contrepoids aux autres pouvoirs.
Sur les questions du militaire en France, il existe un consensus par le silence qui est «assourdissant». L’absence de discussion des questions de politique et d’économie de la défense au cours des élections présidentielles en est une récente confirmation.
Comment expliques-tu ce constat qui a l’apparence d’une évidence?
Comme souvent, les facteurs anciens croisent d’autres plus contemporains. La France présente, à mon avis, deux singularités produites par la «longue durée». Le militaire a été au cœur de la consolidation de l’Etat que ce soit sous forme de guerres, du rôle social des militaires sous la monarchie absolutiste, ou même des manufactures royales. Ainsi que les travaux de Charles Tilly [voir, par exemple, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe 990-1990, Aubier 1992] l’ont montré, cela n’est pas exceptionnel, mais les guerres de conquêtes conduites par Louis XIV, puis Napoléon Bonaparte soulignent la prégnance de l’institution militaire au sein de l’Etat. Depuis l’expansion impérialiste de la France au XIXe siècle, l’institution militaire a consolidé son enracinement avec une force toute particulière sous la Ve République.
L’autre singularité de la France est l’omniprésence de l’Etat dans les rapports économiques et sociaux. Marx rappelle dans Le 18 brumaire de Louis Napoléon Bonaparte que: «l’Etat enserre, contrôle, réglemente, surveille et tient en tutelle la société civile, depuis ses manifestations d’existence les plus vastes jusqu’à ses mouvements les plus infimes». L’Etat, c’est concrètement «son armée de fonctionnaires d’un demi-million d’hommes et son autre armée de cinq cent mille soldats». L’extension des fonctions économiques et sociales de l’Etat a certes modifié cette répartition des effectifs, mais elle a surtout amplifié la pénétration des institutions étatiques au cœur de rapports sociaux.
Ce n’est donc pas un hasard si depuis la Révolution française, en passant par Napoléon Bonaparte, la Restauration, la Monarchie de Juillet, Napoléon «le petit», la Commune de Paris et la IVe République, les grandes convulsions sociales de l’histoire trouvent leur dénouement dans une transformation radicale des formes de domination politique.
En somme, l’interaction de ces deux singularités – l’armée au cœur de l’Etat et l’Etat au cœur des rapports sociaux – a conféré à l’institution militaire un rôle essentiel qui est plus important que celui qui existe dans les autres pays occidentaux.
Quant aux facteurs contemporains qui expliquent ce «silence assourdissant», l’accord droite-gauche facilite évidemment ce consensus. Les partis qui ont alternativement dirigé les gouvernements sont d’accord sur l’essentiel: l’arme nucléaire, la présence militaire assortie d’interventions périodiques en Afrique subsaharienne, le niveau de dépenses militaires. Tous revendiquent la poursuite des hausses budgétaires décidées par la présidence Hollande afin d’atteindre un ratio du budget de défense au PIB de 2%, ce qui signifierait une augmentation d’au moins 15% de ce budget – de l’ordre de 5 milliards d’euros par an, au minimum. Et ceci, sans compter l’engagement inflexible en faveur de l’arme nucléaire qui nécessiterait un doublement des crédits affectés au nucléaire d’ici à 2030 (passage de 3 à 6 milliards d’euros), selon le responsable de la DGA (Direction générale de l’armement – Ministère de la Défense)
Pour expliquer ce silence sur les questions militaires, on peut également remarquer la relative discrétion des mouvements anti-guerre et des organisations politiques qui les animent. Les mobilisations menées en France ont principalement visé l’impérialisme américain, comme ce fut le cas en 2002-2003 contre l’intervention de ses armées en Irak pour renverser Saddam Hussein. On a assisté à une sorte d’union nationale derrière Chirac après qu’il se fut prononcé, à la suite de Gerhard Schröder, contre cette intervention. Les envolées lyriques de Dominique de Villepin devant le Conseil de sécurité des Nations Unies [février 2003] ont pourtant pris place alors que le président de la République avait déclenché quelques mois auparavant une opération militaire en Côte d’Ivoire [1].
Plus de 4000 militaires français ont été présents dans ce pays, témoignage du rôle persistant de la France dans ses anciennes colonies et du soutien à un chef d’Etat qu’elle a, quelques années après, contribué à renverser. Le débat qui fut organisé en 2003 par Carré Rouge et A l’Encontre auprès d’intellectuels marxistes français constata leur silence sur cette intervention française. Pour le dire un peu brutalement, l’anti-impérialisme américain bien présent en France s’accommode finalement assez bien de la discrétion sur le militarisme des gouvernements français.
Enfin, dans un contexte de chômage permanent, qui frappe des millions de personnes, l’angoisse de perdre leur emploi et l’espoir que leurs enfants soient à leur tour embauchés dans les établissements présents sur le territoire pèsent pour le moment plus lourd pour les salariés que l’hostilité à la production d’armes et à son commerce lucratif pour les industriels de l’armement mais mortifère sur les nombreux lieux de guerre dans les pays où les armes françaises sont exportées. Des études menées aux Etats-Unis (et présentées dans l’ouvrage) montrent pourtant que les dépenses publiques consacrées à l’éducation, la santé et l’environnement sont plus efficaces en termes de création d’emplois que les dépenses militaires.
Pourrais-tu tracer les lignes de force d’une intervention politique dans ce domaine?
Convaincre les salarié·e·s de l’impasse vers laquelle conduit la production d’armes et plus généralement de l’ampleur des détournements de ressources financières pour une industrie qui ne crée aucune valeur, sauf pour les actionnaires des groupes de l’armement, est difficile. Un programme de reconversion des productions militaires exigerait, si l’on suit Seymour Melman, une figure pionnière dans la critique de l’industrie de défense aux Etats-Unis, trois éléments essentiels: une décision politique au niveau gouvernemental et législatif; une planification des objectifs; ainsi que des initiatives sur les lieux de travail (usines, laboratoires, bases militaires).
Le débat national sur ces questions n’est pas contradictoire avec les initiatives conduites au niveau territorial et des entreprises par les salarié·e·s, les élu·e·s et les associations. C’est à ce niveau que des projets peuvent être élaborés, qui organiseront la production sur de nouvelles bases et reconvertiront les activités des entreprises à spécialisation militaire vers des productions socialement utiles et non destructrices de l’environnement, comme l’est la production, l’utilisation et le stockage des armes. Par exemple, c’est seulement au niveau des territoires et des entreprises qu’il est possible de dresser une cartographie des emplois occupés dans la production militaire et d’établir une correspondance avec ceux qui seront nécessaires pour les nouvelles activités en termes de qualifications et de compétences. Ce premier inventaire incomberait aux salarié·e·s, aux syndicats et autres organisations qui sont prêtes à mener une telle action.
Depuis quelques années, les armées françaises interviennent plus fréquemment…
Il est vrai que les décisions de Sarkozy et de Hollande d’intervenir en Libye, en République centrafricaine, au Mali ont donné un coup d’accélérateur aux opérations militaires à l’étranger. Un rapport parlementaire bipartisan se demande d’ailleurs s’il s’agit d’«une passion française».
Pas de rupture, donc, mais une amplification du militarisme français, dont d’autres signes témoignent: augmentation significative des dépenses militaires sous la présidence Hollande, obstination à vendre des armes quel que soit l’usage qui en est en fait par les clients (utilisées par le gouvernement égyptien contre son peuple, par l’Arabie saoudite contre les populations civiles au Yémen, etc.). En réalité, les guerres n’ont jamais cessé, ni pendant la période de «coexistence pacifique» entre les Etats-Unis et l’URSS, ni depuis les années 1990. La France en tant qu’elle est une des grandes puissances militarisées contribue directement ou indirectement à ces guerres. C’est donc l’intensification des interventions françaises qui doit être expliquée.
L’association entre capitalisme et guerre paraissait évidente aux marxistes et socialistes d’antan. Engels prévoit en 1887 une guerre mondiale d’une intensité inconnue jusqu’alors et au cours de laquelle «huit à dix millions de soldats s’entre-tueront» (il était optimiste: l’extermination frappa 9,7 millions de soldats et près de 10 millions de civils). Quelques années après seulement, en 1895, Jaurès rappelle dans un discours sur «l’armée démocratique» que «votre société violente et chaotique, […] porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l’orage».
Cependant, le déclenchement des guerres nécessite une analyse concrète, faute de quoi on se livre à des généralisations hâtives. Les dirigeants français qui ont décidé ces guerres l’ont fait dans une configuration historique particulière que j’appelle le «moment 2008». Celui-ci a combiné une modification radicale dans la situation économique mondiale marquée par l’arrivée d’une «longue récession» dont personne ne peut prévoir la fin avec une nouvelle donne géopolitique marquée par le «printemps arabe» qui a renversé ou ébranlé des régimes dans des régions où l’influence de la France est forte (Maghreb et Machrek, Afrique subsaharienne, etc.) et par la prudence de l’Administration Obama dans ses engagements militaires.
Une «fenêtre d’opportunité» s’est donc ouverte pour conforter le militarisme des gouvernements français. Au-delà des «guerres du Président», une expression qui indique l’ultra-centralisation qui est présente de longue date, on peut citer comme facteurs: l’influence des groupes financiers et industriels liés au militaire – que j’ai défini comme le «méso-système de l’armement»; la montée en puissance de l’armée dans la vie politique, en particulier au sein du groupe qui conseille les présidents de la République Sarkozy et Hollande; le déclin industriel et le déséquilibre dans le couple franco-allemand qui font du militaire un des derniers «avantages comparatifs» de la France vis-à-vis de son partenaire dans l’espace européen. Ces facteurs ont convergé à un moment donné pour déclencher des interventions militaires qui visent à défendre les positions géopolitiques et les intérêts économiques là où ils sont menacés, c’est-à-dire d’abord sur le continent africain.
Le dernier chapitre intitulé «Vers l’état d’urgence permanent» établit une corrélation entre les interventions militaires et l’installation dans l’état d’urgence…
Cet état d’urgence a été voté pour la première fois le 14 novembre 2015; il est donc à ce jour en place depuis près d’un an et demi. L’histoire montre que les guerres menées par les dirigeants d’un pays sont en général corrélées à une restriction des libertés publiques dans leur propre pays. Ces guerres nécessitent en effet de bâtir une union nationale solide, de rendre inaudibles les voix dissidentes, et souvent de les réprimer. Il y a plus d’un siècle (en 1907), Karl Liebknecht, qui en tant que député socialiste au Reichstag, fut le seul (avec Rosa Luxemburg) à ne pas voter les crédits de guerre à l’empereur Guillaume II, montrait dans un remarquable texte destiné à la jeunesse que l’utilisation du militarisme ne servait pas seulement à l’extérieur du pays, mais également contre la population de son propre pays, au premier chef contre la classe ouvrière, mais également contre les minorités nationales et religieuses.
Je montre dans mon ouvrage que dès le XIXe siècle, l’expansion coloniale de la France a cheminé avec une utilisation de l’armée contre les «ennemis intérieurs», à l’époque la classe ouvrière et les autres classes laborieuses considérées comme des «classes dangereuses».
L’utilisation conjointe de l’armée et d’un arsenal répressif contre les populations «dangereuses» est une constante dans toutes les guerres menées par la France, y compris dans les guerres coloniales des années 1950. L’état d’urgence a été précisément créé en 1955 pour combattre les luttes menées pour l’indépendance de l’Algérie.
La connexion entre guerres à l’extérieur et restriction des libertés publiques à l’intérieur s’est fortement relâchée après la fin de la guerre d’Algérie et l’état d’urgence qui fut à nouveau décrété en 1962 contre l’OAS. Au cours des décennies passées, les nombreuses interventions militaires effectuées par l’armée française en Afrique ont été menées sans conséquences majeures sur les libertés publiques en France.
La situation actuelle est tout autre. En 2012 a été décidée par le président de la République l’intervention française au Mali. L’«éradication du terrorisme» a été réitérée après les attentats commis en France en 2015. C’est un objectif aussi imprécis qu’illusoire tant que les moyens militaires sont les seuls utilisés. La réalité est plutôt celle de la présence de l’armée française dans des anciennes colonies africaines qui s’est consolidée. Cette situation rappelle les protectorats de l’ère de l’impérialisme d’il y a un siècle et semble promise à durer. Cette restriction des libertés publiques via l’état d’urgence constitue le troisième élément d’un triptyque dont les deux autres sont l’engagement militaire accru de la France et les attentats sur le territoire métropolitain.
L’état d’urgence et sa pérennisation depuis 2015 impliquent par définition une restriction des libertés publiques. Il a été utilisé pour entraver les mouvements sociaux contre la loi El Khomri. Il est principalement utilisé contre les jeunes, nés de parents ou grands-parents immigrés, qui cumulent en France des obstacles de classes et ethniques. Les minorités ’visibles’ le sont plus encore lors des contrôles de police, comme l’ont montré à la fois les études des chercheurs, les tests d’embauche réalisés par SOS racisme et d’autres ONG, et récemment la Cour de cassation qui a condamné l’Etat – en fait la police – pour «contrôle d’identité discriminatoire».
La relation entre l’interventionnisme à l’extérieur et le développement sécuritaire à l’intérieur a pris une nouvelle ampleur avec la phase de mondialisation du capital dominée par la finance. J’avais critiqué dans la Mondialisation armée, publiée avant le 11 septembre 2001, le mythe développé par les économistes et les politistes qui, dans leur apologie de l’ordre néo-libéral, nous expliquaient que les «marchés» allaient apporter la paix et la démocratie dans le monde. Cette mondialisation au format ’PDF’ (Peace-Democracy-Free trade) ignorait que le capitalisme n’est pas seulement un mode de production, il est un régime de domination sociale qui a besoin d’un «bras armé». Depuis une quinzaine d’années, les doctrines stratégiques nous annoncent l’effacement des frontières entre menaces extérieures et intérieures, économiques et non-économiques, étatiques et non-étatiques. On a beaucoup mentionné les restrictions des libertés démocratiques mises en œuvre par l’Administration Bush après le 11 septembre – que Donald Trump a décidé d’amplifier.
La France est, si l’on ose dire, mieux placée encore pour subir les remises en cause des libertés. L’article 16 de la Constitution [«pleins pouvoirs», «pouvoirs exceptionnels»], l’état de siège figurent dans l’arsenal constitutionnel et constituent avec l’état d’urgence un «cocktail explosif», pour reprendre les termes d’Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues, deux professeurs de droit public [L’état d’urgence. Etude constitutionnelle, historique et critique, Ed. L.G.D.J, novembre 2016]. Le durcissement des tensions sociales, un nouvel attentat qui frapperait en masse la population pourraient activer ces mesures constitutionnelles et donner des responsabilités supplémentaires non seulement au président, mais également aux appareils militaires et sécuritaires chargés de leur mise en œuvre. Pas besoin d’imaginer un golpe installant un dictateur, tel que l’Amérique latine en a connu, pas même un coup d’Etat similaire à celui de 1958 en France, qui a résulté de la crise politique au sein de l’armée et dont les institutions de la Ve République sont issues. (20 avril 2017)
_____
[1] L’opération Licorne qui a pris fin en 2015 avait été autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU.
_____
Claude Serfati: ancien maître de conférences en économie, habilité à la direction de recherches. Ses recherches principales portent sur l’économie politique de la mondialisation et l’économie industrielle. Chercheur associé à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) et au CEMOTEV (Université de Versailles-Saint-Quentin). Membre du Conseil scientifique d’ATTAC. Il a notamment publié L’Industrie française de défense (2014), Impérialisme et militarisme. Actualité du XXIe siècle (2004) et La Mondialisation armée (2001). source : http://ift.tt/2oY1Plf
0 notes