DeFacto est un blog dont l'objectif est de discuter et de partager des sujets allant de la géopolitique moderne, à des éléments historiques et économiques.
Last active 60 minutes ago
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
L’État de l’exil

77 ans après, une lecture réfléchie s'impose afin d'explorer avec attention le devenir de la question juive dans toute sa complexité et sa pérennité, tout en cherchant à appréhender l'évolution de l'État-Nation en tant que principale configuration politique de la modernité.
En effet, Il est crucial de comprendre pleinement la portée de la création et de l'expérience de l'État hébreu, ainsi que leur impact sur la conception même de l'État-nation. C'est dans cette entreprise que Danny Trom, l'auteur de "Persévérance du fait juif" (2018), s'attelle avec perspicacité dans son dernier ouvrage (2023).
Cependant, il convient de souligner que l'approche de Trom demeure limitée, étant prise au piège d'une vision étroite qui ne parvient pas à intégrer le contexte post-ottoman, colonial, puis inégalement décolonisé au sein duquel l'État hébreu a émergé. De plus, elle tend à minimiser l'effroyable réalité de la construction de cet État, marquée par l'expulsion d'une grande partie de la population autochtone et la persistance de l'occupation jusqu'à nos jours.
Il aurait été essentiel que l'auteur prenne pleinement en compte cette tragédie. De même, une comparaison avec d'autres experiences de construction état-nationale au Proche- et au Moyen-Orient, aurait enrichi son analyse et permis une meilleure compréhension des enjeux complexes qui y sont associés.
L'auteur a tendance à sacrifier tous les autres aspects au profit d'un dialogue d'idées avec Herzl et les pères fondateurs du sionisme politique puis de l'État, tout en avançant avec une incantation fervente la thèse centrale de l'ouvrage selon laquelle "l'État d'Israël hérite de la dialectique de l'exil et non de sa pure négation".
Cela peut susciter un réel intérêt chez ceux qui parviennent à peser et discerner, en arrimant conceptuellement une certaine philosophie de l'histoire du fait juif à une réflexion globale sur la permanence et le devenir de l'État-Nation.
Effectivement, malgré l'eurocentrisme conventionnel et l'obsession "herzlomane" qui caractérisent l'approche de l'auteur, celui-ci diss��que habilement ce qu'il qualifie de "procrastination constitutionnelle" d'Israël. Il analyse minutieusement comment l'assemblée constituante élue en 1949 en Israël a fini par repousser à la Knesset suivante la tâche de rédiger une constitution, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui.
0 notes
Text
Miroirs Arabes de la Pax Ottomanica.

Rares sont les historiens à avoir saisi l'ampleur de la thèse du soviétique Nikolai Alekseevich Ivanov dans son intitulé "La conquête ottomane dans les pays arabes" (Moscou, 1984). Pour Ivanov, c'est en ralliant les guildes rurales autour d'un certain discours égalitariste, d'enracinement paysan et anti-nomade, que le sultan Sélim Yavuz (le Terrible) est parvenu à unifier le plateau anatolien sous son sceptre, en refoulant le danger d'une confédération turcomane anti-ottomane.
Une telle confédération aurait soumis, en cas de consolidation et d'élargissement, l'ensemble du plateau aux cavaliers d'archers qizilbash ultra-chiites du shah Ismail.
La guerre entre les deux Empires Ottoman et Safavide, loin de s'apparenter à une quelconque résurgence de l'ancien conflit entre Byzantins et Sassanides, s'alimente d'une véritable dynamique de guerre civile anatolienne et turcomane, où le sultan Sélim a su jouer le "social" contre le "messianique".
Elle demeure néanmoins une scène de confrontation majeure entre les deux branches de l'Islam, quoique le sunnisme ottoman et le chiisme safavide allaient subir une mutuelle transformation par le biais de cette confrontation.
La victoire décisive de Sélim à Çaldiran (23 août 1514) et le sac de Tabriz, la capitale des Safavides, allaient dans le sens d'une ruine de l'hétérodoxie dans les deux camps, d'une affirmation de la prise en charge du sacré, mais surtout de la question de la légitimité de l'Empire, par les ouléma et une meilleure clôture des deux orthodoxies.
Dans cette âpre lutte avant Çaldiran, les Quzilbash célébraient dans la personne du shah Ismail l'exemplification même de l'Imam caché. Ils chantaient la gloire de leur "guide parfait" (murshid-e kamil) ayant mis fin à la période d'occultation majeure du douzième Imam.
Cette vision a été considérée comme hérétique par les prestigieux oulémas chiites de l'époque, mais elle est restée largement populaire en Anatolie, où la vénération de la mémoire du shah Ismail a été conservée jusqu'à nos jours dans la tradition confrérique hétérodoxe des Bektâchî-Alévis, historiquement hégémonique dans le corps des Janissaires.
Les Quzilbash dénonçaient le "déracinement" de Sélim. Ils critiquaient le padishah ottoman pour son oubli de ses racines turcomanes et steppiques, le rapprochant de plus en plus d'un semblant de basileus byzantin et reniant l'idéal d'un grand khan dans la bonne tradition turco-mongole. La bravoure de ces hommes coiffés de bonnets rouges, enflammés d'un farouche enthousiasme messianique, les poussait à mépriser la structure même de l'armée ottomane, composée de ces ramassis "nés chrétiens", déracinés pour servir d'esclaves militaires à un Sultan déraciné, par le biais du système de recrutement forcé, le devchirmé. Le sultanisme, dans sa notion wébérienne, c'est-à-dire, un régime de domination patrimoniale dépendant largement de l'arbitraire du chef, ne pouvait à lui seul résister à cette guerre d'unification anatolienne et de refoulement du chiisme safavide.
C'est là que la thèse ivanovienne est utile : pour contrecarrer la propagande pan-turcomane et chiite, le sultanisme devait réussir son "front commun" avec le soufisme et l'Akhisme. Les corporations de la Futuwwa anatolienne, les Akhiyat al-Fityan, bien décrites par l'explorateur maghrébin Ibn Battuta au XIVème siècle, frères de l'au-delà et de l'ici-bas, allaient ériger le Sultan en "roi des paysans" et développer une sorte de "populisme ottoman" (en référence, dans l’emploi que fait l’orientaliste soviétique Ivanov, au narodnisme, le populisme russe du XIXème siècle), expression qui a suscité beaucoup de débats dans les dernières années de l'Académie soviétique, mais sans grand écho ailleurs.
Ce populisme entretenu par le sultan et sa clientèle s'est avéré éphémère et illusoire à long terme, car il ne possédait pas les conditions nécessaires pour perdurer et évoluer. En revanche, il nourrissait les espoirs et les attentes, loin du plateau anatolien. Il a fini par converger avec un certain désir d'ottomanisation parmi les populations arabophones du sultanat mamelouk.
Ivanov repère une vision fantastique arabe préalable à la conquête ottomane de la Syrie et de l'Égypte, où l'enthousiasme religieux suscité par la prise de Constantinople (1453) se doublait d'une idéalisation d'un "règne de justice" imaginaire. Une fois que la Syrie fut conquise par les troupes de Sélim, cette idéalisation aurait poussé à une polarisation : d'un côté, les partisans enthousiastes de la "Pax Ottomanica" en terre arabe, les agriculteurs, les commerçants et les artisans, et de l'autre, les mécontents, anciens auxiliaires des mamelouks, notables des villes et bédouins. Le "sultanisme-populisme" ottoman, loin de pouvoir répondre convenablement aux "rêveries égalitaristes paysannes", devrait plutôt défendre les sociétés locales agraires ainsi que les espaces urbains contre les razzias bédouines.
La logique de l'historien soviétique peut sembler rigide et trop schématique, mais nous pensons qu'elle conserve toute sa pertinence. En la combinant avec l'approche de Bruce Masters dans "The Arabs of the Ottoman Empire" (2013), nous sommes invités à réfléchir non seulement à la conquête ottomane des pays arabes en tant que prolongement du mouvement d'unification anatolien et du "populisme ottoman", mais aussi à un processus de légitimation ottomane qui s'est accompli par l'annexion des anciens territoires du sultanat mamelouk, majoritairement arabophones.
Bruce Masters, plutôt que de considérer la question de la légitimation autour du califat, la situe plutôt au niveau d'une théologie politique soufie élaborée par l'éminent juriste Şemseddin Ahmed Kemalpaşazâde (1468-1536), juge militaire de Sélim lors de sa conquête de l'Égypte, puis titulaire de la plus haute fonction religieuse de l'Empire en étant nommé Şeyhülislam par le sultan le Magnifique, fils de Sélim.
Fervent admirateur de la mystique divine andalouse du Cheikh al-Akbar Ibn Arabi, Kemalpaşazâde avait une conviction durable : la grande synthèse entre sunnisme et soufisme devait être réalisée sur une base « akbarienne », en se basant notamment sur la doctrine de l'Unicité de l'Être, Wahdat al-wujud (Il n'y a que Dieu qui est), et son corollaire, la doctrine de l'Homme Parfait, al-Insan al-Kamil ("L'homme parfait est, selon Ibn Arabi, la parfaite image de Dieu et contient en lui toutes les choses").
L'appropriation de cette thématique de l’Insan al-Kamil a fourni au sultan ottoman une légitimation quasi-cosmique : il était l'individu le mieux disposé en son temps à se rapprocher de cet idéal de l'Homme Parfait. Le même Kemalpaşazâde, qui avait lancé un anathème sulfureux contre les ultra-chiites d'Anatolie, avait édité une fatwa moins célèbre aujourd'hui dans laquelle il consacrait la mystique d'Ibn Arabi comme source idéologique et spirituelle du régime, ou pour reprendre l'expression d'Ivanov, comme cadre référentiel du « populisme ottoman », du « populisme-sultanisme ».
S’adressant à l’ensemble des ulémas du Sultanat, Kemalpaşazâde ne tempère guère ses propos : « Ô vous, les hommes, sachez que le Cheikh suprême, le modèle le plus noble, le pôle des connaisseurs et chef de ceux qui professent la doctrine de l’Unité, Muhammad Ibn al-‘Arabî at-Tâ’î al-Hâtimî al-Andalusî, juriste inspiré accompli et excellent guide, bénéficie de vertus merveilleuses, de grâces extraordinaires et de disciples en multitude, reconnus par les savants et les personnages illustres. Quiconque est négatif à son égard se retrouve dans l’erreur et quiconque persiste dans cette attitude est égaré. Le sultan a pour devoir de le rééduquer et de l’obliger à changer de convictions, étant donné qu’il incombe au sultan l’ordre bien (admis) et l’interdiction de ce qui est négatif. »
C'est ainsi que la conquête de la Syrie et de l'Égypte par Sélim, prélude aux quatre siècles de domination ottomane de la région arabophone, s'accompagne d'une réhabilitation, voire d'une sacralisation d'Ibn Arabi.
Éminente spécialiste du soufisme andalou, Claude Addas nous rappelle toutefois que : « Le personnage ainsi honoré d'un hommage impérial n'était pourtant pas de ceux dont, à l'époque, les notables damascènes vénéraient la mémoire. Un voyageur marocain, quelques années auparavant, avait pu à grand-peine se faire indiquer l'emplacement du cimetière privé des Banû Zakî, où reposait Ibn Arabî : l'œuvre de ce dernier était alors en Syrie la cible de violentes polémiques et son auteur, frappé d'anathème, n'échappait à l'oubli que par la haine posthume qu'il suscitait chez la plupart. On s'interroge donc encore sur le motif de la fervente attention que porta Sélim à un maître spirituel dont l'enseignement était obscur et décrié : la métaphysique n'était pas son fort et sa politique n'avait rien à y gagner » (Claude Addas, Ibn Arabî et le voyage sans retour, 1996).
Un apocryphe est certes attribué à Ibn Arabî, intitulé « al Shajara al nu’maniyya fi al dawla al-uthmaniyya » (l'Arbre généalogique du règne ottoman). Ce dernier est censé prédire les hautes destinées de la dynastie ottomane, annoncer la victoire finale sur les Mamelouks et présenter le sultanat ottoman comme l'ultime et dernière puissance musulmane universelle jusqu'à la fin des temps, mais « ce grimoire a été manifestement rédigé post eventum et il est fort peu probable que Sélim l'ait connu. Il n'explique donc pas la surprenante dévotion du sultan ».
Le « sultanisme – populisme » retrouvait dans la Mystique d’Ibn Arabi une esquisse de théologie politique : le Sultan parfait est l’Homme Parfait. Cette projection sur Selim Yavuz de la catégorie de l’Homme Parfait, investit surtout dans le contraste. Le shah Ismail est salué comme « Guide Parfait » par ses fervents Qizilbach : à l’ésotérique de l’ultra-chiisme devrait répondre, non seulement un exotérisme sunnite, mais surtout un « ésotérisme sunnisé », moyennant la terminologie mystique d’Ibn Arabi. Puisque Selim Yavuz fait mine d’Homme Parfait, sa victoire sur le shah Ismail est une œuvre de démystification voulue par Dieu. Vaincu, le Shah sera ramené à la catégorie d’un guide imparfait, si ce n’est un non-guide.
Le sac de Tabriz sonnera le glas de son mahdisme, et la guidance de la communauté. Loin de transcender la période de l’Occultation majeure du douzième imam, il sera objet de polarisation et de convoitises en Iran, entre ceux qui plaident pour l’autorité théologico-politique des rois, et ceux qui plaident pour l’autorité théologique-juridique des oulémas, continuateurs et gérants du legs des Imams.
En tant que « miroitage » de cette thématique akbarienne de l’Homme Parfait, le sultan ottoman ne pouvait limiter son ambition à une simple reprise du califat. La légende d’une transmission des droits abbassides du Califat au sultan Selim Yavuz, selon laquelle le calife abbasside al-Mutawakkil III, qui tenait, comme ses prédécesseurs depuis la chute du califat à Bagdad, un rôle de figurant à la cour mamelouke, fait prisonnier après la bataille de Marj Dabiq, aurait transmis son titre à Selim, soit au Caire, soit à Constantinople, en plus des reliques sacrées du prophète, se voit démentie par l’historiographie.
Pour autant, le mythe d’une continuité califale « quoique symbolique » depuis les califes bien guidés jusqu’à l’abolition du califat par Mustafa Kemal en 1924 continue à exercer son emprise sur les esprits commémorant le drame de cette abolition, et larmoyant sur l’orphelinat de l'oumma une fois qu’elle se retrouve « sans calife ». Comme le note Gilles Veinstein dans sa contribution sur la « Question du Califat » (2006), aucune source contemporaine, ni ottomane ni arabe, ne mentionne cette transmission, véritable fiction juridique tardive, datant de la fin du XVIIIe siècle. Même plus « Les sources ottomanes contemporaines ne soufflent mot de l’existence même d’un calife au Caire ».
Quant à Mutawaakil III, déporté à Constantinople, ainsi que d’autres dignitaires mamelouks, il finira par regagner l’Égypte en 1521, après la mort de Sélim et l’avènement du règne de Soliman, et il continuera, semble-t-il, à se désigner calife, et à nourrir une double nostalgie, pour les Abbassides et les Mamelouks. Le chroniqueur Diarbekri précisera même qu’il y a toujours un calife en Égypte en 1541-1542. Le très symbolique califat abbasside du Caire allait s’éteindre donc dans la pure marginalité.
Il est arrivé à des sultans ottomans, bien avant Sélim, de multiplier les titres de gloire et de souveraineté, y compris le califat, mais jamais ce titre ne sera privilégié avant la fin du XVIIIe siècle, de même qu’il ne serait jamais « axial » avant la fin du XIXe siècle. Après la conquête de la Syrie et de l’Égypte, Sélim Yavuz devrait compléter ses titres impériaux en reprenant à son propre compte le titre de « serviteur des deux saints sanctuaires » (d’origine ayyoubide, porté ensuite par les sultans mamelouks, et depuis 1925 par le roi saoudien).
Tant que le sultanat ottoman représentait une puissance montante et en voie d’expansion, le titre de calife demeurait assez périphérique, et parfois inexistant même, parmi les titres exprimant la souveraineté du sultan padishah, Shahn shâh, Malik, Khan. Les padishah ottomans se voulaient avant tout des continuateurs de l’œuvre d’Alexandre de Macédoine puis des empereurs romains et byzantins. L’Empire ottoman s’est voulu résolument un saint-Empire romain islamique, sa réunification des territoires réunis jadis par les empereurs byzantins, sa continuation de la tradition « césaro-papiste » reposant notamment sur une étonnante symbiose entre le sultan et l'Église grecque orthodoxe, le disposaient davantage à aller dans ce sens.
Parallèlement, il revendiquait l’héritage turco-mongole de grands khans, et devrait reprendre pour le compte des deux sultans, Sélim 1er et Soliman le magnifique, le titre timouride de « Shahib Kiran », « le maître de la conjonction des Planètes » (Saturne et Jupiter), promus à la domination universelle. Le padishah ottoman est le sultan des sultans, celui qui distribue des couronnes aux monarques de la terre. Dans son histoire parallèle des trois Empires de la poudre à canon, « Islamic Gunpowder Empires. Ottomans, Safavids, and Mughals » (2011), Douglas E. Streusand, a le courage de suggérer la charge polémique de ce titre de « Sahib Qiran », en contraste avec la notion imamique du « Sahib Zaman».
L’avènement de l’ère de la « Pax Ottomanica » avec la conquête du Sultan Selim reposait donc sur un double support : le prolongement du « populisme anatolien » patronné par le padishah, idéologie du sursaut et fer de lance contre les Qizilbach, reconduit après coup contre les Mamelouks, et la réhabilitation de la Mystique d’Ibn Arabi comme matrice de la Théologie Politique du Sultan Parfait, Roi Universel et « Sahib Qiran ».
Cela dit, cette double assise de la Pax Ottomanica sera secouée et vilipendée dans le centre même du Sultanat. Au XVIIe siècle, le juriste anti-mystique Kadizade Mehmet lance l’attaque frontale contre le fondement akbarien de l’image de soi de la période expansionniste, par une campagne de diffamation haineuse contre Ibn Arabi et sa doctrine de l’Unicité de l’Être, dénoncée comme panthéisme.
Sur le plan de la longue durée, il faudrait comprendre que ce fondement akbarien du sultanat devenait dérisoire dans une période d’affaiblissement chronique des sultans par rapport à leurs grands vizirs et à la société de cour, de même que, après l’écrasement de la flotte ottomane à Lépante en 1571, l’Empire ne pouvait plus aspirer à un « Royaume Universel ». Avec l’éclipse d’Ibn Arabi et la tentation de l’Homme Parfait, un autre auteur de langue arabe maghrébin, sera revendiqué davantage comme autorité intellectuelle par les élites impériales : Ibn Khaldun. C’est en méditant sur ses Prolégomènes traduites en langue turco-ottomane, que les élites de la classe dirigeante allaient poser la question de "déclin", et chercher les conditions de résilience face au déclinisme.
Alors que la question « Comment construire un Empire Universel? » conduisait le padishah ottoman vers la Tombe d’Ibn Arabi, l’interrogation plus épineuse, « Comment sauver l’Empire? » évoluait surtout dans le sillage d’Ibn Khaldun. La Pax Ottomanica, en dépit de ses aspirations, révélait ses fissures et ses faiblesses structurelles au fil du temps.
La confrontation avec les empires rivaux, l'épuisement des ressources, et les contestations internes menaçaient son édifice. Les élites ottomanes, confrontées à la réalité de la décadence, s'éloignaient progressivement des idéaux mystiques pour se tourner vers des penseurs plus pragmatiques, tels qu'Ibn Khaldun.
Ainsi, la Pax Ottomanica, initiée par la conquête de Sélim, était une épopée complexe, mêlant des dynamiques populaires, des aspirations mystiques, des réalités politiques et des réflexions intellectuelles. Elle représente une page cruciale dans l'histoire du Moyen-Orient, où les courants idéologiques et les visions du pouvoir ont forgé le destin d'une région en mutation constante.
0 notes
Text
À propos de Koselleck, de Hartog, de Rosa, et du Kairos qui ne fait plus irruption...
1 Reinhart Koselleck est essentiellement reconnu pour son apport décisif à la compréhension de la temporalité historique, en particulier à travers son concept de Sattelzeit (époque de bascule) et sa théorie des temporalités multiples en histoire.
Son mérite fondamental réside dans l’analyse fine de l’interaction dialectique entre différentes strates temporelles : celle, brève et ponctuelle, des événements, et celle, plus lente — quoique désormais sujette à une accélération inédite — des structures.
2 Koselleck articule la relation entre événements — entendus comme des ruptures conjoncturelles, des surgissements marquants — et structures, ces formations sociales durables, institutions ou dispositifs de longue durée, qui façonnent les conditions de possibilité de l’action humaine et le sens même des événements.
L’événement constitue une discontinuité, une brèche dans l’ordre établi, souvent imprévisible, parfois spectaculaire. La structure, quant à elle, désigne le soubassement relativement stable de l’histoire, dont l’évolution est lente, mais qui assure la cohérence et l’intelligibilité du devenir. Ce qui, selon lui, caractérise la modernité, c’est une accélération conjointe : non seulement les événements se multiplient et s’enchaînent à un rythme croissant, mais les structures elles-mêmes entrent dans un régime de transformation accélérée. Cette double dynamique accentue l’historicité et complexifie la relation entre rupture et continuité.
3 Or, il me semble possible d’avancer, non sans prudence, qu’au XXIe siècle, la distinction koselleckienne entre événements et structures, aussi rigoureuse et féconde soit-elle, ne peut plus être tenue pour un socle indiscutable. Ce n’est pas tant que les structures se seraient fragmentées au point de devenir méconnaissables — une telle fragmentation, prise isolément, ne suffirait pas à invalider le modèle — mais bien plutôt parce que la temporalité de l’événement elle-même tend à se dilater, à se fondre dans un flux continu saturé d’instantanéité. Dans le schéma de Koselleck, l’événement est un point de rupture circonscrit, un surgissement singulier qui vient, à la faveur de sa nouveauté, infléchir ou perturber la continuité structurale. Il constitue l’exception, le choc, la disjonction. La structure, elle, est le « fond » historique, le plan de cohérence au sein duquel l’événement prend sens. Mais aujourd’hui, l’événement ne se présente plus comme ce point bref et délimité. Il tend à s’étirer, à devenir une expérience prolongée, saturée de commentaires, d’actualisations, de relances médiatiques constantes. L’événement n’est plus un kairos identifiable, mais une atmosphère. Il ne surgit plus : il plane.
4 Ce phénomène ne se réduit nullement à ce que Hartmut Rosa a nommé « société de l’instantanéité » ou « accélération sociale », même si ces analyses conservent une acuité certaine. Il s’agit ici d’une mutation plus profonde, dans laquelle l’événement perd sa ponctualité, sa discontinuité, sa charge de nouveauté.
Il se déploie au contraire dans une temporalité fluide, indistincte, où s’effacent les frontières entre rupture et processus, entre exception et quotidienneté. Cette dilatation trouve son origine dans la prolifération exponentielle des canaux de diffusion contemporains — réseaux sociaux, flux d’informations en temps réel, dispositifs de médiatisation ubiquitaire — où l’événement est sans cesse ressaisi, rejoué, recomposé, amplifié, voire distordu. Il devient un torrent autoréférentiel, un flux qui se donne comme événement sans jamais s’achever en événement. À la manière de l’Ouroboros, ce serpent mythique qui se mord la queue, l’événement contemporain s’étire indéfiniment, se dévore lui-même, absorbant — ou du moins redéfinissant jusqu’à l’épuisement — la structure.
5 Le temps historique se trouve ainsi bouleversé : la distinction entre événement et structure se brouille, et avec elle, notre faculté à penser le devenir historique. Chez Hartmut Rosa, cette accélération produit une forme de dissonance temporelle : compression du présent, perte de la durée signifiante, désajustement croissant entre rythme social et capacité humaine à y répondre. Mais si l’accélération sociale est bien réelle, elle ne suffit pas à décrire ce que j’appellerais une dilatation paradoxale de l’événement: celui-ci ne disparaît pas dans le flux, il s’y étend, se diffuse, se suspend, perdant ainsi sa netteté, sa singularité, sa valeur de rupture. Il ne s’agit donc pas d’une simple vitesse qui écrase le temps, mais d’un étirement du présent qui interdit toute mise à distance.
6 François Hartog, de son côté, développe le concept de "régime d’historicité" pour désigner la manière dont les sociétés se représentent leur rapport au temps — autrement dit, les configurations collectives par lesquelles passé, présent et futur s’articulent dans une conscience historique. Pour lui, notre époque est marquée par le "présentisme": un régime où le présent hypertrophié absorbe le passé — réduit à une mémoire éclatée — et le futur — relégué à l’impensé, à l’indécidable ou au suspendu. Mais Hartog demeure dans un cadre essentiellement herméneutique : il s’attache à la manière dont les sociétés se racontent le temps, dont elles le configurent symboliquement. Il interroge les récits du temps, non sa texture vécue. Son analyse reste tributaire d’une épistémologie des représentations collectives, là où je chercherais à désigner une mutation d’un autre ordre : une transformation méta-représentationnelle, qui affecte non seulement notre manière de dire ou de penser le temps, mais notre manière de le vivre, dans sa densité charnelle, dans son immédiateté perceptive.
7 Ce que je tente de mettre en lumière, c’est une transformation phénoménologico-ontologique de l’événement : celui-ci ne se manifeste plus comme une séquence localisée, dotée de signification, mais comme un flux continu, indifférencié, perpétuellement réactualisé, qui sature l’expérience, envahit la conscience, désactive le recul, empêche la synthèse. L’événement cesse d’être un éclat dans le temps : il devient nappe, atmosphère persistante, climat de présence ininterrompue. Le présent ne fait plus rupture : il pèse.
8 Dans le cadre théorique de Reinhart Koselleck, le présent n’est jamais homogène : il est traversé de part en part par des strates temporelles inégales — ce que désigne sa célèbre formule paradoxale de la « simultanéité du non-simultané » (Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen). Hérité en partie d’Ernst Bloch, ce concept est chez Koselleck profondément remanié : il vise à penser la consistance du présent comme entrelacement de temporalités hétérogènes. Ainsi, des éléments du passé persistent sous forme de longues durées, d’autres se modifient plus lentement à travers des structures, tandis que des événements surgissent de manière abrupte et imprévisible. Le présent, loin d’être univoque, se constitue comme un nœud de temporalités disjointes — un conglomérat d’âges disparates. Or cette configuration semble aujourd’hui se désarticuler.
9 L’événement, tel que l’historiographie "classique" le définit — rupture, discontinuité, irruption — tend aujourd’hui à se dilater, à perdre sa ponctualité, au profit d’un présent atmosphérique, diffus, omniprésent : un kairos devenu brouillard. Ce temps décisif, ce kairos, s’est transformé en une opacité indécidable, analogue à la vapeur qui monte aux yeux avant la mort.Dans l’Iliade et l’Odyssée, Achlys désigne précisément cette brume soudaine qui se répand sur les yeux du mourant, annonçant l’effacement progressif de la vision à l’instant fatal. Dans les Purana indiens, la notion de "brouillard obscur" joue un rôle similaire : il évoque à la fois la désolation liée à la mort et la confusion des désirs humains. Dans le Vedānta on trouve une image parallèle : celle de la transformation de l’âme en brume, métaphore de la dissolution dans un état subtil, vaporeux, reflet de l’éphémère existence post-liminaire et de l’illusion (maya) qui voile la réalité ultime.
Or aujourd’hui, l’événement ne fait plus irruption : il s’insinue, il se dilue. Il n’interrompt plus : il enveloppe. Il ne fracture plus : il diffuse. Comme la buée sur les yeux du mourant, il trouble il empêche toute prise. La vapeur est ce qui empêche le surgissement de l’événement. Ce kairos devenu vapeur ne tranche plus le temps : il le brouille.
10 Dès lors, ce n’est plus la coexistence conflictuelle de temporalités différenciées qui caractérise notre expérience historique, mais un effacement progressif de l’hétérogénéité elle-même, au profit d’un présent perpétuel, indistinct, sans dehors. Ce brouillage du temps produit une mutation inédite du régime de temporalité : la non-contemporanéité, loin d’organiser la perception historique, se trouve désactivée, dissoute dans une consistance molle, continue, indistincte.
11 Nous sommes ainsi confrontés à une alternative conceptuelle :
— soit nous vivons dans une hyper-contemporanéité, où tout coexiste sans hiérarchie ni contraste, où le temps s’épaissit mais ne se différencie plus, conduisant à une sorte d’aplatissement ontologique du devenir ;
— soit nous devons repenser la non-contemporanéité non plus comme hétérogénéité des strates historiques (à la Koselleck), mais comme disjonction entre la forme médiatique du temps et les capacités perceptives du sujet. C’est alors un désajustement d’ordre ontologique — une discordance entre la temporalité fabriquée par les dispositifs techniques et le rythme sensible de l'existence.
12 Dans cette configuration, la non-contemporanéité koselleckienne se trouve prise en étau entre deux forces opposées mais convergentes :
— d’un côté, l’hypermédiatisation de l’événement, qui en étire indéfiniment la durée et en dissout la singularité dans un flux perpétuel d’actualités ;
— de l’autre, l’émergence de régimes infrahumains de temporalité — computationnels, biologiques, climatiques — qui excèdent nos capacités de perception et de symbolisation. Ces régimes ne se présentent plus comme des temporalités lentes ou invisibles, mais comme des régularités autonomes, opérant selon des rythmes inaccessibles.
13 Il en résulte une forme de désynchronisation généralisée : entre la conscience humaine et les systèmes techniques, entre l’histoire vécue et les mutations du vivant, entre la mémoire collective et la temporalité des flux automatisés. Non seulement l’hétérogénéité temporelle ne produit plus de tension interprétative — comme chez Koselleck — mais elle devient illisible, indistincte, absorbée dans un double effacement : un présent hypertrophié, d’une part, et des régimes de temporalité non humains, d’autre part. Le temps cesse alors d’être un théâtre de dissonances pour devenir une surface opaque, saturée, qui échappe à toute historicisation.
14 Le kairos ne fait plus irruption. Le « vaporal » — terme que l’on pourrait proposer en français — ne hante pas : il empêche.
À l’inverse le spectre, tel que le conçoivent Marx (Le Manifeste) ou Derrida (Spectres de Marx), est ce qui revient sans être présent, persiste sans corps, agit sans actualité. Il est un revenant, porteur d’un passé non résolu, un fantôme de l’Histoire dont la logique est celle du retour différé, de la dette non soldée, du non-clos. Le spectre constitue une forme négative de présence, mais une présence encore structurée : il interpelle, traverse, met en demeure. Le spectral se lie à une hantise politique, à un reste qui signale une vérité enfouie ou différée, une justice suspendue.
Là où le spectral évoque une mémoire non soldée, un passé qui revient hanter le présent — figure marxienne de l’histoire comme dette ou promesse différée —, le vaporal désigne un tout autre régime : celui de l’événement dissous, rendu indistinct, évaporé dans l’atmosphère d’un présent perpétuel.
Le spectral appartient à une logique de l’irruption différée ; le vaporal, à celle de l’évaporation sans surgissement. Le premier hante ; le second englue. L’un fait signe vers ce qui fut ; l’autre empêche ce qui pourrait advenir. Le spectre interpelle la mémoire ; la vapeur dissipe toute historicité...
0 notes
Text
La complexe unicité de la Shoah .

La Shoah ne peut être attribuée à l'ensemble de la civilisation occidentale. De même, il est impératif de ne pas limiter la responsabilité au seul parti nazi, ni d'assimiler l'antisémitisme en général à l'antisémitisme radical des nazis. Cependant, il est crucial de reconnaître que l'idéologie d'extermination du national-socialisme, ainsi que sa mise en pratique, ont des origines multiples et complexes.
Tout d'abord, les Juifs ont été fallacieusement diffamés en tant que boucs émissaires pour tous les maux qui ont frappé l'Allemagne, notamment sa défaite politique après la Première Guerre mondiale. Hitler niait toute défaite militaire en 1918 et croyait que sans la présumée collusion entre le marxisme juif et la finance juive, l'Allemagne aurait pu continuer à se battre. Cependant, cela seul n'explique pas pourquoi l'antisémitisme nazi est devenu si radical.
D'autres éléments ont contribué, notamment une vision alarmiste d'inspiration darwinienne, selon laquelle les Allemands humiliés et en déclin, étaient sur le point d'être colonisés. Cela a conduit à la conclusion qu'il fallait inverser les rôles en colonisant l'Europe de l'Est et les territoires soviétiques. Cette vision s'est appuyée sur la notion de "Lebensraum" de Ratzel et l'expérience de la colonisation allemande de la Namibie, qui avait abouti à un génocide. De plus, la complicité allemande dans le génocide des Arméniens en Anatolie, perpétré par le gouvernement ottoman jeune-turc, a joué un grand rôle.
Cependant, même cette vision coloniale et cette perspective eugénique extrême ne suffisent pas à expliquer l'Holocauste. Il a fallu également une nuance dans la théorie raciale, à savoir l'idée qu'il existe une hiérarchie des races, mais que les Juifs sont en quelque sorte une non-race, une pollution raciale à éliminer pour instaurer une paix entre les races.
Les nazis n'adhéraient pas à l'idée d'une guerre interminable entre les races, mais ils envisageaient la possibilité de bâtir une paix pérenne fondée, en cas de leur victoire, sur le consentement à une hiérarchie raciale stricte, inscrite au sein d'un système de race-caste imaginaire s'étendant à l'échelle mondiale. Cet élément s'avère être un élément crucial dans la structure conceptuelle sous-jacente au motif du génocide ; néanmoins, d'autres composantes se révélaient indispensables à sa réalisation.
Un élément crucial dans la fermentation du motif génocidaire fut la confrontation entre l'antisémitisme nazi et celui découvert pour la première fois parmi les émigrés russes blancs en Allemagne, qui ont propagé l'idée du "judéo-bolchévisme", selon laquelle les Juifs, à travers le communisme, menaient la barbarie asiatique contre l'Europe et l'Allemagne.
Ensuite, cette conception trouvait un écho parmi les peuples baltes et slaves orientaux conquis lors de l'opération Barbarossa. L'antisémitisme populaire au sein de ces populations conquises considérait les Juifs comme des alliés du régime communiste ou attribuait une dimension juive au régime même. Cette passion du lynchage avait des racines profondes dans une hostilité historique envers les Juifs en tant qu'usuriers, intermédiaires, circoncis, intellectuels ainsi que dans des motifs religieux agressifs, tels que le "Déicide" et le "meurtre rituel."
Paradoxalement, l'antisémitisme populaire parmi les peuples conquis a suscité des inquiétudes chez les Allemands concernant les tendances pogromistes de leurs auxiliaires Slaves et Baltes. Cela a contribué à façonner l'industrie de la mort nazie, car dans la logique nazie, les pogroms étaient considérés comme pré-industriels dans la haine envers les Juifs et ne produisaient que de la culpabilité, des remords et un esprit juif de vengeance. Il était donc nécessaire pour les nazis de les remplacer par une logique industrielle, incarnée par les camps de concentration et les chambres à gaz.
Cependant, il subsistait une lacune cruciale en ce qui concerne la conjoncture du génocide, comblée seulement après l'entrée des États-Unis dans le conflit et la désillusion de la Wehrmacht dans les suites de la bataille de Moscou. C'est le sentiment d'être acculé entre le capitalisme anglo-saxon et le collectivisme judéo-bolchévique qui propulsera l'antisémitisme radical des nazis, en particulier des SS, à son apogée.
L'industrie génocidaire a été facilitée par la complicité d'une grande partie de la société allemande, qui préférait délibérément ignorer "les détails". De plus, de nombreux peuples conquis dans les territoires soviétiques occupés, y compris les ultranationalistes ukrainiens, ont été complices. Les nazis, ayant de plus en plus besoin de leurs auxiliaires slaves et non-aryens après 1943, ont cherché à gagner leur soutien en leur montrant qu'ils se débarrassaient des Juifs et des Tsiganes. De plus, lorsque la défaite devenait de plus en plus inéluctable, les nazis n'ont eu comme "exploit" que la destruction totale des Juifs d'Europe à présenter aux générations futures, selon leur vision.
0 notes
Text
Éclectisme...

A chaque découverte d'un article vanteur des mérites du livre numérique, je m'évade pour me rappeler d'une chose : le véritable clivage pour moi ne réside pas là, mais bien entre ceux qui s'attachent inconditionnellement à la copie Hardcover et ceux qui se contentent du paperback. Cette distinction perdure avec évidence pour les ouvrages en anglais, qu'ils soient édités à Londres, New York ou Delhi.
En français, le clivage prend une tangibilité différente, se jouant entre le grand format et les livres de poche. Et il va sans dire que je penche en faveur du hardcover et du GF lorsque cela est envisageable, sauf pour les romans, où je préfère me plonger dans l'exaltation d'une lecture en folie. Accroître mon arsenal en Pléiade revêt pour moi une importance égale à la régulation du réchauffement climatique.
Quant aux livres en langue arabe, il est vrai que depuis quelques années, je suis pleinement immergé dans le monde de l'exclusivement numérique.
En effet, la bibliophilie est une passion qui se situe entre l'amour de la lecture et l'amour de la collection. Collectionner des livres est une façon de lire et d'écrire d'une manière presque créatrice. Cela peut être considéré comme une forme démiurgique d'aménagement du monde, où l'on donne vie et projet à sa collection.
Il est indéniable que j'alterne souvent entre la lecture numérique et le plaisir de tenir le livre imprimé entre mes mains tout en parcourant les pages du même ouvrage. Nuit après nuit, je préfère plonger dans les mots sur mon téléphone, préférant cette expérience à celle sur l'iPad. Pourtant, ce qui me lie aux livres papier va bien au-delà de l'odeur et du toucher conscients, c'est surtout la possession de leur couverture, lorsqu'elle est à la hauteur, qui m'enchante.
Mais c'est également un drame, la crainte qu'à un moment donné, le livre ne s'abîme, exigeant de lui une sollicitude minutieuse. Parfois, je me retrouve à choyer un livre papier au-delà du nécessaire, pour ensuite me tourner vers son édition numérique, qui, je l'avoue, ne gémit ni ne souffre, mais cela n'est en rien un compliment à mes yeux.
Les livres numériques sont trop transcendantaux pour moi, mais je les utilise quand même! Ensuite, c'est le principe d'individuation qui fait que ce livre est ce qu'il est et non autre chose. Dans mes logiciels, avec des milliers de livres électroniques et de PDF, j'ai davantage l'impression qu'ils font tous partie d'une même matrice.
0 notes
Text
Tensions anthropologiques 2
Parmi toutes les phrases intrigantes, paradoxales, aussi simples que labyrinthiques, aucune n'égale la manière dont Claude Lévi-Strauss entame les "Tristes Tropiques" (1955): "Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions."
Parfois, je suis tenté de croire que cette ou ces deux phrases divise la pensée humaine en un avant et un après.
En effet, cette déclaration suscite plusieurs interrogations : Serait-ce un rappel de la fatigue ressentie ou une attitude épuisée face au travail de terrain ? Reflète-t-elle un regret du temps de la prédation ou un dégoût rappelant celui du voyeurisme ? Un embarras lié à la notion même du fieldwork gommant le temps même du travail entrepris, le temps perdu, y compris celui qui s'écoule dans la quête de ce terrain même, temps jamais plus répertorié dans la collecte des résultats ?
Peut-être est-ce une réponse à l'auteur des "Argonautes du Pacifique occidental" (1922) et à sa chère notion quasi-magique d'observation participante ? Peut-être est-ce une manière de faire sentir la monotonie de l'observation répétitive une fois l'exotisme éclipsé et la théorie non encore esquissée ?
S'agit-il d'une distance critique ou d'une mise à distance de la critique ou d'une nostalgie envers l'ère de l'anthropologie de cabinet ? Ou plutôt est-ce la justification d'un retour réfléchi au cabinet après l'achèvement de l'épreuve du voyage et après avoir trimé sur le terrain?
Peut-on écarter les circonstances exiliques liées à l'occupation et à la guerre ? L'exilé confronté à l'exotisme n'ouvre-t-il pas la voie au chant de l'exode et à l'errance?
Serait-ce une aversion envers l'exotisme, du moins en tant que notion digne d'un cocktail "Barbar" ou plutôt une expression de la rareté de l'exotisme, de son extinction, de la difficulté de le trouver, alors qu'il demeure oniriquement merveilleux dans son statut d'inconnu, suscitant le désir de l'introuvable, non seulement de l'inconnu ou du non-familier?
Peut-être est-ce un subtil mélange de toutes ces possibilités ou peut-être aucune d'entre elles ? En amorçant les "Tristes Tropiques" par une détestation avérée des voyages, est-ce uniquement le voyage de l'ethnologue qui est concerné, ou cela concerne-t-il également ce qui lie ces Tropiques à la tradition du "voyage philosophique" en premier lieu?
Cependant, ce qui m'interpelle davantage, c'est ce que CLS expose une trentaine de pages plus loin : "Le rêve, "dieu des sauvages", disaient les anciens missionnaires, comme un mercure subtil a toujours glissé entre mes doigts. Où m'a-t-il laissé quelques parcelles brillantes ?" Il affirme alors que c'est insidieusement à ce moment-là que "l'illusion commence". Illusion ou désir, ou peut-être les deux simultanément ? Un aveu de naïveté, une soif d'éclat, ou plutôt, dans le cas de l'ethnologue, un enchantement qui se désenchante de manière tout aussi enchanteresse.
Et ici, CLS soulève en passant une question astucieuse et fondamentale à mes yeux : "Quand fallait-il voire l'Inde, à quelle époque l'étude des sauvages brésiliens pouvait-elle apporter la satisfaction la plus pure?" Bon, ceux qui ne sont pas familiers avec le style de CLS et son époque peuvent partir, laissant aux autres le soin de comprendre ce qu'il entend par "le cercle infranchissable", "moins les cultures humaines étaient en mesure de communiquer entre elles et donc de se corrompre par leur contact, moins aussi leurs émissaires respectifs étaient capables de percevoir la richesse et la signification de la diversité." Il s'avoue prisonnier d'un dilemme: "tantôt voyageur ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont tout ou presque lui échappait - pire encore inspirait raillerie et degout; tantôt voyageur moderne, courant après les vestiges d'une réalité disparue. Sur ces deux tableaux je perds et plus qu'il le semble." il est important de noter qu'au niveau de cet extrait, la perte de réciprocité dans le saut vers l'expérience du voyageur moderne n'est pas explicitement soulignée.
0 notes
Text
Tensions anthropologiques..
Ce qui m'a tant passionné dans la tradition anthropologique, c'est la possibilité de voyager à travers les récits d'ethnographes et d'ethnologues, et de m'immerger dans leurs observations participantes.
Malgré les débats entourant cette notion d'immersion et son potentiel de manipulation, notamment les critiques adressées à Bronisław Malinowski (1884-1942) pour sa supposée complicité avec la supériorité coloniale, ses travaux restent essentiels pour comprendre la circulation du Kula et explorer la sexualité dans les îles Trobriands. Le grand mérite de Malinowski est d'avoir fait voler en éclats l'universalité du complexe d'Œdipe freudien.
De même, le livre "Coming of Age in Samoa" de Margaret Mead (1901-1978) m'a transporté dans le monde des adolescentes samoanes, qui, selon ses recherches, connaissent une période de transition relativement calme et sans conflit, remettant ainsi en question les normes occidentales de l'adolescence tumultueuse. Plus tard, ces travaux ont été remis en question et elle s'est fait accuser de vouloir prêcher dans sa paroisse en manipulant les jeunes samoanes pour qu'elles disent ce qu'elle voulait entendre.
Or il en est ainsi dans la tradition anthropologique, avec ces écoles fondatrices, de l'évolutionnisme au diffusionnisme, du fonctionnalisme au structuralisme, sans oublier le culturalisme. Des travaux et des contre-travaux émergent, dans lesquels le travail de terrain est de moins en moins à l'abri de la modernisation et de l'occidentalisation. Cependant, le terrain demeure propice à un effort continu pour élargir l'universalisme en le diversifiant, et pour surmonter le fossé entre l'anthropologie et l'écologie, en offrant de nouvelles approches moins rigides quant aux dualités entre nature et culture, histoire et nature, histoire et culture.
Il en va ainsi des thèses exposées dans "Patterns of Culture" de Ruth Benedict (1887-1948), qui examine les différences culturelles à travers une comparaison de trois cultures distinctes (les Zuni, les Dobu et les Kwakiutl). Elles ont défié toute conviction envers l'universalisme hérité des Lumières.
Par contre, les travaux de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) sur les Bororo, une tribu amérindienne vivant en Amazonie, ont permis d'explorer leur organisation sociale, leur système de parenté, leurs pratiques religieuses et leurs structures sociales. CLS a également réalisé des recherches parmi les Nambikwara, un groupe indigène du Brésil, portant sur leur organisation sociale, leur cosmologie, leur système de parenté et leur art.
Mais ce qui me retient chez lui, c'est une fois de plus cette question de la manipulation, cette fois-ci non plus la manipulation de la société étudiée par l'observateur participant qui y intervient, mais l'accusation lancée par CLS à Marcel Mauss (1872-1950) concernant l'explication de l'énigme du don. Selon CLS, Mauss s'est complètement laissé berner par le sorcier de la tribu, qui prétendait que le don circulait en raison d'une mystérieuse force magique présente dans l'objet offert, récupéré et renvoyé. Lévi-Strauss reproche à Mauss de se laisser mystifier par les magiciens indigènes qui, chaque fois qu'ils doivent justifier des événements qui leur semblent inexplicables, font appel au "mana" comme à un signifiant flottant qui entrave une compréhension plausible de la chose.
Après tout, je parle de l'anthropologie comme d'une tradition, tout comme de la philosophie, de la sociologie, et même du marxisme, bien que je ne sache pas jusqu'à quand je vais continuer à coexister avec cette notion de tradition savante. Cependant, je préfère faire une distinction entre les "traditions savantes" plutôt qu'entre les "disciplines" ou entre les "discours".
Eh bien, dans cette tradition anthropologique, le grand mérite a été de mettre en exergue mais aussi en tension la radicalité des échanges entre les humains.Ainsi, le tournant levi-straussien a consisté à interpréter l'interdiction de l'inceste comme un mécanisme de don. Je te donne ma sœur, je reçois ta sœur. En revanche, le mérite de Maurice Godelier (1934 - ) a été de prendre ses distances par rapport au pouvoir absolu de l'échange en anthropologie, au danger de tout ramener à un phénomène d'échange.
Après tout, c'est ce qu'on appelle le marxisme : la détermination des relations d'échange par les relations de production, par les conditions de reproduction d'un groupe, d'une collectivité, d'une société, de l'humanité. En tout cas, ou du moins ne pas réduire la complexité de la reproduction sociale aux seuls paradigmes de l'echange.
Actuellement, je suis en train de lire le dernier livre de Godelier , intitulé "Quand l'Occident s'empare du monde XVe - XXIe siècle : Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ?". Dans cet ouvrage, Godelier explore son parcours d'anthropologue en l'articulant avec l'histoire globale, tout en proposant des réflexions sur l'avenir, y compris à long terme. Il s'agit d'une œuvre d'une remarquable fraîcheur mais aussi d'une sage vieillesse. L'auteur a 89 ans.
Godelier, lui aussi, a effectué des travaux sur le terrain dans des contrées lointaines. Dans tous ses livres, il revisite son travail de terrain chez les Baruya, une tribu papoue de Nouvelle-Guinée. Là-bas, il a mis en évidence les rituels et les pratiques associés à la construction de la masculinité et à l'exercice du pouvoir masculin, ainsi que les conséquences de cette domination sur les femmes et les relations de genre.
Il a découvert chez les Baruya une société sans classe, quoique fortement inégalitaire. Il a articulé les processus de production avec l'échange. S'est arrêté notamment devant ce qu'il désigne comme le "grand homme" de la tribu. Soit dit en passant, la domination masculine chez les Baruya nécessitait une séparation des garçons et des filles entre 9 et 20 ans, ainsi que leur entraînement dans la forêt aux côtés des adultes, avant que le garçon atteigne l'âge de 20 ans et ne soit considéré comme mature, prêt à choper une nana au sein de sa tribu.
Je n'ai jamais pu me restreindre à une seule tradition savante. Je préfère plutôt être un nomade, évoluant entre l'anthropologie, la philosophie, la philosophie politique, l'histoire des religions.
En revanche, l'anthropologie, loin de se limiter à des collectivités isolées ou en repli par rapport aux sociétés plus larges, ou ensuite par rapport aux vagues successives de la modernisation, de la capitalisation, de la déforestation, a considérablement enrichi la théorie critique du capitalisme et a étudié les répercussions de la modernisation, de la bureaucratisation, de la marchandisation, de la monétarisation puis de la financiarisation, dans les cultures les plus éloignées et les plus diverses.
En même temps, elle s'est également penchée sur les retours inestimés du tribalisme, je dirais même du tribalisme trans-moderne, ainsi que sur la résilience différenciée du chamanisme et les modalités inépuisables du réenchantement du monde.
Non loin de la pertinence du perspectivisme amérindien de l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro (1951 - ), qui insiste que l'étude des peuples autochtones de l'Amazonie ne doit pas se limiter à l'exploration d'une culture, mais doit également inviter à une découverte d'une pensée profonde qui se renouvelle chez ces peuples sur le commun, la vie en communauté, et sur notre rapport à l'environnement. Ira-t-on jusqu'à chercher chez ces autochtones une "théorie critique" voire "révolutionnaire" alternative face à l'échec du marxisme? À un certain degré, oui, il est prudent de se contenter de cette approximation.
Ce qui m'intrigue également, c'est la transition qui s'opère dans le domaine de l'anthropologie, passant d'une complicité avec l'impérialisme et le racialisme euro-occidental à une approche visant à décoloniser la tradition anthropologique, pour ensuite s'attaquer à la décolonisation à grande échelle de ce qui reste encore à décoloniser dans ce monde.
Il est fascinant de noter que, curieusement, l'Union soviétique était très méfiante à l'égard de la sociologie, tandis qu'elle se montrait au contraire très accueillante envers l'anthropologie, qui conservait dans l'académie soviétique le nom d'ethnographie. L'ethnographie soviétique a apporté une contribution significative, notamment dans les études sur le nomadisme et le chamanisme. Malheureusement, ses découvertes restent souvent peu connues en dehors de l'ancien espace soviétique et en dehors de la langue russe.
Le fondement du regard ethnographique et anthropologique était en premier lieu l'ouvrage de Friedrich Engels (1820-1895), "L'Origine de la Famille, de la Propriété Privée et de l'État" (1884). Quoi qu'on puisse dire de ce livre qui est une compilation et une synthèse datant du XIXe siècle, puisqu'il prenait pour argent comptant le concept du communisme primitif et du matriarcat.
Plus tard dans ma vie, j'ai réalisé que Engels manifestait un intérêt particulier pour les caractéristiques spécifiques de chaque peuple, ce qui contrastait avec l'approche rigide basée sur les classes sociales. On retrouvait chez Engels un peu de l'approche des "Patterns" de Ruth Benedict. De plus, Marx et Engels ont abordé de manière complexe et changeante l'articulation et l'interaction entre l'analyse de classe et l'ethnicité.
Mais mettons de côté Marx et Engels pour le moment. Il est vrai que la tradition anthropologique était initialement étroitement liée à l'impérialisme, au colonialisme et à la théorie des races. Cependant, au fil du temps, elle s'est engagée dans un processus de décolonisation interne, ou du moins elle a vécu la décolonisation comme une épreuve interne, comme une tension créatrice, développant ainsi des outils d'exploration et d'inspiration qui ont contribué ou qui devrait contribuer à la théorie critique du capitalisme et de l'impérialisme.
Je dois avouer que je suis davantage attiré par cette perspective anthropologique au sein de la théorie critique, qui aborde l'impérialisme et le capitalisme, plutôt que par l'approche anti-néolibérale de la sociologie contemporaine qui me paraît assez mécanique.
Cependant, il est essentiel de distinguer les contributions anthropologiques qui enrichissent réellement la théorie critique de celles qui s'égarent dans un anti-capitalisme de type "new age"...
En revanche, je ne suis pas quitte avec l'autre retournement de situation dans la tradition anthropologique. Je fais allusion à la tendance à délaisser l'anthropologie du lointain pour privilégier l'anthropologie du proche, mettant ainsi l'accent sur l'étude ethnographique de sujets plus familiers, tels que l'épicier au bas de ton immeuble ou les liens de parenté dans ta propre famille.
Je ne suis pas en mesure de répudier tout un paradigme, mais je dois admettre que cela n'a pas le même impact sur moi que les récits sur les Brororo et les Baruya, par exemple.
Ce qui m'intrigue davantage, c'est la justification donnée à ce changement de perspective, passant du lointain au plus proche. On prétend souvent que cela évite de sombrer dans l'exotisme, mais je pense que ce n'est pas un argument convaincant. C'est un peu comme chercher des Baruya au Starbucks du coin.
En fait, je préfère un aller-retour entre l'anthropologie du lointain et du proche, mais surtout pas une anthropologie qui se limite à sa propre tribu.
Et que dire du monde d'aujourd'hui ? Dans ce monde qui semble se re-tribaliser, peut-être aurons-nous des tribus où chaque groupe aura son économiste tribal, son intellectuel organique tribal, son specialiste des RI tribal et son anthropologue tribal, à la place des magiciens d'autrefois.
0 notes
Text
Nationalisme contre état nation .
1 La tension entre nationalisme et État-nation constitue l’une des clefs d’interprétation des contradictions inhérentes à la modernité politique.
2 Le nationalisme, en tant qu’idéologie, postule une communauté homogène fondée sur une identité culturelle, linguistique ou ethnique, tandis que l’État-nation, en tant que construction politique, s’ancre dans un cadre institutionnel souvent hétérogène, modelé par l’histoire, les contingences du pouvoir et l’élaboration, la pérennisation et le renouvellement des consensus patriotiques et citoyens.
3 L’État-nation moderne, fondé sur le mythe historique dit « westphalien », s’est généralement édifié sur des territoires où coexistaient des groupes aux identités plurielles. Pour assurer son unité, il a soit cherché à homogénéiser ces populations par l’éducation, la langue et la centralisation, soit intégré leur diversité dans des dispositifs plus souples, tels que le fédéralisme ou le multiculturalisme.
4 Le nationalisme, en revanche, tend à essentialiser l’identité nationale et à en faire le principe souverain de la légitimité politique. Il rêve d’accomplir son propre État-nation, mais il se rend vite compte qu’il doit mener une ingénierie accélérée et frénétique pour faire exister la nation qu’il désire. Si la conjoncture ne lui facilite pas la tâche, il court le risque de devenir prisonnier de son propre irredentisme, jusqu’à en périr.
5 Ainsi, le paradoxe central de la modernité politique réside dans le fait que l’État-nation, censé être l’aboutissement du nationalisme, se trouve également fréquemment fragilisé par lui. Cependant, tous les nationalismes ne se valent pas. Il en existe qui cherchent à éviter le conflit avec la logique de l’État-nation, ou qui se présentent même comme le reflet de l’État-nation en place : sa conscience de soi, sa manière de gérer la diversité, et son caractère. D’autres, en revanche, en s'acharnant à dessiner des cartes fantaisistes de leur territoire national unifié désiré, ne réalisent même pas à quel point ils rejettent en réalité l’idée même d’État-nation, oscillant entre clanisme et mégalomanie impériale.
dès lors que des revendications identitaires viennent contester sa logique unificatrice.
6 Le cas turc est particulièrement fascinant : son nationalisme repose sur une fusion inédite des conceptions française et allemande de la nation. À l’instar du modèle français, il a imposé une identité nationale unifiée par la langue, l’éducation et un État centralisé, niant la diversité ethnique et culturelle héritée de l’Empire ottoman au profit d’un récit homogène structuré autour de l’identité turque. Cependant, il a également intégré une dimension organiciste, à la manière du modèle allemand, définissant l’identité turque sur des bases ethno-culturelles, exaltant une essence prétendument ancestrale et construisant un récit national fondé sur la glorification d’un passé mythifié. Cette approche racialiste s’est traduite par des politiques d’exclusion et de purification ethnique, notamment à travers les massacres et déportations visant les populations non turques (génocide arménien, échanges de populations avec la Grèce, répression des Kurdes). Cette double logique, à la fois assimilationniste et exclusive, éclaire la radicalité du nationalisme turc, irrémédiablement "jeune turc".
Toutefois, au-delà de la fusion franco-allemande poussée à l'extrême, le nationalisme turc se révèle aussi bien tribal ou clanique que porteur d’une mégalomanie impériale.
7 C’est précisément ce qu’Öcalan a saisi sur le tard : si le nationalisme turc repose sur une fusion brutale entre jacobinisme et organicisme, le nationalisme kurde, quant à lui, doit s’éloigner autant du jacobinisme que de l'organicisme. Mais cela ne signifie pas pour autant l’abandon de tout nationalisme. Il s’agit plutôt de la construction d'une "république invisible", au-delà des découpages, des entités territoriales consacrées.
8 Pour en saisir la portée, il convient de se remémorer la notion d’église invisible. Dans cette conception théologique traversant plusieurs courants du christianisme : "L'Église invisible est la véritable Église, que seul Dieu peut voir." Les Frères de la Pureté (Ikhwan al-Safa), quant à eux, évoquent l'État invisible : دولة أهل الخير L'État des vertueux. Öcalan me semble effectivement avoir saisi la puissance matérielle des virtualités à l'âge numérique, la dialectique du visible et de l'invisible.
9 Évidemment, il semble pleinement appréhender les impératifs de la conjoncture géopolitique, mais une telle constatation reste insuffisante. Subordonné aux pressions du moment, il franchit un seuil à la fois délicat et troublant, tant pour les siens que pour les kurdophobes : celui de l'édification d'une république populaire, invisible et transfrontalière.
10 "Clandestins, devenez invisibles". Tel me paraît être le message d'Apo à tout un siècle.
0 notes
Text
Embrasement Régional : Guerre Algéro-Marocaine 2025,
Anatomie d'un scénario .
Est-on jamais réellement préparé au scénario du pire ? S’agit-il d’une question de préparation, de budget, de stratégie, ou est-on simplement à la merci des circonstances ? Les variables infinies du champ de bataille et des individualités induisent une part de hasard qui limite forcément nos capacités d’anticipation.
À quoi servira à l’avenir d’imaginer le pire si l’on est incapable de se rendre compte de ce qu’il advient ? Quand vous êtes en guerre, quel meilleur moyen de ne pas avoir à combattre que de persuader votre adversaire que le conflit n’existe pas ? .
Pour s’en rendre compte, il faut mesurer l’ampleur des périls qui nous entourent, sans verser dans la paranoïa. C’est à cela que servent les exercices de prospective, si périlleux soient-ils. Mais y songer présente plusieurs vertus : montrer l’importance de la « résilience » d’un État, évaluer ses forces, identifier ses faiblesses. Le tout pour tenter d’éviter les « ruptures stratégiques » qui mettraient en difficulté l’armée marocaine. Comme toujours, espérer le meilleur… tout en se préparant au pire.
L’article que vous vous apprêtez à lire vous propose une version d'un conflit à venir, avec des variables définies pour permettre d’engager une intervention cinétique maximale de l' armée marocaine .
Tout commence par des escarmouches dans l’ouest du Sahara. Les tensions entre Rabat et Alger, qui se sont déjà aggravées depuis la coupure des relations diplomatiques entre les deux pays à l’été 2022, n’ont fait qu’empirer.
Les deux pays sont arrivés à une dégradation telle de leurs relations, allant même jusqu’à une rupture de leurs relations diplomatiques, que l’on ne peut rien exclure . Par ailleurs, le conflit israélo-palestinien change à nouveau la donne dans la région : il unifie les Algériens autour d’un sujet très fédérateur, tout en fragilisant le Maroc en raison de ses liens avec Israël .
Le 15 juin , des blindés algériens T‑90SA occupent l’oasis de Figuig. Le territoire, ancré entre le Maroc et l’Algérie, est un haut lieu de tensions entre les deux pays. Des militaires bloquent désormais le passage des cultivateurs de dattes marocains, qui cheminent quotidiennement à cet endroit pour rejoindre leurs vergers.
À l’inverse des crises précédentes – la frontière est fermée officiellement depuis 1994 mais un laissez-passer existe pour les agriculteurs –, l’armée algérienne n’aurait donné aucune indication avant son intervention. Aux premières heures du conflit, la confusion règne : s’agirait-il d’une initiative d’une simple faction de militaires, indépendante du pouvoir ?
Le soir de cette intervention, Alger reconnaît pourtant la présence de ses soldats dans l’enclave. Elle explique vouloir répondre aux manquements des exploitants agricoles pour « sécuriser sa frontière alors que des bandes criminelles organisées déstabilisent la région. Ces déclarations sont vivement contestées par les agriculteurs, qui en appellent à Rabat. La tension s’accroît quand, deux jours plus tard, l’agence marocaine de presse (MAP), proche du pouvoir, explique que des militaires algériens seraient entrés dans la ville d’El Khabta. Le Maroc menace de sévir y compris militairement , si les producteurs de dattes ne sont pas libérés .
Pendant plusieurs jours, le statu-quo demeure, une « marche verte » étant organisée par les cultivateurs dans l’oasis. Mais le 20 juin, alors que le soleil s’abîme dans la Méditerranée, une détonation déchire le désert. Deux militaires sont blessés et un autre est tué dans ce qui ressemble à un attentat-suicide commis par un cultivateur. Alger se fait menaçant et affirme que cette attaque ne restera pas impunie . La situation dégénère alors que les journaux algériens rapportent des mouvements proches de la frontière .
Le 22 juin, une unité de 35 soldats algériens s’introduit en territoire marocain au petit matin. Des coups de feu sont échangés à la frontière. Le bilan est lourd : 3 soldats marocains sont tués, et 11 blessés tandis que 4 morts et 18 blessés sont à dénombrer du côté algérien. À la mi-journée, en dépit du ballet diplomatique qui s’est mis en place ces derniers jours pour calmer les deux puissances régionales, l’escalade se poursuit : Rabat dénonce une intrusion inadmissible qui menace l’intégrité de son territoire . Le roi ne se privera pas de répliquer. Dans un engrenage qui rappelle douloureusement les événements de 1963, en ce 22 juin 2025, l’Algérie et le Maroc entrent en guerre.
De l’autre côté de la Méditerranée, Paris assiste, impuissant, à la concrétisation d’un conflit craint en haut lieu depuis plusieurs décennies.
Les tensions entre l’Algérie et le Maroc sont à l’évidence un sujet de préoccupation pour la France qui suit cette situation avec la plus grande vigilance .Il est difficile d’imaginer qu'une guerre entre le Maroc et l'Algérie n’ait pas de conséquences d’ordre politique et socio-économique sur la France .
Des déplacements de populations accompagnent souvent les conflits qui durent. Comme ses voisins espagnol et italien, la France sait que celui qui est en train de se nouer entre Alger et Rabat risque de bouleverser une situation déjà complexe. Mais, pour l’instant, l’exécutif est comme paralysé.
Voyez ce qu’il s’est passé en 2020, quand le Hirak s’est constitué en Algérie . Paris était déjà tétanisé alors qu’il ne s’agissait “que” d’un mouvement civil et pacifique. Imaginez l’ampleur de la tétanie si l’on se retrouve face à une guerre aux portes de la Méditerranée.
Paris se garderait bien de prendre position entre les deux pays, ne serait-ce qu’en raison des diasporas algérienne et marocaine présentes en France. Des tentatives de médiation seraient perçues comme de l’ingérence et donc, quelque part, comme un retour du refoulé de la colonisation.
Dans cette situation inextricable, Bruxelles n’est d’aucun secours. Si l’Union européenne et son Parlement condamnent toute escalade entre le Maroc et l’Algérie, aucune décision substantielle n’est prise dans la foulée, malgré l’insistance de Paris pour une solution de médiation animée par les équipes de Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.Cette option est vue par les Français comme le meilleur moyen de trouver un interlocuteur « neutre » dans le conflit, délesté du poids de l’histoire qui freine Paris. Mais cette demande reste lettre morte.
Les Européens ont tendance à penser – comme Washington d’ailleurs – que l’Algérie et le Maroc sont encore quelque part un problème du ressort de la France. Il y avait toujours une espèce d’attentisme des autres chancelleries, qui regardaient d’abord l’attitude de Paris avant de réagir .
Sur le terrain, pourtant, la situation se dégrade rapidement. Le 2 juillet, l’armée algérienne reprend le village d’Ich, enclave marocaine dans la région de Figuig. Les observateurs internationaux estiment que la guerre des Sables se rejoue sous leurs yeux. Mais la différence avec le conflit des années 1960 est de taille : il ne s’agit plus de pays venant à peine de reprendre leur indépendance, faisant s’affronter deux armées mal équipées. Leur budget militaire a considérablement augmenté au cours des dernières années.
En 2023, l’Algérie a alloué plus de 22 milliards de dollars à sa défense, le double de ce qu’elle lui avait consacré en 2022. La défense est désormais le premier poste budgétaire du pays. Le budget moindre du Maroc – 12,2 milliards de dollars – est toutefois renforcé par des achats d’équipements militaires, notamment aux États-Unis.
En avril 2023, Rabat a ainsi demandé à acquérir l’équivalent de 250 millions de dollars d’équipement militaire américain, avant de réaliser avec ce pays des exercices conjoints. Les sommes consacrées aux armées ne sont pas les seuls indicateurs de l’intérêt militaire porté aux deux pays. Désormais, Maroc et Algérie sont deux forces militaires aux alliés puissants et qui se jaugent.
Certains ingrédients présents aujourd’hui n’existaient pas il y a deux ans. Le conflit en Ukraine a solidifié les alliances du Maroc avec les États-Unis et de l’Algérie avec la Russie. Par ailleurs, les accords d’Abraham signés par Trump ont mis les États-Unis et Israël dans le camp marocain. Ajoutez à cela les tensions habituelles au sujet du Sahara occidental.
Déjà, des vagues de réfugiés commencent à se presser sur les rivages de la Méditerranée. La crainte d’une déstabilisation globale de la région se fait sentir, alors que les groupes armés dans le sud du Sahara bénéficient de la baisse de vigilance des armées algérienne et marocaine. La Tunisie, refusant de voir arriver des réfugiés d’Algérie ou du Sahel, ferme complètement ses frontières.
En France, on s’écharperait sur les plateaux télé dans des débats sans fin sur la politique d’asile. Des tribunes d’artistes seraient publiées dans la presse. En résumé, vous auriez un débat affectif, mettant l’accent sur la composante morale, alors que l’on traite d’un conflit guerrier. Désemparés, les pays européens du sud de la Méditerranée tentent chacun d’ouvrir, sans succès, des canaux de communication avec Alger et Rabat.
Une initiative française semble néanmoins se dégager : Paris, Rome et Madrid proposent de mener une médiation à trois voix entre les deux capitales. Cela serait sans doute le seul moyen d’enlever la charge historique qui pèse sur la France .
Tandis que le conflit fait rage sur le terrain, le sommet des trois parvient à réunir les dirigeants algériens et marocains autour d’une table le 23 juillet. Ce succès de la diplomatie de l’Europe du Sud est présenté comme une victoire en soi par les médias italiens, français et espagnols.
Mais le triomphe est de courte durée. L’armée marocaine, en défense, parvient à tenir ses positions malgré le manque de soutien en équipement des alliés américain et israélien, peu désireux de s’engager dans l’engrenage du conflit. L’Algérie, qui jouit pourtant d’un équipement militaire extensif, souffre d’importants problèmes logistiques. Les munitions livrées par la Russie, éprouvée par la guerre en Ukraine, sont rares. Le 4 août, deux chasseurs bombardiers Su-34, livrés à l’Algérie par la Russie en début d’année, sont interceptés par le système de défense missile sol-air israélien. Ils s’écrasent non loin de la frontière, côté marocain. L’un des quatre pilotes, toujours vivant, est capturé et présenté à la presse. Le Maroc menace de rompre ses relations diplomatiques avec la Russie, mais l’embarras est avant tout algérien.
Alors qu’elle est en position délicate – son armée étant plus affectée que prévu –, l’Algérie subit un sabotage de pipeline. La communauté internationale peine à en identifier le responsable mais en accuse le Maroc, et réfléchit à appliquer des sanctions économiques. Pour inverser la balance diplomatique, Alger décide de couper l’approvisionnement en gaz de tous les pays soutenant le Maroc. La Tunisie, soucieuse de ne pas avoir de problèmes avec son voisin, finit par donner sa préférence à Alger. L’Italie, handicapée par le blocus énergétique algérien, est bien moins proactive qu’auparavant dans l’opération de médiation européenne qui ressemble de plus en plus à un cul-de-sac.
En France, on regarde d’autant plus la situation dégénérer que l’on craint une exportation du conflit sur le territoire national. Les services marocains ont été très actifs sur le sol français pour faire passer des messages ces derniers temps. Il n’est pas exclu, dans la mesure où les familles des dignitaires des deux pays ont des maisons en France, des enfants qui vont à l’école en France, que des événements puissent avoir lieu dans l’Hexagone. D’autant que les deux pays pourraient avoir leur carte à jouer.
Un régime algérien aux abois peut être tenté de jouer la surenchère en direction des pays dans lesquels il a une forte communauté : en Espagne, en Belgique, et évidemment en France , Le risque pour la France d’une guerre Algérie-Maroc serait celui de son exportation sur le territoire français.
Les plateaux télévisés transpirent d’une crainte d’abord murmurée, puis avouée à haute voix : celle d’un affrontement communautaire entre descendants d’Algériens et de Marocains, qui aurait particulièrement lieu dans les banlieues françaises. Les forces de police et de gendarmerie sont sur le qui-vive. Le ministre de l’Intérieur, bien que se voulant rassurant, annonce prêter la plus grande attention à la situation. Mais, en dépit des prévisions les plus sombres, peu de tensions éclatent dans l’Hexagone, en dehors de quelques incidents isolés en Île-de-France et dans le Sud.
Dix jours plus tard, le conflit devient sanglant et tourne court. Une incursion de blindés algériens près d’Oujda, capitale de l’est du Maroc, se solde par un échec retentissant. Les Marocains détruisent une quinzaine de chars de bataille algériens. Alger dénombre 30 morts dans ses rangs, quand les pertes de Rabat restent basses. En dépit de leur supériorité technique, les Algériens sont en grande difficulté.
Un cessez-le-feu est établi entre les deux pays grâce à la médiation de l’Égypte. Mais le soulagement collectif est de courte durée.
Conséquence de cette défaite, le régime algérien est fortement fragilisé. Après une telle conclusion du conflit, un régime comme celui en vigueur aujourd’hui en Algérie serait chancelant. Il y aurait le risque qu’il devienne aussi paranoïaque que fragile. Cette fragilité est d’autant plus prégnante qu’un régime militaire est aujourd’hui en place en Algérie.
En règle générale, les pouvoirs militaires ont du mal à se relever des défaites. Regardez les conséquences de la guerre des Malouines, qui a entraîné l’effondrement de la dictature argentine. Si une nouvelle génération domine la vie économique du pays, le pouvoir politique est encore entre les mains de l’armée, qui représente 12 % du PIB national. Un record mondial. Le changement a des conséquences directes sur les ressortissants de l’Algérie, mais aussi sur son voisin méditerranéen français. Fragilisé, le pouvoir est contesté par des factions politiques hostiles à la France, qui présentent Paris comme un ennemi à combattre pour parvenir à l’unification d’une nation algérienne fracturée.
La situation s’envenime dans la région occupée par les Kabyles, dans le nord de l’Algérie. Des militants du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) voient dans l’affaiblissement du pouvoir l’occasion de revendiquer l’indépendance. Depuis Paris, une association luttant pour l’indépendance de la Kabylie encourage l’organisation d’élections dans la région. Son président se déclare candidat, et encourage les Kabyles vivant dans l’Hexagone à prendre part à la campagne et au scrutin. Lorsqu’un mouvement de contestation populaire éclate, les plus hauts gradés accusent Paris de l’instrumentaliser à son profit. Le 18 novembre, le gouvernement algérien annonce avoir déjoué un attentat du MAK, pourtant contesté par ce dernier. Le ton monte, et Alger décide de prendre des mesures pour éviter tout débordement.
On peut très bien imaginer une fraction de l’armée et des unités indépendantes qui feraient sécession et décideraient de provoquer le Maroc, la France et même l’Espagne. Ça ne veut pas dire entrer dans une guerre entre Alger et Paris mais dans des accrochages militaires qui peuvent venir compliquer la donne intérieure .
Le 8 septembre, plusieurs attentats sont menés sur le territoire algérien. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), filiale d’Al-Qaida, revendique l’attaque. Face à cette déstabilisation qui va crescendo, certains généraux aimeraient demander l’assistance de la France, pour sécuriser la frontière avec le Mali. L’état-major présidentiel préfère se tourner vers la Russie.
Le 16 septembre, le président algérien accuse la France de malveillance et assure être prêt à défendre la patrie .
Le lendemain, des missiles Iskander fournis par Moscou sont tirés en mer Méditerranée, dans le cadre d’un exercice impromptu.
Avec ses liens forts avec la Russie et sa relation plus qu’ambiguë avec la France, l’Algérie constitue une menace théorique. Elle dispose de sous-marins russes type Kilo avec des missiles de croisière conventionnels performants. Ses équipements sont dans l’ensemble de très bonne qualité .
Sur les conseils de son chef d’état-major particulier, le président français déclare que la France répliquera de manière proportionnée à toute agression . Il se refuse à aller plus loin. Pour des raisons historiques et sociologiques évidentes, la France n’entrera jamais en conflit militaire avec l’Algérie.
Inquiet de l’instabilité en Algérie – le pays semble se morceler en différentes factions –, Paris décide d’organiser une opération d’évacuation.
Environ 80 000 personnes appartiennent à la communauté française en Algérie. Mais le problème de l’évacuation des ressortissants est que, sur ces 80 000, 78 000 sont des binationaux franco-algériens. Ils sont donc considérés comme algériens par les autorités algériennes, ce qui impliquerait de fait des complications supplémentaires, alors que des gens avec la double nationalité chercheraient à partir en France.
La situation est d’autant plus complexe que les aéroports commerciaux sont fermés.
Paris décide donc de mener une opération militaire extrêmement délicate pour évacuer ses ressortissants. Elle négocie avec le pouvoir en place dans la capitale, qui, bien que contesté, accepte que des bâtiments militaires s’approchent des côtes algériennes. Le 30 septembre, une flotte de navires civils accompagnés de deux porte-hélicoptères d’assaut font route vers les villes d’Oran et d’Alger, où se pressent les ressortissants français vivant en Algérie.
Pour l’évacuation de ressortissants, il faut que des A400 M puissent être mobilisés rapidement .
Une partie de l’armée algérienne proteste contre cette opération et dénonce une intervention néocoloniale. Le pays serait particulièrement fracturé, divisé en différentes factions militaires. Bien sûr, vous auriez des démocrates pro-occidentaux, mais vous auriez aussi des nationalistes, désireux de maintenir en place l’ancien système, et des factions proches des courants islamistes. Le tout sur un terreau général particulièrement hostile à la France, entretenu depuis des années en Algérie.
En guise de représailles à ce qu’elle estime être une attaque, et contre l’avis du pouvoir encore sur place à Alger, la partie la plus radicale de la junte met la main sur une partie de l’équipement militaire algérien. Elle envoie des missiles visant les navires français. L’un d’eux atteint sa cible. Pendant plusieurs jours, les images d’un porte-hélicoptères amphibie (PHA) français qui s’abîme en baie d’Alger, l’équipage fuyant pour éviter de couler, tournent en boucle sur toutes les chaînes de télévision. L’opération d’évacuation est globalement considérée comme un succès, mais quatre militaires sont morts. Les images du navire coulant en Méditerranée sont une humiliation cuisante pour la France.
Le pouvoir algérien en place assure s’occuper des militaires rebelles, mais ceux-ci ne semblent pas être intimidés, au contraire. Alors qu’une cérémonie d’hommage aux soldats décédés a lieu aux Invalides, Emmanuel Macron apprend qu’un deuxième missile Iskander tiré par la junte a visé la base militaire de Toulon. Le système de défense sol-air est efficace, mais l’inquiétude demeure. On ignore de combien de missiles dispose la section radicale de la junte. Que se passera-t-il la prochaine fois ?
À Paris, le pouvoir est tétanisé. Le Conseil de défense, réuni autour du chef de l’État, hésite. Oui, la France doit répliquer à cette agression. Mais à qui l’attribuer, alors que le pouvoir à Alger ne soutient pas cette action menée par une frange ultra-radicale ? Et dans quels délais ? D’intenses discussions ont lieu, alors que Paris affiche son entente avec le « partenaire algérien » qui détient le pouvoir à Alger.
Aujourd’hui, un tel événement est inimaginable. Mais dans le cadre d’un effondrement complet, de phobie d’une action française plus d’une junte mal contrôlée ? La question de la réplique serait épineuse.
Après quelques heures de réflexion, Paris réagit .
Dans la plus grande discrétion, une opération spéciale conjointe avec les militaires algériens fidèles au pouvoir est menée sur le sol algérien pour arrêter les responsables. Deux Rafale M s’envolent depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Guidés par les militaires algériens sur le terrain, ils effectuent plusieurs frappes ciblées. Dix jours plus tard, on apprend par voie de presse l’exécution des commanditaires. Malgré l’élimination d’une partie de la junte, l’Algérie s’enfonce dans le chaos.
0 notes
Text
Monographie du Bangale...
Au Bangladesh, un "gouvernement bureaucratique et ultra-corrompu de gauche" a été détroné précisément par une alliance d'islamistes et de conservateurs, mais les libéraux fantastiques souhaitent toujours voir Benjamin Constant à la tête des protestations.
Le nom des Frères musulmans au Bangladesh est Jamaat-e-Islami Bangladesh, historiquement opposé à la séparation du Bengale Est du Pakistan. La plupart des étudiants sont coordonnés par eux, via le "Bangladesh Islami Chhatra Shibir", une organisation estudiantine islamiste souvent réprimée mais aussi fréquemment accusée de violences politiques.
Les groupes non islamistes étaient significativement actifs dans la mobilisation, mais ils ne peuvent diriger l'ensemble. Loin s'en faut.
Les Awamistes détronés ne sont pas isolés. Peut-être que le renversement de Sheikh Hasina les conduira à changer de direction.
Mais la lutte entre les awamistes et le milieu réactionnaire qui s'est emparé du Bangladesh aujourd'hui ne fait que commencer.
La Ligue populaire 'Awami' (l'équivalent de عامة ou عوام en arabe, donc 'populaire' dans une connotation plébéienne) s'est avérée être le maillon faible parmi les trois grands, en plus de l'armée et des propriétaires des usines textiles.
Pourtant, l'État, c'est profondément la Ligue. Dé-awamiser l'État est une tâche des plus difficiles.
Le Bangladesh est un des rares États du monde à continuer à mentionner le socialisme dans sa constitution: "Pledging that the high ideals of nationalism, socialism, democracy and secularism, which inspired our heroic people to dedicate themselves to, and our brave martyrs to sacrifice their lives in, the national liberation struggle, shall be the fundamental principles of the Constitution" [préambule].
À l'origine des manifestations se trouve le refus d'un système de quotas réservant une immense majorité des emplois publics à la clientèle de la Ligue Awami, sous prétexte qu'ils descendent des vétérans de la guerre d'indépendance contre le Pakistan.
Depuis 53 ans, le pays repose sur ce mythe fondateur ; ce mythe éclate maintenant.
À l'époque, l'Inde était intervenue en lançant une guerre victorieuse contre le Pakistan occidental pour l'obliger à se retirer du Bengale où son armée commettait un génocide au nom de la communauté religieuse et d'une nation très artificielle qui n'avait pour critère que l'appartenance religieuse et qui voulait imposer l'ourdou aux Bengalis, au risque de les écarter de la fonction publique et des universités.
Aujourd'hui, tout ce qui préoccupe l'Inde, c'est d'empêcher les pauvres du Bangladesh de traverser la frontière vers son territoire.
0 notes
Text
Le Tandem Malsain : "Politicisme" vs "Économisme".
Au niveau des "dispositions d'esprit", ce pays est marqué par deux extrêmes qui laissent un goût d'amertume.
D'une part, un politicisme qui se vante même de marginaliser les questions d'ordre économique et social sous prétexte que cela nous éloigne du sérieux, du viril et de l'effectif.
Ce politicisme, prenant une multitude de formes, nourrit les plus philistins des soupçons envers toute analyse économique, présupposant qu'une telle analyse ne serait que de la poudre aux yeux cherchant à détourner les esprits de la voie politique authentique, la seule capable de capter l'élan et de mettre en marche les enjeux principaux.
Le volet économique ne serait ainsi qu'un épiphénomène qui doit constamment être rappelé à sa place subalterne, à son rang de valet de chambre, sous peine de perdre en rigueur dans l'approche et de renoncer à toute emprise sur la dynamique réelle qui se joue ailleurs.
En revanche, un économisme étriqué et méprisable réduit tout à la cupidité et à la malhonnêteté orchestrées par un groupe de banquiers et leurs acolytes au sein de la classe politique.
Cet économisme est encore plus populiste que le pire des politicismes. Tout comme ce dernier, il néglige toute étude et toute réflexion sur les liens sociaux ainsi que sur les rapports sociaux.
Pour les adeptes de cette manière de s'empêcher de penser, la base sociale est soit passive et démoralisée si elle n'adhère pas à leurs absurdités, soit considérée comme un peuple révolutionnaire authentique si elle se laisse influencer par leurs schémas simplistes et leurs formules désespérées.
Tous deux, le politicisme et l'économisme, dénigrent simultanément l'analyse des classes sociales et de la lutte des classes, même si c'est avec des formulations différentes.
C'est que les promoteurs de l'économisme au sein de la gauche, engagés dans une bataille contre les moulins à vent du néolibéralisme, cherchent toutefois à reprendre la rhétorique, voire plutôt la lyrique de la lutte des classes, mais épurée tant des classes sociales que des luttes réelles. Ils optent davantage pour l'adoption du concept du "99% contre 1%", ce qui relève en réalité d'une mascarade envers la tradition marxiste.
Dans le cadre du marxisme, les polarisations et les tensions se manifestent au sein de la société elle-même, plutôt qu'ailleurs. Cela implique que la société ne peut jamais être réduite à une seule classe commune, en excluant la classe dominante de la dynamique sociale comme si elle était extérieure à la société. Bien sûr, si un noyau dur de l'oligarchie représentant 1% de la population existe, il serait probablement accompagné par 10 à 20% de la population ayant des intérêts de classe réels qui les différencient foncièrement des classes populaires. Cela ne peut être uniquement attribué à la manipulation, aux mensonges, ou même à l'explication simpliste du "clientélisme", un terme qui isolément ne porte que peu de signification.
L'économisme , particulièrement celui qui s'exprime au sein de la gauche, c'est en réalité du pipeau, un flan de populisme.
Cependant, encore une fois, il s'agit d'un populisme élitiste, condamné à rester éternellement à l'écart de tout véritable épanouissement en accord avec les masses, de tout cheminement vers une "ligne des masses". C'est de l'économisme de malfrat, morne à en crever.
L'économisme qui se limite à expliquer toute prise de distance par rapport aux enjeux économiques comme un simple égarement causé par une manipulation suscitée par un intérêt économique reflète une vision étroite de l'économie elle-même.
En reléguant les impulsions et fantasmes, l'économisme, la pire des idéologies pour un marxiste conséquent, réduit l'économie à des besoins à satisfaire ou à une activité à empêcher de stagner.
La dualité de l'homme entre sa nature éphémère et son désir de durabilité ne sous-entend pas qu'il est divisé en deux. Il est constamment à la fois les deux aspects. Lorsqu'il réfléchit à ses besoins quotidiens, il garde simultanément à l'esprit sa propre mortalité et celle des autres. Il ne segmente pas son temps entre ces deux pensées, ne dédiant pas une heure à satisfaire ses besoins et une autre à faire le deuil de sa mort future.
L'exclusion des soucis existentiels, ainsi que des pulsions et des fantasmes liée à la double condition antinomique de l'homme du domaine économique, ainsi que l'arrogance de l'économisme qui imagine un monde où seuls les sujets économiques sont discutés en dehors des heures de loisir, relève en réalité de la tromperie et de la duperie.
0 notes
Text
Le corporatisme de type nouveau

1 Le fascisme initialement préconisait le corporatisme dans le domaine du travail.
2. Le corporatisme fasciste reposait sur le principe d'une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes de l'économie, notamment les travailleurs, les employeurs et l'État.
3. Ces groupes professionnels étaient censés œuvrer ensemble en poursuivant des objectifs communs et en défendant les intérêts de la nation, considérée comme un corps social organique, excluant les éléments perçus comme nuisibles, parasites, subversifs ou superflus. Cela se faisait sous la supervision et le contrôle du gouvernement central et du régime fasciste.
4 Le corporatisme était envisagé comme une alternative aux conflits de classe et visait à apaiser les tensions entre les travailleurs, les employeurs, les entrepreneurs et l'État en instaurant des mécanismes de négociation et de résolution des différends au sein de chaque secteur économique.
5 De nos jours, un autre type de corporatisme fascisant prend de l'ampleur dans le monde. Il s'agit du corporatisme sécuritaire engageant la coopération entre des instances intra-étatiques et d'autres para ou extra-étatiques. Cependant, l'ordre de subordination entre ce qui détient le sceau de l'État et ce qui se positionne en opposition à l'État varie d'un endroit à l'autre dans le monde. De plus, les réseaux de cette subordination sont souvent informels et présentent des variations en termes du degré de conscience de ce système.
6. Nous passons donc d'un ancien modèle corporatiste, qui a soit été subjugé par le fascisme, comme en Italie, soit a pris le dessus sur le fascisme, comme dans l'Espagne franquiste, à un modèle corporatiste qui se construit relativement éloigné du monde du travail, même s'il a d'importantes répercussions sur ce dernier. Cependant, ce corporatisme implique des groupes détenant différents degrés d'autorité, d'intelligence, de force de répression et de pouvoir d'interpellation, ce qui peut rendre la vie difficile pour les individus ou groupes qu'ils entourent ou ciblent.
7. Dans les années écoulées, une trop grande importance a été accordée à la prolifération de différents types de populisme. Cependant, parfois en se nourrissant de la vague populiste elle-même, parfois en se développant à son insu, ou encore dans son sillage, c'est le corporatisme sécuritaire qui a commencé à prendre en charge plusieurs pays, notamment dans les États en échec.
8. Ce nouveau corporatisme fascitoïde ne craint pas directement les conflits de classe, comme cela était le cas en Europe sous l'effet de la révolution et de la guerre civile russes, ainsi que de la polarisation en faveur ou contre le bolchevisme.
9. De plus, le corporatisme actuel n'a pas besoin de dévaloriser le bolchevisme pour en tirer inspiration en créant une organisation anti-communiste militante, contraignant la bourgeoisie à abandonner le libéralisme au nom de la terreur contre le communisme.
10. Ce nouveau modèle de corporatisme fascitoïde investit dans la peur de la guerre de tous contre tous, la crainte de l'état naturel hobbesien (par référence à Thomas Hobbes).
Cependant, au lieu de chercher à échapper au chaos généralisé par le biais d'un contrat social, même dans les limites du pacte hobbesien (échange de libertés contre des droits, en particulier le droit à la propriété et le droit de protéger sa vie contre la violence arbitraire), il opte plutôt pour un régime d'arbitraire ciblé.
11. Effectivement, un tel régime serait caractérisé par son arbitraire, son absence de légitimité institutionnelle, et le manque de modalités de légitimation claires. Il ne serait pas centralisé mais plutôt composé de plusieurs centres, tout en maintenant une hiérarchie distincte. Ce régime serait convaincu qu'il peut éviter à la fois l'état de guerre de tous contre tous et le pacte social. Il rejetterait à la fois la déstabilisation et la cohésion sociale, optant presque quotidiennement pour une cible à diffamer et à persécuter, et il pourrait même, dans certains cas et à moindre coût, de mobiliser une petite foule en fonction du dossier envisagé. Dans un pays comme le nôtre, les opportunités ne manqueraient pas en raison des peurs mutuelles exacerbées, de l'instinct grégaire frustré, de l'inculture systématique, ainsi que de la montée du complotisme.
12.Contrairement à la corporatisation du travail, ce nouveau type de corporatisme se désintéresse du travail en lui-même. Il place sa confiance en tous les employeurs, estimant qu'ils gèrent parfaitement leurs entreprises et leurs usines. Ce corporatisme fascistoïde vise avant tout à prévenir les débordements populaires et les émeutes. Toutefois, la répression des émeutes et des manifestations de colère populaire représente un challenge constant pour ce type d'arrière-garde au pouvoir.
13. À l'heure actuelle au Maroc comme dans d'autres pays d'ailleurs, l'anti-Soros est devenu un épouvantail agité jour et nuit par ce corporatisme sécuritaire. Auguste Bebel disait que l'antisémitisme était le socialisme des imbéciles, et de manière similaire, on pourrait considérer l'anti-sorosisme frénétique comme "l'anticapitalisme des ignorants". Dans notre cas , l'anti-Soros est devenu l'anti-capitalisme des oligarques du coin!
14. Le corporatisme absorbant le politique dans le sécuritaire et le sécuritaire dans l'euphorie ne peut être conçu que comme une transition. Dans notre cas, s'il est considéré comme une coordination de préservation contre la désintégration, il ne fait que renforcer et accélérer le processus de désintégration, tout en créant une atmosphère de démoralisation générale.
0 notes
Text
Inflexibilité persistante : la page indomptable du Likoud .
Malgré l'échec de la communauté internationale depuis le début du conflit actuel à trouver l'esquisse d'une solution, ne serait-ce qu'avec une orientation visant à prévenir une escalade extrême dans l'ensemble de la région du Proche-Orient, il faut dire que le texte prudent proposé par Malte, qui a fini par s'imposer, a réussi à naviguer au milieu d'une paralysie atroce du Conseil de Sécurité depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, une situation qui perdure et s'aggrave toujours.
Depuis environ une décennie, le système international semble être en état d'agonie de plus en plus ressentie.
Aucune résolution de l'ONU n'a pu être adoptée en 2022 pour condamner l'invasion russe d'une partie de l'Ukraine, ni pour dénoncer les bombardements massifs de la population civile à Gaza par les Israéliens. La guerre se poursuit alors que le droit international ainsi que le système international laissent à désirer. Dans cette situation de fragilité du normativisme sur la scène internationale, la dramatisation atteint des sommets. La brutalisation s'accompagne largement d'une hyper-victimisation. Les Russes affirment mener une guerre contre les nazis en Ukraine, tandis que les Israéliens comparent le Hamas aux nazis.
Cette légèreté dans la manière dont la mémoire du national-socialisme allemand est reprise de manière généralisée, sans considération appropriée, est très symptomatique. Cela contribue à créer un effet analogique avec la situation qui prévalait à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, le système international qui a été mis en place à la fin de cette guerre, lors des conférences de Yalta et de Potsdam, semble plus obsolète, périmé et dysfonctionnel que jamais. Pourtant, des alternatives ne semblent en aucun cas être à portée de vue.
Le monde se retrouve maintenant pris en étau entre une guerre prolongée en Ukraine, qui pourrait durer de nombreuses années encore, et une guerre massive contre Gaza. Les mécanismes de freinage et les garanties pour éviter l'extension de cette guerre et sa généralisation dans un conflit total et régional restent insuffisants.
Les deux conflits menés simultanément à présent l'un en Ukraine l'autre au Proche-Orient flirtent sérieusement avec la logique du choc des civilisations, à condition de pouvoir facilement échanger l'étiquette de civilisation contre celle de barbarie. Dans les deux cas, l'Occident est impliqué dans une confrontation avec une partie d'une autre civilisation. Cependant, si par rapport à la guerre russe en Ukraine, une partie du monde, soit le "Rest" par opposition au "West" semblait plus ambiguë et hésitante, dans le conflit actuel, la division est plutôt présente au sein dans ce 'Reste' globale.
En Inde, on peux mieux constater qu'Israël a réussi à gagner le soutien d'une partie du Sud Global, comprenant l'Inde de la Hindutva ainsi qu'une variété de pays africains subsahariens.
Cependant, le consensus occidental en faveur du soutien à Israël est destiné à être érodé par des dissensions internes avec le temps, même si la principale limitation de cette solidarité occidentale envers l'État hébreu provient de la droite au pouvoir en Israël même. Celle-ci n'aspire surtout pas à se retrouver dans une situation où l'après Hamas à Gaza lui imposerait un engagement dans un sens redonnant vie à la solution des deux États.
Une pacification consentie par la communauté occidentale, même si elle est réalisée par des moyens des plus brutaux, est à craindre et à rejeter par cette droite, car elle pourrait lui imposer des concessions susceptibles d'attiser la suspicion, et ultérieurement, de conduire à une confrontation avec la société des colons en Cisjordanie, qui représente, y compris pour le Likoud même, le potentiel d'un autre Hamas.
Au cours de la dernière décennie, Israël a semblé snober l'Occident et éprouver une méfiance envers ses élites au pouvoir.
Ses dirigeants et meneurs d'opinion ont critiqué inlassablement le
droit-de-l'hommisme européen, réagissant comme outragés envers l'accord sur le nucléaire iranien d'Obama, et ne se sont même pas sentis à l'aise avec le plan de paix de Trump et de son gendre!
Trump avait surpassé ses prédécesseurs dans son enthousiasme envers l'État hébreu en reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé, malgré la résolution de l'ONU condamnant cette occupation, et en déplaçant l'ambassade américaine à Jérusalem.
Le gouvernement israélien avait cherché à promouvoir des relations diplomatiques ouvertes avec les monarchies du Golfe, tout en évitant tout engagement susceptible de conduire à la création d'un État, même s'il s'agissait d'un micro-État disséminé ou de faible envergure, dans les territoires occupés en 1967.
Puis, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a surgi. Israël n'a pas suivi de manière catégorique le consensus occidental hostile à la Russie, adoptant une position ambiguë similaire à celle de nombreux autres pays du Moyen-Orient et du Global South.
L'état hébreu a évité de compromettre ses relations avec Moscou, ce qui lui a valu des critiques répétées de la part du président ukrainien Zelensky.
Soudainement, tout a changé à la suite d'attaques sans précédent et de la prise de deux cents otages. Israël s'est senti plus ébranlé que jamais, cherchant un soutien accru de la part de l'Occident, en particulier des Américains. Joe Biden a montré lors de sa visite à Jérusalem au lendemain des attaques du Hamas un engagement indélébile envers Israël, supervisant une campagne de destruction massive contre Gaza. Cependant, rien de tout cela ne pouvait remédier à la divergence entre les deux perspectives.
Pour les Américains, une fin dans la terreur est préférable à une terreur sans fin. Elle pourrait ouvrir la voie à un règlement final qui permettrait la coexistence d'un État palestinien light, d'une part, et d'un État israélien infiniment plus musclé.
Cependant, cette perspective n'est pas partagée par le Likoud. Laissez-moi expliquer. En tant que forme d'extrémisme, le Likoud incarne l'extrémisme consistant à éviter toute décision définitive.
Il refuse de trancher de manière irrévocable et de préciser les engagements mutuels nécessaires, que ce soit concernant le statut de Gaza ou celui de la Cisjordanie.
Pour le Likoud, les territoires occupés en 1967 devraient demeurer dans un état de limbes perpétuelles, figés dans un état de transition sans fin, un chantier ouvert et une grande prison.
Le Likoud n'est aucunement enthousiaste à l'idée qu'en éliminant le Jihad islamique à Gaza, on pourrait restaurer les chances d'un règlement raisonnable du conflit avec un partenaire palestinien plus raisonnable. Ce que le Likoud s'efforce de prouver depuis deux décennies, sans relâche, c'est qu'un tel partenaire n'existe pas et n'existera pas. Ceux de Ramallah sont trop mous, même à son goût, ceux de Gaza sont trop brutaux et nihilistes.
Le Likoud est fermement convaincu que rechercher un partenaire palestinien pour la paix est une perte de temps et d'énergie, alors qu'il est ouvert à poursuivre des efforts de paix avec les monarchies du monde arabe.
Pour Netanyahou, tout comme avant lui pour Begin, la perspective de paix est souhaitée et considérée comme réalisable avec les pays arabes, mais sans la nécessité d'inclure les Palestiniens dans ce processus.
Cette perspective visant à atteindre la paix sans impliquer les Palestiniens porte la plus grande responsabilité dans l'actuel enlisement sombre et sanglant.
Pour le Likoud c'est exactement le contraire: éliminer le Hamas pourrait ouvrir des opportunités pour la paix avec les monarchies, à condition de ne pas risquer la création d'un État palestinien. Pour le Likoud, éviter toute concession aux Palestiniens est crucial afin d'éviter tout affrontement potentiel avec les colons de Cisjordanie.
Ces colons incarnent à la fois l'extension de l'État et une situation de non-État, voire d'anti-État. La perte de contrôle sur ces colons est une préoccupation majeure en Israël. Pour l'aile droite du sionisme, notamment pour le sionisme révisionniste, un Israël sans la Cisjordanie demeure un État incomplet, un État hors de soi-même. En revanche, pour le Likoud, la Cisjordanie ne doit ni être pleinement annexée à Israël ni être cédée aux Palestiniens. Elle est plutôt un laboratoire permanent où la société des colons est appelée à changer la donne, un processus exigeant plusieurs générations.
Cependant, ces colons ont développé un sentiment de méfiance envers tous les gouvernements d'Israël, ainsi qu'envers le monopole de la violence légitime détenu par l'État. Ironiquement, ils semblent davantage soutenir le modèle milicien prévalant dans les pays de la région. Ce caractère milicien de la société des colons en Cisjordanie, combiné à une intransigeance idéologique et religieuse directement liée à une interprétation biblique d'action directe issue du Livre de Josué, pourrait nourrir les pires extravagances.
Si ces colons devaient s'inspirer de l'incident de Babri Masjid en Inde en 1992 pour entreprendre une action similaire d'escalade dans l'enceinte du sanctuaire des patriarches à Hébron (al-Khalil) ou même mettre en danger la mosquée al-Aqsa de Jérusalem, cela pourrait susciter une inquiétude dépassant largement les frontières israéliennes, pouvant potentiellement affecter le monde entier d'une rage non expérimentée jusqu'à présent.
L'incident de Babri Masjid en Inde en 1992 a été une tragédie où une mosquée, la Babri Masjid, située à Ayodhya, a été détruite par des extrémistes hindous qui affirmaient que l'emplacement était le lieu de naissance du dieu Rama. Cette destruction a déclenché des violences et des tensions religieuses majeures à travers le pays, causant des pertes en vies humaines. Certains colons extrémistes pourraient être tentés de s'inspirer de cet événement pour promouvoir leurs conceptions des choses, notamment à l'égard d'al-Aqsa, en justifiant leurs actions par des croyances mythico-historiques frustrées.
Même si la guerre se déroule à Gaza et contre Gaza, l'enjeu essentiel demeure en Cisjordanie. Pour Israël, la guerre à Gaza va se poursuivre jusqu'à la destruction de la direction militaire du Hamas. Paradoxalement, la recomposition du mouvement après le démantèlement du noyau militaire dure en question semble plus réaliste et moins hasardeuse que la résurrection du Fatah.
Quant au Hamas, jusqu'à présent, tout porte à croire que l'axe iranien, tout en inspirant d'une part la volonté et le momentum de l'escalade et en nourrissant cette vision apocalyptique de l'amplification de la lutte, n'était pas conscient de l'ampleur préméditée de l'escalade une fois mise en exécution, ce qui a surpris tout le monde.
Toutefois, ceci engendre une problématique étant donné que ladite décision a été arrêtée par la faction militaire sans impliquer préalablement l'aile politique du mouvement, opérant ainsi en doublant la substitution vis-à-vis des résidents de l'enclave assiégée
Jusqu'au 7 octobre, l'essentiel du conflit se déroulait entre les formations pro-iraniennens et Israël dans le cadre d'une guerre statique. Le Hamas a ensuite opté pour une stratégie offensive absolue, passant d'une guerre de position à une guerre de mouvement. Bien que cette action ait infligé un coup psychologique traumatisant pour Israël, elle limite les options pour contrer le rapport de force militaro-technologique qui reste largement en faveur d'Israël.
Cependant, plutôt que de se désinvestir vis-à-vis du Hamas, l'axe iranien opte pour persévérer dans une stratégie de guerre d'usure et de guerre de positions, tout en élaborant une approche opérationnelle transcendant les frontières, impliquant les entités affiliées à cet axe en Irak, au Liban et au Yémen. Mais pour le Hamas, est-il encore envisageable de rétrograder de la guerre de mouvement vers la guerre des positions ? Cela demeure incertain. Toutefois, parvenir à éliminer définitivement le mouvement demeure un défi difficile à concrétiser. Il est également nécessaire de considérer la possibilité de susciter, dans les territoires Palestiniens occupés, un mouvement similaire à celui du mouvement islamique à l'intérieur d'Israël.
Dans son ouvrage 'The Paradox of Liberation' paru en 1995, le philosophe politique américain Michel Walzer a choisi d'étudier simultanément l'évolution des mouvements de libération en Inde, en Israël et en Algérie. L'insertion d'Israël dans une comparaison avec les mouvements de libération nationale en Inde et en Algérie est sans doute révoltante pour les Arabes, en particulier pour les Palestiniens, pour qui Israël représente un fait colonial et non pas un État né d'une lutte anticoloniale, contrairement à ce que soutient la rhétorique officielle en Israël. Néanmoins, sur le plan de la représentation des choses, le sionisme s'est bel et bien présenté comme un mouvement de libération nationale, tout comme les deux autres mouvements étudiés par Walzer. Il a évolué d'une période où il était sous l'influence d'une idéologie laïque et progressiste, vers une époque marquée par la montée en puissance du sionisme révisionniste, de plus en plus imprégné du revivalisme biblique.
Cette guerre actuelle semble incapable de générer des réactions assez fortes pour inverser cette tendance, même si, en théorie, elle remet en question des décennies entières où les idées concernant les droits nationaux et la construction nationale étaient subordonnées à des dynamiques de revivalisme mythologique davantage que religieux.
De plus, le camp pour la paix en Israël a fait naufrage avant même l'avortement du processus de paix entre le gouvernement travailliste et l'autorité de Yasser Arafat.
Depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995, l'assassin a imposé sa logique à toute la société : aucun individu ne devrait consentir à la moindre concession sur les terres occupées en 1967, même celui qui était le chef d'État-major pendant cette guerre, sous peine de provoquer une guerre civile. Ainsi, selon cette logique, l'assassinat de Rabin aurait été un acte visant à préserver la paix civile en Israël! Le parti de Rabin, et à sa gauche, le mouvement de la paix, n'ont pas réussi à inverser cette logique ni à prouver que c'est avec la paix avec la Palestine que la cohésion sociale israélienne sera préservée.
Le mouvement pour la paix en Israël est apparu à la fin des années 70 selon trois logiques distinctes. D'abord, d'anciens officiers et des sionistes déterminés, irrités par la défaite de la gauche sioniste aux élections de 1977 face à Begin, ont commencé à envisager qu'une réponse à la droitisation d'Israël pourrait être la réalisation d'une paix avec les Palestiniens. Cette paix serait vue comme une entente entre deux mouvements de libération nationaux qui, bien qu'ayant longtemps été en opposition, se verraient contraints de conclure à une coexistence pacifique en fin de compte.
Deuxièmement, des "nouveaux historiens" et des "post-sionistes" ont entrepris une démarche inverse, choisissant de déconstruire la grande narrative sur la guerre de 1948 en tant que guerre d'indépendance et de décolonisation.
Troisièmement, certains se sont réjouis de la visite de Sadate et de son discours à Jérusalem, ainsi que de la signature de la paix avec l'Égypte, mais sont restés perplexes car le gouvernement de droite cherchait la paix avec l'Égypte sans pour autant envisager la même démarche avec les Palestiniens.
Cependant, étant donné que ces trois piliers du mouvement pour la paix ont soit fini par se désintégrer, soit subir l'isolement et le dessèchement l'un après l'autre, peut-on encore espérer voir émerger un mouvement favorable à la paix en Israël ? Je ne parviens pas à comprendre comment la guerre actuelle pourrait contribuer à cela. S'opposer à Netanyahou seul ne suffit pas à raviver une volonté pour la paix en Israël.
Israël peut-il véritablement se libérer de l'emprise de Netanyahou?
Son influence perdurera pendant de nombreuses années encore. Il a symbolisé deux facettes sur la durée. D'une part, une opposition constante à tout effort visant à mettre un frein à la colonisation en Cisjordanie et à toute tentative de création d'un État palestinien, même dans ses formes les plus souples et réduites. La seconde facette réside dans sa capacité à éviter de graves débordements, préférant des campagnes de frappes limitées plutôt que des conflits majeurs.
Pourtant, ce même Netanyahou, confronté à une protestation de grande envergure en début d'année pour avoir empiété sur le pouvoir judiciaire et sapé l'État de droit, s'est finalement engagé dans le conflit le plus destructeur mené contre les Palestiniens. Il n'est pas exempt de responsabilité dans cette guerre, étant pointé du doigt pour la passivité et la nonchalance des appareils le 7 octobre face aux attaques. La résolution de la question des otages pèse lourdement sur lui et aura des répercussions directes. Il en subira probablement les conséquences, mais continuera néanmoins d'exercer une influence bien plus significative que ce que l'on pourrait imaginer. L'ensemble de la société et l'establishment israéliens ont, d'une certaine manière, adopté une vision proche du Likoud suite aux attaques. Un netanyahouisme ambiant s'est propagé même parmi les opposants les plus farouches à Bibi. S'en détacher? Pas pour l'instant. Peut-être même pas pour cette génération.
0 notes
Text
Quelques réflexions préliminaires sur le populisme (suite à la lecture d'un statut intriguant sur Facebook)
Pour un Jacques Rancière le mot “populisme” ne veut absolument rien dire, si ce n'est une pulsion de “haine de la démocratie”. Pour Ernesto Laclau, le rejet du populisme est symptomatique du rejet de la politique tout court. Les intuitions de Rancière et l'approche de Laclau ont le mérite de nous avertir contre tout emploi à outrance, et tout usage exclusivement péjoratif du terme. Cela dit, il me reste difficile de consentir au déterminisme implicite de Laclau. Pour le regretté théoricien argentin l'équation est telle: le rejet du populisme est un rejet de la politique, donc le populisme devrait-être “revisité” comme une “manière de construire la politique”. Nulle doute que l'essor du phénomène populiste, ou plutôt son va-et-vient, a de quoi nous enseigner sur la désintégration du politique, mais de là à saluer dans le populisme “une manière de construire la politique” tout court il y a un pas à affranchir à ses risques et périls. Laclau partait de l'expérience argentine, du péronisme. Tout en critiquant les généralisations libérales et marxistes à propos du péronisme taxé de “populisme”, l'auteur de la “raison populiste” ne devait pas s'interdire l'usage de cette notion. Il va redécouvrir le populisme paradigmatique dans le péronisme. Celui-ci procède par bricolage idéologique, mais dans le cadre de la “construction de la politique”, c'est-à-dire de la construction du “sujet populaire” par le biais d'un “appel au peuple”, appel à visage double, démocratique et autoritaire.
1. Je tiens l'oeuvre de Laclau en haute estime, sans toutefois accepter son déterminisme ni partager sa carte de comparaisons planétaires vite faites. Le populisme est une “manière de construire la politique” qui peut conduire très facilement à la court-circuiter.
2. Il y a une dimension populiste dans chaque mouvement, ou dans chaque discours, qui se réfère à ce mode spécifique d'interpellation idéologique spécifique: “l'appel au peuple”. Cette dimension peut augmenter ou diminuer en intensité ou en épaisseur, partager des valeurs conservatrices ou progressistes. Tant que cette dimension populiste est arrêtée ou adoucie par d'autres composantes ou dimensions du même mouvement ou du même discours, on a du mal à étiqueter l'ensemble comme “populiste”. Mais s'il arrive que pour une raison ou une autre, la dynamique et la rhétorique de “l'appel au peuple”, absorbent l'ensemble de la formation, du mouvement, ou de discours, il serait donc “opérationnel” de parler de populisme. J'ai tendance à voir le populisme dans l'expérience du péronisme plutôt que dans le nassérisme, parce que, dans celui-ci, “l'appel au peuple” est resté occasionnel (face à la sécession de la Syrie, Nasser n'a pas recouru à un tel appel).
3. Le populisme peut être de droite ou de gauche. Le “populisme” reste donc un concept efficace ou opérationnel pour étudier le nationalisme religieux du BJP en Inde. Mais il s'agit là avant tout d'un populisme électoral de droite. Les mésusages d'un concept ont le mérite de nous inviter à le repenser, le reformuler, mais rarement à le congédier une fois pour toute. Il est question de populisme et non pas d'autres choses, chaque fois qu'on se trouve face à un mouvement qui fait de “l'appel au peuple” son identité propre, et qui donne au charisme du chef une importance quasi magique pour l'effectuation de cet “appel au peuple”. Utile de nuancer les différences entre les populismes, le “populisme autoritaire” de Chavez est assez différent du “démocratisme teinté de populisme” de Tsìpras. Mais le démocratisme, en tant que populisme de gauche, n'est pas égal à sa propre image idéologique: il témoigne certes de la crise profonde des institutions de la démocratie libérale, représentative ou “électorale”, mais de là à “incarner le demos-en-acte”, il y a un glissement “propagandiste”, l'illusion d'une mobilisation permanente. Corriger les mythes de la représentation par la “logique du plébiscite” n'est pas une bonne correction.
4. Les “populistes russes” ou les Nardoniks du XIXème siècle n'étaient pas des véritables populistes. S'en méfier de l'amalgame. Dans le narodnisme, il n'était question ni du charisme plébiscité du Chef, ni de “l'appel au peuple”. Il était question de “croisade vers le peuple”, d’“aller au peuple”, d'une montée de Sion, le Sion du monde rural et paysan. En exotisant le peuple russe, les narodniks préservaient le principe aristocratique, le libéraient même du joug de la subordination tsariste. Le grand mérite du “populisme russe” qui n'est pas du tout “un populisme - appel au peuple” réside dans cette éxotisation. La mémoire naïve du narodnisme peut servir d'antibiotique contre les abus du populisme, surtout du populisme de gauche.
5. Un autre antibiotique: la philosophie de Spinoza. Tout en s'écartant de la tradition de méfiance de la philosophie politique classique vis-à-vis de la multitude, Spinoza a su dégager tout l'art de la prudence (Caute! Soit prudent! comme devise) à l'égard de la multitude. Cette éxotisation narodnique du peuple, et cette prudence spinozienne à l'égard de la multitude, ont de quoi permettre une critique mesurée du populisme sans verser dans le cynisme.
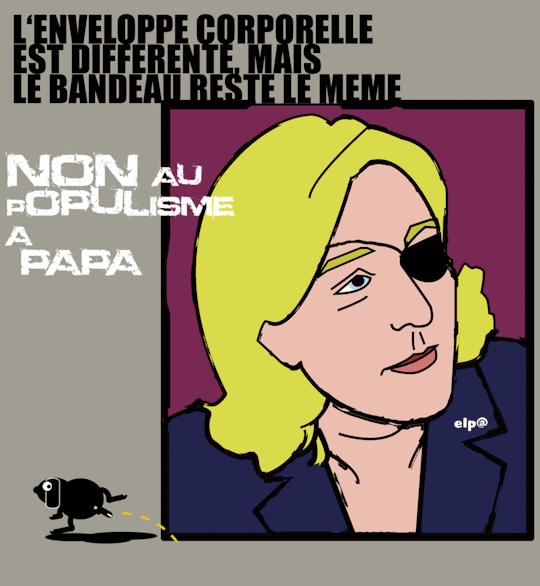
0 notes