Les idées reçues "Les Français n'ont plus confiance dans le médicament" "Les Français ont une image négative des entreprises du médicament" "Les médicaments coûtent cher à la Sécurité sociale"
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
«Prix des médicaments : la France ne doit pas céder à la surenchère des Big Pharma»
Un collectif comprenant des représentants de médecins, des patients et d’organisations non gouvernementales (ONG) a demandé à la France de ne pas « céder à la surenchère des big pharma » après les appels de plusieurs dirigeants du secteur à relever les prix en Europe face à la menace des droits de douane américains, dans une tribune publiée mardi 13 mai 2025 sur le site de l’Humanité. Ils font explicitement référence à la tribune diffusée fin avril par le Financial Times, dans laquelle des CEO ont appelé à augmenter les prix en Europe et à créer « un prix européen » qui valorise pleinement les médicaments et leurs indications.

« Derrière cette prise de position, ce ne sont pas les considérations de santé publique qui dominent, mais bien celles d’acteurs financiers, avant tout soucieux de défendre une certaine idée du rendement. »
L’accès des patients aux traitements reste bien la première considération des entreprises du médicament. Elles mettent d’ailleurs en place un certain nombre d’actions concrètes en ce sens : des politiques de prix différenciés pour adapter le coût des traitements au niveau de revenu des pays, des productions de génériques à bas coût via le Medicines Patent Pool pour certains médicaments ou encore la création ou le soutien de programmes de dons de médicaments et de coopération humanitaire.
Néanmoins, elles restent des entreprises privées avec des emplois à préserver et une activité (recherche et développement) extrêmement risquée qui demande des investissements considérables. Le coût moyen de développement d’un nouveau médicament a atteint 2,3 milliards de dollars en 2022 [1]. En moyenne, on estime qu’il faut tester entre 5 000 et 10 000 molécules pour qu’une seule atteigne finalement le marché en tant que médicament approuvé. La soutenabilité financière des entreprises du médicament est une considération importante pour l’ensemble de la société.
« En 2024, Sanofi a réalisé un bénéfice net de 5,7 milliards d’euros. Novartis, de son côté, a enregistré un bénéfice net de 11,9 milliards de dollars. Des montants qui, dans un contexte où les systèmes publics peinent à financer les soins essentiels, suffisent à démasquer l’imposture. Ces profits, associés à des niveaux de rentabilité comparables à ceux de secteurs comme le luxe, sont aux antipodes de la prétendue crise de compétitivité de ces entreprises. »
Il ne faut pas tout mélanger et diaboliser le secteur privé sans prendre en compte l’ensemble de la situation. D’abord, il n’y a pas de super profits en France mais un taux global d’imposition sur l’industrie pharmaceutique de 60% du résultat d’exploitation dont 88 % de prélèvements sectoriels. Le secteur du médicament en France, ce sont aussi des centaines de PME et un ancrage dans les territoires.
Réduire l'industrie pharmaceutique à la seule dimension financière est non seulement biaisé mais inexact. Avec près de 110 000 salariés sur le territoire, elle est un moteur économique pour la France, 4e contributeur à la balance commerciale et à la richesse du pays. Il en va de l’intérêt des citoyens français et européens d’attirer les entreprises à investir sur leur(s) territoire(s).
« Se posant en permanence comme victimes des régulations, les firmes pharmaceutiques imposent l’opacité sur l’ensemble du cycle de vie des produits médicaux — coûts de recherche et développement, investissements publics massifs et prix sciemment dissimulés — et en profitent pour imposer des tarifs sans réelle justification ».
D’une part, les entreprises du médicament ne se positionnent pas comme des victimes mais comme des acteurs responsables à part entière du système de santé. Nous faisons régulièrement des propositions pour rendre le système plus efficient, comme la démarche de contractualisation soumise au gouvernement et proposant des mesures concrètes pour réaliser 600 millions d’euros d’économies (bon usage, délistage…). Notre secteur, qui ne cesse de perdre en poids dans les dépenses de santé (environ 9%), reste le principal contributeur aux économies de santé avec 1,6 milliards de clause de sauvegarde reversée en 2025.
D’autre part, en France, les prix des médicaments ne sont pas « imposés » par les laboratoires. Ils sont fixés par l’Etat à l’issue d’une négociation avec chaque entreprise et selon des critères définis par la loi et liés à l’évaluation par la HAS. La méthodologie de négociation ainsi que des précisions sur l’interprétation de la loi sont publiées dans l’accord-cadre entre le Leem et le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé).
[1] Etude Deloitte sur l’industrie pharmaceutique « Effondrement des rendements sur les investissements de recherche », janvier 2023.
0 notes
Text
« Déremboursement des médicaments à SMR modéré et faible »
Des médias relaient une piste d’économies possibles pour le système de santé, via le déremboursement des médicaments remboursés entre 15 et 30 % (Le Figaro, Télématin, France info « Ces médicaments inefficaces qui coûtent des millions », RMC…). « De nombreux médicaments (…) sont remboursés, souvent à 15 %, voire à 30 %, alors même qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque effet bénéfique pour les patients », explique le Pr Rémy Boussageon, président du CNGE. « En 2022, les médicaments remboursés à 15 % coûtaient encore autour de 200 millions d’euros à l’Assurance-maladie, selon la dernière édition du panorama de la Drees ».

Les médicaments à SMR « faible » ou « modéré » ont un intérêt de santé publique.
Ces médicaments ont été évalués par la commission de transparence de la HAS et ont reçu un avis favorable à la prise en charge par la collectivité. Ils sont donc utiles. Il s’agit de médicaments dont la démonstration est plus difficile à établir (pathologies rares, dernière ligne de traitement…), ou dont l’efficacité et la tolérance justifient de les réserver à une catégorie particulière de personnes. Par exemple, c’est le cas des antagonistes des récepteurs H2 (anti-H2) et les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) utilisés notamment dans le reflux gastro-œsophagien (RGO) [1]. Dans les années 90, les anti-H2 ont été supplantés par les IPP, plus efficaces dès lors que les symptômes sont typiques et rapprochés. Le SMR des anti-H2 est passé d’important à faible, avec un taux de remboursement à 15%. Pour autant, la HAS ne considère pas que ces médicaments ne doivent pas être prescrits, juste qu’ils doivent être réservés aux personnes qui n’ont que des symptômes intermittents.
Il s’agit d’une double peine pour les patients qui ont besoin de ces traitements. En effet, si ceux-ci étaient déremboursés, ils ne bénéficieraient plus ni de la prise en charge par l’Assurance-maladie ni de celle par les complémentaires santé.
D’un point de vue économique, le bien-fondé d’une telle mesure est discutable.
Le calcul des économies générées par une telle mesure est plus compliqué, car il doit tenir compte du report de soins. En effet, de nombreux prescripteurs et patients pourraient se tourner vers des médicaments remboursés par l’Assurance-maladie (potentiellement moins efficaces pour eux mais plus onéreux), ce qui génèrerait des surcoûts.
[1] Rapport sur la réforme des modalités d’évaluation des médicaments, Dominique Polton, 2015
0 notes
Text
Réaction du Leem au communiqué de presse du 1er septembre 2023 de France Assos Santé « Pénuries de médicaments : les laboratoires payés pour respecter la loi ».

Le Leem réagit aux propos de France Assos Santé qui, de nouveau, présente une vision à charge des entreprises du médicament, réitère son accusation de « chantage au prix » et suggère que les industriels pourraient avoir un intérêt à organiser des ruptures d’approvisionnement.
L’intérêt de l‘industriel pharmaceutique réside dans sa capacité à générer du chiffre d’affaires sur le marché français, ce qui implique la mise à disposition du traitement, sans interruption, pour les patients qui en ont besoin.
Loin de constituer des « incitations à respecter la loi » sur les stocks de médicaments et l’approvisionnement de la France, la hausse du prix de l’amoxicilline est une mesure indispensable pour assurer la survie du modèle économique de ce médicament ancien et sa disponibilité sur le long terme pour les patients.
L’amoxicilline est une molécule « mature », dont le prix fabricant hors taxe est inchangé depuis 2006 : 0,76€ pour un flacon pédiatrique, 1,09€ pour une boîte de 12 gélules de 500mg, 3,40€ pour une boîte de 14 comprimés de 1g.
Par comparaison, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 24 points depuis 2010 (INSEE), reflétant l’inflation qui impacte les coûts de production. En parallèle, les laboratoires pharmaceutiques sont soumis en France à une pression croissante de la régulation économique (baisses des prix, augmentation de la clause de sauvegarde et des remises…).
La France est le pays d’Europe où le prix des médicaments est le plus bas : en moyenne 37% de moins qu’en Allemagne, 17% de moins qu’en Italie, 12% de moins qu’en Espagne et 6% de moins qu’au Royaume-Uni (IQVIA 2019).
Or, en situation de tension internationale sur les stocks, l’approvisionnement d’un pays où le produit est en difficulté économique n’est pas priorisé. Pire, les boîtes ou flacons prévus pour la France sont parfois réexportés dans d’autres pays par le mécanisme d’export parallèle.
Le Leem rappelle la mobilisation et les efforts entrepris par les entreprises du médicament pour lutter contre les pénuries, notamment au travers d’une plateforme rendue publique en avril 2023 et de l’implication totale des industriels dans le Plan hivernal du gouvernement pour anticiper toute tension sur les médicaments essentiels.
Parler de « chantage au prix » dans ce contexte est inapproprié et mensonger.
0 notes
Text
Réaction à la tribune de Pierre-Vladimir Ennezat « La liste des médicaments essentiels devrait éliminer les thérapeutiques ayant des bénéfices douteux » publié dans Le Monde du 13 juillet 2023
« Cette liste essentielle devrait donc éliminer de facto les thérapeutiques avec des bénéfices douteux ainsi que les médicaments dits « moi aussi » (« me-too drugs ») qui sont essentiellement des copies de molécules originales ; la principale motivation des firmes pour développer de tels médicaments sans originalité étant marketing ».

Les laboratoires ne développent pas des médicaments dans un « but marketing », cela n’a aucun sens. L’objectif est de mettre à disposition des patients des médicaments qui permettent de les guérir ou d’améliorer leur qualité de vie (au terme d’un parcours de recherche et développement long, coûteux et risqué). Avant d’être mis sur le marché, les médicaments font l’objet d’une évaluation stricte par la Haute autorité de santé en France et l’Agence Européenne du Médicament. En outre, il existe des critères précis pour prétendre au remboursement, parmi lesquels l’amélioration du service médical rendu par rapport aux thérapeutiques existantes. Il ne s’agit donc en aucun cas de « bénéfices douteux ». En outre c’est le médecin, en l’état des connaissances scientifiques existantes, qui décide de la prescription la plus adaptée à la situation de son patient.
« A l’heure de la dérive et des aléas climatiques, du déficit hydrique croissant et des pollutions diverses de l’air, des sols et des nappes phréatiques, il n’est plus acceptable de proposer une offre de soins excessive et énergivore ».
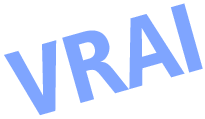
Face à l’urgence climatique et en écho à l’invitation du Haut Conseil pour le climat à décupler les efforts de réduction des émissions de CO2, le secteur pharmaceutique a adopté un plan d’engagements pour contribuer à la transition écologique en France : un plan de décarbonation et une feuille de route 3R (Réduction, Réemploi, Recyclage) en phase avec les objectifs nationaux de sortie du plastique à usage unique à horizon 2040. Il existe de nombreux leviers qui ne nécessitent pas de priver les patients des traitements dont ils ont besoin. Enfin, les entreprises du médicament sont aussi engagées dans « le bon usage » à travers l’Association française du bon usage du médicament qui a justement consacré son dernier colloque au sujet de l’environnement.
0 notes
Text
Le Leem s'indigne des propos de la rapporteure de la Commission d‘enquête du Sénat sur les pénuries de médicaments, Laurence Cohen, qui accuse de manière injustifiée les entreprises du médicament de chantage au prix, et instruit - de manière choquante - un procès en cynisme contre une industrie pourtant largement mobilisée pour la santé des patients.
MISE AU POINT
Chantage au prix : Laurence Cohen accuse les entreprises du médicament de « rabâcher que la première solution aux pénuries est d’augmenter les prix » :
Cette déclaration ne reflète en aucun cas le discours tenu par le Leem lors de son audition devant le Sénat.
Le Leem a toujours mis en avant le fait que les pénuries étaient multifactorielles. Parmi les nombreux facteurs énumérés par Philippe Lamoureux, Directeur général du Leem, lors de l’audition – hausse de la demande mondiale due à l’évolution de la population et des systèmes de soins, à la chronicisation des maladies graves, à des problèmes industriels tout au long de la chaîne industrielle complexe… – les prix bas ont simplement été mentionnés comme une "circonstance aggravante".
Extrait de l’audition de Philippe Lamoureux au Sénat (compte-rendu officiel de l’audition du 28 mars des représentants des laboratoires et entreprises pharmaceutiques). « Premièrement, nous nous considérons comme coresponsables de ces ruptures d'approvisionnement : nous ne cherchons pas à nous dédouaner. Nous sommes évidemment parties prenantes. Pour nous, le prix n'est pas un critère explicatif. En revanche, c'est un critère d'aggravation. La structure de prix française ne nous permet pas de lutter à armes égales face à nos voisins européens. »
Laurence Cohen affirme également que la « négociation [dans la fixation des prix est] structurellement déséquilibrée avec le CEPS » au bénéfice des entreprises
Le prix du médicament est administré : le régulateur a le dernier mot.
Les temps de négociation sur les prix en France sont pourtant parmi les plus longs d’Europe et outrepassent le délai légal européen dans 90% des cas.
Procès d’intention : On peut lire dans la synthèse du rapport du Sénat « un laboratoire qui développe un médicament en monopole dispose, de fait d’un droit de vie ou de mort, sur les patientes et les patients. »
Cette déclaration dénote une approche idéologique, qui nie purement et simplement l’apport thérapeutique d’un nouveau médicament.
Plus fondamentalement, cette approche signe une méconnaissance profonde des missions premières qui animent l’ensemble des entreprises du médicament.
Il ne faut pas confondre monopole et propriété intellectuelle. Quand un nouveau médicament entre sur le marché, un brevet est déposé, cela signifie qu’une innovation couvre un nouveau champ thérapeutique, ce qui est une bonne nouvelle, puisque cela permet d’améliorer la santé.
Ces propos sont blessants et ne reflètent pas la réalité des 103 000 salariés français de l’industrie du médicament qui se mobilisent pour la santé des patients.
« Insatisfaits des tarifs proposés, les entreprises ont « plusieurs armes à disposition : arrêt de commercialisation, déremboursement ou déni de l’accès précoce » :
Cette déclaration repose sur un contresens total sur la stratégie des entreprises : il n’est pas dans leur intérêt d’arrêter de commercialiser, que leur médicament ne soit pas remboursé ou que les innovations n’arrivent pas jusqu’au patient grâce à l’accès précoce !
En revanche, les entreprises du médicament expliquent qu’elles doivent faire face à de nombreux obstacles d’ordre très souvent administratifs, pour remplir leur mission.
La production et la mise à disposition d’un médicament engendrent des coûts (notamment les matières premières, l'énergie, le transport, l'édition des informations pour le patient et le prescripteur, la pharmacovigilance, les salaires de l'ensemble des employés de la chaîne...). A titre individuel, des entreprises doivent envisager d'arrêter la commercialisation d'un médicament lorsque les revenus ne leur permettent plus de couvrir ces coûts de manière satisfaisante.
Nous sommes d’accord sur un point avec le rapport : la nécessité d’un pilotage centralisé au plus haut sommet de l’Etat, pour éviter la discordance entre les ambitions affichées par le gouvernement et les stratégies de régulation guidées par une logique purement budgétaire.
Les industriels pharmaceutiques envisagent d’abandonner la production de près de 700 médicaments, incluant des MITM
Le Leem préconise de sécuriser en priorité les MITM dans la lutte contre les pénuries de médicaments.
Les prises de parole du Leem sur les risques de pénuries ont justement pour but d’alerter les pouvoirs publics afin d’éviter au maximum d’arrêter la production de médicaments.
Le Leem dénonce ces propos susceptibles d’abîmer auprès des patients l’image d’un secteur mobilisé au service de la santé.
Et rappelle que les entreprises du médicament ont proposé le 11 mai 2023 un nouveau plan d’actions concrètes pour contribuer à la lutte contre les pénuries et garantir l’accès aux médicaments en France.
Face à ce problème de société de la plus haute importance, les entreprises luttent avec les pouvoirs publics : ne nous trompons pas de combat.
0 notes
Text
Réaction à l’article d'Antoine Beau « Les médicaments innovants, difficiles d'accès en France ? La bataille des chiffres » publié dans l’Express du 30 juin 2023.
« Il faudrait en moyenne 497 jours pour qu'un nouveau traitement approuvé en Europe arrive aux Français, d'après l'EFPIA, le lobby des industries et associations pharmaceutiques européennes. Son équivalent national, le Leem, explique de son côté qu'un Français devrait attendre 380 jours de plus qu'un Allemand, avant de bénéficier de ces nouveaux produits. Selon ce document, les données les plus pertinentes s'avèrent parfois occultées par les lobbys. Ainsi, le temps d'attente pour une nouvelle thérapie est plutôt de l'ordre de 240 jours en moyenne, affirment les auteurs du rapport Charges et Produits de la CNAM. »

L’Assurance Maladie a mené une étude sur les délais d’accès aux nouveaux médicaments en ne considérant que les ASMR 1 à 4 et les produits remboursés en France fin 2021, ce qui limite leur échantillon à seulement 30 médicaments...
A noter que cette étude est faite sur la même temporalité que l’Observatoire de l’Accès du Leem (que le journaliste n’a pas intégré dans son papier). Sur cette liste limitée de médicaments, les données de l’Assurance Maladie sont bien conformes à celles du Leem.
« Dans leurs indicateurs mis en avant, les industriels européens ne prennent pas en compte la procédure "d'accès précoce". Or elle permet d'obtenir un médicament en urgence, avant sa mise officielle sur le marché. Avec ce mécanisme, la France n'a plus que 85 jours de retard sur l'Allemagne, et se classe loin devant l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, rappelle l'Assurance Maladie ».

L’EFPIA, comme le Leem, précisent toujours s’il s’agit ou non de données tenant compte des mécanismes d’accès dérogatoires. Le dispositif d’accès précoce ne doit pas masquer l’enjeu que représente l’entrée des traitements dans le circuit classique. En effet, les conditions d’accès à ce mécanisme dérogatoire sont relativement strictes, peu de molécules y sont éligibles et peu de patients sont donc traités. Loin d’être universel, l’accès précoce reste une mesure exceptionnelle. D’ailleurs, à ce jour en France, environ 50 000 patients bénéficient de ce dispositif alors que 12 millions de patients sont traités.
0 notes
Text
Réaction aux propos de Charlotte Masia, qui a évoqué « un effet d’aubaine majeur » dans les demandes de hausses de prix lors de son audition par la Commission d’enquête au Sénat sur les pénuries de médicaments.
Lors de son audition par la Commission d’enquête au Sénat sur les pénuries de médicaments, Charlotte Masia a fait au nom de la DSS (Direction de la Sécurité Sociale) des déclarations erronées sur le secteur pharmaceutique. Elle a évoqué « un effet d’aubaine majeur » dans les demandes de hausses de prix formulés par des industriels au titre de l’accord 28 de l’accord-cadre Leem-CEPS.

Pour rappel, le prix des médicaments n'est pas libre, il est strictement encadré par l'Etat à l'issue d'un parcours d'évaluation scientifique et d'une négociation entre le laboratoire et l'Etat.
La loi prévoit que le prix d'un médicament est fixé (par arrêté ministériel) puis baissé régulièrement, en fonction de son ancienneté, de la perte de brevet ou du prix d'autres médicaments à même visée thérapeutique par exemple.
Les hausses de prix ne sont pas interdites par la loi, mais l'accord-cadre entre l'industrie pharmaceutique et l'Etat les limite à des cas spécifiques de hausses de coût des matières premières ou, exceptionnellement, à d'autres dépenses d'exploitation, et uniquement pour des médicaments qui répondent à un besoin thérapeutique qui ne serait plus couvert si le médicament en question disparaissait du marché.
Cela veut dire que l'entreprise ne peut pas adapter le prix du médicament au cours du temps, pour prendre en compte les effets de temps long (car cela n’entre pas dans le champ des hausses de prix prévues par l’accord-cadre) : l'inflation, l'évolution des salaires ou les coûts de maintien et de modernisation de son outil de production. La marge s’érode donc au fil du temps, c’est-à-dire que le modèle économique du médicament se fragilise.
Or, un laboratoire qui ne fait plus de marge sur la fabrication de son médicament est un laboratoire qui ne peut plus investir dans le fonctionnement ni dans l'augmentation de ses capacités de production. Ces situations mettent parfois en danger la survie même de l'entreprise et représentent des risques d’approvisionnement pour l’avenir.
Chaque demande de hausse de prix est soigneusement examinée par le CEPS qui s’assure que la demande entre dans le champ prévu par l’article 28 de l’accord-cadre. Régulièrement, des entreprises sont déboutées ou obtiennent des hausses qui ne prennent pas en compte les effets de temps long (inflation, salaire, maintien de l'outil de production) et leurs produits restent dans une situation économique critique.
Les économistes sont clairs : si les prix sont figés et ne peuvent pas s'adapter, on risque une disparition de l'offre. Il n'y a pas d'effet d'aubaine ou de chantage dans les demandes de hausses de prix, mais des entreprises qui cherchent à continuer la commercialisation de leurs produits.
0 notes
Text
Réaction aux propos du docteur Martin Ducret qui réactive le mythe d’une France sur-consommatrice de médicaments, dans l’émission « C’est ma Santé » sur France Info le 2 avril 2023.
Il cite une étude qui affirme que les médecins prescrivent trop systématiquement de médicaments en France par rapport au Royaume-Uni, notamment « par influence des laboratoires » à travers leurs « visiteurs médicaux ».

La France n’est plus du tout la championne de la consommation de médicaments (étude IQVIA/Paris Dauphine de février 2020) :
>> La consommation française qui était nettement plus élevée que celle des autres pays en 2004 et en 2014, ne l’est plus en 2019, après une baisse de 16% entre 2004 et 2019, largement imputable aux mesures d’encadrement des prescriptions mises en place par l’assurance-maladie. Sur la même période, la consommation en Allemagne a augmenté de 27%. Les écarts se sont resserrés entre la France et l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, qui ont connu des croissances positives (respectivement +2,0%, +12,3% et +5,9%).
>> La consommation française de médicaments par habitant, toutes classes et tous statuts confondus, est ainsi désormais dépassée par l’Allemagne et est proche de celle du Royaume-Uni.
>> Dans le détail des classes thérapeutiques, la France n’occupe la première place que sur les antibactériens oraux, malgré les efforts répétés des pouvoirs publics pour en réduire l’utilisation.

Par ailleurs, les entreprises du médicament sont engagées depuis de nombreuses années dans le « bon usage du médicament », notamment via l’association ABUM, qui préconise un usage raisonné des médicaments.
0 notes
Text
Réaction à l’article "Les laboratoires vont-ils trop loin pour recruter des volontaires ?" d’Alexis Da Silva, publié dans La Croix le 24 janvier 2023.

Des informations essentielles pour comprendre l’ensemble de la situation sont passées sous silence. Le Leem souhaite les rappeler ici : • L’objectif général des essais cliniques sur des volontaires sains est d’évaluer la tolérance et la sécurité des médicaments. C’est une étape indispensable. Sans ces recherches, il n’est pas possible de mettre au point de nouveaux traitements et de les rendre accessibles aux patients qui en ont besoin. • Les recherches sont réalisées dans un cadre très strict qui prévoit un suivi renforcé pour la sécurité des participants. • Les volontaires ne sont pas rémunérés, il s’agit d’un dédommagement (temps passé, transport, hébergement). • La France est l’un des rares pays à avoir instauré un plafond maximum pour les indemnités annuelles (pas plus de 4 500 euros par an par volontaire). • Elle est également l’un des rares pays à avoir un registre exhaustif national des participants à ces recherches. • Suite à l’accident qui s’est produit il y a plusieurs années à Rennes, la France a renforcé ses mesures de pharmacovigilance en 2016.
0 notes
Text
Réaction au Communiqué de France Assos Santé sur les pénuries de médicaments du 23.11.2022
« France Assos Santé appelle le gouvernement à réintroduire dans le PLFSS 2023 une mesure, initialement prévue par l’exécutif, visant à « inciter les industriels qui disposent de produits remboursés matures et de produits plus récents à maintenir l’accès à leurs médicaments anciens ». En effet, les revendications de prix élevés sur les nouveaux produits peuvent par ailleurs être accompagnées par des choix stratégiques de certains laboratoires pharmaceutiques de concentrer leur activité sur de nouveaux produits à forte marge et donc d’abandonner l’exploitation d’autres produits matures moins rentables. »

La mesure visée ici n’aurait pas permis de résoudre les pénuries de médicaments, bien au contraire. Elle visait à conditionner l’inscription de produits innovants à l’engagement des entreprises de maintenir la commercialisation de leurs médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), sous peine d’une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente par le produit qui n’est plus accessible.
En instaurant un lien sans objet entre l’arrivée d’une innovation pour les patients et le maintien d’un médicament ancien, cette mesure aurait constitué une contrainte financière supplémentaire sur les produits matures, dégradant encore un peu plus leur condition d’exploitation en France. Les ruptures d’approvisionnement font d’ores et déjà l’objet de pénalités financières. La perspective d’une sanction supplémentaire aurait même pu inciter des entreprises à dé-commercialiser les médicaments matures avant l’arrivée d’une innovation. Le risque aurait alors été double : d’une part, appauvrir l’offre de molécules sur le territoire français et, d’autre part, retarder l’arrivée d’innovations.
Par ailleurs, les entreprises du médicament – comme les associations de patients - sont mobilisées depuis des années sur le sujet. Elles ont mis en place des mesures pour anticiper les risques et collaborent activement avec les agences sanitaires pour informer les professionnels de santé et proposer des solutions alternatives. Le Leem a lancé la plateforme TRACStocks fin 2020 pour fournir aux autorités un suivi automatique des stocks agrégés inter-entreprises sur l’ensemble du territoire national.
Malgré cette préoccupation constante des entreprises, il devient de plus de plus en plus difficile de garantir un accès aux médicaments en Europe. En effet, les causes des tensions, à la fois structurelles (insuffisance des capacités de production par rapport à l’augmentation ou à la fluctuation de la demande mondiale) et conjoncturelles (tensions d’approvisionnement en matières premières, hausse du coût de l’énergie…), sont de plus en plus nombreuses.
0 notes
Text
Réaction à l’article "Contre la résistance aux antibiotiques, la recherche et la production publique de médicaments s'imposent" de Charlotte Brives, Pauline Londeix et Jérôme Martin, publié dans Le Monde le 21 novembre 2022.

« Le désintérêt des multinationales pharmaceutiques compromet une réponse adaptée au fléau de l’antibiorésistance. »

La résistance aux antimicrobiens est un problème qu'aucun acteur ou secteur ne peut résoudre seul, et pour lequel des incitations sont nécessaires pour soutenir l'innovation.
En 2020, plus de 20 grandes sociétés pharmaceutiques se sont mobilisées et ont créé le Fonds d'action contre l'antibiorésistance (AMR Action Fund) afin d'investir près d'un milliard de dollars dans la recherche et le développement d'antibiotiques et de soutenir le pipeline pour les prochaines années. Le Fonds d'action est désormais le plus grand partenariat public-privé au monde à soutenir le développement de nouveaux antibiotiques.
Les entreprises du médicament ont appelé les gouvernements à mettre en place de nouvelle incitations économiques, des évaluations pragmatiques de la valeur des antibiotiques et des réformes de remboursement permettant l'accès. Ces dispositions sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients d'aujourd'hui et de demain.
Pour en savoir plus >> https://www.leem.org/presse/santexpo-antibioresistance-le-besoin-medical-ne-fait-pas-le-marche
0 notes
Text
Suite au documentaire d'Hugo Clément diffusé sur France 5, le 14 novembre 2022.

«Cyclamed ne recycle pas les médicaments. Ramener ses médicaments chez son pharmacien revient exactement au même que de les jeter à la poubelle, ils finissent incinérés. »

• Les médicaments non utilisés (MNU) qui entrent dans le circuit Cyclamed sont tous incinérés dans des unités de valorisation énergétique (UVE) pour ordures ménagères, conformément à la réglementation (Article R. 4211-27 du Code de la Santé Publique), UVE qui fournissent de l’électricité ou de la chaleur pour éclairer ou chauffer des logements et établissements publics.
• Il est essentiel de rapporter ses médicaments en pharmacie car le circuit Cyclamed protège de 2 risques majeurs :
O L’insécurité sanitaire : les poubelles d’ordures ménagères sont régulièrement fouillées, avec tous les risques encourus de détournements, d’utilisations inadaptées et de circuits parallèles de revente de médicaments. La précaution est d’autant plus de mise pour les piquants/coupants/tranchants à risque infectieux utilisés par les patients en auto-traitement (exemples : seringues, stylos à insuline…) : leur collecte se fait également en pharmacie et un circuit d’élimination dédié a été créé par les entreprises pharmaceutiques (co-organisme DASTRI depuis 2012).
O La pollution : 35 % des ordures ménagères sont enfouies dans les sols, et non pas incinérées, avec des risques potentiels de pollution des eaux de surface ou souterraines. Via Cyclamed, c'est l'intégralité des déchets qui est incinérée et valorisée énergétiquement. A l'heure de la crise énergétique, il faut s'en réjouir.
O 87 % des Françaisen 2022 ramènent leurs MNU en pharmacie, selon une étude BVA ; un geste à encourager si l’on veut protéger la santé des humains et de la planète.
0 notes
Text
Suite à la publication, le 1er septembre 2022, de « Combien coûtent nos vies », un essai politique très partisan

Vive critique de tout un secteur industriel, du gouvernement et de la société libérale en général, « Combien coûtent nos vies » est un manifeste de deux auteurs engagés qui tentent de faire passer leur vision idéologique de la politique du médicament pour une enquête objective.
Il ne faut pourtant pas s’y méprendre. Bien que leur travail fasse preuve d’une certaine qualité d’écriture et de pédagogie, il n’échappe pas à deux écueils. Le premier en frôlant le complotisme avec de présupposées relations masquées entre les entreprises du médicament et les institutions. Le second en essayant de dégager des théorèmes généraux à partir d’exemples précis dans le monde entier sur des médicaments très spécifiques.
Nous l’aurons compris, la volonté de Pauline Londeix et de Jérôme Martin est avant tout politique. Il s’agit de changer radicalement le système, notamment en nationalisant puis en « internationalisant » le système de santé et de production des médicaments. C’est d’ailleurs l’objectif affiché de leur association « OTMeds ».
Chacun son plaidoyer. Celui-ci s’affranchit néanmoins de nombreux éléments contextuels et laisse supposer aux lecteurs de cet essai que cela serait simple et efficace à mettre en place.
Comme si les conditions de la concurrence n’étaient pas réglementées au niveau international. Comme si un opérateur public ne devait pas être soumis aux mêmes règles de production qu’un opérateur industriel.
Comme si un opérateur public national pouvait aller chercher des principes actifs sur le marché chinois dans de meilleures conditions qu’une multinationale industrielle produisant pour 150 pays.
Comme si un opérateur public était capable de produire à des coûts de production compétitifs par rapport à un opérateur privé (sachant qu’il faudrait probablement injecter plusieurs milliards pour créer un nouvel outil de production).
Comme si demander à un opérateur public de produire des médicaments matures sur la base des tarifs de remboursement actuels – et donc à perte – serait sans incidence sur les finances de l’Assurance maladie et sur le contribuable.
Et la liste pourrait être encore plus longue.
La crise l’a mise en évidence, mais la fragilisation importante de l’outil industriel français est une réalité sur laquelle le Leem alerte depuis des années. Sur 89 autorisations de mise sur le marché au niveau européen en 2020, seuls 8 médicaments étaient produits en France, loin derrière l’Allemagne, l’Irlande et l’Espagne. Nous avons perdu une autonomie stratégique complète pour certains produits, notamment les produits les plus anciens, principalement issus de la chimie.
Mais soyons lucide. Individuellement, aucun pays n’a la capacité d’être autonome au niveau de sa production, de sa recherche et de son innovation dans le médicament. En outre, induire une compétition sanitaire entre les pays européens aurait des conséquences catastrophiques sur le plan politique, économique, logistique et sanitaire. Nous devons la jouer collectif.
Bien des réponses aux sujets soulevés par ces deux activistes résident sûrement dans un surcroît d’Europe. Et les choses avancent dans le domaine des essais cliniques, de l’évaluation scientifique, de la politique industrielle et de l’accès des patients aux médicaments. Autant d’initiatives soutenues par le Leem.
Pourtant, cet essai politique ignore délibérément ces perspectives européennes, préférant s’inspirer de modèles très discutables, éloignés et peu transposables dans notre pays. Heureusement, nous nous accordons sur une note finale positive : des solutions existent.
0 notes
Text
Suite à la publication de l’article « En pharmacie le prix de certains produits s’envole » dans Le Parisien du 1er août 2022

Le Leem souhaite apporter quelques précisions sur l’évocation de ces hausses de prix.
“Depuis deux ans, les labos et les industriels ont réévalué les tarifs de certains articles et médicaments vendus sans ordonnance et ne justifient pas toujours ces hausses”.

Attention à ne pas laisser croire par un raccourci que les prix des médicaments remboursés augmentent. Il faut clairement distinguer les médicaments et la parapharmacie. La quasi-totalité des produits cités par Le Parisien ne sont pas des médicaments.
Les prix des médicaments remboursables sont administrés par l’Etat. La fixation de leur prix est un processus strictement encadré par la loi et dont la responsabilité incombe au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS). Ce prix légal ne peut en aucun cas augmenter au gré de l’inflation ou de la volonté des entreprises.
Et pourtant, l’industrie pharmaceutique est fortement impactée par les conséquences de la situation économique et géopolitique actuelle (hausse du coût des matières premières et de l’énergie, ruptures d’approvisionnement d’éléments de conditionnement, inflation généralisée).
Elle se retrouve prise en étau entre des coûts de production en forte hausse et ses prix finaux qui ne peuvent s’ajuster à ces contraintes.
Cette situation touche particulièrement les petits fabricants, les entreprises produisant en Europe et les acteurs intermédiaires de la chaîne du médicament.
0 notes
Text
Réaction du Leem à la publication de l’interview de Gautier Centlivre dans Alternatives Economiques du 12 juillet 2022

Suite à l’interview de Gautier Centlivre, coordinateur plaidoyer à Action Santé Mondiale, dans le journal Aternatives Economiques, le Leem souhaite apporter des précisions concernant des allégations erronées ou approximatives visant directement les entreprises du médicament.
- « MSF a réalisé une cartographie indiquant qu'une centaine d'unités de production dans les pays en développement seraient capables de produire des vaccins ARNm Covid-19. Or, ces sites n'ont jamais été sollicités pour le faire par les groupes pharmaceutiques, même au plus fort de la crise. »

Parmi les sites de production répertoriés dans la cartographie réalisée par Médecins sans Frontières en décembre 2021, nombre d’entre eux ont fait l’objet de partenariats avec l’industrie pharmaceutique. C’est le cas de Samsung Biologics en Corée du Sud avec qui Moderna a mis en place un accord de services de fabrication et d’approvisionnement. Ou encore d’Aspen Pharmacare en Afrique du Sud avec qui Janssen Pharmaceuticals a conclu un accord de fabrication de son vaccin.
De façon générale, les entreprises de médicaments ont choisi de participer à l'effort mondial contre la pandémie en multipliant les partenariats de fabrication et de production qui s’élèvent aujourd’hui à 381 accords à travers le monde. Ce sont les laboratoires qui ont mis en place ces licences volontaires, ce qui explique d’ailleurs l’absence constatée de recours aux licences obligatoires.
- A la question "Qu'a fait l'industrie pharmaceutique pour aider le monde à sortir de cette pandémie ?", Gautier Centlivre parle de la mise au point des vaccins « grâce à l'argent public ». Rappelons tout de même que les start-ups, telles que BioNTech et Moderna, essentiellement financées par des investisseurs privés, ont travaillé pendant 10 ans au développement de la technologie à ARN messager sans réaliser le moindre bénéfice. Se faisant, elles ont pris d’énormes risques (en 2007, la société qui a précédé BioNTech a failli fermer). Des financements publics sont arrivés une fois la pandémie déclarée, pour accélérer le développement et la production de certains vaccins anti-Covid. Et encore, pas pour tous. Moderna a ainsi reçu 1,5 Md$ de l’opération américaine Warp Speed en mai 2020 et 1 Md$ du BARDA. Mais BioNTech a refusé l’aide de Warp Speed et préféré nouer un partenariat avec Pfizer (800 M$) et des fonds privés de Singapour (222 M$). Elle n’a reçu que 375 M€ de fonds publics allemands. Quant aux pré-commandes des Etats, ce ne sont pas des financements, seulement des avances de trésorerie, pour accélérer le développement et la production.
En général, la mise au point et la production de vaccins exige beaucoup d’investissements et de temps pour une rentabilité pas toujours assurée. Dans le cas du Covid, il y a encore 353 candidats-vaccins à l’étude, pour seulement 5 commercialisés en Europe. Et c’est la même chose pour les traitements. Nombreux sont ceux qui auront pris des risques et qui auront échoué. Le succès n’est jamais garanti.
Nous déplorons, comme Gautier Centlivre, les inégalités d’accès aux vaccins Covid, comme aux autres produits de santé. En juillet 2021, l’OMC avait identifié 27 goulets d’étranglements à la production et la distribution des vaccins, pour la plupart administratifs et réglementaires. Le Leem avait alors demandé aux gouvernements de supprimer les restrictions commerciales, de partager les doses et de préparer les systèmes de santé à déployer la vaccination. Car ce sont ces sujets qu’il faudra adresser en priorité pour améliorer l’équité d’accès. L’industrie pharmaceutique n’est pas un rempart mais, au contraire, un allié engagé dans ce combat. Le 19 juillet 2022,la Fédération internationale des industries du médicament (IFPMA) a formulé, sous l’appellation de « Déclaration de Berlin pour l’équité d’accès en cas de pandémie », une proposition destinée à garantir l'approvisionnement précoce en vaccins, traitements et diagnostics des populations qui en ont le plus besoin lors de futures pandémies.
Enfin, si comme le souligne l’auteur, "nous sommes très loin d'en avoir fini avec le Covid », nous aurons besoin de ces centaines de vaccins et traitements en développement. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons encourager la recherche sur ces molécules en continuant les investissements et en assurant un cadre juridique solide de propriété intellectuelle pour ceux qui les réalisent.
0 notes
Text
Suite à la publication de l’article "Lait infantile, hygiène... les prix des produits parapharmaceutiques gonflent" sur le site de BFM Business le 7 juillet 2022

Le Leem souhaite faire une mise au point pour éviter tout amalgame.
“Invoquant le contexte géopolitique actuel, les laboratoires pharmaceutiques augmentent leurs prix les uns après les autres. Pourtant, d'importantes hausses ont déjà été actées en janvier. Ces augmentations de prix sont surtout pratiquées par les grands laboratoires, pourtant plus susceptibles de rogner sur leurs marges”.

Il ne faut pas confondre articles de parapharmacie dont les prix sont libres, et médicaments, dont les prix sont administrés.
La fixation du prix des médicaments remboursables en France est un processus strictement encadré par la loi et dont la responsabilité incombe au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS). Ce prix légal ne peut en aucun cas augmenter au gré de l’inflation ou de la volonté des entreprises. C’est même l’inverse qui se produit : chaque année, le CEPS remplit un objectif de baisses des prix des médicaments ; il est de 830 M€ pour 2022.
L’industrie pharmaceutique est impactée par les conséquences de la situation économique et géopolitique actuelle (hausse du coût de l’énergie et des matières premières, ruptures d’approvisionnement d’éléments de conditionnement, inflation généralisée). Elle se retrouve prise en étau entre des coûts de production en forte hausse et ses prix finaux qui ne peuvent s’ajuster à ces contraintes. Cette situation touche particulièrement les petits fabricants, les entreprises produisant en Europe et les acteurs intermédiaires de la chaîne du médicament. La faillite de ces acteurs pourrait entraîner des ruptures d’approvisionnement, donc des conséquences dramatiques pour la santé des Français. Afin de soutenir et prévenir la défaillance des acteurs les plus fragiles, le Leem porte actuellement devant les pouvoirs publics un plan d’urgence.
0 notes
Text
Suite à la parution de l’article « Brevets : comment les labos pervertissent le système » publié dans Que Choisir en juin 2022.

Le Leem souhaite apporter des précisions sur la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les pratiques européennes.
« Les entreprises pharmaceutiques ont développé une stratégie pour retarder l’arrivée des médicaments concurrents et génériques en prolongeant le plus possible les protections juridiques de leurs produits les plus rentables ».

La propriété intellectuelle a permis des avancées thérapeutiques majeures pour les patients et elle stimule de façon importante la recherche et le développement.
L'evergreening est une expression péjorative pour décrire la pratique qui consisterait à breveter une série d'inventions afin de prolonger de manière injustifiée la durée de protection contre la concurrence des génériques. Cette accusation est infondée.
Il existe différents types d’inventions brevetables réalisées tout au long du développement d’un médicament (principe actif, procédé de fabrication, indication thérapeutique, formulation…). Un laboratoire qui détient un brevet sur un principe actif peut ensuite déposer un brevet pour une nouvelle indication thérapeutique de ce même principe actif. Cela se justifie par le fait que la recherche et développement sur de nouvelles indications thérapeutiques implique des recherches longues et coûteuses. Mais la portée de la protection par brevet sera limitée à cette indication précise et ne prolongera pas la durée de protection du brevet sur le principe actif. En outre, aucun brevet relatif à des améliorations ultérieures du produit original ne peut empêcher l'entrée d'une version générique du produit original.
Par ailleurs, l’accusation de dépôt brevets sur des modifications « mineures » ou « inutiles » - destinés à prolonger la période de protection contre la concurrence des génériques - est également erronée. La délivrance d’un brevet se fait par l’office européen et les offices nationaux sur la base de critères objectifs précisés par la loi et d’une évaluation rigoureuse. Il faut « justifier une solution technique à un problème technique, qui doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle » (1). Par exemple, un conditionnement d’ampoules d’injections qui sécurise le transport des ampoules et les rend plus facilement manipulables par les infirmiers, peut être breveté.
(1) https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/les-criteres-de-brevetabilite
0 notes