Text
S’opposer au concept de résilience ? Enjeux politiques et musicaux d’une notion.

En février 2021 sortait l’ouvrage de Thierry Ribault illustrant un tournant participationniste des politiques publiques par l’expérience de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Contre la résilience, à Fukushima et ailleurs ( l’ouvrage de Thierry Ribault, publié à l’Échappée ) propose de défaire ce que serait une « idéologie » de la résilience, accusé de se « faire passer pour la réalité alors qu’elle ne fait qu’exorciser la catastrophe, la dépouillant de son caractère profane en la consacrant »[1] À partir de cet ouvrage, en somme très pertinent concernant l’expérience japonaise, il convient de se demander si la résilience serait l’équivalent de la pensée confondant mérite et malheur.
À l’heure d’une crise sanitaire sans fin, où les gouvernements demandent à toutes et à tous résilience et patience, comment l’expérience politique de la résilience nucléaire japonaise permet-elle d’éclairer celle, actuelle, issue de la pandémie de covid-19 ? Comment la techno apparaît comme révélateur, ou point aveugle, de cette résilience dans le discours gouvernemental ?
De l’utilisation d’une notion à un concept
Revenons tout d’abord à l’avènement de la notion. La résilience, c’est tout d’abord un héritage sémantique lié aux matériaux. Le terme traduit leurs capacités à « absorber de l’énergie sous l’effet d’une déformation ou d’un choc, avant de revenir à un état initial ». Adaptation et solidité, donc.
Depuis les années 40, la notion est utilisée principalement en psychologie positive puis elle rentre principalement dans le champ de l’écologie dès les années 1970, face à la catastrophe annoncée. À partir des années 1990 et 2000, la notion est associée à un ensemble d’« expériences douloureuses » individuelles ou collectives (maladies, deuils, catastrophes naturelles, crises économiques/sociales/ sanitaires, etc.)
En France, la notion a été importée et popularisée principalement par les travaux du neuropsychiatre Boris Cyrulnik pour aider notamment les agents faisant face à toutes sortes de traumatismes et d’épreuves. D’inspiration Nieztchienne, même si le trauma percute et laisse son empreinte dans le corps, la résilience permettrait de sublimer l’expérience, en tout cas, de continuer d’exister.
Et c’est ici que Thierry Ribault intervient : la résilience est dangereuse, principalement en politique publique.
Faite d’adaptation et de pliage, la résilience a pour objectif de se renforcer en quelque sorte après ladite épreuve.
Pour Ribault, plus simplement, elle est « l’art de prétendre résoudre l’impossible ». Si cette notion est désormais rentrée dans le langage commun – en témoignent les nombreux appels à la résilience depuis plus d’un an – la notion peut devenir concept politique lorsqu’elle est la solution, et non plus seulement une façon de faciliter les solutions à apporter, car « c’est là le principe de la résilience : préparer les récepteurs au pire sans jamais en élucider les raisons ».
Préparer au pire : confinements sur confinements, plus de musique techno depuis plus d’un an. Prévisions annoncées : 2021 sera l’ère des épidémies, il faudra faire face. Mais comment faire face ? En s’habituant ? En étant « résiliant » ?
On a vu que finalement, fin avril 2021, les confinements à la chaîne et le couvre-feu à 19h depuis presque sept mois constituent une nouvelle habitude – certes douloureuse – mais qui fut finalement globalement très respectée : est-ce le bien-fondé de la mesure ou la peur de perdre de l’argent face à la menace (une amende de 135 euros) qui convainquit les agents d’être résilient, de s’adapter ? Peut-on parler d’individus résilients ? Comment y faire face sans déprimer ?
Finalement, cela risque d’être l’enjeu central de la période post-covid. Récemment, radio parleur se demandait si la souffrance et la santé mentale des français était politique. Est-ce qu’accéder à la résilience, c’est un acte politique ? Il me semble que ce serait plutôt tenter de sortir une oreille du tunnel, se reposer (un peu) parmi les difficultés.
Mais alors, maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? On attend ? Et jusqu’à quand ? Nous prenons peur collectivement en apprenant que le covid risque d’être un petit apéro sanitaire face à ce qui pourrait nous attendre ? Et si, plutôt, on réfléchissait à pourquoi le covid est apparu ? Comment faire pour qu’il ne soit plus ?
« Fukushima comme Covid-19 constitue désormais un concept en soi, une abstraction anhistorique qui (…) fait passer pour une entité objective ce qui est un fait social » .
Dans ce sens, Eva Illouz indique que le concept de résilience ne doit pas servir la cause néo-libérale, ou, de façon mieux dite, « ne doit pas faire accepter la violence de la société ultra-compétitive ». Mais n’est-ce pas, justement, ce qui est en train de se passer actuellement ?
Résistance, fabrication du monde et ignorance organisée : la thèse de Ribault
Reprenons l’ouvrage de Ribault. Sa thèse principale est la suivante : la résilience s’appuie sur une non-connaissance, une sorte d’ignorance organisée qui permettrait de passer outre les risques annoncés. À Fukushima, cela s’illustre par la volonté des pouvoirs publics de permettre le retour des habitants sur les terres contaminées : les terres ne seraient plus contaminées, et, même si le recul scientifique manque (de la même manière que le débat autour du déploiement de la 5G en France), l’affirmer permet de devenir résilient, de « continuer à vivre ». Or, les risques encourus sont réels : être résilient, serait-ce prendre le risque de continuer à vivre comme si l’événement n’avait pas eu lieu, finalement ?
En tout cas, l’exemple de Fukushima mais aussi du Covid-19, censés pouvoir permettre de penser au « monde d’après » ne semblent pas avoir au cœur des réflexions qu’ils soulèvent les raisons du désastre pour en sortir : le nucléaire d’un côté, le mode de vie capitaliste de l’autre. (« Préparer au pire sans jamais élucider les causes », donc.)
Cela revient à une « technologie du consentement » et à une « idéologie de l’adaptation » qui entraine une « culture du risque » ( politique du coup risque/bénéfice) mais aussi, et surtout, une responsabilisation individuelle.
Les gestes barrières ! Et puis, s’il arrive malheur, le non-respect de la consigne sera ciblé par les pouvoirs publiques comme première cause de responsabilité : pas le nucléaire, pas le mode de vie qui détruit les écosystèmes, etc. mais bien les façons dont les individus vivent avec les dangers.
La musique techno, un facteur de résilience politique ?
La résilience semble aussi être facteur du déploiement de la musique techno : face à la désindustrialisation de la ville de Detroit, du chômage montant et du travail difficile à l’usine pour les agents qui en bénéficient toujours, la machine aliénante devient objet de création.
La techno naît en effet de cette récupération de l’objet de travail ; la machine ; à un objet de création musical qui deviendra par le biais un objet politique.
En effet, Encontre s’attache à montrer les liens entre contestations sociales et musiques technos, et la démonstration de la machine comme objet politique de création peut être retrouvé ici.
Quand cette machine deviendra importante et cristallisera l’attention et les populations dans les clubs, et que des États comme l’Angleterre obligerons ces derniers à fermer à 1 ou 2 h du matin – interdisant de facto à la musique techno de subsister – les subcultures se réinventeront et évolueront en créant les Free parties et les teufs dans les années (1990).
En 2020 et 2021, les clubs sont fermés. Les free et les teufs recherchés, brandies comme des ennemies publiques numéro 1, mettant la vie d’autrui en danger.Si la musique techno est un exemple résilience, elle est pourtant un « mauvais exemple » pour le gouvernement, une sorte de « mauvais » risque, celui pris à danser ensemble, a contrario du « bon risque » qui serait de travailler ensemble.
Serait-il le moment de remettre en cause ce concept, et cette adaptation constante qui lui est propre, en réfléchissant foncièrement à la manière dont il est possible de vivre, sans Etat sécuritaire et capitaliste ?
[1] Voir L’ouvrage de Thierry Ribault, Contre la résilience, à Fukushima et ailleurs, l’Échappée, 2021
3 notes
·
View notes
Link
Encontre réalise un entretien avec Aggressively trans pour Radio Parleur.
2 notes
·
View notes
Text
Hirak en Algérie, l’invention d’un soulèvement. Fiche de lecture de l’ouvrage paru en février 2020 sous la direction de Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui et Salima Mellah.

«À l’internationale, c’est la surprise » [1]
Dans une vidéo parue sur le site internet du journal Le monde retraçant l’enjeu de l’élection présidentielle de décembre 2019[2]en Algérie, la journaliste, Laureline Savoye dresse un portrait des dix derniers mois allant du début du hirak en février 2019 à l’élection fort contestée de décembre 2019.
Elle y évoque ainsi une « surprise » pour les médias internationaux concernant l’enclenchement du mouvement.
Pourtant, nombre de signes avant- coureurs laissaient présager le hirak : cela est d’ailleurs une des principales apport de l’ouvrage Hirak en Algérie, l’invention d’un soulèvement dirigé par Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui et Salima Mellah : si nombres de médias internationaux avaient délaissés la question des révoltes aglériennes , celles-ci ne cessaient pas d’exister pour autant.
Paru aux éditions La fabrique à la fin du mois de février dernier, l’ouvrage retrace le début du mouvement du hirak- du début du mois de février au mois de novembre 2019, avec une volonté tenace : informer le public français des évolutions du mouvement, tout d’abord à partir d’une étude des origines du mouvement ( chapitre 1 : Aux origines du mouvement) puis de son déroulement ( chapitre 2 : un mouvement d’une puissance extraordinaire) et enfin du traitement médiatiques à l’étranger ( chapitre 3 : les réactions du régime et des puissances étrangères) .
Évoquant un « tournant historique » (nom donné à l’introduction) le Hirak du peuple Algérien est ici raconté par 18 articles écrits par 16 auteurs différents. Ils sont ici présentés par La fabrique comme « journalistes et professionnels algériens ayant participé au mouvement, ainsi que celles de spécialistes du pays, algériens et français. » Cet ouvrage est une initiative de l’association Algeria-Watch, association algérienne créée en 1997 pour dénoncer les violations des droits humains et « faire connaître les réalités de son régime et de sa société ». Souhaitant « analyser les effets du hirak sur le pouvoir » , cette ouvrage pose également la question de la construction de savoir.
Je travaille cette année, pour mon mémoire dans le cadre d’un master en sociologie sur les transferts entre les savoirs militants et les savoirs dits « théoriques » dans la maison d’édition la Fabrique. il me paraissait, compte-tenu de la diversité des profils ( entre universitaires, journalistes, et/ ou manifestants etc) intéressant d’analyser cet ouvrage sous un angle critique de la construction d’un savoir « français » ( ou du moins accessible en France) sur le hirak en Algérie. Autrement dit, je chercherai, dans cette fiche de lecture critique, à comprendre la construction d’un savoir ( qui le créer ? ) et comment sa légitimité est accordée ( ou non ?) .
Ainsi, je commencerai par étudier la volonté d’informer, d’un traitement du hirak « bancal » sur la scène internationale au projet d’ouvrage de l’association Algeria-Watch.
Ensuite, je me questionnerai sur les transferts entre les savoirs des luttes et, justement, les luttes de savoirs.
Dans un troisième temps, j’analyserai pourquoi nous pouvons dire que l’Hirak est « une insurrection qui n’est pas tombée du ciel ».
Enfin, dans une dernière partie, j’évoquerai le début d’une sociologie du mouvement opérée par l’ouvrage.
I. La volonté d’informer. D’un traitement du hirak « bancal » sur la scène internationale au projet d’ouvrage d’ Algeria-Watch
A) Le traitement médiatique du hirak à l’international
« Ce mouvement, par son originalité et son ampleur, contredit directement un certain nombre de représentations et d’idées reçues sur la société, perçue comme repliée sur ses conservatismes. »
Dans le dernier article de l’ouvrage, « le hirak sur la scène internationale » écrit par Omar Benderra, l’auteur analyse la façon dont le hirak a mis de nouveau l’Algérie « sous le feu des projecteurs médiatiques » avec comme axe principal l’idée que les médias internationaux mainstream[3], si ils n’évoquaient pas l’Algérie d’une façon tronquée, n’en parlait pas ou peu. C’est ainsi que nous pouvons relier cette idée à la « surprise » évoquée en introduction par le journal Le Monde.
Avant d’évoquer les réactions décrites par Benderra à partir du 22 février, premier acte de la contestation populaire, il convient de revenir sur l’absence de traitements journalistiques politiques à l’étranger, comme le fait François Gèze lors de son article « Une démocratie de façade, une société verrouillée ». Il parle ainsi d’un « aveuglement ( volontaire ?) de la communauté internationale », affirmation donnant lieu à une partie de l’article. Dans celle-ci, il y énonce une couverture des événements par les médias occidentaux « restée largement engluée de longue date par les officiers du régime » . En prenant l’exemple français, il réalise une argumentation basée sur une socio-histoire du traitement médiatique de la politique Algérienne à partir des médias français. Ainsi, des « biais idéologiques- comme le racisme antimusulman » ont favorisé un « aveuglement et désinformation durant les années de la « salle guerre », un désintérêt croissant pour l’ Algérie des médias à partir des années 2000 » et une « faiblesse de la recherche universitaire ».
Pourtant, il indique quelques réussites journalistiques françaises à partir des années 80 ( citant les travaux de Garçon, Stolz, Simon, Gentile, Dissez, Rivoire, Yous, Souaïdia ou encore Matoub) qui doivent faire face, si ils ne se tiennent pas aux « discours de propagande » aux généraux sous leur vrai visage, celui d’assassins dont les escadrons de la mort n’hésitent pas à s’acharner sur (…) des journalistes » [4]Ce qui, dès lors, a entraîné dans les médias français ( et plus largement internationaux) un abandon des investigations sur la politique algérienne, « conscients des manipulations » et « devenant, à leurs yeux, trop compliquée ».
Cela s’explique par ailleurs par le tournant post -2001, où la propagande des dirigeants algériens se fit passer pour un allié évident à l’internationale contre le terrorisme, ce qui contribua à faire oublier les crimes de guerres connus sous leurs nom à l’internationale.
Dès lors, en février 2019, le hirak apparaît comme une « surprise » pour les médias internationaux.
En revenant à l’article d’ Omar benderra, qui porte justement sur ce sujet , il indique que lorsque les médias étrangers parlent de l’Algérie, ils renvoient à une image « tronquée » , abîmée par la guerre contre les civils de 90, « ses manipulations, ses massacres et ses distorsions » qui ont orienté une opinion internationale vers une perception « d’une conflictualité manichéenne opposant des islamistes barbares à une armée, certes sanguinaire, mais « républicaines » et certainement mieux disposée à l’égard de l’occident que les partisans d’une théocratie médiévale ».
De cette image tronquée, créant une « surprise » début février 2019, François Gèze retient des médias algériens comme internationaux la persistance, au début du mouvement, à parler d’une révolte uniquement contre Bouteflika plutôt que comme une révolte globale : il me semble que c’est de cela que part la volonté de l’association Algeria-Watch de rédiger l’ouvrage Hirak en Algérie, l’invention d’un soulèvement. Par une volonté d’informer.[5]
B) Une initiative de l’association Algeria-Watch
Créée en Europe (Allemagne) en 1997, cette association anime le site internet du même nom disponible en anglais, français et allemand. Sur ce site, sont disponibles de nombreux rapports et documents relatifs aux violations des droits humains en Algérie. Il y’a également des articles et des témoignages. En France, Algeria-Watch existe depuis 2002 comme une association : les membres sont bénévoles. Sur leur site internet, les deux principaux objectifs de l’association sont détaillés comme suit :
« Le double objectif de l’association Algeria-Watch est :
– de rassembler les informations permettant de mieux comprendre les ressorts complexes de la guerre qui déchire l’Algérie depuis 1992, provoquant des ravages tant sur le plan humain (150 000 à 200 000 morts, des centaines de milliers d’orphelins, des dizaines de milliers de torturés, plus de 10 000 disparus, au moins 1,5 million de personnes déplacées, plus de 500 000 exilés, etc.), que sur les plans économique, écologique et éthique ;
– de prendre et soutenir toute initiative visant au rétablissement de la paix, la vérité et la justice en Algérie. »
Ici, ce qui nous intéresse tout particulièrement est de comprendre la volonté d’informer, la volonté de la création d’ouvrage sur le hirak paru en France de la part d’ Algeria-Watch.
Ainsi, l’association permet à des contributeurs (journalistes, activistes et des citoyens algériens ) ayant suivi le mouvement de partager leurs analyses, et c’est en cela que l’ouvrage détient une approche originale, que nous détaillerons dans les prochaines parties.
II. Savoirs des luttes, luttes des savoirs
Après avoir étudié l’intention première de l’association et des auteurs, nous aimerions, dans cette partie, nous interroger sur les légitimités accordées aux luttes, analyser la façon dont un savoir particulier est créé sur le hirak.
Le séminaire Savoirs des luttes, luttes des savoirs[6]interroge la façon dont sont construits les savoirs sur les luttes sociales mais aussi leurs liens avec une lutte des savoirs, qui sous-entend une opposition entre un savoir dit théorique et un savoir empirique. Je souhaiterai, dans cette partie, étudier les transferts possibles entre ceux deux formes de savoirs, à partir du questionnement proposé par le séminaire.
Je procéderai par une étude biographique des auteurs : autrement dit, je m’interrogerai sur la façon dont les parcours légitiment un certains savoirs sur le hirak.
Ainsi, l’association Algeria-Watch indique laisser place à des activistes et des citoyens algériens ) ayant suivi le mouvement construire un savoir.
A) La direction de l’ouvrage
Auteurs
Biographie par La fabrique
Nom des articles
Omar Benderra
Né en 1952, économiste, ancien président de la Banque publique en Algérie, a été chargé de 1989 à 1991 de la renégociation de la dette nationale. Consultant indépendant, il est l’auteur de nombreux articles sur la politique et l’économie algériennes.
Introduction ; « La benqueroute au bout de la dictature » ; « le hirak sur la scène internationale » ‘ III)
François Gèze
Né en 1948, éditeur, a dirigé de 1982 à 2014 les Éditions La Découverte, où il a notamment publié de nombreux livres consacrés à l’histoire de l’ Algérie coloniale et à l’ Algérie contemporaine. Il est membre depuis 1998 de l’association Algeria-Watch et a publié de nombreux articles sur son site.
Introduction ; « une démocratie de façade, une société verrouillée » ( I)
Rafik Lebdjaoui
Né en 1966, journaliste, est membre de l’association Algeria-Watch.
Introduction ; « Quand les artistes deviennent partie prenante du hirak » ( II) ; « le lexique du hirak : la bataille des mots »
Salima Mellah
Née en 1961, journaliste, a crée en 1997 l’association Algeria-Watch, consacrée à la dénonciation des violations des droits humains en Algérie, qu’elle anime depuis lors. Elle est l’auteure de nombreux rapports et études sur les violations des droits humains dans les pays arabes.
Introduction ; « le rôle majeur du traumatisme de la « sale guerre » des années 90 » ( I) ; « Février- novembre-2019 : chronologie de la révolte populaire contre le régime Algérien »
Parmi les quatre auteurs qui dirigent l’ouvrage, nous trouvons la créatrice de l’association Algerian-Watch ( Salima Mellah, qui est journaliste algérienne, qui vit à Berlin ) et trois proches collaborateurs de l’association : François Gèze, éditeur, universitaire, écrivain, français) un journaliste ( Rafik Lebdjaoui) et une économiste vivant en France, Omar Benderra.
Ainsi, les quatre parcours biographiques se ressemblent en tout point : tous font partis de l’association Algeria-Watch, sont journalistes ou exercent une activité de journaliste ( écriture d’articles ou d’ouvrages journalistiques). 2 sont des algériens ayant émigrés en Europe et un français ; ce qui expliquerait la possibilité de diriger cet ouvrage sans risque de représailles du pouvoir.
B)Les contributeurs
Auteurs
Biographie par La fabrique
Noms des articles
Zineb Azouz
Née en 1969 à Constantine, est diplômée en statistique mathématique et enseigne cette discipline à l’université de Constantine. Elle est l’auteure de nombreux articles sur la politique algérienne, la biométrie et la vaccination, publié sur Algeria- Watch, Hoggar, AlgeriaNetwork et sur son site.
« À Constantine, le réveil politique de la cité » ( II)
Houari Barti
Né en 1973 à Oran, est journaliste au Quotidien d’Oran depuis 2004.
« À Oran, le hirak nous a réveillés de notre torpeur » ( II)
Abdelghani Badi
Né en 1973, avocat à la Cour d’ Alger depuis 1999, est le président du bureau d’ Alger de la ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme depuis 2013, et vice-président de la Fédération arabe des centres des droits de l’homme.
« Entretien : une répression ciblée, la justice instrumentalisée » (II)
Amine Bendjoudi
Né en 1989 à Alger, titulaire d’un master en intelligence artificielle de l’ USTHB, est photographe indépendant, scénariste et digital manager.
« Les mouches électroniques » de la police politique sur les réseaux sociaux » ( II)
Hocine Dziri
Né en 1972, journaliste à Alger, a publié plusieurs articles en Algérie à l’étranger.
« La couverture très orientée du hirak par les médias algériens » ( II)
José Garçon
Née en 1949, membre de l’ Observatoire de l’ Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la fondation Jean-Jaurès, journaliste à Libération de 1974 à 2008, est spécialiste du Maghreb et plus particulièrement de l’ Algérie.
« Un régime opaque et corrompu, habité d’un profond mépris du peuple » ( I) ; « La périlleuse mise à nu d’un ordonnancement mafieux »
Hadj Ghermoul
Né en 1981, père de deux enfants, milite au sein du comité national pour la défense des droits des chômeurs.
« Entretien : « ce peuple ne rentrera pas chez lui tant qu’il n’aura pas trouvé sa dignité » ( II)
Hocine Malti
Ingénieur des pétroles, a participé au lancement de la Sonatrach ( créée en décembre 63) dont il a été vice-président de 1972 à 1975. Aujourd’hui consultant pétrolier, il est l’auteur de Histoire secrète du pétrole algérien et de nombreux articles sur l’économie algérienne.
« La spectaculaire et ambivalente offesnive anticorruption, une grande victoire du hirak » ( III)
Hasssina Mechaï
Née en 1978, journaliste franco-algérienne, travaille pour différents médias internationaux et français, dont le point, middle east eye, Ehko, Ballast.. Elle s’intéresse à la gouvernance mondiale, à la société civile et au soft power médiatique et culturel.
« la résurgence de la mémoire de la lutte contre le colonialisme français » ( II)
Mohamed Mehdi
Né en 1965, est le pseudonyme de Lazhar Djeziri, journaliste au quotidien d’ Oran. Ingénieur de formation, il a commencé le journalisme fin 94 à l’ Hebdo libéré, avant de rejoindre l’équipe de La Nation puis de Libre Algérie.
« trois fragments de vie à l’ombre du hirak » ( II)
Ahmed Selmane
Né en 1957, politologue et journaliste, est l’auteur de plusieurs études dans des revues spécialisées sur le système politique et les médias algériens, et a notamment collaboré à l’hebdomadaire la nation.
« une insurrection qui n’est pas tombée du ciel » ( I)
Habib Souaïdia
Né en 69, ancien militaire, est l’auteur de La Sale guerre. Le témoignage d’un ancien officier des forces spéciales de l’armée algérienne et de nombreux articles publiés sur le site Algeria- Watch. Il vit en France depuis 2000, où il est réfugié politique.
« Face à la mobilisation populaire, un pouvoir fragilisé par la lutte des clans »
Ici, nous remarquons principalement que la direction d’ouvrage a permis à des auteurs restés « sur le terrain » de partager leurs analyses à un public français en publiant à la maison d’édition française La fabrique : en majorité journalistes, Hadj Ghermoul, décrit comme « militant et manifestant » et le seul à apparaître sans avoir un statut particulier de journaliste ou d’universitaire : ce qui est intéressant, c’est que sa parole est donnée, légitimée dans un cadre journalistique, sociologique : celui de l’entretien qui cadre le discours et la pensée.
Après avoir travaillé principalement sur la forme de l’ouvrage, les deux prochaines parties traiteront principalement des savoirs énoncés dans ce dernier. Tout d’abord, dans cette partie, nous verrons pourquoi, comme Ahmed Selmane, nous pouvons indiquer que l’hirak est « une insurrection qui n’est pas tombée du ciel » puis nous verrons comme les auteurs analysent les éléments sociologiques du mouvement.
III. L’Hirak, « une insurrection qui n’est pas tombée du ciel »
Comme nous l’apprend Ahmed Selmane dans son article « Hirak, une insurrection qui n’est pas tombée du ciel » ( à la fin du chapitre 1) Le hirak est loin d’être cette « surprise » évoquée par la journaliste dans l’introduction. En effet, depuis les années 2000 des manifestations males couvertes par la presse algérienne se sont multipliées. Pour l’auteur, ce sont l’ « accumulation de ces mouvements, conjuguée au mépris de plus en plus désinhibée du pouvoir à l’égard de la population qui a crée les conditions du surgissement du hirak ». Il indique alors que « l’incroyable gabegie et l’immortalité de la caste dirigeante, la rapine et la corruption érigées en mode de fonctionnement, la hogra en règle absolue, tout cela créait depuis longtemps les conditions d’une insurrection que seule la hantise d’un nouveau basculement dans la violence généralisée faisait retarder »
Pourtant, ces conditions objectives réunies ne déterminent pas forcément le début d’une insurrection. Alors, dans quel sens pouvons-nous affirmer que le hirak est une insurrection qui n’est « pas tombée du ciel ? »
A) Des raisons historiques
Il est nécessaire de rappeler que l’élément jugé « déclencheur » du hirak en février dernier fut l’annonce d’un 5 ème mandat du président Bouteflika. Mais des causes conjoncturelles interviennent bien avant, comme le rappelle le premier chapitre de l’ouvrage, « aux origines du mouvement » . Ainsi, la « salle guerre » des années 90 semblent avoir joué un rôle « majeur ». En effet, suite à la disparition de plus de 20 000 personnes, dont les principaux responsables sont « les milices » une des principales revendications de l’hirak est de connaître la vérité sur cette guerre.
B) un régime « incompétent », une corruption
Par ailleurs, le coup d’Etat de janvier 1992 met en place un « terrorisme d’ Etat » et renforce une économie au bénéfice des réseaux clientélistes déjà présente : cela se transforme, à partir des années 2000 selon les termes d’ Omar Benderra en « longue embellie financière essentiellement bénéficié à une caste d’intermédiaires, le régime s’étant révélé incapable de stimuler la production et les emplois ». Ainsi, la menace d’une déroute économique est l’un des principaux facteurs du hirak.
C) Un mépris du peuple
D’un autre côté, « l’arrêt du processus démocratique en janvier 1992 et une décennie de violences extrêmes infligées à la société ont discrédité tous les cadres politiques, y compris ceux qui se disent aujourd’hui dans l’opposition après avoir, pour nombre d’entre eux, activement soutenu la guerre contre les civils » : l’opposition aux clans de politiques et militaires apparaît là aussi comme un facteur clef du hirak.
Ce mépris du peuple, opéré par les dirigeants est résumé par la façon suivante par José Garçon :
1. Des discours des dirigeants imprégnés des colons français
2. Une toute puissance de la police politique
3. La primauté des militaires
4. Des clans militaires aux attributs de groupes d’intérêts
D) Des manifestations avant-gardistes au déclenchement du hirak
Comme nous avons pu le voir avec des ouvrages tels que Alger, capital de la révolution[7]le hirak intervient dans une dynamique de mouvements sociaux qui ont marqué principalement les deux dernières décennies. Ainsi, Ahmed Selmane affirme dans son article que « la contestation n’a jamais cessé en Algérie, même si elle est restée parcellaire et atomisée du fait de l’action permanente des apparails policiers pour empêcher toute veilléité d’organisation autonome. (…) les contestations se sont exprimées le plus souvent hors des cadres existants- à travers des émeutes violentes ou des blocages de routes » : avec ces revendications diverses ( contre le chômage, les coupures ou le manque d’eau et d’électricité , la distribution contestée des logements, le manque de service public ) cette multiplication des émeutes depuis plus de 20 ans, en majorité locales ( de fait de l’absence d’une organisation pouvant créer un lien national décrite par Selmane) a rendu possible l’éclosion du hirak.
De fait, par cette somme d’émeutes produites localement depuis plus de 20 ans, l’annonce d’un cinquième mandat de Bouteflika le 10 février a eu l’effet d’une bombe : d’abord locales, plusieurs manifestations ont lieu contre ce mandat dès le 13 février. Il aura suffit d’une organisation pouvant créer un lien national manquant aux autres émeutes : un appel anonyme lancé sur Facebook, appelant à des protestations le 22 février : ce sera le premier jour du mouvement, l’acte 1 de cette contestation.
IV. Un début de sociologie du mouvement
L’ouvrage est récent : publié en février 2019, l’écriture rend compte d’une période allant du mois de février au mois de novembre 2019. Il n’est en conséquent pas abordé le boycott de l’élection présidentielle du 12 décembre.
Néanmoins, un début de sociologie du mouvement a pu être opéré dans l’ouvrage, et c’est cela dont nous allons rendre compte dans cette partie.
A) Une grande diversité dans les manifestants du vendredi
Dans son article « À Constantine, le réveil politique de la cité », Zineb Azouz dresse un portrait des manifestants du vendredi : elle évoque alors « une grande diversité » qu’elle distingue dans quatre groupe différents :
1. L’élite francophone(ou francisée)
Définit comme des individus issus de la bourgeoisie locale, les femmes de cette catégories qualifiées de « modernes » par l’auteure sont souvent présentées en couple, voire en famille. Au début du hirak, ce groupe se caractérise contre l’opposition au 5 ème mandat mais avec une réticence à s’opposer aux généraux ou à s’afficher à côté des familles de disparus.
2. Les jeunes de classes populaires
Pour l’auteure, cette catégorie regroupe des jeunes de classes populaires « politisée et informée » d’une jeunesse « abandonnée » et qui par conséquent « n’adhère à aucun parti et n’est nullement sensible aux discours islamistes. » Plus que seulement contre le 5èmemandat, cette catégorie s’illustre, dès le début par une motivation principale particulière : la « disparition du système. »
3. Les familles de disparus et leurs sympathisants
Cette catégorie se compose des familles de disparus : essentiellement féminin, l’auteure souligne que ce groupe semble avoir été marginalisé semaine après semaine dans le hirak.
4. Les Algériens « ordinaires »
Ici, il s’agit de regrouper pour l’auteure tous les autres manifestants ne rentrant pas dans les trois dernières catégories, qu’elle nomme donc « algériens ordinaires » : dit « sans orientation politique dominante » avec une population féminine qui serait de moins en moins présente durant l’évolution du hirak, il me semblerait intéressant d’avoir plus de contenus sur cette catégorie qui, sûrement, est loin de former des individualités homogènes.
Également, Les disparités géographiques sont énoncés dans l’ouvrage, où les correspondants dans certaines villes ( Constantine, Oran ) évoquent un début du hirak particulier : par exemple, le fait qu’à Constantine, les familles de disparues se sont peu à peu constituées comme élément phare de contestation dans la ville.
B) Une résurgence de la mémoire contre le colonialisme français
En outre, l’analyse du discours des manifestants, en particulier la résurgence des discours contre le colonialisme français semble pertinent pour rendre compte d’un début d’analyse sociologique du mouvement .C’est ce que propose de faire Hassina Mecahaï dans son article « La résurgence de la mémoire de la lutte contre le colonialisme français ».
Ainsi, pour les marcheurs du hirak, l’ambition est de s’inscrire dans une mémoire révolutionnaire commune en « dépassant l’héritage figé imposé par l’historiographie officielle » . Cela se montre dans certains slogans, pancartes ou slogans, comme celui évoqué par l’auteur : « 1962, indépendance du sol. 2019, indépendance du peuple » ou encore « la guerre de libération s’est arrêtée le 5 juillet 1962… Pour reprendre le 22 février 2019 » mais aussi par l’utilisation des mêmes termes : « martyres », « résistants »,
Dès lors apparaît, dans l’analyse de Mecahaï, une doubbe tendance : d’un côté une volonté d’aboutir la guerre d’indépendance et de l’autre côté, le dépassement de cette mémoire. Pour ce faire, la mémoire d’autres luttes antérieures sont évoquées.[8]
Bien sur, cela est un « début » d’analyse du mouvement récent, qui est loin d’être terminé, malgré la crise sanitaire qui persiste également en Algérie. Si les aspects sociologique et analytique de l’ouvrage pourront sûrement être améliorés au fur et à mesure de l’avancement du hirak, nous pouvons d’ores et déjà remarqué que ce dernier œuvre tout d’abord pour informer d’une manière journalistique, ce qui est au cœur du projet d’ Algeria-Watch, l’association initiative du projet. Fondé par une journaliste algérienne ayant émigré en Allemagne, nous avons remarqué que les principaux coordinateurs de l’ouvrage avaient le même parcours : travaillant sur l’Algérie mais de l’ Europe, ce qui permet d’éviter des représailles politiques mais n’est pas sans poser d’autres problématiques : en permettant à des journalistes, universitaires, manifestants ( mais s’exprimant dans des cadres journalistiques ou universitaires, par le biais d’entretiens) participants au cœur du hirak semble donner une légitimité particulière au savoir construits de l’ouvrage.
[1]Vidéo. « Algérie : retour sur dix mois de hirak, mouvement populaire de colère » Le monde,par Laureline Savoye, décembre 2019
[2]Ibidem
[3]Mainstream dans le sens où ces médias sont les médias les plus accessibles/ les plus utilisés
[4]Aggoun Lounis et Rivoire Jean-Baptiste. Françalgérie, crimes et mensonges d’États, page 569, La découverte, 2004 cité par François Gèze.
[5]En référence à l’ouvrage de Michel Foucault, La volonté de savoir,Gallimard, 1976 (premier tome d’ Histoire de la sexualité)
[6]Séminaire Luttes des savoirs, savoirs des luttes, EHESS, 2018-2019, animé par Alessandro Stella et Nicolas Jaoul
[7]Mokhtefi Elaine. Alger, capitale de la révolution. La fabrique, 2019
[8]Sur ce point, voir Mokhtefi Elaine. Alger, capitale de la révolution. La fabrique, 2019
1 note
·
View note
Text
Queer, techno: entre subversion et normalisation. Dernière partie

Chapitre 1. Les lieux : club, soirées, notion de safe space
A. Club techno queer : un « safe space ? » un concept sémantique qui fonctionne
«Espaces totalitaires en devenir ou oasis de paix éphémères, les safe espaces divisent, tout en s’immisçant chaque jour un peu plus dans la lutte contre les discriminations. Alors que les offres de soirées inclusives se multiplient, quelle est la place de ces espaces dans le milieu de la nuit ? (Introduction du dossier « En lieu sûr” par la journaliste Cécile Giraud dans le magazine de techno Trax (Eté 2019)).
« on a atterri dans le milieu queer de techno (...) au début c’était vraiment du hasard. Finalement, je me suis jamais sentie aussi bien que dans ce milieu-là. (...) parce que en général ce sont que des personnes qui subissent des oppressions, les mêmes que ce que moi j’ai pu subir, et donc du fait y’en a moins aussi. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus conscients, et à l’air de tout ça. » (Manon). « C’est un espace où on peut y aller comme on veut. C’est à dire que... les mecs s’ils veulent ils peuvent se travestir, venir avec des chaînes, tu sais que tu ne vas pas te faire juger, où tu sais que tu ne vas pas te faire peloter si t’as pas envie. (...) tu te feras pas emmerder quoi. » (Elise)
« Chris : c’est pas comme quand t’es en boîte de nuit et que tu dois te conformer à certains codes... et alors que là finalement, tu es libéré. Si tu veux te mettre à poil, tu le fais, personne va te juger, genre... c’est vraiment la liberté. Maeva : c’est ça, c’est la liberté. » (Entretien à la volée avec Maeva et Chris)
Ce que nous remarquons, dans ces extraits d’entretiens évoquant un « safe space » c’est que la soirée queer de techno se différencie et pourrait se nommer queer à partir du moment où cette dernière propose �� ou du moins essaie – un espace safe, un safe space. Ce dernier est défini par Geneviève Pagé comme « un espace de communication exempts d’oppresseurs »1 (propos recueilli dans le dossier de Trax). Pourtant, si les définitions de safe space semblent être fixées et établies par les personnes interviewées (généralement comme un lieu où les agressions morales, physiques à partir de formes de discriminations sont dans l’idéal impossibles, en réalité évitées le plus possible et où un contrôle est opéré à la fois par les organisateurs/organisatrices et à la fois par les participants/participantes à la soirée) le concept en sciences sociales est plus compliqué à définir, comme le rappelle Anne Plaignaud dans son article « Safe space et charte de langage, entre subversion et institution d’une Constitution » le terme est « directement emprunté au militantisme américain dont l’origine en tant que concept institué et expression consacrée reste assez nébuleuse et dont l’archéologie semble encore à faire ». Ainsi, elle évoque une première déposition de safe space au milieu des années 1980 par des employé.e.s LGBT de AT&T réunis en assemblée grâce aux travaux de Nicole Christine Raeburn (Changing Corporate America from Inside Out68) mais également « depuis 1996 par une ONG reconnue par le droit américain sous le nom d’Equal ! pour le droit des travailleurs LGBT de Nokia ». De plus, elle note que les acteurs et actrices décrites sont «noire.e.s, s’inspirant du fonctionnement des assemblées des Civil Rights en mettant en exergue l’intersection des constructions d’identités, aussi bien que des luttes ». L’article Anne Plaignaud indique également que d’après Moira R. Kenney dans Mapping Gay L.A : the intersection of place andpolitics69, cette notion pourrait remonter « aux bars gays et lesbiens des années 1960 en Californie, où s’organisent des groupes de conscientisation. Le principe est simple : offrir un espace dans lequel, qui que l’on soit, on ne vive plus les agressions et micro agressions, recoupant ce que Lieber appelle ‘’harcèlement ordinaire’’(2007) , mais ayant aussi cours dans l’espace privé : toutes les petites manifestations “non consenties” ramenant une personne à une position sociale objectifiante, étriquée et dépréciée auxquelles on est soumis.e dans le reste de l’espace public et privé en tant que représentant d’une catégorie de “personnes opprimées systémiquement” ».
Ainsi, le safe space ne pourrait pas être un grand espace, à l’échelle d’une entreprise toute entière par exemple, comme le remarque Plaignaud, mais plutôt « un espace délimité dans lequel on tente de neutraliser ou de limiter les mécanismes d’oppression que l’on retrouve à l’extérieur ». C’est dans ce sens également qu’allait Manon, organisatrice de la soirée Confess : pour elle, d’une part le « safe space » ne peut être complètement assuré, et s’il pouvait l’être, ce ne pourrait être uniquement grâce aux efforts des organisateurs et organisatrices, mais aussi grâce à une atmosphère garantie par tous les participants. D’autre part, cet essai de safe space peut être fait à des soirées comme la sienne, la confess car elles accueillent au maximum 450 personnes, mais plus difficilement pour des soirées comme la Possession, qui, s’étant développées, se retrouve en difficulté sur ce point. Elle indique ainsi : « La Possession par exemple, y’a encore un public queer comme c’est l’ADN de possession, cela dit ça se ressent de moins en moins parce que sur 4000 personnes le public queer se voit moins ».
Ainsi et pour conclure, si des controverses existent sur une dimension identitaire, il ne nous semble pas pour autant pertinent de le traiter dans notre sujet car les soirées étudiées sont toutes des soirées mixtes (la non-mixité n’est pas même évoquée). « Nos » safespaces, ceux décrits par les personnes interviewées s’éloignent donc peut-être d’une certaine façon d’une définition universitaire, militante d’un safespace. Le « nôtre » serait donc un espace qui, s’il ne peut le promettre complètement, essaie par/grâce à ses acteurs de proposer un espace de sécurité face à un espace public qui ne l’est pas toujours voire qui ne l’est pas. Ainsi, le propre des soirées queer de techno, ce qui les distinguerait des autres types de soirées serait le fait que leurs participantes et participants puissent réaliser des actions sans avoir peur des réactions que cela pourrait procurer dans un espace public non averti (nudité, non-hétérosexualité publique, voire pratiques sexuelles).
B. Réflexions sur la spécificité de la soirée en club
Ce qui nous paraît intéressant à souligner est que le terrain s’est opéré dans une dimension particulière : les soirées queer de techno n’ont pas de club propre, comme cela a pu être le cas avec par exemple la période du Pulp. Aujourd’hui, les soirées sont organisées avant le choix de l’espace, et ce dernier n’occupe pas la place centrale de la soirée. Autrement dit, les organiseurs et organisatrices des soirées ne sont pas directeurs et directrices de clubs, mais louent ces derniers pour le déroulement de la soirée.
La fin du Pulp a provoqué une réorganisation de la géographie spatiale de la nuit : avec l’arrivée des Flash cocotte, qui pouvaient se passer dans plusieurs clubs et les autres petits à petits, qui ont suivi le modèle de la Flash cocotte, plus rentable économiquement et moins risqué car cette option ne demande pas un investissement de lieu à long terme. Les soirées virevoltent dans des lieux différents et les collectifs d’organisations ont comme tâche de trouver un espace adapté. La principale raison est sans doute financière. Le fait d’organiser une soirée demande proportionnellement un investissement moindre qu’investir dans un lieu dont on est propriétaire et qu’il faut rentabiliser. L’inspiration et l’héritage des raves/free et d’une techno berlinoise d’après la chute du mur dans des hangars désaffectés semblent également avoir entraîné un regain d’intérêt depuis les années 2010 pour les warehouse comme nous le montre encore une fois le succès des soirées Possession.
Néanmoins, en faisant la typologie des soirées queer de techno, nous avons pu remarquer que les lieux, s’ils ne constituaient pas en eux-mêmes les soirées sont sensiblement les mêmes : s’il existe diverses soirées, les lieux loués pour l’occasion restent souvent les mêmes, y compris pour des organisations différentes. Ainsi, nous avons pu remarquer dans notre tableau des typologies des soirées queer une prédominance de certains lieux, tels que le Wanderlust, le petit bain (où chaque kindergarten est organisée) ou encore la machine du moulin rouge.
La principale difficulté que cela peut amener est que les organisateurs ne sont pas maîtres de toutes les règles du lieu, ce qui entraîne par exemple le fait qu’une bonne part des soirées queers de techno doivent organiser ou subir une fouille et/ou des toilettes genrées, ce qui n’est pas sans questionnement pour une soirée queer. Pour Manon, deConfess, cela est un véritable problème dans l’organisation des soirées, « quand c’est en club en général ce sont les règles du club qui priment ».
Ainsi, elle oppose un modèle de réussite, celui de la soirée Péripate – qui se caractérise par «une seule et même équipe» et qui ne «sous-traite pas à des prestataires extérieurs », composée « quasiment que de personnes queer, et les personnes qui ne le sont potentiellement pas ce sont des personnes qui connaissent la soirée, qui y vont depuis le début » – face aux autres soirées qui rencontrent des difficultés à permettre aux publics d’accéder à un espace où la binarité n’est plus de mise.
Chapitre 5. Les pratiques « queer » dans latechno : entre subversion et normalisation
A. La fête techno comme outil militant : pratiques et limites
« Si demain n’a pas lieu, alors autant aller danser ce soir ». Voici la conclusion de l’intervention « Paillettes et poppers : lorsque le grand soir s’achève au petit matin »de Mathias Quéré lors de la journée d’étude «Fête et militantisme LGBTQ+»73organisée le 1er mars 2019 au Havre. Réalisant une thèse de doctorat sur l’histoire et l’archive des mouvements homosexuels français entre 1974 et 1986, cette affirmation marquait la période de crise du sida avant Act up et la trithérapie, où la fête, exutoire face à la crise du sida, devient un répertoire d’action militante. Historiquement, un tournant s’opère d’après Quéré par un glissement de nouveaux lieux LGBTQ+ vers les boîtes et les clubs, et ce serait donc à partir de cette crise du sida que la fête devient un outil militant et plus seulement un lieu de socialisation. Avec Act Up et ces nouveaux modes d’actions politiques, la fête, et principalement la fête techno ( la fin des années 80 correspondant à l’avènement de la techno et de la house dans les clubs français et principalement parisiens) se structure comme moyen militant. Une « culture gay » se serait constituée à partir des bars et des clubs qui serait directement responsable d’un militantisme individuel et collectif. À l’heure de la trithérapie, des organisations telles que (et principalement) Act Up gardent l’outil de la fête, peut-être comme héritage de ce moment incertain dû à la maladie.
Bien sûr, l’héritage de ces années est à problématiser voire à questionner. Pour certains, dont Mathias Quéré, il y aurait une rupture du lien entre la fête et le militantisme depuisla fin des années 80 : une troisième génération de moins de 25 ans, moins politisée, issus des « années disco » arriverait sur la scène. Pourtant, une affirmation aussi rude est, il nous semble, à nuancer. Il conviendrait pour commencer de s’entendre sur une définition du militantisme, de la personne militante et par ce fait, de ce qui est-ou non- faire de la politique contestataire.
Comme nous l’avons évoqué dans la deuxième partie de cetravail, l’idée d’un « c’était mieux avant» qui revient parmi les personnes interviewées et la doxa reste à questionner. Cette remise en cause de cette idée dominante, si propre à Serres, nous permet de nous questionner sur ce qui fait le militantisme LGBTQ+ aujourd’hui. Ainsi, si des soirées parisiennes telles que la Confess n’hésitent pas à revendiquer en première ligne leur objet militant, la plupart de celles de mon terrain (cf. typologies des soirées) ont une ligne plus consensuelle, où le et la politique sont à trouver là où on s’y attend le moins. Autrement dit, les soirées queer de techno parisiennes les plus grandes (celles qui accueillent le plus de public) ne souhaitent généralement pas aborder un angle politique, bien qu’on puisse penser que le fait de se définir comme queer peut être perçu, en particulier par des militantes et militants, de toute évidence comme politique. Ainsi, sur mon terrain, un premier degré d’investissement politique (c’est à dire avec un message clairement revendiqué comme politique et destiné à des militantes et des militants) s’est avéré plutôt discret : par exemple, lors d’une Flashcocotte, un drapeau de la manif pour tous flottait, ironiquement, sur la grande scène en guise de décoration. Dans les entretiens réalisés, et à partir de la typologie des définitions des queers, c’était justement ce qui posait problème aux militants et militantes : que ces grandes soirées queer « mainstream » ne prennent pas position politiquement, que ce soit pour les questions LGBT+, mais également dans une lutte anticapitaliste qui serait liée au terme du queer militant. Pour Eva, militante queer et antifasciste, une différence serait à faire entre de « réelles » soirées queers qui auraient le droit de porter ce nom, et les autres, celles sur lesquelles j’ai travaillées pour la plupart, qui abuseraient du terme selon elle. Ainsi, elle énonce « pour moi queer c’est un combat politique » et par conséquent, la nomination des soirées queer et techno serait « jouer sur... enfin tu vois c’est comme en mai 68, y’a plein de trucs et pleins de mouvements qui ont été récupérés pour faire de la thune, et clairement le sucre75 c’est pas un truc queer. En fait c’est un truc queer parce que ils aiment jouer sur ça parce que ça fait hype et branché, mais quand tu payes plus de 20 balles ta place, ça peut pas être un truc queer, ça va à l’encontre de la lutte anticapitaliste qui va derrière » (Eva)
Chez les personnes interviewées se définissant comme militantes, l’aspect financier, le coût assez élevé des soirées pose clairement une limite aux revendications discursives du terme queer, par leur exclusion des personnes les plus précarisées. Pourtant, et pas uniquement d’un point de vue militant, Quéré semblait lors de son intervention vouloir prévenir d’une récupération marketing du terme queer, et donc de la perte de valeur du terme. Cette récupération aurait ressemblée à celle d’une récupération de la pride. Bien que cette idée puisse être contestée, par le fait que ces soirées, en s’intégrant dans un circuit économique et donc de connaissance (par exemple, dans le sens où une soirée mise en vente sur des circuits classiques de mise en vente de soirée techno, comme sur le site de Resident Advisor permet au plus grand nombre de connaître l’existence de cette soirée, et donc de s’y rendre ) plus « classique », se rendent accessibles au plus grand monde, et donc puisse permettre au plus grand monde de connaître des/les revendications queer. (dans le sens premier, c’est à dire militant et universitaire du terme queer).
Nous pouvons cependant appuyer les propos de Quéré, par propos tenus lors de nos entretiens : ainsi, Elise, habituée des fêtes queer de techno, définissait ces dernières comme justement un lieu dénué de politique, ou le terme queer était synonyme d’LGBT non politisé. A l’encontre de ces dernières, des soirées souvent moins connues, dans d’autres lieux, telle que la Confess à Paris semble aller à contre- courant. Ainsi, Manon, membre du collectif qui organise les soirées de la Confess, indiquait que la soirée était une soirée militante, tout d’abord car les fonds étaient reversés entièrement à des associations, principalement à Act up mais qu’également, une non-mixité choisie était décidée dans la programmation de la soirée, mais aussi des organisateurs référents pour assurer un « safe space » à l’intérieur de la soirée durant laquelle différents messages inclusifs étaient postés.
En dehors de cette soirée de notre panel, pourrait-on donc en conclure que les soirées queer « mainsteam » sont dénuées de militantisme politique ? De toute évidence non.
D’abord, si nous prenons seulement en compte le premier degré d’investissement politique que nous avons décrit plus haut, nous observons, comme cela est apparu depuis quelques années dans les prides, une re-politisation traditionnelle contestataire, qui s’illustre principalement par des soirées comme la Confess, les soirées de techno organisées à la Mutinerie ou encore des médias tels que manifesto XXI.
Si nous prenons ce que nous qualifierons de deuxième degré d’engagement politique, un militantisme non-organisé par groupe politique mais par groupe social, la plupart des soirées peuvent s’illustrer comme des soirées où la fête reste un outil militant. Ainsi, lors du premier entretien, Lison, 21 ans disait : « le militantisme queer (en parlant des associations) est surtout, je dirai, géré par les personnes de la génération au-dessus de nous. Donc les organisateurs de soirées sont de plus en plus de notre génération ». Ici, le militantisme ne s’opère pas par un répertoire d’actions politiques classiques, mais par l’outil de la fête, qui le devient par plusieurs aspects : par le fait d’exister, de s’affranchir des normes conventionnellement admises (binarité, hétérosexualité...) mais aussi de normes juridiques (pratiques de prises de drogues, transition non médicalisée) et du fait de plus ou moins le revendiquer, ce qui ressemble à une politisation proche de celle de la pride, des « marches de fierté ». Dans cette idée, Linon énonce encore : « Il y a toujours une forme de militantisme déjà parce que le premier pas du militantisme c’est d’assumer qui tu es. D’assumer la communauté dont tu fais part, sans avoir peur de te cacher. Déjà de base y’a toujours du militantisme là-dedans ».
Un troisième degré d’investissement politique, ce serait la présence même des personnes – et non pas seulement une identité clairement revendiquée – qui pourrait être politique. Ainsi, si nous prenons l’exemple d’Elise pour qui la fête queer de techno est une fête dépourvue de politique, Arnie Kantrowitz affirme que « même si ces soirées ne parvenaient pas à politiser ceux qui venaient pour s’y amuser, elles renforçaient un sentiment de confiance dans la capacité collective à libérer l’expression d’une sensibilité gaie » (propos recueilli par Guillaume Marche dans son ouvrage La militance LGBT aux Etats-Unis 81).
C’est donc peut-être finalement par une subversion des normes que le militantisme LBGTQ+ se retrouve dans les soirées de techno. Par ailleurs et pour conclure, nous pouvons évoquer Konstantinos Eleftheriadis, pour qui, les festivals queer invitent « à (re)penser le queer comme un mode d’organisation militante autonome, inscrit dans des espaces précis où différents acteurs/actrices aux trajectoires et positions sociales diverses mettent en place des pratiques militantes obéissant à des logiques d’action collective propres ».
B. Le corps queer : entre subversion et normalisation
Comme nous venons de le voir, la fête queer de techno semble être un lieu privilégié pour s’affranchir des normes de binarités, sexualités. Mais cela est- il vraiment possible ? Si oui de quelle manière ? Quelles sont les pratiques qui permettent de parler de subversion de normes ? Nous nous interrogerons dans cette partie sur la possibilité de passer les frontières du genre et de la sexualité dans les soirées techno labélisées queer, en se questionnant sur l’aspect à la fois subversif et normatif des corps, qui résulte d’une volonté de pouvoir.
b.1 Une figure particulière : le drag
« C’est la vie beaucoup plus que le droit qui est devenue alors l’enjeu des luttes politiques, même si celles-ci se formulent à travers des affirmations de droit. Le droit à la vie, au corps, à la santé, au bonheur, à la satisfaction des besoins, le droit par-delà toutes les oppressions ou aliénations, à retrouver ce qu’on est et tout ce qu’on peut- être, ce “droit” si incompréhensible pour le système juridique classique, a été la réplique politique à toutes ces procédures nouvelles de pouvoir qui, elles non plus, ne relèvent pas du droit traditionnel de la souveraineté »83. Dans le dernier chapitre du premier tome d’Histoire de la sexualité, « La volonté de savoir », Foucault énonce la bascule qui s’est opérée entre un contrôle exercé sur les corps et le pouvoir des corps à produire leurs propres transformations.
Le « droit au corps » pourrait ainsi se retrouver dans la figure du drag (drag queen, drag king ) droit au corps qui s’affirmerait contre une biopolitique, désignée par Foucault comme « ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites et fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine ». Cette biopolitique se serait transformée à partir d’une prolifération des technologies politiques, « qui à partir de là, vont investir le corps, la santé, les façons de se nourrir et de se loger, les conditions de vie, l’espace tout entier de l’existence ».
On retrouve ici l’histoire du traitement médical des personnes trans, mentionnée dans l’article de Beaubatie: la première partie de son article est en effet consacrée à l’histoire de la pathologisation de ce qui était initialement appelée la « transexualité ». Le concept de biopolitique de Foucault s’applique donc au processus médical, dans la mesure où celui-ci s’illustre comme un nouveau moyen technologique de contrôler les corps. Ici, la figure du drag permettrait de s’affranchir, dans une certaine mesure, de cette biopolitique (bien que celle-ci, c’est ce que l’on verra plus tard, est tout aussi créatrice d’une forme nouvelle de biopolitique).
La figure du drag s’est illustrée de manière très importante sur mon terrain, lors des soirées queer. Justement, dans son article, E. Beaubatie reprend l’analyse de Judith Butler dans Trouble dans le Genre de 1990,86 où « elle démontre le potentiel subversif d’une figure non-cisgenre ». En effet, « la philosophe conçoit la possibilité, pour les drags comme pour d’autres, de resignifier le sexe » car, « la féminité incarnée par une personne assignée au sexe masculin prouve que le genre n’a pas d’essence ; au contraire, c’est lui qui donne sa signification au sexe ».
Ainsi, et pour en revenir à Foucault, « une autre conséquence de développement du biopouvoir c’est l’importance croissante prise par le jeu de la norme aux dépends du système juridique de la loi ». Et le phénomène de Drag – qu’il s’agisse principalement dans les soirées queer observées de Queens ou, plus marginalement, de Kings –, consiste précisément à jouer avec la norme, à explorer le pouvoir subversif du genre. Néanmoins, si le drag s’illustre comme un outil de subversion du genre très puissant, son potentiel subversif tend à se limiter à sa normalisation (à comprendre dans le sens de création de nouvelles normes). Pour reprendre les termes employés par Beaubatie, si les drags dénaturalisent le genre, elles/ils le réifient en même temps. Il ajoute ainsi : « C’est le principe de la déconstruction : la transgression n’advient que dans unedialectique avec la norme et le pouvoir d’agir ne s’accomplit qu’en regard des déterminismes ».
Finalement, ce qui fait la force subversive du drag, c’est peut-être sa volonté de pouvoir l’être.
b.2 L’essai de passage des frontières entre affranchissement et limites
Dans Art queer, une théorie freak, Lorenz Renate se questionne : « comment l’art queer peut-il être abordé d’une manière qui ne classifie pas, ne nivelle pas, ne comprenne pas, mais poursuive, par d’autres moyens, la dénormalisation qu’il induit, le désir d’être autre, d’être-ailleurs et de changer ? Une politique queer radicale exige non seulement que nous proposions des images et des stratégies de vies pour des sexualités et des genres alternatifs, mais aussi que nous promouvions toutes sortes d’expériences économiques, politiques, épistémologiques et culturelles qui cherchent à produire de la différence et de l’égalité en même temps. ».
En suivant cette interrogation, nous pouvons nous demander s’il existe un corps queer. Si oui, comment serait-il possible de le catégoriser, de l’identifier ?
Nous venons de voir que le souhait de s’identifier comme queer, ou justement de se désidentifier était une variante commune. Chez Nicaise par exemple, cela se retrouve dans sa troisième catégorie qui souhaite « troubler le genre ». Chez Beaubatie, on le retrouve dans l’élucidation des théories queer, principalement à partir de la remise en question voire d’un refus idéologique de transition médicale. Il évoque alors le Post- Transsexual Manifesto, publié en 1991 par Stone, qui souhaite en finir avec l’obligation pour les trans de passer pour des personnes cis genre. Chez Foucault, ce n’est pas un passage mais l’ensemble de son œuvre qui le destine à la théorie queer, notamment par l’importance de ces écrits pour les ouvrages de Butler.
A partir de ces écrits, nous pouvons donc en conclure que le corps queer serait un corps qui détient la volonté de pouvoir subvertir le genre et la sexualité. Cependant, il nous semble important de traiter de la difficulté des corps queer concrets à toujours s’affranchir de ces frontières du genre et de la sexualité. Tout d’abord, et comme nous avons commencé à le clarifier plus haut, la redéfinition constante du terme queer interroge la définition du corps queer. Si le queer est pour certains synonyme d’un sigle LGBT, comment celui-ci permet-il de passer les frontières de la sexualité, voire du genre ?
Revenons à la figure du drag. Si Butler la voyait il y a presque trente ans comme un des éléments les plus subversifs du genre, par son aspect performatif qu’elle décrit comme quelque chose qui doit être compris « non pas comme un acte singulier ou délibéré mais plutôt comme la pratique réitérative et citationnelle par laquelle le discours produit les effets qu’il nomme », il existe bien un débat au sein de la littérature sur le drag et sur sa réelle ambition subversive, comme nous le rappellent Luca Greco et Stéphanie Kunert dans leur article « drag et performance » paru dans l’Encyclopédie critique du genre dirigée par Juliette Rennes. Ils notent ainsi que « l’aspect politique du drag se révèle aussi à l’aune des co-constructions de genre, race et classe révélées par les chercheurs et chercheuses ». Par cette affirmation, la subversion des autres normes annexes peut ainsi être discutée, la subversion du genre entraînant d’autres problématiques liées à la race et à la classe. Comme exemple, nous pouvons reprendre celui présent dans l’article, où bell Hooks récuse l’idée de subversion du genre opérée par Paris is Burning de Jennie Livingston (documentaire également cité par Beaubatie et Butler) car ce documentaire érigerait une suprématie, un supra-modèle de féminité blanche bourgeoise. Ainsi « dépeinte, l’idée de la féminité est totalement personnifiée par la blanchité ».
Pour en revenir à Beaubatie, il énonce aussi que la transgression « n’advient que dans une dialectique avec la norme et le pouvoir d’agir ne s’accomplit qu’en regard des déterminismes » (en parlant alors des trans comme des drag). La transgression pourrait alors être un facteur où le bio-pouvoir permettrait une reconfiguration des normes. Par ailleurs, en reprenant Foucault cette fois-ci, nous pouvons avancer que le fait que la notion de sexe (que nous pouvons élargir à notre problématique) est de plus en plus présente et qu’elle est vue comme un processus de libération cache d’autres rapports de pouvoir. Ainsi, il dit que si « la notion de sexe a assuré un retournement essentiel ; elle a permis d’inverser la représentation des rapports du pouvoir à la sexualité et de faire apparaître celle-ci non point sans sa relation essentielle et positive du pouvoir, mais comme ancrée dans une instance spécifique et irréductible que le pouvoir cherche comme il peut à assujettir ».
La volonté de pouvoir s’affranchir des normes de genre et de sexualité est composée de questionnements liés aux rapports de pouvoir présents dans cette volonté. Le corps queer, s’affranchissant des normes n’en finirait pas d’en construire d’autre. Concluant son article par le fait que les trans ne sont pas entièrement subversifs pas plus que les psychiatres ne sont entièrement normatifs, Beaubatie souligne également le fait que l’andocentrisme critiqué dans la théorie queer est lui-même présent dans celle-ci. Pour lui, « le genre structure non seulement la fabrique médicale des trans’, mais aussi les références théoriques de leur mobilisation ». Et ces mobilisations, lorsqu’elles sont transgressives, s’expriment par une volonté de pouvoir jouer de son corps : c’est ainsi que les soirées queer de techno deviennent le lieu d’expérimentation du corps queer.
En revenant à notre terrain, nous avons remarqué que le corps, par ces soirées, devenait,en quelque sorte une identité, ou du moins permettait à cette dernière de s’exprimer. Tout d’abord, l’expérience des drogues semble être une forme de retour au corps, où de nouvelles sensations émergent, et où des comportements, dont des rapports aux corps jugés « hors-normes » peuvent s’exprimer. Ainsi, en reprenant le concept élaboré Par Paul Preciado dans son ouvrage Testo Junkie, qui évoque à partir d’une analyse sur « la transformation du sexe en objet de gestion politique de vie » ( biopolitique de Foucault) mais aussi une analyse des « nouvelles dynamiques du techno-capitalisme avancé » une industrie pharmapornographique porteuse du capitalisme postfordiste, dans le sens où cet industrie chercherait à « contrôler la subjectivité (...) en participant à la production d’états mentaux et psychosomatiques d’excitation, de détente et de décharge, d’omnipotence et de contrôle total ».
Les produits phares seraient donc l’administration de médicaments, d’alcool, de tabac, de testostérone, etc. A l’instar de Beaubatie évoquant des transitions non médicales, « queer », Préciado, par son expérience d’injection de testostérone, non médicalisée souhaitait défier tout ordre de biopolitique. Nous pouvons donc transposer son analyse à notre étude de cas: la drogue. Consommée hors-cadre médical et par auto- administration elle pourrait devenir, elle aussi, un moyen de s’affranchir de ce biopolitique et de ce biopouvoir, de ce contrôle du corps. Ainsi, en reprenant Preciado mais également Dustan l’injection de substances modifiant les perceptions dans un cadre contestataire (auto-administrée) permettrait une «reconstruction des affects subjectifs.
Dans nos entretiens, la question de la drogue, le rapport au corps que cette dernière entretient avec l’individu revient souvent. Ainsi, Jean signale que sa difficulté d’« intégration » pourrait être due justement en parti au fait qu’il ne consommait pas de drogue, et donc ne pouvait pas être « dans l’ambiance ». Il indique ainsi : « j’ai un peu l’impression de ne pas être dans l’ambiance et de ne pas faire des choses que j’ai au fond de moi envie de faire, et d’avoir toute cette pression sociale que t’as tous les jours de devoir se retenir, se contenir et de ne pas agir de la manière dont tu as profondément envie. C’est vrai que c’est quelque chose que je regrette un peu dans le fait de ne pas prendre de drogues, de ne pas pouvoir atteindre un état... un moment où tu te sens tout permis et c’est ce qui est génial dans ce genre de lieu où c’est hyper safe »
Ainsi, pour Jean et les autres personnes interiewées, les drogues permettraient (à l’instar de l’alcool dans de nombreuses soirées festives) de « se mettre dans l’ambiance de la soirée et être un peu en communion avec les autres, c’est à dire ressentir à peu près la même chose » (Entretien avec Jean). Les personnes interviewées sont loin d’être toutes consommatrices. Elles s’accordent pourtant pour signaler un rapport particulier au corps, à la musique et entre les individus lors des interactions qui changent avec les drogues et donnent une coloration particulière à ces soirées.
Aussi, pour revenir au corps en lui-même, les soirées du terrain semblent permettre de devenir un outil d’expérimentation de soi, que ce soit ou non pour performer le genre. De la sorte, Liso, Manon et Eva, trois interviewées qui s’identifient comme femmes cis, évoquent une pratique particulière pouvant, d’après elles, uniquement avoir lieu dans les soirées queer : le fait, par exemple, de pouvoir être « seins nus » sans avoir l’impression que les individus autour y voient une sorte de sexualisation du corps. (cf. entretiens avec Manon, Eva et Lison) .
D’une autre manière, Jean indique, de façon très pertinente que pour lui, le queer serait une esthétique, dont la musique techno serait une variable propre d’une « culture queer ». Cette esthétique se baserait sur un corps, « des cheveux colorés, des paillettes, tout le style vestimentaire un peu underground » qui passerait par une « volonté de se montrer... en jouant sur la confusion des genre, en se maquillant comme un drag ou des trucs comme ça ». En parlant de la pratique du drag, Jean la définirait comme une idée de confusion de genre, construite à partir de « ce que tu as physiquement, ton apparence, et juste la transformer à un point où ça devient un peu irréel » et donc pas seulement un « travestissement » : même si ce dernier peut, par définition, s’élaborer « tous les jours », c’est donc la « performance » qui caractériserait le drag.
Pour finir cette sous-partie sur le corps, il reste à évoquer la pratique de la danse, en particulier le voguing (mais dont le lieu est plus un bal que les soirées de notre terrain), que Teresa, photographe de la scène de voguing de Paris96, définit comme « la lutte, l’activisme à travers l’art, les corps. »
b.3 politique d’identité : identification et désidentification
Comme nous avons pu le voir, un des débats internes du queer est sa prise de position face à l’identité queer. Peut-on se définir comme queer, ou au contraire, le queer est-il forcément un processus de désidentification ? Il est difficile d’apporter une réponse tranchée à ce questionnement, comme nous le montre par exemple la dislocation du groupe militant Bach Back aux Etats-Unis en 2010 à cause d’avis divergents sur la question. Pourtant, pour les labels des soirées techno, cela ne semble pas être un questionnement, dans la mesure où les soirées portent le nom queer. Du côté des militantes et militants, cela pose plus problème. Ainsi, à la question « est-ce que pour toi le queer serait aussi une identité ? » Eva répond : « Non, pour moi queer c’est un combat politique. »
Pour les autres, une identité queer est clairement revendiquée, ou du moins, questionnée. Nous pouvons donc légitimement nous demander si l’identification queer permettrait de s’affranchir des normes de genre et de sexualité (le fait d’avoir une identité de genre ou de sexualité minoritaire n’entrainant pas par conséquent une nouvelle identité par exemple lesbienne ou gay, qui stipule une identité de genre précise là où le mot queer signifierait juste une identité de genre et/ou de sexualité non majoritaire) ou si, justement, cette identité renvoie à des catégories présupposées de classification, ou les efface.
Dans cette perspective, il nous semble intéressant de nous attarder sur des classifications opérées au sein du « queer » : dans un panel restreint de personnes interviewées et rencontrées, ces dernières s’identifiaient comme queer, mais généralement également comme personnes de genre masculin, féminin, non-binaire et ou trans. Le terme queer venait plus remplacer une identité sexuelle (gay, lesbienne, bi etc) plutôt qu’une identité de genre. Autrement dit, pratiquement tous les gens rencontrés dans l’enquête s’identifiaient comme queer (et non pas comme gay, lesbienne, bi, excepté le terme de pan qui a été prononcé deux fois avec le queer) et avec une identité de genre distincte. Bien sûr, ces résultats sont issus d’entretiens d’une quinzaine de personnes seulement, donc une montée en généralité s’avère être assez compliquée.
Par ailleurs, une critique quelques fois opérée était l’invisibilisation des femmes, des lesbiennes, des personnes non binaires et/ou trans au profit des hommes cis-genre gay par le terme devenant universel de queer. Ainsi, lors d’une conférence intitulée « Que reste-il de la culture Pulp ? Etats des lieux des nuits lesbiennes », certaines anciennes actrices du Pulp évoquaient un problème minoritaire lesbien dans le mot et les soirées queer. Pourtant, un public se définissant principalement comme non masculin semble éclore dans une scène queer particulière, à l’image de la Mutinerie ou la soirée Wet for me.
En outre, une identification propre, qu’elle soit queer ou autre peut être un essentialisme stratégique pour reprendre les termes de Guillaume Marche. Ainsi, « le but est de faire valider symboliquement le trait qui fait l’objet d’une stigmatisation. Il s’agit ici d’un essentialisme stratégique qui véhicule l’idée de son propre dépassement. (Calhoun, 94, Cusset 2012) »
Conclusion
Les soirées queer de techno s’illustrent comme une réalité contemporaine des pratiques du queer. Par son histoire, le queer semble se distinguer entre d’un côté des groupes militants (à tendance activiste) et de l’autre des groupes artistiques ou universitaires qui vont plutôt théoriser le queer. Ces deux groupes ne s’opposent pas, mais se complètent, du moins par une volonté performative. Le mot queer a commencé à proliférer dans les années 1990, d’une part par les écrits et conférences de De Lauretis, de l’autre par les groupes militants dont Queer nation fut à l’origine. Dans ces mêmes années, la musique techno se déplace des Etats-Unis à Paris, et est recueillie par ce public queer, ou du moins par une communauté homosexuelle qui se retrouve dans des «soirées parisiennes ». Petit à petit, du Pulp aux soirées queer de techno, la liaison entre les deux relève d’un « roman national » où l’héritage sert de justification.
Par ce terrain, dans ces soirées, nous avons donc cherché à comprendre comment, ce que nous avons appelé un « roman national » de la techno s’était formé et pourquoi ce dernier pouvait à lui seul expliquer cette part de mythe. Notre terrain, découlait d’une méthodologie propre à l’école de Chicago et de l’interactionnisme symbolique, à savoir une étude qualitative qui oscillait entre observation participante/participation observante et entretiens. Nous avons interrogé les transferts entre des théories et des pratiques du queer. Pour ce faire, nous avons tout d’abord identifié qu’il existait désormais une pluralité de définitions du et donc des queers, et que par ces différentes définitions, il était possible de questionner un éventuel passage dans la dénomination de « soirées LGBT » vers les soirées queer.
Par ailleurs, par une attention portée à la géographie des soirées, nous nous sommes rendu compte que ces dernières, à Paris, avaient une caractéristique commune : des locations de lieux, ce qui entraîne des questionnements pour la sauvegarde d’un « safespace », étant donné que les organisateurs et organisatrices de la soirée doivent faire face à des règles déjà établies par les clubs. Nous avons également questionné cette notion de « safespace » qui semble être une des principales caractéristiques de ces soirées, en évoquant ses principales limites. Pour finir, nous avons évoqué les principales pratiques des soirées queer de techno, notamment la drag. Nous avons vu de quelle manière cette manière de performer le genre était à la fois subversive et normative.
De manière générale, cette affirmation issue d’une réflexion sur les pratiques du drag nous pousse à conclure que les transferts des théories aux pratiques du queer s’illustrent par une volonté subversive à l’encontre des normes hétérosexuelles, et plus rarement dans ce terrain (bien que les premiers écrits queers aillent dans ce sens) une volonté subversive à l’encontre d’un modèle binaire, voire dans une réflexion militante à l’encontre d’un modèle patriarcal et anticapitaliste.
Cette volonté subversive est à la fois normative, dans le sens où cette dernière fabrique de nouvelles normes malgré son refus des normes, et c’est que l’on pourra principalement approfondir en cinquième année.
Notes:
-Plaignaud Anne. « Safe space et charte de langage, entre subversion et institution d’une Constitution » Itinéraires [En ligne], 2017-2 | 2018, mis en ligne le 10 mars 2018, consulté le 06 août 2019. -Raeburn, Nicole christine. Changing Corporate America from Inside Out- Lesbian and Gay Workplace Rights. University of Minnesota press, 2004.
-Kenney, Moira R. Mapping Gay L.A : The Intersection of Place and Politics. Temple university Press. 2001.
-Kantrowitz Arnie. Under the Rainbow :Growing Up Gay.St Martin’s Press, 1996 -Marche, Guillaume. La militance LGBT aux Etats-Unis, Presses universitaires de Lyon, 2017.
-Eleftheriadis, Konstantinos. «Les festivals queer, lieus de formation de contre-publics transnationaux ». Questions de communication 2018/1(n°33) - Foucault, Michel. Histoire de la sexualité, tome 1. Chapitre 5, Gallimard 1976
-Beaubatie, Emmanuel. « Psychiatres normatifs vs. Trans’subversifs ? Controverse autour des par cours de changement de sexe », Raisons politiques, vol 62, no.2, 2016 -Butler, Judith. Trouble dans le genre, Routledge, 1990
- Lorenz, Renate. Art queer une théorie freak, B42, 2018 - Nicaise, Sarah. « Des corps politisés : trajectoires et représentations de’’gouines’’» Cahiers du genre, numéro 60, 2016 -Stone, Sandy transmanifesto 1993
-Preciado, Paul. Testo junkie : sexe, drogue et biopolitique. Grasset, 2008
-Dustan Guillaume. Génie divin. Balland, 2001 - Baroque Fray, Eanelli Tegan. Vers la plus queer des insurrections. Libertalia, 2011
-Conférence « Que reste-il de la culture pulp ? Etat des lieux des nuits lesbiennes » le 25 novembre 2018 à Paris. Inrocks festival, avec Fanny Corral, Rag et Sophie Morello.
-Calhoun Craig. Social theory and the Politics of identity blackwell, 1994 100 Cusset François. « Trop plein d’essence » Quaderna, n°1, 2012
-Greco, Luca, et Stéphanie Kunert. « Drag et performance », Juliette Rennes éd., Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux. La Découverte, 2016, pp. 222-231.
2 notes
·
View notes
Text
Queer, techno: entre subversion et normalisation. Une enquête sociologique à Paris. Partie 4. De la théorie queer aux queers d’aujourd’hui

Durant les entretiens, nous avons questionné systématiquement les interviewés sur la façon dont ils définiraient le terme queer. Voici leurs réponses, assez différentes les unes et les autres, que nous traiterons dans un second temps :
« Pour moi, de base, c’est un terme qui englobe tout ce qui n’est pas hétéro et cisgenre. De base c’est ça.Après je pense qu’aujourd’hui queer, plus qu’un mot qui représente une sexualité ou une identité de genre, c’est une culture. Donc l’identité de genre et de sexualité, c’est LGBTQ+ (...) et queer c’est vraiment toute la culture qui va avec ». Lisa, 21 ans.
« Le queer ? Je sais pas, le queer c’est à la base les personnes qui se revendiquent comme pas hétéros j’imagine, mais ça a un peu dévié j’imagine avec tout ceux...tous les événements queer et l’ésthétique queer. Ca a plus dévié vers un phénomène de mode j’imagine, quelque chose comme ça. Pour moi ce n’est pas forcément le mot LGBT, c’est quelque chose de différent, j’imagine. Parce que le queer moi je le considère plus comme une certaine esthétique auquel tu prends part et puis peut-être un mode de vie ».Jean, 20 ans.
« Alors queer en fait... c’est vrai que c’est un peu compliqué, queer à la base c’est bizarre. C’est un terme anglo-saxon. C’est en gros, au sens littéral, les personnes bizarres (...) qui ne rentrent pas dans les normes. Donc c’est hyper large. Toutes les personnes qui ne se définissent pas, selon un genre ou selon, qui sont pas cis forcément. » Manon, organisatrice de la soirée La confess, 27 ans.
«Pour moi queer c’est un combat politique (...) la personne queer, c’est une personne qui veut s’émanciper des normes de genre et de la société hétéronormée au final de la société capitaliste en générale. Donc en fait ça veut dire pas seulement combattre les oppressions de genre mais aussi
combattre les oppressions de classe. » Eva, 21 ans.
« Pour moi queer c’est tout ce qui est lié plus ou moins avec le LGBT. Après, je sais qu’il eu plus ou moins des théories et que certains queer c’est vraiment un acte militant et revendicatif. Au contraire moij’ai l’impression que c’est un truc qui englobe tout, et qui se veut assez ouvert et festif pour moi. (...) Quand on dit queer, c’est souvent associé, contrairement au mot LGBT, qu’on peut employer pour les manifestations, pour la gay pride etc, pour moi queer bah c’est des soirées queer, des événements queer. C’est lié à l’événementiel, quoi. » Elise, 25 ans.
« Quelque chose de pas normatif. Mais politique. Parce que le mot queer c’est une charge politique militante. » Teresa, 25 ans.
« Pour moi ça veut vraiment dire bizarre. Mais dans le sens positif du terme. Pour moi bizarre, mais sans jugement de valeur, enfin pour moi c’est la bizarrerie mais en oubliant la normalité. Enfin tu sais on a une idée du normal qui est l’hétérosexualité etc., et du coup pour moi queer ça a été inventé pour dire que genre ces gens sont bizarres mais en oubliant que la normalité, le terme de normalité qui est l’hétéroséxualité et... tu vois ce que je veux dire ? » Entretien « à la volée », Joanna, 23 ans.
Bien sûr, ces définitions ne sont pas exhaustives et concernent seulement sept personnes interviewées. Néanmoins, ce panel montre déjà une certaine diversité des manières de dire le queer. Nous remarquons par ailleurs que la plupart, pour répondre à la question « qu’est-ce que le queer ? » commence par « pour moi », une façon de signifier que cette définition les engage seulement à titre individuel, et indique une conscience de la non universalité du terme, ou en tout cas le questionne. Nous souhaitons rajouter une définition du queer, qui est celle présente dans le « queer manifesto », là où le mot apparaît sous son angle actuel pour la première fois, en même temps que les premiers écrits de De Lauretis :
« être queer n’a rien à voir avec un droit à la vie privée, il s’agit de la liberté à être public, à être ni plus ni moins que ce que nous sommes. Cela signifie se battre contre l’oppression chaque jour, l’homophobie, le racisme, la misogynie, le sectarisme des hypocrites religieux et notre propre haine de nous-même (on nous a soigneusement appris à nous haïr nous-mêmes). Et maintenant bien sûr cela signifie combattre un virus également, et tous ces homophobes qui utilisent le SIDA pour nous effacer de la surface de la Terre. Etre queer signifie mener une vie différente. Il ne s’agit pas de la tendance dominante, de profit sur lamarge, de patriotisme, de patriarcat ou d’être assimiléE. » Queer manifesto, 1990
La revue de littérature sur le queer, indiquait comment à son tout début, le phénomène se développe selon deux axes différents : un axe militant et un axe universitaire. Ainsi, comme nous l’avons évoqué dans la revue de littérature, Teresa De Lauretis utilise pour la première fois le terme queer lors d’une conférence en février 199063, et ne manque pas d’énoncer une coïncidence : la création du groupe queer nation à New-York.
Pourtant, si De Lauretis souhaite marquer d’emblée une distance avec le queer militant, l’évoquant comme un fruit du hasard, les deux orientations du queer se ressemblent à bien des égards. Si le premier souhaitait s’illustrer en tant que théorie, au sein de la sphère universitaire dans une volonté de « dépasser » les études gays et lesbiennes, et que le queer militant de queer nation avait comme objectif une politique queer radicale, les deux se regroupent sur une remise en cause des frontières de genre et de sexualité. A partir de ces deux compréhensions, nous avons commencé par nous demander quelles étaient, pour ces acteurs de la nouvelle scène queer, leurs définitions du terme, comment ils l’appréhendaient et s’il était porteur de sens. Etait-ce perçu comme une sorte de « Post-lgbt ? ». Il nous était difficile de répondre, car les significations rapportées sont tellement variées, qu’il nous semble utile de parler de queers au pluriel.
En effet, nous sommes consciente qu’il est nécessaire, en présentant un travail, de définir l’usage courant des termes utilisés dans le titre, ce que nous avons pu faire avec le terme de scène. Au début de notre travail, nous retenions comme définition celle qui nous avait fait « enfin » comprendre le sens du mot, issue de « Bash Back, vers la plus queer des insurrections ! » de Fray Baroque et Tegan Eanelli64. La voici :
« Certains liront “queer” comme synonyme de “gays” et “lesbiennes” ou “LGBT”. Cette lecture est inadéquate. Alors que celleux qui s’intègrent le mieux dans les constructions de L G B T pourraient tomber dans les limites discursives du queer, le queer n’est pas une zone d’occupation stable. Le queer n’est pas simplement une autre identité qui peut être punaisée sur une liste de catégories nettes, ni la somme quantitative de nos identités. Il s’agit plutôt de la position qualitative de l’opposition aux présentations de la stabilité – une identité qui problématise les limites maîtrisables de l’identité. Le queer est un territoire en tension, défini en opposition au récit dominant du patriarcat blanc-hétéro-monogame, mais aussi en affinité avec toutes celleux qui sont marginalisées exotisées et opprimées. Le queer, c’est ce qui est anormal, étrange, dangereux. Le queer implique notre sexualité et notre genre, mais il va bien au- delà. Il incarne notre désir et nos fantasmes, et bien plus encore. Le queer est la cohésion de tout ce qui est en conflit avec le monde hétéro capitaliste. Le queer est un rejet total du régime de la normalité. »J’ajoutais à cela les lectures universitaires sur le queer, en particulier les ouvrages deButler, De Lauretis, Bourcier, Preciado et le séminaire « Ethnographies queer » de Gianfranco Rebucini à l’EHES Et je me suis rendu compte, au fil de l’année, que ma propre définition était une définition « militante », dans le sens où elle est issue d’un groupe militant Etats-Uniens, le groupe Bash Back dont l’ouvrage retrace le parcours, et que cette définition était loin d’être la plus répandue dans mon terrain. En effet, lors des entretiens et des observations participantes/participations observantes, j’ai interrogé des individus pour leur demander leurs définitions du queer. Souvent, la réponse était : « est-ce que tu peux me donner une petite minute pour réfléchir ? » Cette réponse renseigne sur la complexité de donner une définition claire, précise et surtout reconnue par toutes et tous.
Néanmoins, il est possible de classer les différentes définitions en cinq catégories : - Le queer comme (Post) LGBTI+ : Dans cette compréhension, assez souvent donnée, le queer semble être le nouveau terme pour qualifier l’LGBTI+. Si pour certains, cela veut dire exactement la même chose, (« une manière plus simple d’évoquer l’LGBT ») pour d’autres, cela caractérise une période « Post-LGBT » où, sans remettre en question le système binaire, cela permet de ne « pas à avoir se définir ». Pour 5 personnes, le queer est décrit comme « Tout ce qui n’est pas hétéro ». - Le queer comme théorie : dans cette définition, le queer est issus des écrits queer, et la formule qui revient le plus souvent est « contre l’hétéronormativité » - Le queer comme fête : pour deux personnes, le queer se définit comme l’espace de la soirée, l’espace de la fête. C’est ainsi que queer représente une délimitation géographique en un espace de fête libre (notion de « safe space » très souvent utilisée par ailleurs) - Le queer militant : ce groupe se rapproche de la définition du groupe Bash Back. Parfois, la définition du queer rejoint même l’anticapitalisme, et c’est souvent ici, que les personnes interrogées, bien que participant aux soirées queer de techno/house, semblent vouloir dénoncer une « récupération » du terme par le marché. - Le queer comme culture, comme esthétique : ici, si le « LGBT » signifie une identité, le queer est la culture qui la compose. Le queer peut même posséder sa propre « esthétique ». Ainsi, notre terrain fait apparaître la coexistence de différentes perceptions du terme queer. Le questionnement autour d’un passage de lgbt vers queer, que nous avons élaboré dans la partie précédente, pourrait trouver une réponse dans le devenir du mot queer. Ce devenir est élaboré par les acteurs de cette scène queer, mais aussi par des théoriciens du queer : ainsi s’échange un savoir entre pratiques et luttes du queer.
Notes:
-Le queer manifesto est un tract distribué par le groupe queer nation lors de la marche des fiertés de New-York en 1990. -De Lauretis Teresa, Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg. La Dispute, 2007.
-Baroque Fray, Eanelli Tegan. Vers la plus queer des insurrections. Libertalia, - Séminaire « ethnographies queer » par Gianfranco Rebucini à l’EHESS, 2018-2019
0 notes
Text
Queer, techno: entre subversion et normalisation. Une enquête sociologique à Paris. Partie 3. L’héritage historique. Mémoire individuelle, mémoire collective : un « roman national » de la techno ?
Comme nous avons pu le voir d’une part dans l’encadré sur la naissance de la techno et de la house (dans la revue de littérature) et d’autre part ci-dessus, dans un rappel de l’arrivée de la techno en France, la techno semble intrinsèquement liée à une scène LGBT+ en tout cas a minima une scène gay (en France). Cela peut nous interroger sur un héritage historique qui serait facteur d’un attachement entre les deux scènes, interrogation qui était à la base l’hypothèse du terrain.
Lors des entretiens, j’ai constaté la ténacité de cet héritage, où nombre des personnes interviewées n’hésitaient pas à évoquer cette histoire pour lier les deux scènes, la scène queer et la scène de techno. Pour une organisatrice de soirées queers de Paris par exemple, leur histoire commune a pour conséquence la création d’un « safe space » (entretien Manon) 55 qu’il convient de garantir. Mon travail n’est pas un travail historique sur l’évolution de la musique house et techno, mais l’histoire est spontanément convoquée. Elle semble avoir laissé un héritage commun qui serait un vecteur d’unification. Ce vecteur est décrit comme un vecteur inclusif, de « tolérance » (mot issu des entretiens, principalement de ceux effectués « à la volée ») qui pousserait par exemple le DJ Laurent Garnier, connu pour être un des initiateurs de ceux que les médias nommerons la French Touch, à annoncer qu’il ne souhaite pas que des personnes racistes ou homophobes dansent sur sa musique, de part cette histoire commune à respecter56Pourtant, l’émergence de la scène la rendant toujours accessible à un public plus large, cette histoire ne semble pas (ou plus) être connues de toutes et tous. De là à mettre à mal le « roman national » de la musique house et techno ?
C’est ainsi que très souvent dans mes rencontres de terrain, est revenue l’idée que c’était « mieux avant » : « C’était mieux avant, lorsque la techno s’écoutait dans les free » ; « C’était mieux avant, quand le Pulp existait » ; « C’était mieux avant, lorsque la techno n’était pas connue de tous » ( entretien « à la volée », lors de la soirée « la toilette » en février 2019) ; « Franchement, la Flash cocotte, c’était mieux y’a deux trois ans quand c’était moins connu ». (Entretien Lison57) Les concepts de mémoire et de nostalgie jouent donc une importance prépondérante sur mon terrain. Si les personnes interviewées avaient toutes et tous moins de 28 ans, la nostalgie semblait jouer un rôle tout de même très important : du fantasme (« ça devait être tellement mieux les débuts de la techno à Détroit ») à une réalité peut-être fantasmée (« la flash cocotte a compl��tement changé. Quand j’ai commencé à sortir, il y a deux ans, c’était beaucoup mieux ») (entretien avec Lison, âgée de 21 ans14) Un âge d’or est convoqué, comme un âge disparu, bien que depuis deux ans, ce qui se présente comme un renouveau (mais qui est peut-être finalement un avènement) des soirées queer de techno prolifèrent, comme nous le montre les nouvelles soirées qui émergent depuis 2015 dans notre tableau ci-dessus.
Par exemple, la soirée Kindergarten, une des plus populaires aujourd’hui (en tout cas présentée comme telle dans les entretiens et plusieurs médias entre l’underground et le mainstream comme Vice) qui existe depuis 2017, se présente comme une soirée club kid héritière du mouvement de même nom qui existait à New-York à la fin des années 80 - début 90. Cette dichotomie entre nostalgie du passé (pratiques et soirées présentées a postériori comme queer) et renouveau (le terme queer pour caractériser les soirées est relativement nouveau : il est utilisé dans les soirées principalement à partir de 2007 et on observe sa croissance exponentielle dans la désignation des soirées à partir de 2014 mais surtout 2015, cf. tableau) trouve son expérience pure dans les soirées queer de techno les plus récentes, à l’image de la Kindergarten.
En remettant au goût du jour la pratique de la drag queen et des clubs kids, la kindergarten est souvent présentée comme la meilleure soirée, la plus sophistiquée, et celle où finalement et étrangement le sentiment de nostalgie est le moins présent, le moins décrié par ces adeptes, puisqu’elle est au contraire clairement ancrée dans la nostalgie des pratiques des années 90 de la scène de New-York dont elle reproduit les pratiques et le décorum. Ainsi, pour Lison (voir le premier entretien et sa comparaison avec les flash cocotte), la Kindergarten est ainsi vue comme la pointe de la nouveauté. Pourtant, à cette soirée qui a constitué l’essentiel de mon terrain, nous observons une sorte d’évolution « à deux mesure » avec un modèle assez clientéliste : une queue généralement de deux heures voit passer les « VIP », personnes sur liste, généralement amies et amis des organisateurs et organisatrices, presse, autres soirées, ou personnes qui ont réussi à se faire connaître des organisateurs et organisatrices, généralement par des pratiques appréciées par la soirée : drag ou club kid) où les habitué-es semblent presque appartenir à un même réseau social.
Dans la participation aux soirées, on retrouve certains aspects de la définition de groupe social, dans le sens où pour une partie des individus (un groupe que nous nommerons « connaisseurs » clairement identifié) se retrouve lors d’un petit nombre de soirées et sont « comme à la maison ». Ce fut notre première impression à la Kindergarten : une soirée pourtant publique, mais dans laquelle un petit groupe, bien mis en avant dans l’espace, se connaissait et cela pouvait presque ressembler à une soirée privée. À ce propos, dans l’entretien réalisé avec Lison59, qui semble appartenir à ce groupe, elle indique en évoquant la soirée Kindergarten : « Je vois quasiment tout le temps les mêmes gens. Quand tu vas à la Kindergarten un peu souvent, tu dois réserver au moins 20 minutes de ta soirée pour dire bonjour à tout le monde en fait. Tout le monde connaît tout le monde, tout le monde peut se connaître. Même si t’as croisé la personne une fois, vous n’êtes pas potes, vous ne vous parlez pas en dehors des soirées, mais vous vous connaissez donc vous vous dites bonjour » Sur la construction de ce groupe, elle indique également « le collectif organisateur, je sais qu’ils étaient déjà amis avant, en dehors à se voir etc. En plus dans le collectif y’a beaucoup de drags qui font des shows ensemble des choses comme ça. Après les gens de la soirée, on va dire que la pierre angulaire ça va être des gens qui sont là depuis le début, qui viennent souvent. Y’a beaucoup de gens qui se voient dans d’autres soirées, y’a des groupes qui se voient aussi dans la vie de tous les jours etc, mais après c’est pas non plus des amis, ça reste une relation de potes de soirées ». Quand je la questionne sur la possibilité et la façon de faire pour « rentrer » dans ce groupe, elle répond : « C’est vrai que ça peu un peu ressembler à des soirées de potes. Mais il suffit que t’y ailles deux fois pour tu te sentes bien, enfin pas incrusté à une soirée de potes tu vois ». De son côté, pour Manon, membre du collectif organisateur de la soirée La Confess, un public d’habitués se met peu à peu en place. Ainsi, quand je la questionne sur le public de la Confess, elle m’indique qu’« il y’a beaucoup de personnes qui étaient à la première qui sont revenues » .
Pourtant, l’intégration à un de ces groupes peut s’avérer compliquée, et cela nous fait donc évoquer des interactions « à deux mesure » avec d’un côté des individus intégrant le groupe social (si celui-ci peut être défini comme tel) et de l’autre des personnes plus distancées par rapport à ce dernier. Dans ce sens, voici un passage d’entretien de Jean. Il y indique avoir commencé à se rendre à ces soirées cette année, mais n’y connaissant personne, avoir rencontré des difficultés. Voici ce qu’il énonce : « au final, y’a un truc un petit peu d’entre soi qui m’a un peu dérangé, où les gens se connaissent très bien et tout, et c’est super pour eux qu’ils se sentent entourés etc. Qu’ils soient dans des endroits entre eux, entre amis etc. Mais j’avoue qu’en étant pas de Paris, en ne connaissant pas ces gens et en étant pas forcément dans la même manière de vivre et n’ayant pas forcément le même point de vue sur ces soirées (...) ça n’a pas été facile de m’intégrer (...) Au début, ça me donnait envie, j’arrivais dans ces soirées et je me disais que c’était un peu dommage de ne pas connaître des gens, enfin surtout que ce sont des gens qui sont.... Enfin même si tu parles avec des gens, tu discutes vite fait et tout, c’est un truc qui est... c’est pas forcément des gens très accueillant ou quoi. J’ai eu ce sentiment là »
Cette notion de groupe social propre à une scène queer de techno peut aussi être questionnée, principalement par le fait que les soirées queer de techno, si diverses et nombreuses soient-elles (voir ci-dessous « typologies des soirées queer de techno parisiennes ») semblent organisées d’une part par des organisateurs/organisatrices qui sont souvent les mêmes. Par exemple, lorsque que je cherchais à contacter des organisateurs/ organisatrices de ces soirées queer de Paris, par la chaîne de contacts de l’organisation, il m’est arrivé plusieurs fois de tomber sur la même personne qui organisait différentes soirées avec différents collectifs. Par exemple, une personne prénommée M qui est la tête de Possession, de Jeudi branco, mais aussi ducabaret sauvage). Dans tous les cas, ces personnes se connaissent bien entre les différentes soirées. D’autre part, les lieux sont souvent les mêmes, indifféremment des soirées et même si elles n’ont pas nécessairement de club attitré. En reprenant l’exemple de M, son contact m’a été donné plusieurs fois en entretien, par différentes personnes. C’était également le cas avec un « F» (qui gère la possession et laconfess un « A » (la péripate) et d’autres)
L’hypothèse d’une socialisation à deux mesures des soirées queer de techno peut donc être posée, la première avec un groupe de personnes qui pourrait presque se regrouper sous la forme d’un « groupe social » (Boltanski, 1979) qui passeraient de soirée en soirée en se reconnaissant, se saluant et en étant les «habitués». Ces derniers ressembleraient au groupe de musiciens de jazz d’Outsiders. De l’autre côté, un groupe constitué « malgré-soi », pour qui on ne peut parler de groupe social que de loin. On retrouve là des personnes intéressées par les concepts, à l’instar de Jean qui peuvent, dans des soirées telles que la Kindergarten se sentir en décalage face à une soirée « qui ressemble à une soirée privée ». Ce public est un public non-habitué, non régulier, pour qui le clubbing queer de techno est une proposition parmi d’autres pour remplir un vendredi ou un samedi soir, et non une source première de socialisation.
Notes:
- Deniaud Jean-Paul, Smael Bouaici. Interview avec Laurent Garnier. « Si certains disent haut et fort qu’ils votent FN, à nous de dire qu’on n’en veut pas ! » Trax numéro 200, mars 2017
0 notes
Text
Queer, techno: entre subversion et normalisation. Une enquête sociologique à Paris. Partie 3: de l’hypothétique passage des soirées ‘’LGBT+’’aux soirées que à une typologie des soirées d’aujourd’hui: genèse, mémoire et héritage

Dans la lignée directe de l’école de Chicago et souhaitant m’inscrire dans une méthodologie propre à l’interactionnisme symbolique, j’ai privilégié, pour ce terrain, une méthode qualitative basée sur des entretiens combinés à des observations participantes et des participations observantes. (Soulé 2007)
Partie III. De l’hypothétique passage des soirées « LGBT+ » aux soirées queer à une typologie des soirées d’aujourd’hui :genèse, mémoire et héritage
Bref rappel sur la genèse des soirées techno en France (à Paris)
Nous avons rapporté, dans un encadré de la revue de littérature une brève histoire de l’avènement de la musique techno. Nous y reviendrons sommairement avec un cadre géographique plus précis : Paris. Cela nous semble pertinent car nous cherchons à comprendre comment et pourquoi le lien entre musique techno et scène queer semble perdurer et comment il paraît s’expliquer justement par cet héritage historique. Ainsi, Guillaume Kosmicki dans « Musiques électroniques : des avant-gardes aux dancefloors » indique que « peu à peu, la France se met aussi au diapason techno. La prise est toutefois assez lente, depuis les quelques soirées marginales organisées par des anglais dans les clubs de la capitale (Pyramid au Palace et Jungle au Rex en 1988, touchant surtout les milieux homosexuels et auxquelles participe alors Laurent Garnier, de passage dans son pays pour y effectuer son service militaire). D’autres clubs parisiens s’y intéressent (comme la Loco ou le Gibus). Casana crée un premier label français en 1990 (Rave Age). Il organise ce qui consacre le début du mouvement rave en France (...) le phénomène grandit en 1992. » Ici donc, ce qui nous paraît intéressant, c’est que les travaux du musicologue Kosmicki pointe une réception particulière d’un « milieu homosexuel » à l’arrivée de la musique techno en France. Cette affirmation possède ces limites propres: de quels «homosexuels» parle-il? d’homosexualité masculine, féminine ? Cette désignation « milieu » pointe-il un groupe social en particulier, une socialisation particulière à un moment donné ou bien la désignation « milieu homosexuel » permet- il seulement de désigner un lieu en particulier fréquenté par des personnes s’identifiants ou étant identifiés comme homosexuelles ? Ce terme permet-il de désigner un espace géographique particulier, par exemple un ou des clubs identifié(s) comme « gay » ?
Ces limites qui concernent l’identification peuvent donc poser problème dans un essai de compréhension de l’arrivée de la techno à Paris. En tout cas, toujours est-il que dans un récit commun. Je parle ici de « récit » car cette histoire a été souvent racontée par des journalistes ou acteurs de la scène de l’époque dans des journaux, par exemple le magasine Trax qui fait office de référence dans la presse musicale spécialisée, ou
23
encore par des musicologues mais qui donc, par définitions, n’usent pas forcement des méthodes sociologiques. Cela nous montre l’utilité, pour un travail plus complet, de réaliser une socio-histoire de la scène techno à Paris. La techno (dans le sens général de musiques électroniques en non pas le sous-style techno) serait arrivée sous la forme de l’acid house45 au Rex à Paris, pour une première soirée en 1988 (Kosmicki, Vix).
Vix46 explique dans son article « Fêtes libres ? une histoire du mouvement techno en France (1989-2004) » que ces soirées étaient fréquentées par un « milieu » homosexuel tout d’abord masculin, même si en réalité, comme nous avons commencé à l’évoquer plus haut, peu de travaux ont été réalisés sur ce fait, et que donc que ce dernier découle plus d’un « récit » ou d’une « mémoire » dont le documentaire « Paris, LGBT& dance music- Uncensored » est le parfait exemple. Ce récit historique n’est pas sans poser de questions : est-ce à cause de l’histoire propre de la house et de la techno de Chicago et de Detroit que l’arrivée en France prit des chemins similaires ?
Dans sa thèse intitulée « Les mondes de la techno à Detroit », Fredéric Trottier souligne justement que même si une « communauté » homosexuelle avait joué un rôle prédominant à Détroit, cette dernière, « établie comme un cultural stigma49dans notre société, dans le cadre des musiques électroniques de danse, est imperceptible car les comportements sexués ne sont pas dissociés dans la plupart des clubs »Néanmoins, le rôle d’une « communauté » gay est plus évidente dans le récit commun à Chicago et à Detroit). Si donc, l’héritage Etats-unien de Chicago et de Detroit sur l’Angleterre et ensuite sur les premières soirées à Paris semble montrer un lien direct entre une émergente scène de techno et une scène gay (constituées majoritairement d’hommes
homosexuels), cette dernière peut-être interrogée : les premiers individus, les acteurs des soirées parisiennes étaient-ils porteurs de connaissance de l’aspect «contre- culturel » de l’émergence de la techno et et de la house de Detroit et Chicago ? Souhaitaient-ils continuer cette part de subversion, ou bien cette musique, et donc cette scène émergente est arrivée dans un « milieu gay » de Paris car les clubs étaient à cette période un lieu propice à une « socialisation » gay ?
La réponse est sans doute à trouver entre ces deux affirmations. Toujours est-il qu’à Paris, le règne des soirées techno/house en club ne durera pas : en 1997, cinq des plus gros clubs de Paris sont fermés pour des histoire de drogue : Le Queen, l’Enfer, lePalace, le Scarp et les Bains. Bien sûr, la plupart survivront sous une nouvelle forme. Nous pouvons cependant retenir que cette période, suite au déclin du club permet l’avènement de la rave et de la free50 (que nous n’avons pas étudié ici) et d’autre part, que le Palace et le Queen, principaux clubs de technos, accueillent une clientèle principalement gay, ce qui exclut une partie de la population LGBTQ+ que nous étudions. Dans les années 90, les raves et les frees (en plus des fermetures liées aux histoires de drogue décrites plus haut) font donc déserter une partie des clubs parisiens. Cela nous amène en 1997, date de naissance du Pulp. Jusqu’en 2007, ce club lesbien est décrit comme un « âge d’or » que ce soit par la presse spécialisée (article de trax51, des Inrocks52 sur les « clubs mythiques ») ou lors de mes entretiens. Cet âge d’or s’appuie sur le fait que nombre d’artistes citent cet endroit comme première influence. Au Pulp, La « rave » la « free » ou la « teuf » sont différentes fêtes de musique techno organisées en dehors d’une structure traditionnelle (hors club), généralement par des sound-systems organisant leurs propres soirées. En France, le mouvement de la free commence au début des années 90, lorsque les clubs, à cause d’une nouvelle loi doivent fermer plus tôt : Les spiral tribe, sound-system anglais arrivent en France et le mouvement de la free prend son essor. La free est différente de la rave : celle-ci est à « prix libre » et en dehors de tout marché. Bien que juridiquement pas illégalle, les divers traités et amendements contre la free en France les rendent très compliqués à organiser dans la légalité. Le label Kill the Dj, Chloé, Ivan Smagghe se réunissaient sous le nom posthume d’Electroclash, terme qui, bien qu’il puisse être remis en cause musicalement, sert souvent à regrouper l’époque du Pulp. Ce qui nous semble particulièrement intéressant dans la décennie Pulp est d’une part l’aspect fédérateur que le club semblait avoir (dans le sens où le public représentait la plupart du temps un même groupes d’habitués) et d’une autre part le rôle dans la mémoire collective que ce dernier a pu jouer dans la construction d’une scène queer de techno (nous verrons cela dans un troisième temps). Pour l’instant, nous pouvons remarquer une prolifération à Paris des soirées se nommant queer depuis la fin du Pulp. Si le Pulp ne se revendiquait pas queer à l’époque, il nous semble qu’il a pu être plus tard et de manière « posthume » caractérisé ainsi. Ainsi, lors d’une conférence consacrée aux nuits parisiennes lesbiennes depuis la fin du Pulp, Fanny Corral évoquait une sorte de queer lesbien, qui plus qu’une identité lesbienne, ou plutôt à partir de celle-ci, pouvait souhaiter passer les frontières du genre et de la sexualité, ce qui est différent d’un queer complètement universel qui peut de fait, à l’image d’un féminisme universel jugé blanc, invisibiliser d’autres oppressions (ici, la place des femmes lesbiennes au sein de la communauté queer).
Après la fermeture du Pulp donc, en 2007, les soirées « types » de mon terrain sont peu à peu apparues: la naissance de la «Flash cocotte», une des premières soirées « queer », est une conséquence directe de la fermeture du Pulp. Pour en revenir à notre typologie des soirées queer de techno aujourd’hui, et pour conclure l’époque du Pulp,nous pouvons dire que le Pulp a eu une influence considérable sur la scène techno queer d’aujourd’hui et apparaît comme le club pionnier. En effet, nous avons remarqué de façon empirique que le Pulp (en excluant peut-être la Mutinerie qui s’avère être plus un bar qu’un club) a été le dernier club queer de musique techno, alors qu’aujourd’hui les soirées ne sont que des soirées et non des lieux, des événements qui circulent de lieux en lieux sans avoir de place particulière, ce qui n’est pas sans poser problème pour la recherche, car un encrage précis dans le territoire de Paris permet une plus facile identification du lieu, de ses objectifs et de ses caractéristiques par les personnes extérieures.
Notes:
-Kosmicki Guillaume. Musiques électroniques, des avant-gardes aux dance-floors, le mot et les restes, 2016 -Voir par exemple ici l’ouvrage de référence dans le domaine journalistique : dir par Deniaud Jean-Paul, 20 ans de musiques électroniques par trax. Hachette, 2017
-Acid house : sous-style de house, ce style se caractérise par une basse réalisée grâce au synthétiseur Roland TB-303. Les bases de l’acid house sont principalement construites dans les citées industrielles d’Angleterre, après avoir reçu l’héritage de la house initiale de Chicago. ( à la fin des années 1980)
- Vix, Christophe. «Fêtes libres? Une histoire du mouvement techno en France (1989- 2004) »Vacarme, vol. 28,no.3, 2004, pp.30-34. 47 Clubbing tv. Paris LGBT et dance musique- uncensored, 2018https://www.clubbingtv.com/video/play/2897/paris-lgbt-dance-music-uncensored/
- Trottier, Frédéric. Les mondes de la techno à Detroit, thèse soutenue le 14/12/2018 à l’EHESS, sous la direction de Denis Laborde. - Goffman, Erving. Stigma : notes on the management of the spoiled identity. New-York, Prentice- Hall, 1963
- Voir par exemple ici l’ouvrage de référence dans le domaine journalistique dirigé par Deniaud Jean-Paul, 20 ans de musiques électroniques par trax. Hachette, 2017 - Sarratia Géraldine « Les clubs mythiques (3/7) : le Pulp, une nouvelle identité lesbienne » les inrockuptibles, le 17 juillet 2011
- Dont il sera question d’analyser lors la sous-partie consacrée à la mémoire, les entretiens sont également disponibles en annexe.
0 notes
Text
Queer, techno: entre subversion et normalisation. Une enquête sociologique à Paris. Partie 2

Revue de littérature
1. De la subculture à la scène
Au début du désir de recherche, il y a Howard Becker(7) et la lecture de son ouvrage classique, Outsiders. Tout commence dans ce récit en 1963, par une étude sur les musiciens de Jazz. Ici, ce n’est pas tant son concept de déviance qui nous intéresse, mais l’étude d’un groupe donné, celui des « musiciens de danse » et surtout sa méthodologie, qui guidera notre enquête. Comme chez Becker, il sera ici principalement question d’observations directes et d’entretiens, dans la lignée de l’École de Chicago et de l’interactionnisme symbolique.
Pour revenir sur le fond, Becker pose les bases permettant de définir la culture comme une réalité propre à un groupe, ce qui nous permet de prolonger la réflexion autour des notions de sous-culture, contre-culture et subculture. Cela nous conduit en 1979, avec l’ouvrage fondateur des cultural studies, Sous-culture, le sens du style de Dick Hebdige(8), à l’intérieur duquel il discute la notion de culture à partir des définitions de Williams, avant de proposer le concept de sous-culture. Williams définit la culture comme « un mode de vie spécifique exprimant une série de valeurs et de significations déterminées non seulement dans le domaine de l’art et de l’éducation, mais dans celui des institutions et des pratiques quotidiennes. Sous cet angle, l’analyse de la culture est la clarification des valeurs et des significations implicites et explicites d’un mode de vie spécifique, d’une culture particulière »( 9) , définition qu’Hebdige définit comme « anthropologique » et qu’il oppose et complète avec celle d’Arnold. Cette dernière « conçoit la culture comme une norme d’excellence esthétique »(10), « le meilleur de ce que l’humanité ait dit et pensé »4 ce qui, d’après Hebdige relève d’un « courant élitiste, conservateur ». Il résume ensuite cette définition en reprenant celle adoptée par Hall, qui serait « une définition entre les deux : la culture comme norme d’excellence et la culture comme l’intégralité d’un mode de vie ». Elle pourrait se résumer de la façon suivante dans une perspective de cultural studies, un « niveau où les groupes sociaux développent des styles de vie différents et donnent une forme expressive à leur expérience sociale et matérielle »(11).
A partir de ces définitions donc, Hebdige élabore la notion de sous-culture qui sera le fil conducteur de ses enquêtes. Dans la perspective Hebdigienne, la sous-culture possède une dimension subversive qui remet en cause des normes données à un instant particulier. Bien que le terme de sous-culture – traduction littérale de subculture – ait été reconnue par les traditions épistémologiques, c’est tout de même d’ici que naissent les controverses scientifiques dans l’utilisation des termes « sous-culture », « contre- culture » et « subculture ». Ainsi, si Bennett souligne que la subculture, « s’est imposée comme cadre conceptuel de référence pour l’examen de pratiques anti-hégémoniques »y compris en langue française, il convient de rappeler, comme le fait Andy Bennett dans son article « Reappraising Counterculture »(12) que « la validité du concept de subculture a pourtant fait l’objet d’un débat théorique permanent, qui s’est focalisé sur sa définition problématique en terme de structures sociales/de classe. » De ce fait, son article propose une requalification du concept de contre-culture qui « fut également érigé en un phénomène socioculturel ayant le potentiel de créer une nouvelle sphère culturelle dépassant la culture parente, et s’en affranchissant idéologiquement »
Ces concepts de subculture et de contre-culture nous servent de point de départ pour l’enquête sur la scène de musique techno et les scènes queer. Cependant, ces définitions ne nous permettent pas complètement (autrement dit ne suffisent pas) pour analyser ce que nous voulons étudier. D’une part car ces définitions, propres aux cultural studiesdans un premier temps, semblent se concentrer sur une culture juvénile, sur l’étude d’un « mode de vie » propre (bien que le concept de mode de vie puisse également être remis en cause et questionné par exemple par McGuigan cité dans l’article d’Andy Bennett, « car il renvoyait à une posture prétendument laudative vis-à-vis de la consommation culturelle et de la création d’identités sociales »(13 ). D’autre part, ces concepts semblent « réduire » notre champ d’analyse aux seuls aspects de la scène techno et de la scène queer qui auraient, à un moment donné, pu fonder une contre ou une sous-culture, ce qui (intuitivement) semble possible seulement à certains moments : lors des raves parties des années 90 ou lors de l’époque du Pulp, ce qui réduit donc considérablement le champ d’analyse des clubs d’aujourd’hui. Néanmoins, la notion de sous-culture – voire celle de contre-culture – pose des bases théoriques indispensables à notre enquête, dans le sens où cette dernière « regroupe » un style de musique et des normes qui en découlent, ce qui permet d’interroger à la fois les normes qui s’y construisent et les transgressions qui s’y produisent.
Cependant, le concept de sous-culture « pure » semble se trouver uniquement avec la pratique des raves, des free-party comme nous venons de l’énoncer. En effet, il existe des écrits sur une sous-culture techno, comme Techno : une subculture en marge(14) de Lionel Porteau, dans lequel il étudie la Free party, les teuffeurs et leurs interactions d’un point de vue subculturel. Nous pouvons pourtant pointer une difficulté concernant notre sujet sur la musique techno : cette dernière a été le plus souvent étudiée par ses pratiques notamment la Free party car justement, cette dernière semble pouvoir se retrouver dans le concept de sous-culture, voire de contre-culture. Mais finalement elle a peu été étudiée par ses interactions en dehors du champ des Free/rave.
En tout cas, si ces concepts de sous-culture, subculture ou contre-culture posent une base théorique, leur héritage, la notion de scène la complète parfaitement. Ainsi, Gérôme Guilbert et Fabien Hein (« Les scènes métales », Volume !, 2006)15 considèrent que « la notion de scène permet de souligner un continuum comprenant des acteurs plus ou moins impliqués physiquement ou culturellement, qu’ils soient musiciens ou non [...] elle permet également de poser la question de la localisation, de l’interaction entre les acteurs, de la circulation des codes liés à un style de manière territorialisée ». Ainsi, la construction historique de la notion de scène décrite par Guilbert et Hein semble se situer dans la continuité de la notion de subculture des cultural studies. Autrement dit, l’analyse de l’émergence de la « scène » techno se nourrit également de ce que l’on sait de l’émergence d’autres subcultures musicales (Becker, Hebdige, Hein...), et cela nous a aidé à spécifier la scène à laquelle nous nous intéressons.
2. L’étude du queer et de la techno, deux champs de connaissance distincts
La difficulté du sujet réside dans le fait qu’il n’existe de toute évidence pas d’écrits universitaires liant clairement la scène queer et la scène de musique techno, et très peu de publications sur le sujet. Ainsi, le seul article disponible dans une revue spécialisée est l’article « Techno : le rôle des communautés gays » (16) , publié dans la revueMouvements en 2005, dans lequel le journaliste et fondateur de l’association Act-up, Didier Lestrade, s’entretient avec Patricia Osganian et Renaud Epstein.
Pour Lestrade, dans les années 70, les gays étaient «dans une situation de marginalisation, d’oppression culturelle comparable à celle des Noirs», ce qui expliquerait, par un héritage historique, le lien entre scène gay et scène musicale. Il explique ainsi que la house est arrivée en France en même temps que le sida, et que cela aurait été en quelque sorte un élément fondateur de cette nouvelle scène. De ce fait, le clubbing mais également les drogues seraient « finalement structurants, au-delà même du temps de la fête. Au point de devenir un élément constitutif de la communauté gay ? »
Notre travail se divisera donc ici sur un travail de fondation de la revue de littérature entre un questionnement sur la fête et le militantisme LGBT+, sur l’étude de la scène techno, puis, pour finir le rapport aux queers et ce que nous pouvons lier entre ces différentes catégories.
A. « Les réjouissances révolutionnaires » (17) : la fête et le militantisme LGBTQI+
Si Lestrade indique un clubbing structurant de la communauté gay, la fête, et particulièrement la fête techno, semble effectivement être un élément structurant de la communauté LGBTQI+, et c’est dans ce sens qu’a eu lieu la journée d’étude « Les réjouissances révolutionnaires », le 1er mars 2019 au Havre. Cette journée d’étude a confirmé que la fête était un élément clé du militantisme LGBTQI+, mais également de la vie LGBTQ+. Cette liaison était évoquée d’un point de vue historique, avec par exemple l’intervention de Mathias Quéré, « Paillettes et poppers : Lorsque le grand soir s’achève au petit matin »(18) qui soulignait la place centrale jouée par la lutte contre le sida et son lien avec la fête. Il indiquait ainsi : « Si demain n’a pas lieu, alors autant aller danser ce soir » en faisant référence aux soirées d’Act Up qui permettaient de recueillir des fonds. En 2018, Konstantinos Eleftheriadis évoquait à propos des festivals queer des espaces qui « invitent à (re) penser le queer comme un mode d’organisation militante autonome, inscrit dans des espaces précis où différents acteurs/actrices aux trajectoires et positions sociales diverses mettent en place des pratiques militantes obéissant à des logiques d’action collective propres. »(19)
B. L’étude du queer
Depuis Paul B. Preciado et son article « Multitudes queer : notes pour une politique des anormaux »(20), nous connaissons l’héritage wittigien, foucaldien, deleuzien, guattarien sur l’avènement de ce que nous pouvons appeler une « théorie queer » et donc sur la pensée de Preciado, théoricien clef du paysage universitaire queer français. En effet, en reprenant l’idée de Wittig qui pense l’hétérosexualité non pas comme une pratique sexuelle mais plutôt comme un régime politique(21) (pensée élaborée, comme le rappelle Preciado, grâce aux écrits d’Audre Lorde(22), TiGrace Atkinson(23), le manifeste « The- Woman-Identified-Woman »(24 )des « Radicalelesbians ») et donc « comme faisant partie de l’administration des corps et de la gestion calculée de la vie et relevant de la “biopolitique” (25), l’hétérosexualité pourrait se définir, en reprenant Foucault et Wittig, comme « technologie bio-politique destinée à produire des corps straights ». Selon Preciado, la théorie queer se serait construite tout d’abord grâce à « un travail de “déterritorialisation” de l’hétérosexualité » et donc du corps, opéré par Wittig et la « french théorie » (en reprenant cette expression américaine). Ainsi, « ce processus de déterritorialisation du corps oblige à résister aux processus du devenir “normal” » et donc «la multitude queer porte en elle, comme échec ou résidu, l’histoire des technologies de normalisation du corps (...) il est aussi la possibilité d’intervenir dans les dispositifs biotechnologiques de production de subjectivité sexuelle”
Un autre usage du terme queer en tant que théorie renvoie au processus de « désidentification » formulé par De Lauretis dans son ouvrage Théorie queer et cultures populaires de Foucault à Cronenberg(27). Pour elle, la théorie queer est issue d’une journée de colloque intitulée « théorisation des sexualités lesbiennes et gaies » à Santa Cruz en février 1990 et de l’article qui s’en est suivi dans la revue differences« Queer theory »(28). Pour De Lauretis, le terme queer permet tout d’abord de questionner les termes « gay » et « lesbienne », en les prenant dans une perspective où ces derniers permettaient d’« articuler les termes dans lesquels les sexualités gaies et lesbiennes peuvent être comprises et imagées comme des formes de résistance à l’homogénéisation culturelle, contrant les discours dominants à l’aide d’autres constructions du sujet dans la culture. » Ainsi, dans le numéro de differences qu’elle coordonne sous le titre « Queer theory » De Lauretis attire l’attention sur deux aspects : « Le travail conceptuel et spéculatif qu’implique la production du discours et la nécessité d’un travail critique qui consiste à déconstruire nos propres discours et nos silences construits ».Il est à noter, comme elle le rappelle par ailleurs dans son ouvrage que sa théorie queer est à distinguer du début d’un queer militant, qui va naître également durant le même mois de février 1990 à New-York, autour du groupe Queer Nation.
Des auteurs tels que Haraway(29), Butler(30), Segdwisk(31), ou encore Bourcier(32) vont dans un deuxième temps « s’attaquer à la naturalisation de la notion de féminité qui avait initialement été la source de cohésion du sujet du féminisme ». Pour ce faire, Butler inaugure en 1990 dans son ouvrage phare Trouble dans le genre une réflexion sur la possibilité d’agir sur les déterminismes genrés par une action performative. La même année, dans Epistémologie du placard, Segdwick va déconstruire non pas le genre comme Butler, mais la sexualité. Elle énonce alors que l’opposition homosexuel/hétérosexuel «affecte les binarismes qui structurent l’épistémologie contemporaine, de savoir/ignorance à privé/public en passant par santé/maladie ». Il est à noter que ces écrits pionniers de la « théorie queer » ont mis beaucoup de temps à être publiés en langue française – généralement à partir du début des années 2000 – et que Sam Bourcier a joué un grand rôle dans leur diffusion, car il est à l’origine de nombreuses traductions, préfaces, articles mettant en avant ces écrits fondateurs non- francophones. Pour résumer cette deuxième étape de fondation de la théorie queer, nous pouvons faire appel à ce passage de Preciado qui dit que « les multitudes queer (...) se font dans l’appropriation des disciplines de savoirs/pouvoir sur les sexes, dans la réappropriation et le détournement des technologies sexopolitiques précises de productions des corps “normaux” et “déviants”. Par opposition aux politiques ���féministes” ou “homosexuelles”, la politique de la multitude queer ne repose pas sur une identité naturelle (homme/femme), ni sur une définition par les pratiques (hétérosexuelles/homosexuelles) mais sur une multiplicité des corps qui s’élèvent contre les régimes qui le construisent comme “normaux” ou “anormaux” (...) Ce qui est en jeu, c’est comment résister ou comment détourner des formes de subjectivation sexopolitiques. Cette réappropriation des discours de production de pouvoir/savoir sur le sexe est un bouleversement épistémologique. »
Puisque la théorie queer est désormais enracinée épistémologiquement, nous pouvons désormais nous attaquer à l’analyse de ces pratiques, et principalement celles des pratiques artistiques, qui nous intéressent tout particulièrement : cela sera fait tout au long de notre développement.
C. Etudier la techno
Comme énoncé précédemment, la musique techno est une musique qui a été étudiée universitairement mais principalement à une certaine échelle (la Free party/rave) et par le biais de certaines pratiques (principalement la danse, les drogues et l’état de transe). Il convient tout de même d’énoncer les principaux écrits, car le clubbing d’aujourd’hui semble tenir son héritage des premières free des années 90. Ainsi, en 2003, Jean- Christophe Sévin, dans « Hétérotopie techno »(33) dresse un état de la littérature sur l’étude de la musique techno, qui va de la construction des premiers soundsystems aux premières raves, qu’il décrit comme une hétérotopie, reprenant le terme de Michel Foucault, à partir des « bulles fictives » décrites par Bombereau en 1999(34). Il observe ainsi des « lieux réels et effectifs, qui sont “des sortes de contre-emplacements réels, sortes d’utopies effectivement réalisées, ( ...) des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables.” » (Foucault, 1984 )(35)En reprenant cette définition, il applique les six caractéristiques des hétérotopies décrites par Foucault aux écrits sur la rave, et commence par y décrire non un espace de déviance, mais au contraire, en reprenant les écrits de Racine, des espaces où « s’opère plus une socialisation qu’une rupture vis-à-vis de la société. »(36) Ce qui peut nous intéresser également pour notre travail sur les clubs. De plus, l’analyse faite par Racine sur l’accès aux raves pourrait également s’appliquer aux soirées que nous étudierons plus tard : « le principe d’ouverture et de libre accès aux événements avec la sélection implicite entraînée par la nécessité de connaître des réseaux d’informations spécifiques »28 (Racine, 2002).
La techno semble donc être un domaine d’étude qui s’est cantonné à l’étude des free party, ce qui explique aussi l’ancienneté de la plupart des études (datant du début des années 2000) suite au ralentissement du facteur exponentiel du développement des free party, occasionné par les lois limitant voire interdisant leurs pratiques. Dans ce sens, Laurent Tessier indique dans « Musiques et fêtes techno : l’exception franco- britanniques des free parties »37 que dans les années 90, des écrits universitaires portant sur la musique techno ont commencé à exister, et que « dans le domaine de la sociologie, un discours apparaît sous l’impulsion de Michel Maffesoli. A travers la revue Cultures en mouvement, mais aussi par la création d’un sous-laboratoire (...) qui lui ont permis de s’imposer dans la presse comme le sociologue “spécialiste” de la techno »29. C’est ainsi que nous nous sommes aperçue, comme Laurent Teissier dans cette citation, de la prédominance des écrits de Maffesoli dans l’étude de la techno, qui s’est donc élaborée principalement à partir de l’étude des free et des raves.
Cela a eu pour conséquences une série de concepts plus ou moins directement associés aux théories de Maffesoli, et plus généralement aux théories postmodernes. Ces concepts ont été associés dans le sens commun aux free partie : « la transe », « l’hédonisme festif », « l’orgie », » la tribu », « le retour au communautarisme » ou encore « l’annihilation de l’individu » Ces notions semblent posséder une sorte d’hégémonie épistémologique dans l’étude de la Free party (et donc de l’étude de la musique techno) qui peut poser problème dans notre étude, car elles ne sont pas forcément transposables à l’étude du clubbing de musique techno. Autrement dit, cette hégémonie épistémologique que semble détenir Maffesoli à partir de ces concepts a pour conséquence une sphère d’étude qui apparaît « limitée » par ces derniers : il ainsi difficile de trouver des écrits sociologiques sur la musique qui se détachent de concepts qui, d’une part, sont difficile à utiliser dans le terrain du « clubbing » ( de l’écoute de la musique techno en club), qui d’autre part qui concerne un moment donné d’une certaine pratique (la free party des années 1990) et qui, enfin, semble donner une lecture définitive des phénomènes.
Cependant, la musique techno (et sa corrélation avec la scène LGBT+/ queer) semble souvent avoir été étudiée d’un point de vue historique, surtout en musicologie. C’est pourquoi nous pouvons terminer cette revue de littérature par un encadré sur les travaux historiques de construction des scènes techno.
brève histoire d’une musique techno
Pour Laurent de Wilde ( « Les fous du son », 2016)(38) tout commence progressivement avec des personnes telles que Edison, Cahill, Theremin, Martenot, Hammond, Scott, Rhodes, Moog qui vont, d’inventions en inventions permettre la première expérience musicale grâce à de l’électricité jusqu’à la création des premiers synthétiseurs. Dans les années 60, l’industrialisation à grande échelle de synthétiseurs Moog permet un développement des productions musicales électroniques. Comme le rappel Guillaume Kosmicki ( « Musiques électroniques » 39 2009) , les musiques électroniques ont deux aspects fondamentaux : la technologie d’une part et le travail sur matière sonore d’autre part. L’essor de la musique électroacoustique puis sa popularisation progressive va permettre l’expérimentation de la dance music à partir des années 80. Ainsi, « Deux tendances sont à distinguer dans les années soixante-dix, tout autant essentielles l’une que l’autre à l’avènement des musiques électroniques ultérieures : la voie expérimentale, suite logique de l’acid rock, et la danse music qui se développe sur les bases du rhythm’n’blues, de la soul et du funk des années soixante. » L’avènement de la musique électronique dans les années 80 peut s’expliquer d’une part par la baisse conséquente des prix des instruments, qui provoque une diffusion de ces derniers, et d’autre part grâce à l’influence de du disco.
Justement, comme le rappel Guillaume Kosmicki, le milieu des années 80 « correspond à l’apparition du garage à New-York, de la house à Chicago et de la techno Detroit dans la ville du même nom ». Cela correspond à une évolution logique technologique et musicale, car l’avènement du home studio et le MIDI en 83 permettent la création de nouveaux moyens de composer de la musique. Sociologiquement, la house et la techno se développent dans des endroits ayant des caractéristiques particulières : » La house et la techno apparaissent au cœur des villes industrielles (New- York, Chicago) ou post-industrielles (Détroit) et se développent par la suite dans des villes similaires ( Londres, Berlin, Manchester, Bruxelles etc) . Elles sont pour la plupart profondément touchées par la misère sociale renforcée par la forte vague de libéralisme qui anime les années 80. (...) C’est une constante : les musiques électroniques naissent dans les villes industrialisées de l’hémisphère nord depuis les années 50. Elles semblent orienter les choix technologiques des créateurs et influencer leur esthétique.
L’auteur y rappel également l’atmosphère particulier des clubs des années 70, lieu de socialisation de « certaines populations homosexuelles américaines », qui ne tardent pas à être touché dans le sida.
D’après l’auteur, c’est donc dans cette sombre période des clubs que naissent les prémices de la house et de la techno. Ainsi, le garage, club à New-York semble être le premier lieu de manifestation de la house : « Au moment où la house se conçoit, elle est en contact direct avec un ensemble de styles issus de la déchéance du disco et consacrant une plus grande dureté dans la sonorité et surtout l’intégration généralisée des sons synthétiques. Les lignes mélodiques sont abandonnées au profit de rythmiques mécaniques la plupart du temps électroniques ». Ouvert de 77 à 87, le club accueil un public plutôt underground, « principalement gay » . La même année, en 77, Frankie Knuckles quitte New-York pour Chicago pour devenir le DJ résidant du Warehouse, club qui donnera son nom à la house, fréquenté par les milieux noirs et gays de Chicago. D’après Kosmicki toujours, « comme le disco précédemment, (...) la house s’inscrit dans les marges de la société ». Si les morceaux house se font reconnaître en Europe, la musique house (et ces principaux auteurs) restent très peu-voire inconnus- du grand public.
A 300 km de là, à Detroit, la techno va naître pratiquement en même temps. Si l’influence « queer » de la musique house n’est plus à démontrer, la techno de Detroit semble s’insérer dans le même héritage, Detroit et Chicago semblant alors bien communiquer, si bien qu’un des pionniers de Detroit, Jeff Mills, n’hésitait pas au début à parler de techno comme sous-style de la house. Ainsi, « L’esthétique de la techno Detroit n’est pas étrangère à celle de la house. Les influences en sont d’ailleurs sensiblement les mêmes ». Comme la House de Chicago, la house de Detroit semble s’inscrire dans le paysage urbain particulier de la ville. Ainsi, Kosmicki affirme : « Derrick May, un des acteurs principaux de l’avènement de la techno Detroit, pense qu’il a, avec ses acolytes, réanimé inconsciemment le souvenir d’un âge d’or où ses parents avaient du travail au sein des usines par l’utilisation des machines et des rythmiques mécaniques qui caractérisent leur musique. Il va plus loin en disant qu’ils ont su donner un sens optimiste à l’utilisation de la machine, en comparaison des ouvriers qui se rendent à l’usine sans espoir et sans but pour s’y soumettre. » C’est un ami de Derrick May, Juan Atkins( avec lequel il créer les émissions « Mojo ») qui lance le premier label de techno, Metroplex. Cinq ans plus tard, le label underground résistance « s’oriente vers le militantisme politique en faveur des populations pauvres afro- américaines de la ville(...) Le dessin est d’unir les races et de briser les barrières sociales »
La House, la techno et l’Europe ( Paris) Toujours en se servant de l’ouvrage de Guillaume Kosmicki comme référence, nous pouvons maintenant évoquer la diffusion de la techno à plus large échelle, l’Europe, et celle qui nous intéresse tout particulièrement : la ville de Paris. Pour l’auteur cet engouement massif peut s’expliquer par deux « révolutions » : d’une part, de la naissance des raves, de l’autre par des « développements esthétiques multiples qui consacrent l’avènement du tout électronique au travers de nombreux styles ». En 1988, l’obligation pour les clubs de fermer à 2h du matin en Angleterre a pour conséquence l’organisation des premières free, qui se propageront très vite en France. Comme le conclue Kosmicki, « Avec les années, les utopies du départ s’estompent ou au contraire se radicalisent » : avec les interdictions de ces dernières à partir des années 2000, une partie des teufeurs, rentrent dans les clubs tandis que l’autre, à l’instar des spiral tribe, y fondent un nouveau mode de vie.
Notes:
- Becker, Howard S. Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance. Editions Métailié, 19858 Hebdig,Dick. Sous-Culture. Le sens du style. Zones, Éditions La Découverte, Paris, 2008
-Arnold, Matthew. Culture and Anarchy, Londres, 1966
- Williams, Raymond. Culture et matérialisme. Trad. De l’anglais par Nicolas Calvé et Etienne Dobenesque, Paris, Ed. Les prairies ordinaire, 2009.
-hall Stuart. Subculture,culture and class .S.Hall. et al. (dir), Resistance Through Rituals, Hutchinson,1976 -Bennett Andy. « Reappraising Counterculture. » Popular Music and Countercultures. Editions Sheila Whiteley and Jedediah Sklower, 2013
- McGuigan Jim. Cultural Populism, Routledge,, 1992 -Pourtau, Lionel. Techno : une subculture en marge, Paris, CNRS Éditions, 2012 -Gérôme Guibert et Hein Fabien » Les Scènes métal ». Volume !, 5 : 2 | 2006, 5-18.
-Osganian, Patricia et Renaud Epstein. « Techno : le rôle des communautés gays. Un entretien avec Didier Lestrade », Mouvements, vol. no 42, no. 5, 2005, pp. 22-31. -Journée d’étude » réjouissances révolutionnaires. Fête et militantisme LGBTQ+ dans le monde. XXe-XXIe » Le Havre, 01 mars 2019, organisée par Agathe Bernier- Monod
- Quéré Mathias « Paillettes et poppers : lorsque le grand soir s’achève au petit matin », intervention présentée lors de la journée d’étude « réjouissances révolutionnaires. Fête et militantisme LGBTQ+ dans le monde. XXe-XXIe » organisée par Agathe Bernier- Monod le 01 mars 2019 au Havre. - Eleftheriadis, Konstantinos. « Les festivals queer, lieux de formation de contre-publics transnationaux », Questions de communication, vol. 33, no. 1, 2018, pp. 135-152.
-Preciado, Paul B. « Multitudes queer. Notes pour une politiques des "anormaux" », Multitudes, vol. no 12, no. 2, 2003, pp. 17-25.
-Wittig Monique, La pensée straight. Traduction de Sam Bourcier, 2003, Paris, Balland, 2003 -Lorde Audre, Sister Outsider, California, Crossing Press, 1984.
-Atkinson Ti-Grace, « Radical Feminism », in Notes from the Second Year, New- York, Radical Feminism, 1970. - Radicalesbians. The Woman-Identified Woman, in Anne Koedt dir. Notes from the Third Year, New-York, 1971
-Foucault Michel. Histoire de la sexualité . Tome I, Paris, Gallimard, 1976.
- La French theory est un corpus de théories apparu dans les universités américaines à partir des années 70, élaboré à partir des idées d’auteurs français entre 1960 et 1980. Si plusieurs idées divergent, beaucoup convergent autour de la notion de «déconstruction» . Les principaux représentants sont Althusser, Baudrillard, Deleuze, Dérrida, Foucault, Guattari, Lacan, Lyotard, Rancière ou Wittig
- De Lauretis Teresa, Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg. La Dispute, 2007. 28 De Lauretis Teresa, « art queer theory » Différences, 2002
-Haraway Donna, the reinvention of Nature. New-York, Routledge, 1991 -Butler Judith, gender trouble. New-York, Routledge, 1991 - Segdwick E.K, epistemology of the Closet . University of California press, Berkeley, 1990 -Bourcier Sam, Queer Zones, politiques des identités sexuelles, des présentations et des savoirs, Paris, Balland, 2001
- Sevin Jean-Cristophe . « Hétérotopie techno » ethnographiques.org, Numéro 3 - avril 2003 [en ligne]. http://www.ethnographiques.org/2003/Sevin.html (consulté le 30/06/19). -Bombereau Gaelle. » Traverser le miroir pour composer la vie » Société. Effervescence techno, numéro 65 25-31
-Foucault Michel. » Des espaces autres » Dits et écrits volume 4 : 1980-1988, Paris, Gallimard : 752- 762 -Racine Etienne. Le phénomène techno. Clubs, raves, free-parties. Imago, Paris, 2002
- Tessier, Laurent. « Musiques et fêtes techno : l'exception franco-britannique des free parties », Revue française de sociologie, vol. vol. 44, no. 1, 2003, pp. 63-91.
- De Wilde, Laurent. Les fous du son, d’Edison à nos jours, grasset, 2016 39 Kosmicki Guillaume. Musiques électroniques, des avant-gardes aux dance-floors, le mot et les restes, 2016
2 notes
·
View notes
Text
Queer, techno: entre subversion et normalisation. Une enquête sociologique à Paris

Se rendre pour la première fois à une soirée de musiques techno labélisée queer par ses organisateurs est un événement. En devenir habitué relève d’un enchaînement de séquences particulières mobilisant désirs et affects. C’est sur ces soirées que porte notre observation, ce qui s’y joue, les espaces qu’elles occupent, les personnes qui s’y rendent ou les organisent... Par cette enquête, par ce terrain, nous avons tenté de comprendre les transferts possibles entre les savoirs du queer et les pratiques du queer à l’intérieur d’une sphère bien particulière de socialisation : les soirées queer de techno.
Leur découverte n’est pas anodine. Elle se fait en général à l’invitation d’amis. Et notre exploration permet d’emblée d’identifier une pluralité de parcours dans leur fréquentation. Des amis, donc, peuvent évoquer une soirée qui vient valider l’objet militant de la sortie (pour un premier groupe clairement identifié, celui des militants et militantes), ou bien qui se caractérise par un « état de liberté » ou une identité queer (ou une désidentification, nous y reviendrons) qui peut laisser place à une notion de « communauté », chère aux personnes interviewées. Dans ce deuxième groupe, nous pouvons encore subdiviser deux sous-groupes distincts : d’un côté les habitués, qui survolent les différentes soirées techno queer de Paris d’une aisance telle qu’ils seraient comparables à un habitant dans sa maison, ou encore, une expression souvent citée pour expliquer la violence symbolique dont parle Bourdieu, comme un enfant de la classe bourgeoise qui « flotte comme un poisson dans l’eau »(1) à l’école. Nous voulons dire ici que dans ce sous-groupe, règnent des individus qui ressemblent de toute part à un groupe social, où les soirées qui les constituent sont faites par et pour eux. Ceci paraît lié au fait qu’une grande partie de ce sous-groupe rassemble des organisateurs, organisatrices ou partie prenante des soirées queer de techno (nous le développerons également plus tard). De l’autre côté, y circulent des électrons peut-être plus libres, pour qui aller dans une soirée queer de techno relève moins d’un engagement total qu’un choix d’occuper son vendredi ou son samedi soir par quelque chose de différent. Néanmoins, la suite d’événements qui provoquent la rencontre avec ce lieu, les soirées queer de techno, n’est jamais un hasard pur. Par exemple, sur notre terrain, nous avons pu noter l’importance du passage d’une ville de « province » à Paris. Cette idée me semblait peut-être un peu fantasmée, ou du moins et pour le dire d’une manière plus juste, encadrée par des écrits tels que ceux de Didier Eribon(2) ou d’Edouard Louis(3) ou encore par des musiques populaires comme « Smaltown boy » des Bronski beat qui énonce en 1984(4) : « Mother will never understand why you had to leave » et dont la version d’Arnaud Rebotini, présente dans le film 120 BPM(5) semble faire partie d’une « esthétique » queer d’aujourd’hui. La rencontre avec le terrain a permis de voir qu’il y avait bien une réalité dans ce « passage » d’une ville de région à Paris et que les soirées « queer » de techno y contribuent.
Ces groupes distincts, dans leurs usages des soirées, forment la séquence particulière des désirs et des affects évoqués plus haut. Leur existence pose des questions étroitement liées au devenir du mot queer : une identité ou un refus d’identité ? Qui est queer, qui ne l’est pas ? de quelle manière (se) forme, se transforme cette identité ? A l’image du « devenir gay » de Foucault, repris par Guillaume Marche dans La militance gay aux États-Unis(6), il semblerait qu’il ne s’agisse pas de « déployer une identité qui ne soit pas un présupposé de l’action mais qui se construise et évolue au fur et à mesure des interactions ».
C’est pour comprendre comment se déploie cette identité que j’ai élaboré une revue de littérature concernant les soirées queer de techno. Puis, je me pencherai sur les méthodes et difficultés rencontrées lors de ce terrain, après les avoir décrites. Lors des parties analytiques, je me questionnerai, à partir d’une typologie des soirées queer de techno, sur un passage hypothétiquement opéré des soirées « LGBT » vers des soirées « queer » et à partir de cette réflexion et de l’élaboration d’une socio-histoire de ces soirées, je tenterai d’élucider le poids de l’héritage pour une mémoire collective, voire un « roman national » de la techno.
Dans une troisième partie, je montrerai que si nous pouvons parler d’une théorie queer, il serait désormais judicieux d’évoquer des queers tant la multiplicité des définitions que dans la diversité et la pluralité des pratiques. Cela permettra de caractériser une partie de ce que sont les queers d’aujourd’hui, pour les personnes qui s’en revendiquent.
Dans une quatrième partie, il sera question de l’exception des lieux des soirées queers : ces dernières n’ont plus de lieux propres, comme c’était par exemple le cas pour le Pulpdans les années 1997-2007. J’interrogerai les conséquences de ces particularités. Par ailleurs, je discuterai le fait que bien que le concept de « safe space » puisse être contesté, il s’avère être un concept significatif pour les soirées queer de techno. Pour finir, certaines pratiques du queer seront analysées quant aux processus de subversion et de normalisation.
Ceci est un mémoire partagé, qui rend compte des méthodes universitaires obligatoires.
1 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude. Les héritiers. Les éditions de minuit, 1964
2 Eribon Didier. Retour à Reims. Fayard, 2009
3 Louis Edouard. En finir avec Eddy Bellegueule. Seuil, 2014 4 Bronski beat. Album the age of consent, 1984 5 Campillo, Robin. 120 battements par minutes.2017. Musique d’Arnaud Rebotini, qui élabore uneversion house de Smalltown boy
6 Marche, Guillaume. La militance LGBT aux Etats-Unis. Sexualité et subjectivité. Presses universitaires de Lyon, 2017.
0 notes
Text
Coronavirus, écologie et responsabilité individuelle : quand Macron restera Macron. Autrement dit : quand tout a échoué, que reste-il à faire ?

L’année avait pourtant si bien commencé pour eux : étouffement progressif de la grève, reprise progressive des trafics de transport en commun, début de mobilisation fragile sur les réformes de la recherche, puis 49-3 et une image particulièrement douloureuse : des gilets jaunes semblant découragés, moins mobilisés, sans doute par la férocité d’un pouvoir sans faille, de grande envergure, mobilisé pour justement, tout faire foirer.
Une Buzyn rassurée, en ce début d’année : le virus ne quittera pas la Chine. Tout va bien donc.
Et pourtant. Et pourtant, il aura fallu seulement quatre jours pour que le gouvernement agisse réellement : en quatre jours, nous sommes passés de la fermeture des écoles à la fermeture des lieux publics, au maintien des élections municipales puis au confinement. En seulement quatre jours, le coronavirus est passé d’une simple grosse grippe à la pandémie la plus dangereuse depuis la grippe espagnole, du début de siècle dernier. En une journée, les parisiens qui allaient voter le matin sont devenus des citoyens inconscients l’après-midi.
La veille, les gilets jaunes manifestaient pour la dernière fois, avec interdiction de porter des masques de protection chirurgicaux, interdiction actée, bien entendu par le préfet Lallement.
Depuis tout juste une semaine, début du confinement, nous ne cessons de nous poser des questions. Est-ce le virus qui tue ou le résultat des politiques libérales désormais incapables de sauver des vies ? Maintenant qu’on a tout fait foirer, que peut-on faire ? Est-il décent de faire croire que nous avons la situation en main et que le virus est « juste plus fort » ?
Si cet enjeu éthique du discours sémantique politique est absent, c’est parce que la stratégie dialectique fut vite choisie : la responsabilité individuelle, ultime ressource pour cacher ses incompétences. Comme en écologie.
Comme en écologie, le gouvernement nous donne la possibilité de devenir des héros, de « sauver des vies » en restant chez nous. En faisant le tri. En achetant moins de plastiques : dès lors, sa responsabilité, la responsabilité étatique, mais aussi la responsabilité commune des dominants (politiques, économiques) est minimisée.
Oubliée l’économie libérale qui tutelle les politiques budgétaires et qui gère les hôpitaux publics. Oubliés les 95 sites de santé et les 175000 lits supprimés par Hollande et les 4172 lits et 3000 services de santé publique fermés depuis Macron. Et surtout, oubliées les démissions communes des médecins hospitaliers de la fin de l’année 2019.
Désormais, les soignants sont des « héros » qu’il faut applaudir tous les soirs à vingt heures, au moment où commence le journal qui égrène le nombre de mors du jour. Quitte à cacher une pénurie épouvantable de matériels et de moyens, autant glorifier celles et ceux qui luttent en première ligne : non pas seulement contre un virus, dû à un modèle de production donnée(1), le capitalisme, mais plus globalement contre la politique dévastatrice, dont les soignants voient les effets depuis fort longtemps, et semblent avoir essayé, par tous les moyens, de faire réagir.
Trop tard.
Par cette crise sanitaire, les dirigeants montrent une nouvelle fois qu’ils ont finalement encore le pouvoir de vie et de mort (2) sur nos citoyens.
Quelle vie humaine compte plus qu’une autre ?(3)
Par leur politique, ils démontrent que la vie des pauvres, des femmes et des personnes vulnérables semble encore une fois moins importante : on a ainsi vu que le télétravail était dans son ensemble une mesure qui protégeait seulement une partie de la population, dans le même moment où les agents de nettoyage continuent de nettoyer les locaux d’Amazon dont les patrons et les actionnaires s’enrichissent grâce au confinement.
Par ailleurs, la vie des soignants semble également moins importante que celle des autorités : ils sont exposés à un risque de mort (à cause de politiques libérales, qui entraînent une pénurie de protections) à la perte de leurs collègues (5 médecins sont morts au 23 mars) et surtout aux traumatismes de devoir effectuer un tri.
La victoire d’une philosophie conséquentialiste, en somme.
Pour le président Macron et tout son gouvernement il n’y a pas de temps à perdre, il faut faire passer le confinement sur les congés payés, car « si l’état, les banques et les assurances font des efforts, les salariés doivent-en faire aussi ». Dès lors, comment ne pas céder à la colère contre « les connards qui nous gouvernent ? » selon la formule de Fréderic Lordon ?(4)
Ici une manière de conclure : rappeler avec Laurent Joffrin dans l’édito de Libération du 18 mars 2020 : « le rôle soudain décisif de la société représentée et organisée par son Etat, dont chacun, empêché d’agir, dépend désormais presque entièrement. L’Etat qui édite les règles sanitaires pour limiter les pertes humaines, l’Etat qui lutte contre le virus grâce à des services publics dont on redécouvre l’utilité précieuse, l’Etat dont on ne déplore plus les coûts excessifs mais qu’on presse au contraire de dépenser sans compter pour aider l’hôpital public, pour garantir la sécurité, pour voler au secours des plus faibles »
[1]Sur ce point, lire l’article de Sonia Shah « Contre les pandémies, l’écologie » dans le monde diplomatique, mars 2020 ( numéro 792)
[2] Voir ici le premier tome d’Histoire de la sexualité de Michel Foucault, la volonté de savoir, où le concept de biopolitique est élaboré ( 1976)
[3] Sur ce point, les réflexions de Judith Butler dans son ouvrage Ces corps qui comptent ( 2009) sont particulièrement pertinentes
[4]Frédéric Lordon, « Les connards qui nous gouvernent »,
Le Monde diplomatique, 190, mars 2020
0 notes
Text
Lordon et le vivre sans

Au début du mois d’octobre, La fabrique sortait le dernier ouvrage de Frédéric Lordon, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent. Dans la même ligne que la plupart de ses précédents ouvrages, Lordon tente de réaliser une philosophie appliquée aux sciences sociales (ou une science sociale appliquée à la philosophie, l’utilisation conjointe de ces deux termes étant en eux mêmes un débat épistémologique et sémantique sur les écrits de Lordon à partir d’un point de vue Spinoziste.)
Le thème, lui, est plutôt neuf, bien que Lordon ait pu y consacrer quelques heures lors d’un un séminaire nommé « Structuralisme des passions, institutions et pouvoirs » durant l’année universitaire 2018-2019: il s’agit d’une réflexion sur un type de discours particulier, émergé plus ou moins récemment qui vante et propose une « vie sans » à savoir une vie sans institutions, sans police, sans travail ou encore sans argent en paraphrasant le sous-titre de l’ouvrage. À travers une conversation par courriel avec Félix Boggio Éwanjé-Épée, enseignant en philosophie, doctorant en économie (ce qui rapproche son parcours de celui de Lordon, entre économie et philosophie) mais également éditorialiste aux revues Périodes et Contretemps, l’ouvrage prend la forme d’un échange de questions/ réponses , entre septembre 2018 et juillet 2019. La première affirmation, qui servira par ailleurs d’un des fils conducteurs de l’ouvrage, et qui porte également le nom du premier chapitre est que les institutions, c’est l’enfer. Ainsi, « les institutions vues de dedans : c’est l’enfer » et « les institutions vues de dehors : c’est l’enfer » . Si ces affirmations venant de Frédéric Lordon peuvent surprendre tout lecteur régulier, par la familiarité du langage utilisé en comparaison avec une difficulté d’accès de lecture bien connue pour ses précédents ouvrages , cette dernière s’inscrit dans une critique des institutions « classiques » . Autrement dit, l’enfer des institutions, pour Lordon, c’est dans un premier temps, à l’intérieur des dites institutions. Ainsi, « L’université devient tendanciellement un lieu où il est impossible d’écrire, les médias un lieu où il est impossible de témoigner du monde, l’hôpital de soigner etc » . Le néoliberalisme apparaît donc selon lui comme le facteur exponentiel de l’avenir « infernal » des institutions. Dans un second temps, l’enfer des institutions s’illustre « en dehors » : Lordon indique alors « qu’il y’a de quoi devenir fou » quand un individu donné, en dehors de l’institution, s’entend dire corps et âme que la police n’est, pour reprendre son exemple, pas la cause de la mort d’Adama Traoré : le face- à face avec cette institution est donc douloureux de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. De tout évidence, c’est donc par ce douloureux contact avec l’institution que nait cet idéal du « vivre sans ». À cette explication de la volonté d’un « vivre sans » donné par Lordon , Félix Boggio Éwanjé-Épée rajoute une raison historique : la création des institutions modernes en particulier l’ Etat- nation, n’est pas « seulement une modalité hiérarchique de la vie en commun en tout temps et en tout lieu : sa forme moderne a eu pour rôle d’étouffer toute possibilité de la fuir, de la refaire ailleurs et autrement, de la déserter » le « vivre sans » apparaît alors comme une possibilité de la déserter. Cependant, et c’est ici l’idée phare de Lordon, le « vivre sans » pose problème dans le sens où le rejet des institutions crée de nouvelles institutions : il illustre alors ses propos par la formation d’une nouvelle justice (les conseils) et d’une nouvelle police (ceux qui gèrent les conseils) à l’intérieur d’une ZAD par exemple : il est donc nécessaire de redéfinir la notion d’institution, définition qui est phare dans le débat d’une possibilité de « vivre sans » . Dans un second temps, Lordon, à partir d’un corpus d’auteurs issus des philosophies de l’antipolitique démontre comment cet imaginaire du vivre sans est la conséquence directe d’une contestation philosophique. Au programme donc, Deleuze et les « devenirs sans avenir », Rancière et la rareté de la politique, Badiou et le sujet politique comme sage spinoziste, et une grande place est donnée à la pensée d’ Agamben ( sur les questions de dispositifs, de suspension ou encore de l’être-séparé) . L'intérêt de l'ouvrage réside dans la forme donnée à l’échange : ainsi, les questions posées par Félix Boggio Éwanjé-Épée, paraissent résumer la pensée de Lordon tout en l’interrogant. En effet, suite à ce chapitre sur les philosophies de l’antipolitique, que nous avons délibérément de cette fiche de lecture, Félix Boggio Éwanjé-Épée souligne que : « Si la philosophie de la destitution aboutit à une impasse et que le geste destituant est voué à l’échec, puisqu’il y aura nécessairement ré-institution de quelque chose, ses énoncés préscriptifs et ses réalisations concrètes n’en indiquent pas moins une orientation révolutionnaire qui innove en balayant la question du pouvoir d’ État au sens élargi ( non seulement le gouvernement et les appareils répressifs, mais aussi ses fonctions normatives et idéologiques) : il n’est plus question de transformer, de faire dépérir ni même de détruire l’ Etat, mais de se soustraire à lui, de former des lieux qui lui échappent. » et que donc « Cela pose la question de l’échelle des reconfigurations institutionnelles dont tu parlais, mais aussi, plus généralement, de ce qui fait ou non autorité sur le collectif ( si ce n’est l’ Etat) .À cette question, , découle l’interrogation « L’Etat : à prendre ou à laisser ? » où Lordon y répond d’une façon qui démontre de l’ originalité de l’ouvrage par rapport à ses autres publications : des conseils révolutionnaires, voire un programme révolutionnaire énoncé à propos de la question étatique. Ainsi, Félix Boggio Éwanjé-Épée rappelle qu’il semble n’y avoir rien de plus repoussant, dans une pensée du « vivre sans » qu’un gouvernement de gauche réformiste ayant été mis au pouvoir par des élections classiques, mais qu’étonnamment, cette idée avait aussi « un pouvoir d’attraction » dès qu’il « s’agit de rompre avec l’Etat du capital ». De cette contradiction, Lordon indique une opinion très claire. Pour abattre le capital, il faut des géants car « le capital est un titan ». Ces géants, ce sont pour les masses, et donc l’ Etat ( car l’ Etat est « un nombre déjà assemblé sous une certaine forme ». ) doit passer par un processus révolutionnaire car pour lui, en résumé ,« 1) La défection généralisée ne fait pas une politique2) Une transformation politique et sociale d’ampleur est une affaire macroscopique, une affaire par le nombre 3) Si le jeu se joue à cette échelle , alors on ne peut pas se désinteresser de l’ Etat qui est une puissance macroscopique a priori distincte du capital 4) Malheureusement cette distinction de principe est largement effacée du fait que, dans le capitalisme, l’ Etat est l’ Etat du capital, en tout cas qu’il est tout sauf l’outil neutre que se représentent les approches instrumentales 5) mais largement veut-il dire complètement voire ontologiquement ? Voilà à mon avis une circonscription possible du problème d’ensemble-définie sur deux fronts opposés : et contre ceux qui ont d’emblée rayé toute idée de faire qq chose avec l’ Etat, et contre ceux qui persistent à y voir un simple outi, offert à la conquête dans la forme de l’élection « démocratique ». Ainsi, à partir de cette réflexion, Lordon imagine plusieurs hypothèses politiques révolutionnaires, mais dont le « vivre sans » questionnerait par son facteur de division des masses, mais aussi, comme le résume Félix Boggio Éwanjé-Épée, lors de sa dernière question de l’ouvrage, que cette idée de vivre sans, dans la pensée de la destitution, « présente une impossibilité fondamentale : l’impossibilité de donner d’autres formes- de meilleures formes- aux agencements humains qui organisent les rapports sociaux ( institutions, économie, gouvernement, etc).
0 notes
Text
Une”radicalité” dans la marche pour le climat? Retour sur le 21 septembre à Paris

Le ton avait pourtant été donné longtemps à l’avance, en prévision du samedi 21 septembre, « jour de rentrée » officiel des mouvements sociaux français.
Cela devait être une « mobilisation historique », du nom de l’événement facebook rassembleur et informateur[1], avec une ligne directrice commune: « contre le système », ce qui pouvait se résumer de la manière suivante : « contre la destruction de la planète, contre le mépris des élites, contre les réformes en cours, contre les fins de mois difficile, contre toutes formes de discrimination, contre l’autoritarisme... ». Bien sûr, comme on pouvait s’y attendre, encore une fois après de nombreuses interdictions, ce fut une manifestation avortée. Comme le souligne un article d’Acta, « on le savait mais depuis le 1er mai dernier, manifester est devenu impossible. Pas interdit, impossible. Quiconque a essayé d’aller à Madeleine ou sur les Champs Élysées samedi 21 septembre s’en est rendu compte. On le savait aussi mais le déploiement policier à Paris était hallucinant. Aussi important que le 8 décembre. »[2]
Initialement, le 21 septembre était prévu de la manière suivante : deux événements organisés distinctement, deux temps. D’un côté la matinée de rentrée des gilets jaunes (qui pour une fois ne portait plus le nom de « gilets jaunes », ce qui interroge sur la définition du mouvement, à l’heure où le gilet n’est plus forcément porté par peur de la répression) était adressée plus globalement à « tous ceux qui veulent que ça change ». L’appel à cette journée de rentrée était signé conjointement par plus de 100 collectifs, associations ou groupes parmi lesquels une grande majorité d’organisations départementales de gilets jaunes, mais aussi les collectifs Adama, désarmons-les, des groupes antifa (Action Antifasciste Paris Banlieue, le Comité Antifasciste Lyonnais), des pages facebook d’information (cerveaux non disponible), des médias investis dans la lutte (Acta), mais aussi et surtout, en tout cas, pour ce qui nous intéresse ici particulièrement, des groupes écologistes tels que Youth for climate (Paris et Brest), Rennes en lutte pour l’environnement, Désobéissance écolo Paris, Extinction Rébellion (de différentes villes françaises ), Deep Green Resistance Paris ou encore, entre autres, le collectif éco-féministes de Strasbourg. De ce côté, le rendez-vous était fixé dès 9h30, sur les Champs avec une ligne directrice : s’unir contre le système, pour « une justice sociale, fiscale et environnementale » mais aussi, trois mois exactement après la mort de Steve, tué par la police lors de la fête de la musique à Nantes le 21 juin 2019, lui rendre hommage, comme aux derniers noms qui résonnent encore « Zineb, Adama, Zied, Bouna, Rémi », tous tués par la police.
De l’autre côté, l’après-midi, une marche pour le climat « classique » , organisée par une coalition d’associations écologiques, 350.org, ANV-COP21, Alternatiba ou greenpeace. Bien qu’il y ait eu pour cette marche pour le climat plus de 90 organisations signataires, dont certaines avaient appelé à la participation aux deux événements, les grandes ONG citées ci-dessus n’ont pas appelé à une participation au rendez-vous du matin-même sur les Champs. Il faut dire que la répression étant bien exercée et bien intériorisée, en particulier depuis un an, le rendez-vous sur les champs était interdit : nous étions bien loin d’un « fin du monde, fin du mois même combat » souvent scandé il y a six mois. À vrai dire, ce slogan, quand il était entendu dans les marches pour le climat pouvait porter à dérision, lorsque l’on sait que les manifestations des gilets jaunes et pour le climat ne sont jamais croisés, en étant organisées dans un périmètre différent à l’intérieur de la ville de Paris.
Ainsi, cette journée du 21 septembre pourrait se résumer de la manière suivante : une tentative échouée une fois de plus face à un Etat sur-puissant. Mais ce serait une analyse pessimiste qui laisserait de côté une bonne nouvelle : une première radicalisation de la marche pour le climat.
Dans un article de lundi matin[3], le chapô résumait bien toute l’affaire : « La marche climat du 21 septembre, organisé par une “inter-orga climat” comprenant Alternatiba et Greenpeace, n’a pas tourné comme ses organisateurs l’avaient souhaité. Alors qu’ils se félicitaient depuis plusieurs mois sur des banderoles de la convergence entre “fin du monde” et “fin du mois”, la présence effective des gilets jaunes à cette marche climat a gêné aux entournures ».
Car cette fois-ci, la marche pour le climat était différente. La « coalition », du matin, bien qu’elle constituait de loin une entité difficilement définissable ou quantifiable, où le nom de gilet jaune n’était plus si évident (Cf. événement du 21 septembre qui indique « Mobilisions-nous sans étiquettes, ça ne doit pas être un tel ou un tel qui se mobilise, mais bel et bien le peuple entier contre le système ») était en partie présente à la marche pour le climat.
Dans ce sens, Tristan Petitdent indique dans son article évoquant la continuité d’un cortège de tête : « Ce fut un débordement immédiat, sans même avoir besoin de se concerter : spontanément, les habitué.e.s des manifs et les Gilets Jaunes se sont placé.e.s devant, en disant simplement «“on est là, la politique c’est nous, la conflictualité, c’est nous aussi”. On a pu voir aussi de jeunes écologistes en rupture avec la pacifisme collaborateur des organisations officielles les rejoindre. La police ne s’y est d’ailleurs pas trompée en tabassant à tout va, en noyant la totalité sous les gaz, en interpellant à la volée ».
De ce fait, découle un traitement médiatique « mainstream » qui évoque « des blacks blocs » et des « gilets jaunes » « infiltrés », comme si nous étions revenus en 2016, où le cortège de tête était constitué de « casseurs infiltrés ». Comme si, l’année écoulée et les stratégies d’émeutes propres aux regroupements des gilets jaunes n’avaient pas suffi à décrédibiliser l’utilisation du mot « black block » à tout va, en évoquant un groupe unique : dans la plupart des articles des médias « mainstream » traitant du sujet, les « black blocs » et les « gilets jaunes » sont encore des unités sémantiques clairement séparés, néanmoins, l’utilisation du terme « ultra-jaune » semble avoir été adopté et démontre une fois de plus cette stratégie de différenciation opérée.[4]
Le problème réside principalement dans le fait que le discours étatique (Cf. les tweet de la préfecture de police) est repris par les principales organisations écologistes organisatrices de la marche, évoquant, comme les syndicats, les partis et les médias traditionnels, une sorte de manifestation volée.
Pour la première fois, une manifestation pour le climat a été confrontée aux violences et à la répression policières. Il en découle une alternative pour les manifestants habitués aux manifestations pour le climat : se ranger derrière le discours des organisations « traditionnelles » calqué sur celui de maintien de l’ordre des syndicats « traditionnels » ou se rallier aux « autres » organisations écologistes s’organisant derrière la volonté de « changer le système ». Finalement, c’est peut-être un combat sémantique qui se joue, en plus d’un combat entre partisans et opposants d’une croissance verte ou d’un débat stérile entre responsabilité individuelle/responsabilité institutionnelle…
Et c’est ainsi que la sphère du militantisme écologique a trouvé un intérêt puissant, le 21 septembre dernier.
Ces prémices ont trouvé leur principale illustration un peu plus tard, dans la journée du 5 octobre 2019 : une « dernière occupation avant la fin du monde » signée par extinction rébellion, des gilets jaunes, le comité Adama, cerveaux non disponibles, désobéissance écolo Paris, Comité de libération et autonomie queer (ancien CALQ), young for climate Paris ou encore terrestres, qui s’illustra par l’occupation du centre commercial Place d’Italie et par d’autres occupations qui se prolongent (Châtelet etc) .De la, par une semaine d’actions organisée par extinction rébellion découle de nouveaux questionnements, principalement sur l’utilisation revendicatif du terme « Non-violence » du collectif.
[1]Page facebook 21 septembre « mobilisation historique »
[2]« il y a ceux qui s’indignent et ceux qui se révoltent » par Tristan Petitdent, acta.zone, le 25 septembre 2019
[3]« la manifestation du climat du 21 septembre a-t-elle infiltré par le black block ? » par Maëlle Chouchan et Norbert Makhouf , lundi matin, 3 octobre 2019
[4]« Gilets jaunes, marche pour le climat, journée du patrimoine… un samedi sous surveillance à Paris » par Aline Leclerc et Nicolas Chapuis, Le monde, 20 septembre 2019
0 notes
Text
Savoirs des luttes, savoirs sur les luttes: lundi matin et les gilets jaunes

photo de Berillon.
Luttes des savoirs, savoirs des luttes :
Les écrits sur les/des Gilets Jaunes sur le site internet lundi matin
novembre 2018-avril 2019.
« Que pensent les gilets jaunes ? » « Mais que font les gilets jaunes ? » « Depuis samedi, nous nous sentons un peu moins seul et un peu plus heureux. » Lundi matin numéro 166, édition du 19 novembre 2018
« 450 universitaires se déclarent “complices” des Gilets Jaunes » « Prenant acte de cette aggravation exponentielle des tendances autoritaires du pouvoir et des institutions, nous enjoignons toutes et tous les ami.es de la liberté à ne pas céder un pouce de terrain face à la répression et à s’organiser pour y faire face » « Ce jour là, il faisait beau » « Alors devant le Fouquet’s en ruine tout le monde s’est marré. Tout le monde. Et tout le monde a bu une rasade dans une bouteille sortie du bar. Tout le monde » Lundi matin numéro 184, édition du 27 mars 2019 Le 17 novembre 2018 a lieu la première journée de mobilisation des Gilets jaunes.
Ce mouvement, peut-être par sa singularité, semble tout d’abord avoir suscité dans les milieux militants (« historiques » ou « institués ») des débats, dans lesquels il n’était pas rare de se questionner sur la nécessité de leur présence – ou non – dans les manifestations et autres actions organisées par les Gilets jaunes.
Ainsi, début novembre, l’heure semblait, pour la plupart de ces groupes habituellement prompts à se mobiliser, à l’observation plus qu’à l’action.
En suivant cette idée, nous remarquons une évolution nette des écrits de lundi matinau fur et à mesure que le mouvement s’installe dans la durée. Bien que le site s’illustre très tôt comme un allié, l’édition du 19 novembre 2018 l’interroge, comme le montrent les deux premières citations ci-dessus. C’est ainsi le père d’un lecteur, Gilet jaune, qui écrit le premier article expliquant son engagement, qui, comme l’indique la citation, le rend déjà « un peu moins seul et un peu plus heureux ».
Décrit par le journaliste Mathieu Dejean[1]comme « le foyer insurrectionnel du web », chaque semaine, un florilège d’articles ne sont pas signés, ce qui nous laisse penser que ces derniers sont réalisés directement par la rédaction ou par des contributeurs anonymes. La rédaction est par ailleurs inconnue des lecteurs du site ce qui renforce l’impression d’anonymat.
Entre l’édition du lundi 19 novembre 2018 (numéro 166) et l’édition du 29 avril 2019 (numéro 189), le site lundi matina consacré aux Gilets jaunes 118 articles sur 323, soit 36, 5% de l’ensemble de sa production éditoriales sur cinq mois.
Quelle est la place accordée par le site aux Gilets jaunes, de novembre à avril, que ce soit dans les articles écrits par la rédaction, dans ceux des lecteurs, gilets jaunes anonymisés ou auteurs clairement identifiés par leur patronyme ?
Une première étape du travail consiste à identifier et à lister les articles semaine après semaine. (Le détail et le résultat de tout ce travail est à retrouver dans l’annexe. Lundi matinétant une revue de réflexion sur les émeutes, il était quelques fois difficile de classer un article dans la rubrique « sur les gilets jaunes » ou dans « non concerné ». )
Ce premier travail a été articulé autour de la thématique d’un séminaire de l’ EHESS (« Luttes des savoirs et savoirs des luttes » d’ Alessandro Stella et de Nicolas Jaoul).
Autrement dit, je me suis interrogé sur la manière dont les savoirs issus des luttes et les savoirs universitaires interagissaient (et si leurs dialectiques-oppositions pouvaient justement être remises en cause) dans le traitement médiatique de lundi matin.
Sur 323 articles, 118 consacrés aux Gilets Jaunes en 5 mois
Les 323 articles sont présentés chronologiquement dans un tableau, les numéros de publications étant distingués par leurs objets (thèmes), leur nature (tracts, analyses, etc.) et par leurs signatures.
Sur 118 articles consacrés aux Gilets jaunes :
- 20 sont signés par des personnes présentées comme des « lecteurs » ou par des pseudos uniques (c’est à dire signant uniquement cet article là, que ce soit sur le site de lundi matinou sur d’autres revues)
- 28 sont non signés (ce qui laisse penser, dans le style de l’article et de sa forme, qu’il s’agit de la rédaction de lundi matinou à des fidèles contributeurs (ou non )
- 11 sont signés par des gilets jaunes anonymes
- 3 sont signés par des collectifs
- enfin, 56 sont signés par des auteurs clairement identifiés ou par des revues qui transmettent un article.
Universitaires, écrivains et journalistes avec les gilets jaunes et lundi matin
Les universitaires occupent une place toute particulière sur le site de lundi matin. En occultant le fait de savoir qui est membre de la rédaction (et si celle-ci comprend des universitaires), nous remarquons un traitement particulier de ces écrits. Sur les 56 articles signés, 24 articles le sont par ces derniers (universitaires en fonction ou anciennement en fonction). Ce qui est tout d’abord frappant, c’est que les noms de ces derniers sont quasiment tout le temps mis en avant, dans les ¾ des cas à côté du nom de l’article. Une petite bibliographie expliquant les fonctions de l’écrivain est disponible la plupart du temps soit à la fin de l’article, soit au début. Ainsi, tous les articles de Jacques Fradin (qui a écrit 3 articles sur le site) sont accompagnés de cette petite biographie : « Economiste anti-économique, mathématicien en guerre contre l’évaluation, Jacques Fradin mène depuis 40 ans un minutieux travail de généalogie du capitalisme. »[2]. Pourtant, si quelques autres articles d’universitaires ressemblent à ceux de Fradin et possédent également une biographie à côté de la signature, d’autres universitaires semblent justement vouloir effacer ce statut, ou du moins, ne pas le laisser paraître. Ainsi, Philippe Tancelin, signataire de plusieurs articles sur lundi matin, se décrit d’abord comme poète, et ensuite seulement comme philosophe. Il n’enreste pas moins que nous ne pouvons pas savoir si ce choix (du nom à côté de l’article, juste en signature, avec biographie ou non) émane de l’auteur ou de la rédaction.
Pour autant, cette prédominance des écrits universitaires peut s’expliquer par le fait que le statut vient légitimer un discours[3]. De plus, leur importance peut s’expliquer par le fait que le site veut être un outil d’analyse, et la nature de ces écrits qui suivent les méthodes propres à leurs disciplines scientifiques d’appartenance constituent des ressources analytiques pertinentes.
Ainsi, les écrits analytiques de lundi matinsont en général plus long, se caractérisent par une qualité d’analyse et des références s’inspirant de la rigueur scientifique. Dès lors, on retrouve sur lundi matindes articles comme « Dans les rues ruineuses de vie » 1[4]et 2[5], par Cécile Carbonel et Alexandre Pierrepont, qui élaborent une analyse ethnographique et anthropologique des Gilets jaunes. Si les universitaires présents dans lundi matincherchent à décrire, à comprendre, à analyser, ils ne restent pas moins des alliés, qui soutiennent la cause voire y participent, ce qui les différencie des autres analystes présents dans les médias « mainstream. » D’ailleurs dans lundi matinest reprise le 27 mars 2019, une tribune signée par 450 universitaires se déclarant « complices » des gilets jaunes[6]et initialement parue le 22 mars dans Médiapart.
Cette tribune est importante dans la mesure où elle soutient non seulement les manifestations, mais elle s’oppose également à la venue d’« intellectuels » à une réunion organisée par le président Macron dans le cadre du « grand débat national ».
Par ailleurs, la photo choisie par la rédaction, à savoir une photo du Fouquet’sdévasté mais protégé par les « forces de l’ordre » pour illustrer l’article peut faire penser que ces signataires ne soutiennent pas uniquement un mouvement pacifique, mais affirment leur complicité face à ce qui semble dénoncé par les médias « mainstream ». L’article initialement paru sur Médiapartétait beaucoup plus « neutre » car seul le texte, sans image rapportée, était présenté. En regardantla liste des 450 universitaires signataires, ce qui est frappant (mais pas surprenant pour autant), c’est la surreprésentation d’universitaires de certaines disciplines et provenant de certaines universités en particuliers. Ainsi, il y a une prédominance des universitaires en sciences sociales (anthropologues, ethnologues, historien mais particulièrement politistes et sociologues, et une sur-représentation des universités Lyon 2, Paris 8, Lille, et dans une moindre mesure de l’EHESS, de Sciences po (diverses écoles) ou de l’université Toulouse Le Mirail. (Une partie de la description des signataires est à retrouver elle aussi en annexe)
Plus largement, et pour revenir aux articles de lundi matins signés par des universitaires, il semble exister une pluridisciplinarité assez étonnante : plusieurs universitaires en littérature/théâtre, en art, en économie, en philosophie, autant qu’en sociologie ou en anthropologie. Les articles anonymes ou signés sous pseudo peuvent encore accroître la diversité des approches.
Il est à noter également que les écrits universitaires ont pris de plus en plus de place au fur et à mesure de l’avancée du mouvement : là ou le 19 novembre aucun écrit universitaire n’était présent, ils constituent à la fin de la période une grande majorité des articles sur lundi matin.
Sur les 56 articles signés, 24 sont écrits par des universitaires, 22 par des personnes présentées comme « écrivain », « journaliste » ou « essayiste ».
Les autres articles signés le sont soit par des pseudos, soit par des patronymes non associés à un statut.
Dans tous les cas, analyses, comptes rendus de terrain, enquêtes, participent à la construction d’un savoir sur les luttes.
Le savoir des luttes et lundi matin : témoignages et écrits des gilets jaunes
A l’inverse, le début du traitement des gilets jaunes sur lundi matindonne tout d’abord la parole aux premiers Gilets jaunes, et aux premiers lecteurs souhaitant écrire sur le sujet. La première édition du 19 novembre consacre ainsi trois article aux Gilets jaunes : un signé par un père de lecteur, gilet jaune, qui vient répondre à l’interrogation de la rédaction « que pensent les gilets jaunes ? », puis deux témoignages de lecteurs, ayant faits des « enquêtes ». Dans le premier article, il est tout d’abord question du traitement médiatique général des Gilets jaunes, décrié par l’auteur. Il indique ainsi :
« Après, je comprends que ce flou, cet inconnu, fasse peur à certains. Beaucoup de gens dans mon entourage n’ont pas voulu rejoindre les gilets jaunes car ils disaient que c’était un truc de facho manipulé par le Front National.Sauf que ce n’est pas le cas, ils sont nombreux les politiciens qui voudraient récupérer le mouvement, le FN en première ligne (et Mélenchon pas loin derrière) mais pour l’instant aucun n’y arrive. Entendons-nous bien, je ne dis pas qu’ils n’y arriveront pas mais si cela arrive ce sera le cancer qui tuera le mouvement. Et oui, j’ai vu à la télévision qu’il y avait eu des actes et des insultes intolérables contre des homosexuels et des personnes d’origine étrangère, ça me révulse comme tout le monde mais c’est dégueulasse d’en faire ses choux gras pour amalgamer tout le monde et sous-entendre que lorsqu’on est « populaire » on est forcément bête et méchant. »[7]
Ici, il est donc question de l’origine populaire supposée des gilets jaunes, mais aussi de son affiliation avec des groupes d’extrêmes droites qui étaient médiatiquement très présent dans les débats sur les Gilets jaunes au début du mouvement. C’est peut-être pour cela que nous pouvons peut-être expliquer le non-ralliement immédiat de lundi matinpour les Gilets jaunes.
Pourtant, cette affirmation peut être nuancé par le titre du second article proposé par lundi matin le 19 novembre : « Une émeute anti-Macron sur les champs- Elysées ? »[8]Dans cet article, ce sont de jeunes lecteurs qui sont allés, non pas manifester avec les gilets jaunes pour la première fois mais qui sont allés enquêter. Ils énoncent ainsi : « Contre l’unisson argumentatif qui va paradoxalement, sur le sujet des Gilets Jaunes, du gouvernement à certaines franges de l’extrême-gauche en passant par le Nouvel Obs, nous souhaiterions rappeler, une fois n’est pas coutume, la maxime maoïste : “Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole” ». Une première forme de ralliement possible semble se dessiner à la fin de cette article : « Nous voudrions à notre tour parler le plus précisément possible de ce qui a eu lieu le 17 novembre à Paris, et livrer quelques réflexions à l’intelligence collective. Pour tenter de saisir ce qui est en train de se passer, par-delà les niaiseries médiatiques et les critiques faites en chambre. Sans fermer les yeux sur tout ce dont nous ne serons jamais solidaires. Mais sans rater pour autant des potentialités nouvelles et des formes de lutte réjouissantes. Pour que ceux qui ne se sont pas déplacés puissent prendre connaissance de la situation, et en tirer les conclusions nécessaires. »
Il semble y avoir, dans cette première édition, une forme dedifférenciation des écrits : le 19 novembre, à lundi matin, l’heure ne semble pas encoreau ralliement, mais plutôt à une forme de compréhension, de soutien. Petit à petit, la prise de position de lundi matinchange en devenant clairement une prise de position d’allié, de participant. Si cette position semble changer petit à petit, un revirement de situation a bien lieu dans l’édition du lundi 3 décembre, où près de 28 articles sur 33 portent sur les Gilets jaunes, et sur la journée du samedi 01 décembre, qui a été marquée par des comportements qualifiés d’émeutiers, par exemple dans l’édition du 2 décembre du journal Libération, dans laquelle des journalistes parlent d’ « émeutes inédites à Paris depuis 68 ». [9]Dans cette édition, les analyses fusent, les écrits d’un style universitaire anonymes également. Mais lundi matinprend également un nouveau rôle dans le mouvement : un rôle de diffuseur des écrits, des tracts et vidéos des gilets jaunes et des maisons du peuple de différentes villes. Le 3 décembre également, les lecteurs livrent des témoignages de chacune des villes. Ce qui change, à partir de cette date, c’est que les « lecteurs » ne livrent plus uniquement un témoignage d’enquête, du dehors, mais deviennent des acteurs qui témoignent de l’intérieur, en se définissant pour la plupart désormais comme Gilets jaunes.
A partir de cette date, les écrits de Gilets jaunes restent présents tout au long de l’année et semblent montrer une envie d’un savoir issu du terrain des luttes, au sein des luttes de savoir qui se jouent dans la revue en ligne.
Ainsi, semble coexister sur le site de la revue une construction de savoirs sur les luttes, mais également une construction d’un savoir issu du terrain des luttes. L’approfondissement d’une réflexion sur une possible lutte entre ces deux formes de savoirs au sein de Lundi matin pourrait être une perspective intéressante.
[1]« Lundi matin, le foyer insurrectionnel du web », Mathieu Dejean, les Inrockuptibles, le 04/10/16
[2]Lundi matin, page de Jacques Fradin.
[3]Bourdieu Pierre, « ce que parler veut dire » 1982, Fayard
[4]Carbonel Cécile, Pierrepont Alexandre « Dans les rues ruineuses de vie », lundi matin, 29 janvier 2019
[5]Carbonel Cécile, Pierrepont Alexandre « Dans les rues ruineuses de vie », lundi matin, 27 mars 2019
[6]450 universitaires, « 450 universitaires se déclarent complices des gilets jaunes », lundi matin, 27 mars 2019
[7]Anonyme, « Depuis samedi, nous nous sentons un peu moins seuls et un peu plus heureux », lundi matin, 19 novembre 2018
[8]Anonyme, « Une émeute anti-Macron sur les Champs-Elysées ? » lundi matin, 19 novembre 2018
[9]Fansten Emmanuel, Le Devin Willy, Halissat Ismael, « Paris : émeutes inédites depuis 68 », libération, 2 décembre 2018
0 notes
Text
Neopop

Jasmine, c’est un peu comme la grande soeur admirable dès que tu commences à aimer un peu la techno. C’est le genre de personne qui se réveillait déjà en 5ème avec Gesaffelstein en le programmant soigneusement sur son téléphone . Le même genre de personne qui était déjà fanatique des pionniers dès le collège, qui pouvait tenir à l’âge de 12 ans un débat sur tel ou tel sample utilisé par celleux qu’elle écoutait. C’est celle aussi qui connaissait absolument tout le vocabulaire à connaître pour analyser la musique, alors que la plupart des moldus recalés à l’entrée de Poudlard et à l’âge d’y être ne distinguaient généralement pas une musique d’une autre, et qualifiaient, comme les non-initiés, toutes ces qualifications de «musiques électroniques».
Jasmine est désormais une daronne de 20 ans. Il y’a un peu plus d’un an, elle rentrait d’un voyage au Portugal et commençait sa propagande sur le Neopop. S’ensuivit des artifices de forces de persuasions, où Jasmine arrivait alors à convaincre une bonne partie de son entourage que le Neopop était le meilleur festival de techno d’ Europe.
Je fus l’une des personnes à se faire avoir, mais c’était avec un grand enthousiasme, car Jasmine se trompe rarement en terme de musique.
Il est vrai qu’avec ses connaissances empiriques et théoriques sur la musique techno, elle possède cette légitimité qui fait que quoi qu’elle dise, son discours sera légitime et entendu. ( Bourdieu, ce que parler veut dire, 1982)
Le Neopop, c’est donc un petit festival, qui réunit, depuis 2006, les têtes d’affiches et qui propulse les nouveaux-nés grandioses vers l’avant.
Situé à Viana Do Castelo, à une cinquantaine de kilomètres de la ville portugaise de Porto, le festival s’est installé sur le port industriel de la ville entre les remparts du fort et les machines du chantier naval.

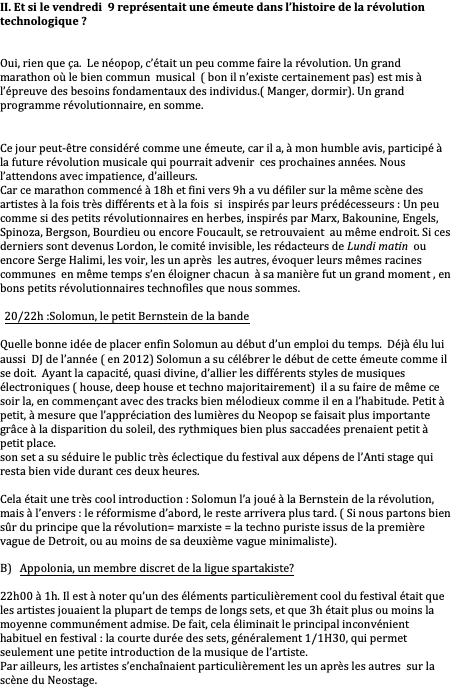
0 notes
Text
Pourquoi

Photo de Berillon
Tout contre est le petit frère du subversif qui vient enfin d’être crée.
Il ressemble comme deux goutes d’eaux à son aîné, seul le nom change, car ne voulions plus forcément ressembler à un nouveau journal édité pour le première fois en 1873. Tout contre est, nous l’espérons, un journal qui regroupera des visions, des éléments et des métaphores subversives sur le monde qui nous entoure.
Nous pensons que l’historique de la courte vie du subversif permet d’expliquer la volonté de tout contre. Alors, le voici:
Le subversif, nom (peut)-être (trop) ambitieux, peut être questionné par l’ambition du terme et de ses effets. Il peut aussi, en conséquent, se nicher dans le presque-rien. Il peut se trouver dans un propos en apparence anodin, il n’a pas besoin de grandes déclarations revendiquant sa subversion.
Autrement dit, le nom de subversif a été choisi pour ce fixer un but: la réflexion autour du mot lui-même et des discours produits à partir du terme “subversif’ et l’auto-réflexion de chacune et chacun.
Si cette réflexion est un jour subversive, alors le journal aura acquis son premier objectif.
Par ailleurs, inspiré par de nombreux cafés concept de Montréal, qui allient avec aisance un bar et un barbier, le subversif souhaiterait être un lieu de débat et de discours à propos de la musique techno. Si ces articles touchent à la politique, si ils arrivent à atteindre le discours subversif ( qui est légitime pour en juger?) alors le journal aura conquis son deuxième ( et pas des moindre) objectif.
Penser la subversion là où elle semble la moins présente, voilà le résumé du projet du journal.
0 notes
