Eva SAORINE, Elsa DUGOURD et Chloë PESTANA, nous sommes trois étudiantes en dernière année de licence d'arts de la scène. Ce tumblr vise à exposer un sujet mettant en lien la culture et la société, en se penchant sur le phénomène des théories qui touchent toutes formes d'arts et ce grâce à différents exemples concernant les contes pour enfants, illustrés à travers plusieurs articles.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Les messages cachés dans l’art, psychose ou réalité ?
Que ce soit à travers les pages d’un bestseller, du dernier titre d’un artiste à la mode ou bien des dessins animés qui ont bercé notre enfance, un bon nombre d’entre nous cherchent à créer du sens à ce qu’ils voient. Les « théories » fleurissent aujourd’hui sur la toile et au sein de nos discussions quotidiennes, mais sont-elles le résultat d’une psychose collective ou se basent-elles sur une réalité implicite ?
Selon le dictionnaire Larousse, une théorie est « un système d’hypothèses sous-tendant les interprétations des évènements ». A l’ère du numérique, elles se font sujet et parfois débats de nombreux internautes qui s’accordent ou non sur ces dernières.
Tous les arts en sont les cibles. Comme vous le verrez ici, c’est notamment le cas pour les contes pour enfants et leurs nombreuses adaptations, qui se feront témoins de notre analyse...
0 notes
Text
Le cas Disney
Depuis 1937, année de la sortie du premier long métrage d’animation signé Disney (ndlr ; Blanche Neige et les 7 nains), cet univers féérique est devenu une référence pour les enfants et parents du monde entier. Les princesses, héros et autres joyeux compagnons font partie intégrante de nos enfances. Chacun d’entre eux, et d’autant plus depuis qu’internet est devenu un outil de communication mondial, deviennent les cibles parfaites des fans et leurs théories. Et ce, que ces dernières soient confirmées par la production ou non. Les plus loufoques sont ainsi exposées au grand public et avant d’essayer de savoir pourquoi, nous allons en explorer certains exemples :

Le Roi Lion (1994, 43ème long métrage d’animation des studio Disney) : Ce dessin animé serait calqué presque exactement sur l’histoire d’Hamlet de William Shakespeare et d’ailleurs, Le roi Lion 2 serait quant à lui un parfait copié collé de celle de Roméo et Juliette (dans ce second opus, deux lions de tribus différentes tombent amoureux malgré les discordes de leurs familles respectives). Cela n’a jamais été révélé officiellement par les studios Disney, mais l’évidence plane depuis la sortie du dessin animé. De plus, certaines personnes le voient comme un film raciste où le lion noir (Scar) se bat contre les lions blancs (Simba et son père).
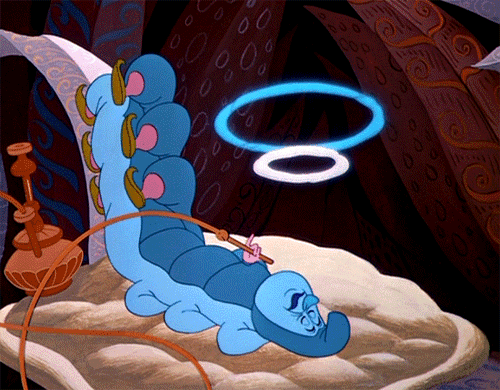
Disney et la drogue : Pour certains, les films Disney seraient pour plusieurs d’entre eux une propagande à la consommation de drogues ; Tout d’abord Dumbo (avec la scène des éléphants roses psychédéliques disponnible ici ), Alice aux pays des merveilles (les champignons qu’ingurgite la petite fille lui feraient imaginer l’histoire qu’elle vit, et voir des choses telles que des fleurs qui parlent, ou une chenille fumant des substances illicites), Le livre de la jungle (le moment précis où Mowgli se fait hypnotiser par le serpent et où ses yeux deviennent vitreux) ou encore Blanche Neige où chacun des 7 nains représenteraient un effet causé par l’usage de drogues ; éternuements, endormissement, irritabilité...

Toy Story / Toy Story 2 : Ces deux volets issus des studios Pixar, rachetés par Disney en 2006, sont sortis respectivement en 1996 et 1999. La très célèbre théorie qui en découle se base sur le fait que le chapeau d’Andy (ndlr : le propriétaire des jouets) est le même que l’ancienne propriétaire de Jessie (ndlr : la cow girl présente dans Toy Story 2). Grâce aux flashbacks, nous comprenons que la jeune Emily commence à grandir au cours des années 60 et il serait donc tout à fait plausible que cette dernière ne soit autre que la mère d’Andy. Elle aurait ainsi légué le chapeau à son fils. Une autre théorie a été imaginée autour de ce dessin animé et elle concerne cette fois le père d’Andy. Il n’apparaît à aucun moment dans les 4 opus, et des fans ont dans l’idée que ce dernier aurait récemment quitté le domicile familial pour des raisons plus ou moins tragiques. En effet, ils déménagent dans le premier opus dans une maison plus petite, et la mère de la fratrie en profite pour leur offrir un chiot, comme s’il y avait un manque à combler. Andy est très attaché à ses jouets, et notamment à Woody et Buzz, deux figures masculines. Cela peut signifier qu’il accepte mal le départ de son père, et le jeune garçon, qui hésite souvent entre son ancien jouet (Woody) et son jouet flambant neuf (Buzz) serait donc coincé entre son passé et son avenir, blessé par la situation. Le dénouement final voudrait donc dire que l’enfant accepte finalement la situation (la mort ou le divorce, le déménagement, sa nouvelle vie...). Réponse des réalisateurs concernant cette théorie : « Cette question nous est souvent posée, mais nous n’avons pas de réponse concrète. Nous ne cherchons pas à créer un mystère autour des parents d’Andy, c’est simplement que ce n’est jamais explicité dans l’histoire. Le père d’Andy est absent depuis le début, c’est tout »

Peter Pan & La petite sirène (1953 & 1989) : Cette fois ci, la théorie mêle deux dessins animés, pourtant sortis à près de 30 ans d’intervalle ! Dans le dessin animé Peter Pan, une des sirène du pays imaginaire ressemble étrangement à la mère d’Ariel (Athéna). Or, nous apprenons que celle-ci est décédée assez jeune. Certains pensent qu’elle aurait été tuée par le Capitaine Crochet, ce qui expliquerait que le roi Triton entretient une peur immense des humains et refuse que sa fille s’en approche. Ces théories mettant en lien deux films d’animations sont peut-être les plus folles et inattendues puisque les dates de sortie sont très espacées mais également que les personnages évoluent tous dans une époque, un univers et une esthétique différente. Pour valider ces théories, faudrait-il donc adhérer à une idée d’univers alternatif, dans lequel tous ces facteurs pourraient cohabiter ensemble, de la même manière que Peter Pan passe du monde réel au pays imaginaire ? À nous de le décider..
Au vu de cette liste non exhaustive, une question s’impose à nous ; D’où viennent ces théories ? Nous pourrions d’abord penser qu’elles sont le fruit d’inspirations violentes et allégoriques. En effet, les contes de Perrault, d’Andersen ou bien des Frères Grimm, majeure source d’inspiration pour Walt Disney et ses successeurs, ne prônent aucune innocence. Chez eux, la mention “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants” est bien loin de s’appliquer à tous les personnages. À titre d’exemple, nous pourrions évoquer le sort des deux demi-soeurs de Cendrillon. En effet, dans la version des frères Grimm, elles se voient forcées de se mutiler les pieds afin d’essayer d’enfiler la pantoufle de verre. Dans le conte original de “La petite sirène” signé Hans Christian Andersen, l’héroïne choisi de se transformer en écume plutôt que de tuer le prince dont elle est tombée amoureuse.

En ayant connaissance des contes originaux, il est plus facile de créer du sens en assimilant les “nouvelles” histoires proposées par les studios Disney, et à vouloir en créer toujours plus, de là à mettre en corrélation différents personnages et différents univers. Faisant écho aux contes de base, la violence se retrouve toujours dans les théories, de façon plus ou moins évidente ; meurtres, drogue, divorce, racisme... Mais ces théories s’avèrent pourtant être bien plus qu’un simple tissage de lien, comme nous le prouvent de nombreux théoriciens, tels que Bruno Bettelheim.
0 notes
Text
Les contes pour enfants ; Bruno Bettelheim et la psychanalyse.
Lorsque l’on évoque la psychologie des contes et leur possible interprétation un nom vient à l’esprit : Bruno Bettelheim. Il est connu avant tout pour avoir psychanalysé les contes de manière très poussée. En effet, se basant sur les théories freudienne, il a analysé les sens cachés des contes et l’importance de l’inconscient chez l’enfant. N’ayant pas de formation pédagogique ou en psychologie, c’est son expérience dans les camps de concentration (Dachau et Buchenwald) qui l’a poussé à entreprendre des recherche sur les réactions inconscientes des enfants atteints de troubles. Notamment ceux à l’origine de l’autisme, auquel il consacrera une partie de sa vie.
Dans son ouvrage phare, Psychanalyse des contes de fées (1976), il explique comment l’inconscient et le conscient de l’enfant sont intimement liés. L’inconscient de l’enfant agit sur le conscient en passant par les rêves, l’imaginaire et les fantasmes qu’il projette sur la réalité. Pour Bettelheim, les contes jouent un rôle primordial dans la manière dont l’enfant abordera les différents éléments de la vie. Il dissèque les contes les plus connus pour en démontrer l'utilité face aux futurs moments de vies de l'enfant. Il défend le fait que les toutes les épreuves de la vie sont contenues dans les contes et servent à former l'enfant inconsciemment par l'acquisition d'attitudes semblables à leur héros / héroïnes, tout en prenant racines dans ses ressources intérieures propres. Contrairement au Disney qui suivront, Bettelheim n’évacue pas les aspects les plus durs des contes au contraire (ndlr : la preuve ici). Il dit « Beaucoup pensent que seules la réalité consciente et des images généreuses devraient êtres présentées aux enfants, pour qu’il ne soit exposé qu’au côté ensoleillé des choses. » mais pour lui « la vie réelle n’est pas que soleil ».
Dans l’histoire de Cendrillon, Bettelheim traite notamment de la rivalité fraternelle, de la sexualité ainsi que de l’accomplissement de la féminité. La pantoufle de verre, selon lui est l’allégorie du vagin (« un petit réceptacle où une partie du corps peut s’y glisser »). L’affirmation de la femme que devient Cendrillon passe par la symbolique des essayages de la pantoufle. La belle mère quand à elle, sert de défouloir à l’enfant, il peut ainsi assouvir son besoin naturel de haine envers ses parents à travers l’image de la marâtre.

Le Petit Chaperon rouge est quand à elle la représentation de la dualité de la jeune fille entre les prémices de la sexualité et l’attachement œdipien au père. Le loup est alors à la fois la figure du père bienveillant et protecteur et du mâle séducteur et dangereux.

Face à ces théories parfois quelque peu fantasque et son absence de formation en psychanalyse, certains ne voyait en lui qu’un « psychanalyste autodidacte », pouvant alors remettre en cause certaines de ses théories. Ses travaux auront tout de même été une source de questionnement autour de la formation psychologique de l’enfant et sa capacité à comprendre de nombreux signes sous-jacent aux histoires racontées.
0 notes
Text
Qu’en retenir ?
Ses ouvrages sur le sujet ont indignés de nombreux parents considérant ses pensées somme destructrices d'un monde, du monde de leur enfance. Outre ses critiques souvent déclamées sans réelles recul sur le sujet, on peut voir dans les travaux de Bettelheim une certaine castration vis à vis de l'imaginaire. En cherchant à décortiquer et décrypter à tout prix les contes, il enferme les capacité de l'imagination, les effets voulus par Bettelheim lui même, sont alors retenu par ces explications assez implacables. Chaque enfant possédant ses propres caractéristiques, il paraît alors difficile de nourrir chaque enfant avec les mêmes contes. Comme souvent prouvé par de nombreux psychanalystes et pédagogues, chacun possède un fonctionnement propre, comment alors peut-on trouver les mêmes références et solutions qu'un autre. Les contes se baseraient alors seulement sur des émotions universelles et non sur des thématiques beaucoup plus précises comme le développe Bettelheim sans son ouvrage. Là où les effets psychologiques des contes sont peut-être les plus compréhensibles et flagrants c'est bien dans l'utilisation des sentiments fondateurs de l'être humain.
En effet l'amour, la mort, la rivalité, la peur, la tristesse, la joie et autres, sont des sentiments communs et ressentis dès le plus jeune âge par chacun des enfant. Comme vu dans un autre article du site, la firme Disney a alors des le départ de ses productions très bien su saisir ces sentiments pour en faire leur marque de fabrique. On a tous et toutes en tête la scène du baiser de la Belle au bois Dormant, le chant de bonheur de Blanche neige autour du puits, la mort du père de Simba ou la mort de la mère de Bambi. Ayant une notion forte de commercialisation, les producteurs ont alors fait le choix d'édulcorer les contes originaux pour en faire des œuvres idéalistes, naïves et basées sur des émotions brutes, primaires. On notera alors le choix de Disney de remplacer la petite pantoufle de vair (fourrure d’écureuil gris) de Cendrillon par une petite pantoufle de verre. Les histoires, alors allégées de leur potentiel psychologique, présentent à l'enfant des archétypes à la limite du stéréotype. Il peut paraître alors évident que certaines personnes cherche à y trouver un sens plus profond. Hier comme aujourd'hui, les théories à propos des significations des différents dessins animés, souvent des Disney parce qu'il sont les plus médiatisés, sont nombreuses et s'avère parfois véridiques. C'est alors qu'intervient une des caractéristique première de l'homme: vouloir trouver une signification à ce qu'il voit. Que ce soit dans la musique, le cinéma, les arts de la scène ou la littérature, chacun d’entre nous cherche à attribuer une signification plus profonde à ce que l’on lit, voit ou entend. Cette quête de sens conduit parfois à un mal être en société, cette crainte fréquente de « ne pas avoir compris ». Au delà de la psychanalyse, les significations d’objets culturels posent la question de pression sociétal sur les individus et la compréhension.

Vouloir forcer l'interprétation, pose un problème : si elle doit être autant démontrée elle n'est peut pas si évidente. Chaque théoricien ou psychanalyste s'ancre dans ses propres courants de pensées et y inclus donc individualité. Un panel de signification est alors possible et doit être pris en compte, mais il doit amener une discussion et des possibilités pour les intéressés et non une vérité absolue à connaître et accepter. Qu’elles soit réelles ou imaginaires, les significations des contes de l’enfance sont multiples. Si Bettelheim va quelque fois trop loin dans la psychanalyse des contes qu’il fonde en grande partie sur ses visions personnelles, les adaptations filmiques sont elles souvent trop simplifiées et adoucies. Vaut-il peut-être alors mieux pouvoir choisir des interprétations parmi un foisonnement de propositions plutôt que nourrir l’enfant d’image atténué et polies, les faisant certes fantasmer mais qui n’éveille que peu l’imaginaire.
0 notes