LE FEU SACRE EDITIONS > 2024 > NOUVEAUX AUTEURS : CINGUALTE, GAYRAUD, MOLET, TELLOP. Et toujours OSSANG, LEMANT, CHABANON, THIELLEMENT, JUGNON, SMITH, HOUDAER, PIGOT, FERRE, BERTIN, VILLARD, JACCAUD, EKEL, SAFFY, PERINO...
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
RIEN QU'UN MAUVAIS RÊVE, par Steven Lambert
Toutes les nécros de Michel Blanc, décédé tragiquement le 3 octobre dernier, ont cité le malentendu célèbre de Jean-Claude Dusse dans leurs gros titres, alors que l'acteur comme le cinéaste a été le seul de la troupe du Splendid à être on ne peut plus clair sur celui bien plus vaste et néfaste que sa bande de copains du Lycée Pasteur a su tourner à leur avantage. Le film de cette prise de conscience sur lui-même et son histoire, et leur dérive, c'est Grosse Fatigue. Le Feu Sacré a voulu lui rendre hommage en republiant ce texte de Steven Lambert.

Michel Blanc dans Grosse Fatigue (1994).
De quel rêve ou cauchemar les inspecteurs de police tirent-ils Michel Blanc lors de la scène d'ouverture de Grosse fatigue ? Est-il possible de sortir d'un rêve pour rentrer, mais sans trop le savoir et de plain-pied, dans un cauchemar ? Comme si l'un n'était que le marche pied de l'autre, un cauchemar sans fin qui nous aurait donné l'illusion, le goût pour des lendemains heureux et sans soucis afin de mieux nous entraîner au fond de son terrier. Et ces fausses interviews télé données par des vraies stars dans cette même scène : de quelle disparition – pour ne pas dire enterrement – annoncent-elles la nouvelle en prenant à partie ce public de cinéma devenu téléspectateurs ?
Vous êtes Michel Blanc ? demande le policier.
Ben je ne sais pas, il est encore trop tôt... Et vous ?, répond l'autre.
Celui qu'on appelle Michel Blanc a tenté avec ce film un exorcisme : celui de son image, son double, celui de sa carrière faite de seconds rôles et lui ayant donné comme par procuration un peu du rayonnement spectaculaire de ses anciens camarades du Splendid. Autant le dire d'emblée : si Grosse fatigue est réussi et fascine, c'est de montrer l'échec de cet exorcisme : autrement dit l'impossibilité pour Michel Blanc, tel un Peter Pan empâté et dégarni, de ne faire qu'un avec son ombre et surtout de faire que l'ombre ne soit qu'une ombre. Or ce film montre précisément la victoire nécessaire de l'ombre de Michel Blanc : la victoire de l'ombre comme lumière, comme la seule lumière qu'il n'y ait jamais eu. La victoire de l'ombre et du masque, du cliché et de la caricature vivante avec tous ses travers, non seulement sur sa personne mais sur son monde. Un monde désormais à l'image de cette imposture : à l'image de ces ruraux enfermés dans leur ringardise, de leurs dîners sans fin, de leurs adorations pour les stars, enfermés dans une vie où même les « miracles » ne sont jamais que l'autre nom du ridicule, l'occasion d'une bonne blague. Un monde où les questions d'identités se règlent avec la police, où les amis vous tournent le dos les uns après les autres quand ils ne vous tabassent pas, où chaque tentative pour répudier l'image infernale que vous vous êtes forgés et qui vous échappe est immédiatement sanctionnée.
Grosse fatigue nous montre ainsi comment une âme qui a perdu son corps le perd une seconde fois, mais sciemment cette fois. Cette première perte, antérieure au film, c'est cet imposteur qu'il faut retrouver et réussir à coincer dans la première partie : essayer de remettre la main sur ce qu'on a laissé filer, par négligence ou par paresse, essayer de sauver sa peau ; l'âme se réveillant un beau matin lorsqu'on vient lui apprendre les méfaits du corps (le viol de Balasko). Une fois attrapé le double maléfique, cet autre soi, ne se laisse pas faire et n'entend rien lâcher : il sait qu'il a la main haute, depuis un bon moment déjà, alors il dicte ses termes. C'est cette nuit au bord de la route où l'on pactise avec l' « ennemi », où l'on se distribue les tâches et où l'on perd sans trop chercher à le savoir : le corps ira faire acte de présence sur les plateaux télé, cachetonner dans des films médiocres pour ne pas éveiller les soupçons, pendant que l'âme ira se baigner au soleil le cœur léger, dans ce qui pourrait être un ultime avatar du Club Med cher aux Bronzés. La révolte de l'âme est inutile, hier comme aujourd'hui : l'ennemi, le Spectacle, cet hôte à qui l'on avait déjà dit oui sans trop chercher à s'en souvenir, est revenu réclamer son dû : il est revenu et il porte désormais notre visage.
Il n'y a pas d'échappatoire : nous ne sommes la victime de ce monde infernal que dans la mesure où nous en avons été l'artisan. C'est ce que cette virée à la campagne sur les traces de l'autre Michel Blanc, celui qui devait être issu d'un milieu autre que la bohème parisienne, nous apprend au même titre que ce pacte faustien conclu en bord de route. L'autre n'est pas là, n'a jamais été là pour nous rappeler au « goût des choses simples » : l'autre est là, dans l'ombre, prêt à saisir sa chance au moindre relâchement comme nous avant lui, pour prendre sa revanche. Revanchard et aigri, pétri d'une vie de ressentiment où l'on collectionne les affiches et photos des films de sa star préférée. Et ce relâchement advient toujours sans qu'on s'en rende bien compte, lorsqu'il est déjà trop tard : lorsqu'on s'est endormi, lorsqu'on s'est retourné dans sa propre image, cette image à laquelle on aura dit au moins une fois oui, juste une fois mais de trop.
Si l'autre vous connaît mieux que vous-même c'est que son monde ressemble à s'y méprendre au vôtre : du Carlton de Cannes jusque Chez Régine à Paris, en passant par les animations de supermarché et les concours topless dans des boîtes de nuit douteuses, il ne s'agit plus que de degrés sur la même échelle. Un monde qu'il connaît mieux que vous à force de ressembler à un de vos films et où l'on ne s'arrête plus après qu'une femme ait rejeté vos avances, parce qu'on sait qu'on peut désormais se le permettre. Un monde où même la prétention à être un auteur, ce parangon d'authenticité auquel on ne croit déjà plus trop soi-même, ne vous sauvera pas.
Une autre manière de dire que Michel Blanc cherche à expier avec Grosse fatigue l'expérience Splendid : la troupe autant que sa trajectoire et son sens, le symptôme qu'elle représente au sein de la société française des années 90. Michel Blanc cherche à expier mais le salut ne vient pas, lui est comme refusé. Lorsque le salut se présente c'est encore sous la forme d'un pacte, d'un donnant-donnant : jouer encore une fois les figurants, les seconds seconds-rôles, les garçons de café pour tout recommencer mais avec la leçon retenue. Autrement dit lorsque le salut se présente, enfin, c'est encore sous la forme d'une caricature, d'un marché de dupes dans lequel on espère perdre sa mémoire, perdre la trace de ce que l'on a fait. Jouer honnêtement la carte de la mauvaise conscience. S'humilier un peu plus comme l'ombre de l'autre à laquelle on est désormais condamné, descendre encore un peu plus bas dans le terrier et peut-être...

0 notes
Text
"LA MAMAN ET LA PUTAIN" (Jean Eustache, 1973), par Pierre Pigot
Le blog du Feu Sacré tenait à revenir sur l'un des événements cinématographiques marquants de cette année : la parution en vidéo de la quasi-intégralité de l'œuvre de Jean Eustache. Avec trônant au centre, ce film proustien qu'est "La Maman et la Putain".

Alexandre lit Proust.
« Longtemps, je me suis réveillé fort tard », telle est la note proustienne parodique sur laquelle s’ouvre le magnum opus de Jean Eustache, explicitement conçu en miroir du grand œuvre du petit Marcel. Alexandre émerge d’un lit qui n’est même pas le sien, et qui reviendra régulièrement comme une matrice dont il est difficile de s’extraire : lieu-refuge, et surtout lieu des femmes, de celles qui obsèdent et qui tourmentent, parce qu’elles se refusent avec obstination à la complète transparence qui devrait, selon leur supposé maître, accompagner leur possession jalouse. La passion d’Eustache pour la Recherche devait inévitablement rencontrer le problème qui se pose à tout créateur confronté à cette cathédrale de mots, d’art et de passion : être brutalement possédé par le désir de la reproduire, pour soi-même, pour en atténuer la force presque transperçante – et s’acharner à ne pas se satisfaire d’une simple reproduction. Tout dépendait du matériau qui était à disposition du fanatique. Proust avait sa propre vie, mais qu’il avait enrichie de sucs fictionnels vénéneux pour tout exégète. Eustache, moins protégé par l’art, n’était capable de mettre au mont-de-piété du cinéma que les parts les plus sacrifiables et les plus précieuses de son existence tourmentée. Moins d’une décennie plus tard, cette transparence s’avérerait fatale – et l’on reverrait, encore et encore, Alexandre assis, torse nu, lisant la Recherche dans sa vieille édition NRF, et plus particulièrement La Prisonnière, ce catafalque du malheur amoureux qui débouche ensuite sur son volume gémellaire, hanté par le deuil – et l’on songerait qu’ici, les photogrammes exhalaient, à défaut du plus beau, du moins le monument funéraire le plus juste qui soit. « Dans quel roman te crois-tu ? », lance Gilberte (la bien nommée) à Alexandre, au début du film, alors que la volubilité irréelle de ce dernier fonctionne déjà à plein régime. Alexandre, en effet, parle comme coule la prose, artificielle, syntaxiquement cassante, généreuse uniquement en feux d’artifices blessants. Le cinéma lui offre la voix de Jean-Pierre Léaud, ses tonalités d’innocence perverse, de naïveté étudiée, de détachement anxieux, de sociabilité paranoïaque. Ses paroles sont la véritable trame de sa personnalité – à côté desquelles son apparence physique ou vestimentaire (le profil d’oiseau mélancolique et obtus, les cheveux longs, les lunettes teintées, les foulards interminables) n’est qu’une concession faite à la réalité des corps, comme le snobisme (qui adore rôder dans l’ombre mouvante du dandy) aime à en circonscrire dans la matière, ici baignée dans un noir et blanc qui se défie de son époque. Ce sont ces paroles qui auraient dû convaincre Gilberte, mais n’ont fait que la confirmer dans sa part d’univers, d’un stérile doucereux, dont elle ne resurgira plus que comme fantôme de supermarché – avec à son coté, un mari incarné par Eustache lui-même, spectre silencieux, trop conscient d’avoir placé son autoportrait dans le seul recoin dont il se sentait digne face à ce que ses propres mots parvenaient à bâtir comme beauté noire : le rayon des fruits et légumes.
Ce n’est pas un film bavard (reproche habituel), mais un film prolixe, profus, où parmi les bruits de la ville (Paris, encore capable de faire sourdre de ses entrailles pompidoliennes un parfum balzacien), bruits enregistrés comme jamais, ne cessent de défiler comme à la parade leurs adversaires de toujours, les mots. Et que ceux-ci soient employés le plus souvent comme des armes impropres, fait justement partie du jeu misérable qu’Eustache feint de célébrer pour mieux le dénoncer. Alexandre utilise le vouvoiement : c’est à la fois une marque de distanciation, une flèche de séduction, et une moquerie du langage à double-fond – de manière totalement française, son discours fleuve, son discours marathon, a moins pour but d’exprimer une opinion, que d’exciser un peu de « réalité » du monde des humains, à l’aide des tenailles du langage, pour en obtenir la maîtrise passagère. Sur ce point, Alexandre est fidèle à l’adage védique, qui affirme que « les mètres sont le bétail des dieux », autrement dit, que chaque syllabe poétique est une armure vivante et divine en soi, une protection changeante et complexe, contre ce qui dans le processus sacrificiel peut blesser celui qui s’en approche. De la même manière, les mots sont pour Alexandre un double de ses foulards imposants qu’il transporte autour de son cou comme des gonfalons prétentieux : mètre gayatri ou trishtub, peu importe, il lui importe avant tout de découvrir, parmi les mots qui s’enchaînent, celui qui sera capable d’enfermer, de blesser, de retenir l’autre dans un cercle invisible, qui serait celui d’un microscopique gothul où quelques femmes, de son point de vue ses femmes, danseraient sa propre solitude. Ainsi l’histoire du tampax, qui doit aussitôt devenir un récit entré à son répertoire (comme celui de la Comédie-Française) – exhibé, digéré, poli telle une pépite d’or du Yukon, exploitable ensuite en société. Ainsi ces vieilles chansons de Frehel ou d’autres chansonniers du tournant du dernier siècle, dinosaures archaïques transportés dans les loges de la modernité cinématographique, mais qui au-delà de leur mélancolie intrinsèque, sont avant tout des transports de mots surarticulés, scandés, nourris d’une émotion que l’homme contemporain souhaiterait faire renaître sincère en soi (et bien sûr, il n’y parvient pas). Sans le savoir, Alexandre prouve que le divin réside désormais dans la chansonnette pour bal des pompiers. Une fois que le pouvoir des femmes unies l’aura défait, que le maquillage l’aura fait rejoindre leur camp dévirilisé, ce ne sera plus l’heure de la démonstration séductrice, mais celle du repliement mélancolique – et le classique, funèbre, sans mots, aura eu raison du populaire.
S’il l’avait connue, Alexandre aurait longuement rêvassé sur la légende de Krisna et des gopi, les seize mille gardiennes de troupeaux qui le vénéraient et tissaient autour de lui des jeux érotiques sans fin. Tout l’équilibre de la relation entre Krisna et ces jeunes filles résidait dans la balance infinie qui régit le svakiya (lien légitime, conjugal) et le parakiya (lien illégitime, adultérin). Alexandre crache d’emblée sur le svakiya parce qu’il l’associe au retour à l’ordre bourgeois qui suit la remise au pas de la société après mai 68. La complicité mentale avec son meilleur ami (qui est en réalité son parfait double dandy hautain, son frère jumeau, mais privé, lui, de toute déchirure psychique) repose sur la croyance hypocrite que le parakiya, la recherche inassouvie de l’unique parmi l’infinie multiplicité féminine, est le seul contrepoids du svakiya auquel en vérité il aspire (car sinon, pourquoi encore et toujours Gilberte, pourquoi, au-delà des questions d’argent, encore et toujours Marie ?). Mais l’écueil majeur du svakiya, autour duquel le film navigue comme s’il s’agissait d’un vaste et sanglant récit de corails ne faisant qu’affleurer la surface, demeure bel et bien la procréation, l’engendrement, le renouvellement des générations au-delà du plaisir égoïste. Quand Alexandre confesse face caméra une histoire qui finit par parler d’avortement, il s’empresse de remettre ses lunettes teintées, qui sont l’équivalent d’un masque : la faille, à charge pour nous de le comprendre, n’est pas celle d’un deuil, mais d’une mauvaise conscience, qui se hâte d’aller se blotir derrière les dandy paraphernalia. Les mots sont cette fois érigés en muraille de Chine, mais avec la mystérieuse Veronika, ils ont rencontré un adversaire de taille, maniant exactement la même arme, mais avec une précision bien différente. « Baiser » : Veronika aime les mots crus, c’est sa philosophie à coups de marteaux – déchirer les bandelettes ductiles du langage avec des lames aiguisées sur le fer de la vie, la vraie, dépouillée de son fantasme, ramenée à l’essentiel d’une humanité qui frôle, dans l’exaltation du sexe, l’animalité. Elle ne cesse de réclamer une promenade au « bord de l’eau » : c’est une créature liquide, plus Mélusine foudroyante que nymphe désirable, jouant de ses cheveux coiffés en bandeaux lisses et inflexibles, puis une fois défaits, tentaculaires et gorgonesques. Ses propres blessures ramènent celles d’Alexandre au stade de l’enfantillage : une puérilité ivre d’elle-même, qui se croyait le dieu de sa parole, et qui se découvre une rivale, à la mentalité aussi acérée qu’Athéna et aussi imprévisible qu’une ménade. Le grand exploit de Veronika est l’instant suprême où elle obtient, enfin, le silence. Ses propres mots ont pris leur victime, le jeune homme trop sûr de ses dégoûts et de ses névroses, à la gorge, et lorsqu’elle démolit sa grandiloquence et sa vanité, elle ne laisse plus, derrière elle, qu’un petit animal piteux et blessé, auquel ont été retirés ses jouets syllabiques, et qui se découvre nu dans une obscurité psychique sordide. Le grand monologue de Veronika, si justement célèbre, qui réussit à unir dans sa confession à la fois le gloria de l’amour et le sanctus des larmes, est un chant profondément personnel, arc-bouté contre toutes les dissimulations, qui réduit à néant tout le vaste échafaudage néoromantique qu’Alexandre avait disposé autour de sa personne. C’est une tempête de désir et de désespoir qui, dans la stase d’un plan unique, ravage tout et s’octroie ainsi la royauté de tout le récit. Et la révélation que Veronika est enceinte, détruira ainsi chez Alexandre les dernières illusions, le rendra à son caractère d’infamie, d’infériorité, de mendicité amoureuse qui était véritablement le sien. Impuissance face à la divinité qui l’a terrassé – qui a obtenu, comme dans tant de hyérogamies grecques, un peu de sperme pour générer du futur – et qui, comme premier acte de serviteur, lui fait recueillir son vomi.
C’est sur cette note de souillure, de chaos et d’humiliation qu’Eustache conclut les quatre heures de son roman, pardon, de son film. Peu auparavant, on avait pu voir Alexandre, soudain muet, se mettre à écrire quelque chose, sur un coin de table, sur un bout de papier. Et c’était la première fois qu’on le voyait, depuis le début de cette longue histoire, réaliser quelque chose qui soit de l’ordre de l’esprit. Ce quelque chose, malgré une moquerie de femme, il restera à jamais invisible, on ne saura jamais ce qu’il contenait, ce qu’il parvenait soudain à exprimer, en mots cette fois non parlés, mais écrits. C’est le résidu irréductible de cette expérience – son mystère d’Eleusis, le seul auquel nous ne pouvions pas être conviés.
2 notes
·
View notes
Text
PAPY A FAIT L'ALGÉRIE, par Maud Bachotet (2/2)
Seconde et dernière partie de l'essai littéraire de Maud Bachotet autour de l'Algérie et d'un grand-père approchés par le biais d'archives photographiques familiales. Work in progress d'un ouvrage futur dont l'autrice nous livre un incipit des plus prometteurs. La première partie est à retrouver ici.

Je suis née pulvérisée des embruns marins et maternels sous le signe astrologique du Poisson, pourtant je nage comme un chien de plomb. Mon père, qui est le seul nageur de la famille mais manque aussi de pédagogie, avait entrepris un été de me pousser sous les vagues jusqu’à ce que mon instinct de survie coordonne mes jambes et mes bras. La technique aussi bien que le résultat sont discutables. Mais je dois reconnaître y avoir gagné un peu de témérité ; il m’arrive de me jeter à l’eau de loin en loin, bien que la plupart de mes plongeons malhabiles s’achèvent en plats magistraux. Devant toute une classe de collégiens hilares, on me forcera à avouer mon inaptitude à la survie en pleine mer, condition sine qua non au stage de voile lui-même obligatoire. Je bénéficierai donc de cours quasi particuliers avec mon professeur de sport et la piscine municipale deviendra, les mercredis après-midi, le théâtre de nombreuses reconstitutions d’une célèbre scène du film Mais où est donc passée la septième compagnie ? C’est d’ailleurs peut-être parce que lui-même n’a pas appris à nager que la technique de « la main en sifflet et vers l’extérieur » de Pierre Mondy amuse tant mon grand-père. Il ne peut s’empêcher, lors de chaque visionnage, de se faire l’écho des meilleures répliques qu’il saccade de son rire hoquetant. Sa préférée étant sans conteste « Qu’est-ce qu’il nage bien, le chef ! » Quand je m’étonne qu’un enfant comme lui qui a grandi les yeux tournés vers la mer ne se soit jamais risqué à y brasser, il me répond « Oh, tu sais, on avait autre chose à faire. » Zachary non plus ne savait pas nager – on forme à nous tous une lignée de brasseurs cassés –, il a pourtant fendu plus d’une fois l’Atlantique de la Manche au golfe du Saint-Laurent et réchappé à autant de naufrages. La maîtrise du dos crawlé, lorsqu’on est amené à porter des kilos de laine et de toile cirée sur le dos et plusieurs paires de chaussettes aux pieds, apparaît sans doute comme superflue dans le curriculum vitæ d’un terre-neuvas. Au milieu du grand nulle part de l’océan, même le nageur le plus chevronné finit par sombrer sous le poids de ses décorations. Bien que la profondeur de la Manche (entre 30 et 80 mètres en moyenne) soit loin d’égaler celle de l’Atlantique (jusqu’à 8 605 mètres), je préfèrerais éviter de m’y essayer à la pratique du saut périlleux. Les fonds marins m’ont toujours effrayée. Qui sait ce qui s’y terre lorsque seulement 5 % des océans ont été explorés ? Lorsque le plus grand spécimen de pieuvre observé mesurait 9,1 mètres et pesait 272 kilogrammes ? À trop vouloir plonger dans l’inconnu, découvrirais-je moi aussi un monstre qui se cache sous la surface trouble ?
Mes pensées sur la noyade et les créatures marines s’approfondissent au son d’une voix masculine crachée dans un haut-parleur m’annonçant la levée imminente d’un vent de force 9 sur l’échelle de Beaufort. Il y a treize barreaux à cette échelle de mesure empirique allant de 0 = « calme », à 12 = « ouragan ou bombe météorologique au-dessus du 40e parallèle ». J’en déduis que 9 = « ça va secouer un peu ». Les quatorze heures restantes de traversée risquent d’être longues. Ayant le vertige facile, je n’aime pas beaucoup les échelles. Je serai pourtant bien forcée de grimper celle-ci à la cadence du vent. Par chance, n’ayant pas réservé de cabine, je n’aurai pas à me hisser de surcroît jusqu’à la couche d’un lit superposé. Je gobe un comprimé de Mercalm en prévision, hésite, en jette un second par-dessus la Manche, bercée d’illusions.
Je profite du calme avant la tempête pour éplucher une nouvelle fois les photos prises par mon grand-père. Il n’apparaît sur aucun clichés saisis à la volée sur le paquebot reliant Marseille à Alger. Sans doute quelques compagnons de route et inconnus possèdent dans leurs propres albums ou boîtes cabossées et oubliés dans un coin de grenier la face cachée des vues que je scrute les yeux plissés sur mon écran. Je l’imagine dans son uniforme, en contre-plongée, l'œil droit dans l’objectif, l'œil gauche avalée par sa paupière fermée fort, comme je l’ai si souvent surpris dans mon enfance. Du départ, il ne semble avoir pris que deux photos : deux prises de vue – une plongée, une frontale –, un même sujet – deux soldats, probablement rencontrés peu de temps avant le départ. Les conflits armés, ça rapproche. Moi, sur mon bateau, je ne risque pas de nouer de liens particuliers avec les touristes, les jeunes filles au pair et les familles franco-irlandaises. Il y a deux autres photos prises depuis un bateau dans mon dossier. Le cadrage n’est pas le même, mais il me semble qu’il s’agit d’une autre embarcation. Celle-ci ne part pas vers l’Algérie, elle en revient. Sur le pont, on distingue une majorité de civils, des Algériens pour la plupart, et non pas de soldats. Surtout, le sujet a changé. Ce n’est plus les copains conscrits qui intéressent mon grand-père, toute son attention se porte désormais sur la cathédrale Sainte-Marie-Majeure dont la silhouette seule annonce les retrouvailles avec la mère qui dorlote, le père qui ordonne, les frères et les chiens qui jappent. Dans la boîte en carton, il y avait un document, une permission accordée du 24 décembre 1960 au 17 janvier 1961 délivrée le 12 novembre 1960 et autorisant le port de la tenue civile. Ces images auraient-elles été prises à cette occasion ? Les hommes en bras de chemise et les reflets du soleil m’indiquent le contraire. Je ne m’en sortirai pas sans les mots de l’appelé derrière l’objectif. Va-t-il finir par me parler ?
La nuit se couche sur une mer sans sommeil. Elle se tourne et se retourne dans sa couche sédimentaire. Bientôt se lève et se cabre. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on raconte à qui veut bien l’entendre que la marée monte à la vitesse d’un cheval au galop. On ne dit rien des vagues et de leurs ruades meurtrières, de leurs sabots qui claquent et fauchent, des vents qui lorsqu’elles s’écrasent avec fureur hennissent. Dans les couloirs du ferry, on croise des petits cercles de membres d’équipage de tout service et de tout grade se concerter à voix basse. Ils ont troqué uniformes amidonnés contre Levis 501 et bolo ties[1]. On distribue des Stetson aux passagers. Dans les cuisines, le rodéo a déjà débuté dans un concert de casseroles renversées et d’assiettes brisées. La compétition se divise en trois temps, on l’appelle également le 3x8. Chaque épreuve doit être accomplie en huit secondes ; pas une de plus, pas une de moins. D’abord, chef et commis doivent discipliner les cuisines en empêchant vaisselle et ustensiles de s’écraser au sol (huit secondes). Le passager (ou coéquipier errant) prend le relai en empoignant d’une main son plateau qu’il est tenu d’acheminer jusqu’à une table sans en faire caracoler le contenu (huit secondes). Pour mener son équipe à la victoire, il doit ingérer entrée-plat-dessert qu’il lui faut par la suite contenir en son estomac (huit secondes). Des sacs en papier kraft sont mis à la disposition des candidats, sans limitation.
En Algérie française, le bronco, le cheval sauvage, indomptable, c’est l’Algérien, le Musulman, l’Arabe. Le bicot. Paronymes dans l’oppression. Pour dompter le cheval, on le sépare de ses congénères, on l’attache, on le selle, on le monte. Le cheval se défend, s’efforce à dégager le cavalier de son dos à grand renfort de cabrioles. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à la résignation à la domination. Pour dompter l’Algérien, on redouble d’ingéniosité, on puise dans des méthodes testées et approuvées. On réprime, on extorque, on terrorise, on humilie, on casse. On rafle, on interne, on torture, on viole, on exécute. Et puis on enrobe ça de bons mots édulcorants : « crevettes Bigeard[2] », « gégène[3] », « corvées de bois[4] ». C’est l’exercice d’une domination sans dénomination qui échouera pourtant à résigner.
À combien s’élève la force du vent qui me traverse sur l’échelle de Beaufort ? Il y a des questions que je ne me suis jamais formulée et qui m’écrasent avec la brusquerie et la puissance de la vague. Celle qui vous entraîne dans son rouleau. Papy peut-il avoir torturé ? Papy peut-il avoir violé ? La tempête qui gronde au-dehors n’est rien comparée à celle que j’abrite. Je ne voudrais pas que la main qui a tracé des volutes dans mon dos ait actionné la gégène. Je ne voudrais pas que les lèvres qui ont pansé mes bobos aient forcé le corps d’une Algérienne. Je ne voudrais pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas savoir. C’est peut-être ça que je suis venue fuir dans cette traversée qui n’en finit pas. Je suis bien forcée de m’avouer que je ne connais rien de l’Algérie française ni de sa guerre. Je n’en sais pas beaucoup plus de mon grand-père. Je n’ai jusqu’alors eu accès qu’à l’un de ses visages, celui du grand-père. Qu’en est-il du père, de l’époux, du collègue, du fils, du frère, du petit-fils ? Qu’en est-il de l’appelé ?
Des arbres qui penchent vers un sol dénudé. Çà et là quelques touffes d’herbes sèches. Un paysage de partout. Le voilà dans le tiers gauche de l’image. Sa maigreur post-adolescente flotte dans une veste et un pantalon cargo. Dépasse un col de chemise posé sur un pull. Les jambes en parenthèses, il ceint le cou d’un âne de son bras droit. Dans son dos, une silhouette semble monter l’animal. Les traits de son visage se noient dans la lumière, mais les deux ombres marquées des fossettes laissent deviner un large sourire tout en dents. C’est un enfant qui sourit. C’est un enfant qui chahute avec ses camarades. C’est un enfant qui s’est déguisé en soldat. Dans un paysage qui pourrait sembler de partout, si ce n’était pour la TTA 47/53 (la tenue de combat toutes armes 1947, modifiée en 1953).
Les aboiements des chiens de compagnie encagés sur le pont et l’écho des vomissements des passagers optimistes ayant embarqué sans trousse à pharmacie m’ont tenue éveillée toute la nuit. J’ai besoin de prendre l’embrun, me doucher de la poisse ambiante. Sur le pont, on a fait la paix. Les animaux se sont tus, la mer a décoléré. J’observe pour la première fois de mon existence un horizon nu. Jusqu’alors il y avait toujours eu un obstacle posé sur la mer. Des monts ou des forts. Des îles ou des pointes. Là, rien. Je me sens subitement très seule sur ce ferry low-cost empli de voyageurs blafards. Je suis Robinson Crusoé déviant sur son radeau. Ignorant où je me trouve. À quoi je tente d’échapper. Ce que je suis venue chercher. Bientôt je débarquerai moi aussi sur une île. D’aucuns l’ont sans doute baptisée « île du désespoir » au milieu du XIXe siècle, lorsque se multipliait les visites du cannibale nommé « mildiou », lorsqu’elle se désertait sous les yeux clos des Britanniques, un autre genre de cannibales, plus sournois. J’y rencontrerai les héritiers d’une autre guerre d’indépendance.
Rosslare, ce n’est ni Marseille ni Alger. C’est plat et vert. Il n’y a aucune cathédrale ou basilique à photographier. Seulement des rangées multicolores de containers et des parkings gigantesques où rugissent les moteurs de bus prêts à partir. Les voyageurs n’y voient qu’un lieu de transit qu’ils traversent sans concevoir qu’il s’agit du coin le plus ensoleillé d’Irlande et que les plages de ce village d’à peine 1 800 habitants pullulent chaque été de touristes. Nous débarquons sous la pluie. Dans cinq heures, trois comtés et vingt-six arrêts, je serai à Cork.
─────────────────────
[1] Sorte de cravate associée à la tenue traditionnelle des cow-boys.
[2] Expression qui désigne les personnes exécutées lors de « vols de la mort », jetées depuis un hélicoptère en mer Méditerranée. Elle tient son nom du général Bigeard, qui a servi durant la guerre d’Algérie.
[3] Abréviation de « groupe électrogène » et terme de l’argot militaire français désignant un générateur électrique portatif. La gégène est utilisée pour torturer des personnes en leur appliquant des électrodes sur diverses parties du corps.
[4] Expression utilisée par les soldats français pour désigner les exécutions sommaires de prisonniers algériens.
2 notes
·
View notes
Text
PAPY A FAIT L'ALGÉRIE, par Maud Bachotet (1/2)
Première partie d'une chronique à la fois familiale et historique, du portrait d'un homme et d'une guerre, "Papy a fait l'Algérie" convoque un réseau d'images gardées secrètes que l'écriture se charge de donner à voir, de transmettre, relier, faire parler. C'est un voyage de recouvrance à la fois physique et mental aux deux pôles Nord/Sud. Maud Bachotet est écrivaine et éditrice, ses travaux d'écriture récents ont pour points de départ l'enquête psycho-géographique, l'imagerie populaire et anonyme, ou encore l'autofiction "psychopompe" (le récit intime se lovant dans celui d'une figure réelle dont l'écrit est leur point de rencontre). "Papy a fait l'Algérie" est sa première contribution au blog du Feu Sacré. Gooble Gobble, bienvenue à elle !

Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy.
J’ai tant grandi que la maison d’enfance me semble devenue de poupée. Je déborde aussi bien du lit que de la baignoire, me cogne le crâne dans la largeur de la trémie chaque fois que je descends l’escalier et peux sans peine m’accouder à la table du séjour depuis le canapé tout en ayant un pied dans la cuisine. C’est un peu comme de vivre dans un voilier à jamais amarré.
Je me souviens du jour où la grande marée avait envoyé le fleuve valser dans les ruelles du village. Mon père, craignant le naufrage, avait pulvérisé de la mousse expansive sur le pas de la porte. Depuis la fenêtre, j’espérais que l’eau monte assez pour emporter notre bicoque au loin. Peut-être aurions-nous ainsi pu rendre visite à nos « cousins des îles ». Mais l’eau s’était arrêtée à une dizaine de centimètres seulement de notre porte. Comme pour me narguer. J’étais dévastée. Autant que je le suis aujourd’hui de me coucher bredouille dans mes draps de petit mousse. Après trois années passées sur les bancs de l’université à ne pas chercher à regarder plus loin que l’horizon de la licence (mes parents n’avaient pas su me payer de longue-vue en laiton ni me conseiller dans mon orientation), j’ai dû me résoudre à m’échouer sur le banc de sable bordant mon bled littoral. Me voici donc ensevelie sous une mer de cartons que je me refuse à ouvrir. Quitte à faire trois pas en arrière (un par année passée loin d’ici), je préfère encore m’immerger dans l’hier. Je retourne placards et tiroirs, relie chaque objet, vêtement ou feuille volante à une image de mon enfance ou de mon adolescence – je fais bien plus confiance aux récits de l’inanimé qu’à mes propres souvenirs. Dans la maigre bibliothèque, je tombe sur un livre de Jéromine Pasteur, Chaveta. Entre les pages, tournées à la volée, je feuillette ma mémoire qui se supplée à celles de l’exploratrice. C’est mon grand-père, dont je n’ai jamais vu le nez dans un bouquin, qui me l’avait donné à lire. Je me souviens d’un bateau construit des mains d’une jeune femme sans expérience. Je me souviens de ce même bateau engloutis quelque part sous l’Atlantique et des larmes de la jeune femme sans expérience. Je me souviens aussi d’un plan élaboré à la récré – au fil de ma lecture, peut-être ? – ayant pour dessein une virée à deux (pré-adolescentes sans autre expérience qu’une poignée d’heures de cours de voile) en catamaran. En revanche, je ne me souviens pas sur-le-champ de la forêt péruvienne, des Asháninkas ni des guérilleros. Ce n’était pas tant le prolongement de l’arrivée qui m’avait fascinée que l’urgence du départ.
Cette urgence, je l’avais toujours eue en moi. Enfant, j’avais vidé une valisette en plastique rouge (un jouet) de son contenu (des jouets) pour la remplir de ce qui me semblait nécessaire à la fuite, à savoir deux culottes blanches, un crayon télévision à double mines rouge et bleue et mon ours en peluche rose. Une fois sur le trottoir, tétanisée par le grondement des voitures, j’avais pris conscience qu’il n’était pas si simple de partir et étais rentrée affronter la peur de ma mère assourdie par le vrombissement du Moulinex. Plus tard, j’avais fini par accepter les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver et d’été à demeure. Mes amies me postaient des cartes où tout était blanc, les pistes de neige comme les plages, et qui me réconfortaient lorsque le vert des champs, des dunes et de la mer me donnait la nausée.
Mon grand-père ne s’est jamais lassé des paysages de son enfance. Tous les matins, il prend sa voiture pour aller saluer la baie et prévoir le temps qu’il fera selon le niveau d’ennuagement du mont. Le samedi, il se laisse conduire par ma grand-mère jusqu’au sémaphore de Granville où il occupe son après-midi à inventorier les bateaux du port. À quoi pense-t-il depuis son banc de guet public ? Au jeune pêcheur en partance pour les grands bancs de Terre-Neuve ? Au jeune appelé sur le point d’embarquer sur l’El Djezaïr ? Au petit garçon rêvant de marcher dans les sabots de son grand-père ? Peut-être m’avait-il mis le livre de Jéromine Pasteur entre les mains pour cultiver chez moi ce désir héréditaire du grand large et qui semblait toujours sauter une génération.
Un jour, ma mère m’a dit : « Je ne comprends pas d’où te viens cette envie de voyager. Moi, je n’ai jamais eu envie de partir. » Je rêvais alors de contrées lointaines, de coutumes exotiques et de langues imprononçables. Je nourrissais une passion dévorante pour la Chine, ensuite détrônée par l’Inde, tandis que ma mère s’était contentée de ne jamais quitter le village qui l’avait vue grandir. Quant à mon père, il n’avait eu qu’à parcourir moins de quatre kilomètres pour l’épouser. La seule personne de mon noyau familial à n’avoir jamais franchi les frontières du village et du pays tout entier se trouvait être mon grand-père. Plus qu’une guerre, l’Algérie avait été pour moi un voyage dans sa jeunesse. Ce n’était pas la Chine, mais ça m’allait bien aussi. C’était un autre continent et on y parlait une langue qui se peint. Quelque part, j’enviais mon grand-père d’avoir « fait l’Algérie ». « Faire l’Algérie », à mes oreilles, ça ne signifiait pas « faire la guerre ». Avec l’innocence de l’enfance, je posais des questions sur le pays et il traçait devant mes yeux des paysages étrangers. Je posais des questions sur la langue et il posait sur la mienne des mots arabes. Je notais déjà sur des feuilles volantes à moitié noircies de dessins tout ce qu’il voulait bien me raconter. Mais j’ai beau fouiller la chambre de fond en comble, je ne parviens pas à mettre la main sur ces premiers témoignages recueillis à l’encre pailletée, peut-être même parfumée. Cette fois, il me faut me fier à ma mémoire.
Je repense à la boîte cartonnée. Plus tôt dans la semaine, mon grand-père m’a demandé au téléphone « dis, la boîte avec mes photos, sais-tu où qu’elle est ? » « C’est moi qui l’ai, papy. Rappelle-toi, tu me l’as prêtée… Je te la rends la prochaine fois que je passe ! » « Ah ! Bon, bon… » Je me suis demandée si ça lui prenait souvent de parcourir ces images. Avant de les lui rendre, je me lance dans un grand inventaire. Je dénombre un total de 190 photographies, 11 cartes postales et photos-cartes et 4 documents. Je distingue les photos de famille des photos que j’associe au service militaire. En attendant que mon grand-père accepte de poser des mots sur ces images, je me contente de les trier à l’estime :
FAMILLE (66)
· Baptême maman (14)
· Maman (15)
· Chantiers (5)
· Chiens (10)
· Fête de mariage (5)
· Autres (17)
SERVICE MILITAIRE (124)
· France (11)
· Algérie (113)
CARTES POSTALES & PHOTOS-CARTES (11)
· Deux femmes devant un décor peint (1)
· Carnaval (1)
· Le vieux pont (1)
· Rue du Pavé (1)
· Gavarnie (1)
· Algérois (1)
· Alger, casbah (1)
· Heureuse année (1)
· Souvenir de mon passage sur l’El Djezaïr (1)
· Souvenir de mon passage sur le Kairouan (1)
· Souvenir de mon passage sur le Ville de Tunis (1)
DOCUMENTS (4)
· Ordre de mission (1)
· Permission (1)
· Ticket de pesage de la grande pharmacie de Bab El Oued (1)
· Carte de prière Sœur Marie-Céline de la Présentation (1)
Les photos ainsi répertoriées, je les scanne une par une. Zoomées et rétroéclairées par l’écran de mon ordinateur, j’en découvre les détails.
Une vue en plongée du pont. Une mer vide occupe quasi entièrement la moitié supérieure du cadre. Au premier plan, deux rangées de valises bon marché, trop petites pour contenir des vies entières. Près des valises, trois hommes en uniforme. L’un d’eux a remarqué la présence du photographe. Il y a de la méfiance dans son regard. Ou peut-être est-ce un rayon de soleil. Sur la gauche de l’image, des civils, trois hommes et une fillette dont la tête est masquée par un foulard, s’appuient au garde-corps pour suivre du regard la trajectoire du bateau. Sur la droite de l’image, un jeune garçon et deux soldats les imitent. Au centre de l’image, deux autres soldats fixent l’objectif. Leur air penaud semble avoir été saisi par surprise. Sans doute le photographe les a-t-il sifflés depuis son nid perché avant de déclencher l’obturateur. Le mauvais cadrage donne à l’image une impression de mouvement.
À force de fixer la photo, je vois la houle onduler, les cheveux ondoyer, les corps tanguer. Surtout, je vois les valises. Le sujet de ce cliché, ce sont elles. C’est le départ. L’ailleurs. L’inconnu. Que met-on dans une valise quand on n’a rien ? Quand on nous somme de tout laisser derrière soi ? De ne prendre que le stricte nécessaire ? Une carte de prière confiée par les mains d’une mère inquiète et qui a marginé au dos « Réciter cette prière pendant neuf jours. N’oublie pas. » ? Moi, dans ma valise, je glisserai cette photo de deux inconnus surpris par le regard de mon grand-père. Il ne remarquera pas qu’elle a disparu.
À faire défiler sur l’écran de mon ordinateur ces paysages en noir et blanc, l’urgence du départ se fait plus que jamais ressentir. Comme l’ont fait avant moi Jéromine, papy, Zachary – la première par défi, le deuxième par devoir, le dernier par nécessité –, je m’en vais prendre la mer. Par dérobade. À une vitesse de 21,5 nœuds, soit 39,8 km/h, il me semble que je pourrais mettre à bonne distance le futur qui s’entête à me rattraper.
Le choix de la destination est simple : 1) il me faut un pays où me rendre par bateau ; 2) il me faut un port d’arrivée au départ de Cherbourg. De tous les pays qui peuplent mes fantasmes d’ailleurs, il ne reste donc plus que la Grande-Bretagne et l’Irlande. Je choisis les rebelles aux colons, la république à la monarchie, la patate à la Marmite, les Pogues à Police.
Pour se rendre à Cork, il n’est pas nécessaire de construire son propre bateau, pas plus qu’il n’est requis de posséder un ordre de mission ou des compétences en matière de pêche à la morue. Il suffit simplement de sélectionner au clic avec ou sans cabine, standard ou supérieure, avec ou sans hublot. Parce que je rêve d’aventure – qui a l’avantage d’être plus à portée de porte-monnaie que le confort –, j’opte pour l’expérience du grand large sans cabine, option hublots à volonté, dix-sept heures de traversée. Débarquée à Rosslare Harbour, il ne me restera ensuite qu’à prendre un premier bus pour Waterford et un second pour Cork. Quatre à cinq heures de route, trois comtés (Wexford, Waterford, Cork), vingt-six arrêts.
Arrivée à Cherbourg, il pleut. Je ne m’en étonne pas. Car l’économie cherbourgeoise repose sur l’eau dans tous ses états. D’un côté la mer, dont quatre ports (militaire, de pêche, de commerce et de plaisance) permettent de tirer profit, de l’autre la pluie, que Jean-Pierre Yvon a l’idée (soufflée par Jacques Demy) d’exploiter en créant en 1986 « Le Véritable Cherbourg », un parapluie haut de gamme multiprimé qui voyagera jusqu’au Japon couvrir la tête de l’actuel empereur Hiro-no-miya Nahurito dont la notice Wikipédia nous apprend qu’il a été décoré Grand maître de l’ordre du Soleil levant mais malheureusement pas de celui de la Pluie tombante. L’Antibourrasque étant à 149 euros, le Pébroque à 299 euros et le Milady en Moire à 650 euros, je prends la pluie. Et je me demande si Geneviève (Catherine Deneuve) aurait pu se refuser à Roland (Marc Michel) et lui jeter ses pierres précieuses à la moustache si seulement elle avait fait une école de commerce et vendu des parapluies de Cherbourg à des princes héritiers.
Je pense à Guy (Nino Castelnuovo), appelé en Algérie dans la première partie du film, en novembre 1957. J’entends ses paroles : Oh... Tu sais, maintenant, ça n’a plus d’importance... / Nous avons même tout notre temps... / Ce matin, j’ai reçu cette feuille de route / et je dois partir pour deux ans... / Alors, le mariage, on en reparlera plus tard... / Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, / je ne reviendrai pas d’ici longtemps... Je pense alors à mon grand-père, Normand lui aussi, ouvrier lui aussi, appelé lui aussi, au même âge, à l’été 1959. C’est drôle, je cours à l’aveugle derrière cette histoire que personne ne veut regarder droit dans les yeux et la voilà qui me devance sur le quai du port de Cherbourg tandis que j’embrasse ma mère, comme tant d’autres l’ont fait avant moi.
Sur la passerelle d’embarquement, je me demande si, là-bas, du côté de la mer Celtique, je trouverais des réponses dans mon disque dur saturé de photos. Sans doute trouverais-je plutôt des questions à poser dans le micro de mon téléphone, que mon interlocuteur, rejetant la faute sur la mauvaise qualité du réseau, pourra ignorer comme bon lui semble.
Depuis le pont, j’observe le quai. Ça fourmille d’adieux en bas. Je distingue mon grand-père, dans son uniforme foncé. Nous ne sommes plus à Cherbourg mais à Marseille. Derrière lui se dresse La Major. Il n’a ni mère à consoler – elle tient son café en Normandie –, ni fiancée à qui chanter des adieux – il ne l’a pas encore rencontrée.
Je sens une présence à mon côté. C’est lui, qui s’accoude au bastingage. Il considère la cathédrale d’un œil déformé à la fois par les rayons du soleil et par un professionnalisme juvénile. À 20 ans déjà, il ne peut s’empêcher de détailler la structure d’un édifice aussi digne – lui qui s’apprête à rejoindre un conflit qui l’est si peu –, de se figurer, sans posséder aucune connaissance de l’histoire de l’art et de l’architecture, quelles techniques les ouvriers de l’époque ont-ils utilisées. Bien plus tard, lorsqu’il sera transporté par taxi à Reims pour qu’un spécialiste de renom pulvérise au laser la tumeur venue se loger dans son oreille, il rendra chaque jour visite (du lundi au vendredi, pendant plusieurs semaines) à la cathédrale de Reims, sans jamais laisser faiblir son admiration.
Je me souviens de la présence de deux photos de La Major, la cathédrale de Marseille, dans la boîte, prises depuis le bateau. Il y en a également trois qui font le tour presque complet (nord, ouest, sud) de Notre-Dame-d’Afrique, à l’ouest d’Alger. Il n’y aucune piété chez mon grand-père. Ces édifices religieux sont pour lui comme des phares. Des points de départ. Et d’arrivée. Des témoins familiers parce que taillés dans le plus noble des matériaux : la pierre.
Je voudrais lui pointer du doigt le Mucem, ce cube posé sur la jetée et voilé d’une mantille de béton. Mais lui ne peut pas la voir. Il ne sait pas encore qu’un musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée verra le jour en 2013 à Marseille et qu’il s’enrichira en 2017 d’une collection d’œuvres et d’objets rassemblée en vue de l’ouverture d’un musée d’histoire de la France et de l’Algérie qui n’aura pas lieu. Alors je me contente de lui dire « est-ce que tu vas finir par me parler ? » Mais lui ne semble pas m’entendre. Son regard s’est posé à son tour sur le quai devenu celui du port de Granville. Il scrute un homme à l’accoutrement d’un autre temps : gros chandail, veste et pantalon cirés, bottes cuissardes, suroît en toile brune, mitaines en laine, baluchon. Zachary, le terre-neuvas. Un peu plus loin, une chorale d’hommes avinés entonne : Ceux qui ont nommé les Bancs / les ont bien mal nommés / ils en font des louanges / ils y ont jamais été. À son côté, une femme fixe la mer avec défi. Derrière eux, une fillette à qui l’on a dit de ne pas se retourner, sous peine de ne pas voir revenir son père, caresse un énorme chien à robe noire qui bientôt s’endort. Je me tourne vers mon grand-père. Je voudrais lui poser des questions sur Zachary, ce grand-père qu’il aimait tant. Mais il a disparu. Je suis de retour à Cherbourg. Et le ferry lève l’ancre.
La seconde partie sera publiée la semaine prochaine.
4 notes
·
View notes
Text
HUIT PROPOS SUR "BASIC", par Steven Lambert
Hier a débuté (et jusqu'au 1er mai) le crowdfunding des préventes du livre John McTiernan : Cinéma Total. On y retrouve les plumes de Yal Sadat, Julien Abadie, Nicolas Tellop, Antoine Mocquet, Arthur-Louis Cingualte, Aurélien Lemant et Steven Lambert, qui en a aussi assuré la direction éditoriale. C'est à lui que nous devons ce texte écrit il y a bien longtemps pour une lointaine revue de cinéma, et qui lui a inspiré "Héroïne", le titre de sa contribution à cet ouvrage collectif à paraître au Feu Sacré dans la toute nouvelle collection La Forge dédiée au cinéma. Parlons donc ici de "Basic", un des tout derniers films de McT, parlons des femmes dans son cinéma, et par elles du secret sans mystère des hommes.

“Fingebant simul credebantque” [1]
Tacite, Annales, V, 10
I.
Imaginez devoir raconter l’histoire de ce film, très simplement, à quelqu’un qui ne le connaît pas encore. La question est de savoir choisir votre point de départ et où vous arrêter. La vraie question, cela dit, est de savoir ce que vous allez cacher.
II.
De toutes les histoires qui traversent, bifurquent, s’évanouissent, se ramifient ou encore s’emmêlent au sein de ce film, celle qui nous est livrée dès les premiers plans y tient une place discrètement centrale. Le Boléro de Ravel lance ses premières notes, d’imposants navires traversent dans un sens puis dans l’autre le Canal de Panama, et une voix de femme nous raconte l’histoire de ces cadavres d’ouvriers, sacrifiés à la construction du Canal, que l’on dissimulait dans des tonneaux remplis de vinaigre pour servir aux apprentis chirurgiens en Europe. « Cet endroit a toujours eu une façon particulière de traiter avec le profit et la mort », conclût-elle. Or ce ne sont pas des bateaux à vapeur qui défilent devant nous mais bien des cargos modernes : le profit et la mort sont là, hier comme aujourd’hui, et la dissimulation toujours à leurs côtés. Cette dissimulation opère non seulement au sein de l’Histoire mais concrètement dans ces quelques plans qui emboutissent passé et présent : derrière les navires les bateaux à vapeur, derrière les bateaux à vapeur les tonneaux et derrière ces tonneaux les cadavres qui allaient rejoindre la florissante économie de la mort. Selon le principe bien connu des poupées gigognes, chaque image sécrète ou est le signe d’une autre image. Ce sont ces images-signes anecdotiques qui nous indiquent, comme en passant, que le film tout entier se place sous le sceau de la dissimulation : l’image est toujours un creuset d’autres images, d’autres histoires qu’elle ne livre pas d’emblée, mais plus fondamentalement : l’image ment.
Ce premier montage (image, son et musique) permet de voir dans cette « ouverture » une allégorie du film lui-même [2]. C’est effectivement à la manière d’un palimpseste avec ses redites, ses ratures, ses ajouts que se présenteront tout au long du film les différents flashbacks. Ces images ne forment pas la matière continue d’un film (dans le film) que l’on reconstituerait patiemment pour arriver, enfin, à une révélation finale mais s’entassent les unes sur les autres à la manière d’un imagier offert à notre distraction : c’est-à-dire autant pour notre bon plaisir que pour nous écarter de l’essentiel. À cet égard le fait que la voix de celle qui sera notre double dans le film soit séparée de son visage pointe vers lui. De la même manière que la voix jetait le doute sur les images et les transformaient en signes trompeurs, le fait qu’elle soit désaccordé du visage qui est le sien nous fournit un indice précieux dans un film qui multipliera les fausses routes et mensonges. Cet indice vient avec le visage de cette femme sortant théâtralement de l’ombre au rythme des éclairs et sur lequel on peut sentir ce mélange instable entre doute et certitude propre à toute révélation.
C’est à cette révélation qu’il nous faudra arriver. Pour qu’il y ait révélation il faut qu’il y ait eu dessaisissement et c’est l’écart entre la voix qui faisait la leçon et le visage désormais défait qui en est la preuve. Ce visage, cette femme, c’est nous : autrement dit quelqu’un qui pensait savoir et qui s’est trompé ou que l’on a trompé. Quelqu’un qui apprend.
III.
La déception de cette femme fait en ce sens écho à notre propre déception une fois le dernier twist advenu avec la fin du film. Elle l’anticipe. Nous avons revu ce visage dans la nuit, son expression particulière laissée en suspens au début du film et très vite retournée à l’oubli par force de retournements. Nous avons, comme elle et avec elle, compris, ayant suivi le même chemin. On nous aura également trompé. La déception du Capitaine Osborne (Connie Nielsen) est une déception amoureuse qui ne dit pas (trop fort) son nom : elle ne concerne qu’un seul homme et moins l’aboutissement de l’enquête ou une faute logique de raisonnement. La nôtre concerne le film lui-même ; bien que les deux soient liées. La raison tient à ce que Basic est une romance dissimulée dans un film qui présente tous les signes d’un thriller : l’exercice qui tourne mal, les fusillades [3], la jungle, la nuit noire et la pluie battante : tout le décor est bien en place, jusqu’aux acteurs connus, mais légèrement décalé. Et ce décalage, qui donne l’impression de voir un film d’action où il ne se passe rien (ou bien trop), tient au fait que l’action est subordonnée à la parole, et plus précisément au mensonge, comme moteur de l’histoire.
Tous les personnages masculins du film mentent et ce sont leurs mensonges qui dictent à la fois le prochain mensonge du voisin et les mouvements des enquêteurs dans l’enceinte de la base, autrement dit l’histoire du film. Seule Osborne ne ment pas parce qu’elle est celle qui d’entrée de jeu voit ses capacités mises en doute par son supérieur hiérarchique : elle est celle qui en silence assiste, observe, rapporte, apprend. Notre semblable, notre image. Elle est hors-jeu même lorsqu’on lui demande de participer, à l’exemple de cette première trahison que lui inflige Hardy (John Travolta) en lui demandant de jouer au good cop/bad cop pour mieux éventer devant le suspect la grossièreté d’un tel subterfuge. À la fin de l’interrogatoire le Colonel Styles (Tim Daly) leur demandera s’il est coupable : Hardy répond oui et ment, Osborne non mais n’est pas écoutée. Il ment parce que l’objet de l’enquête n’a jamais été de savoir ce qui s’est passé mais de faire tomber un trafic de drogue et récupérer un des siens infiltré dans la base : c’est un whodunit où les morts ne sont que simulées, fantasmées et qui porte sur un trafic dont nous n’apprenons que très tardivement l’existence. Faire d’une femme, isolée dans un monde d’hommes qui tous (lui) mentent et qu’on nous présente comme inexpérimentée, le héros caché d’un film n’est qu’une des voies qu’a trouvé McTiernan pour renverser la logique du film d’action qu’il a su lui-même imposer.
Cette logique repose sur trois grands principes où action et parole sont inséparables. Principe démocratique : il n’y a pas de distinction quant à la provenance de la parole, personnages principaux et secondaires sont sur un même pied d’égalité. Principe de confiance : la parole est intégralement acceptée quant à sa valeur de vérité ou son savoir, surtout dans l’urgence ou en cas de crises à résoudre. Et enfin, principe dynamique : la parole que l’on reçoit relance l’action, qui s’y accorde, dans l’espace. Ce sont les vestiges de cette logique que l’on trouve dans Basic où l’on navigue entre les mêmes lieux (bureaux, chambre d’hôpital, salle vide, cabane dans la jungle), où un mensonge chasse l’autre jusqu’au vertige, et où le même petit nombre d’hommes à droit à la parole.
IV.
Le chemin qu’emprunte l’histoire est désormais déterminé par la vitesse propre de la parole, par la vitesse à laquelle le mensonge d’un homme biffure et se surajoute à celui d’un autre. Basic est certes un film très bavard mais c’est un film où les paroles prononcées s’enroulent autour d’un même vide (le prétexte de savoir ce qui s’est passé), menaçant sans cesse de le faire s’effondrer sur lui-même. De cette spirale infernale ne résiste, rétrospectivement, que la romance entre Osborne et Hardy. Autrement dit, dans ce monde peuplé par le mensonge et le mensonge des hommes envers d’autres hommes, les seuls qui affectent réellement Osborne sont ceux prononcés par Vilmer (Harry Connick Jr.), le médecin chef de la base et ancien amant, et par Hardy. Ce sont les deux seuls moments du film où l’on peut la voir sortir violemment de la place qui lui a été assigné : en envoyant à terre Vilmer à coup de bottin et dans un début de corps à corps avec Hardy suggérant une parade amoureuse déguisée en combat.
Parmi tous les mensonges qu’elle peut entendre, Osborne n’en retient que deux. Elle n’en choisit que deux, plus précisément. Et dans les deux cas, il s’agit pour elle de voir vraiment l’homme qu’elle aime, d’essayer de le lever le voile sur son secret. Pour Vilmer, les choses sont claires : c’est un opportuniste, un trafiquant et un salaud. Pour Hardy, les choses sont plus complexes. La première image qu’elle a de lui est fausse bien entendu, c’est celle qu’Hardy choisit de lui donner, à elle dont il ignore encore si elle est à la hauteur, et au Colonel Styles pour lui faire baisser sa garde : Hardy trempé au milieu de la base se grattant l’entre-jambes le temps qu’un camion passe devant lui. Le secret d’Hardy est en fait lié à un signe que seuls Hardy (parce qu’il en fait partie) et Styles (de par son grade) peuvent comprendre : le « 8 » que l’on voit inscrit en bas du papier rendu par Pike (Brian Van Holt) et demandant à ne parler qu’à un ranger. Avant de pouvoir le comprendre, mais seulement à la toute fin du film, Osborne ne sait pas vraiment qui est Hardy et quelle est son histoire. Déception là encore : le secret de ce « 8 » est simplement de désigner une unité opérant dans le secret au sein de l’armée : le secret débouche sur le secret. Cette « 8ème section » (ce nom, signe et sigle) est juste un épouvantail [4] que ses membres n’ont pas jugé bon de contester, l’acceptant sans qu’il ne renvoie à rien (hiérarchie ou nombre de membres).
Osborne choisit pourtant Hardy ; assez pour le suivre, l’espionner et lui sauver la vie face à Styles. Elle retient son mensonge à lui, le poursuit, parmi tous les autres mensonges que le film peut offrir. Aimer quelqu’un, aimer un homme, c’est d’abord aimer son mensonge et aller jusqu’au bout de l’arc-en-ciel avec lui : c’est vouloir percer le secret sans mystère d’un homme. C’était déjà le cas pour Catherine Banning (Rene Russo) et Thomas Crown (Pierce Brosnan) dans le film précédent de McTiernan. Deux romances dissimulées sous le manteau du thriller et comme passées en contrebande [5] : deux films d’initiation à une romance secrète comme au secret d’un homme. Et par deux fois les femmes sauvent les hommes de leur mensonge, pour leur mensonge.
V.
Le fait massif du mensonge des hommes et la nature trompeuse des images sont intimement liés dès que l’on replace la romance au cœur du film. Ils éclairent le sens à donner aux différents flashbacks. C’est en effet peine perdue que de vouloir monter ensemble ces différentes versions d’une même série d’événements dans l’espoir de combler un angle mort du film, de reconstituer la chronologie enfin irréfutable des faits. La raison en est toute simple : ce sont des « visions » d’avantage que des flashbacks : les visions d’Osborne tirées de ce qu’elle recueille auprès des hommes et comme issues de cette nuit épaisse, onirique dans laquelle baigne le film. Le flashback est un procédé stylistique qui dévoile tout ou partie d’une vérité factuelle (ce qui s’est passé) mais en retard pour en renforcer la puissance de révélation. Or, on le sait, rien de ce qui nous est montré dans la jungle ne peut prétendre à cette définition car l’objet avoué de l’enquête n’est qu’un prétexte et la révélation une affaire de sentiments.
Encore une fois c’est par un indice noyé dans la masse mais situé à la toute fin du film que la preuve nous est donnée de cette lecture. C’est cette dernière vision fantasmatique qu’a Osborne d’Hardy poignardant West (Samuel L. Jackson) dans la jungle qui autorise à lui attribuer la paternité de l’ensemble des visions : dernière vision qui vient couronner une longue série de retournements imaginaires et marquer son caractère subjectif par la violence, le désarroi de la trahison qu’elle suggère. Elle en est à la fois l’unique sujet, l’origine et l’objet, dans la mesure où celles-ci sont déterminées par les mensonges des hommes. Ces visions n’adviennent d’ailleurs qu’aux moments où Osborne est physiquement présente pour projeter ce qu’elle entend : ainsi ne saura-t-on jamais ce que Pike et Hardy se disent sur le tarmac, couverts par le bruit du rotor [6]. Elle essaie de mettre de l’ordre dans tout cela, comme nous, mais il est impossible de bien voir ce que l’on ne comprend pas (la toute puissance du mensonge et des hommes entre eux).
C’est qu’Osborne n’a pas encore choisi parmi tout ce qu’elle enregistre. Elle n’a pas encore choisi quelle image et quel secret poursuivre, trop attachée qu’elle est encore aux signes de l’enquête et à l’histoire. En attendant les visions continuent d’arriver comme autant de symptômes dont la crise (ce trop plein, pour elle comme pour nous) sera marquée par cette image furtive d’Hardy magiquement projeté dans la jungle : image désormais au-delà de toute vraisemblance et absolument séparée du reste du film : pure transposition à l’écran d’un état d’âme. Le mensonge des hommes, les visions et l’histoire (le scénario, l’enquête) ne font qu’un.
C’est ensemble et d’un même mouvement qu’Osborne doit apprendre à s’en séparer : telle est, en fin de compte, sa trajectoire dans le film. Refuser enfin le rôle qu’on lui a donné et qu’elle n’a pas choisi (quitte à en choisir un autre [7]). Le temps d’un film pour ne plus être ce témoin ou cette spectatrice passive, le temps d’un film pour se rendre compte qu’on est amoureuse.
VI.
Cette dimension initiatique de la romance a un prix qui passe par le renoncement à un monde de mensonges pour l’élection d’un seul, mais ce prix ne s’arrête pas là. Suivre jusqu’au bout le mensonge d’un seul homme, c’est accepter de disparaître avec lui pour pouvoir partager ce mensonge. Mentir est aussi vital que ludique pour eux. Tomber amoureuse c’est traquer un homme pris dans un jeu auquel il ne renoncera pas, le sauver des conséquences de son jeu, et savoir qu’il n’y a rien derrière son secret. Un jeu du chat et de la souris forcément déceptif auquel on choisit de croire malgré tout. L’autre nom de cette croyance, c’est la confiance : celle que l’on attend sans cesse de l’autre et celle qu’il nous accorde ou nous retire sans cesse. La confiance tant attendue entre deux personnes qui s’aiment et, dans le cas d’Osborne et Hardy, entre deux personnes travaillant en équipe. Cette promesse autour de laquelle l’histoire de Banning et Crown s’enroulait déjà : la nécessité et, dans le même temps, l’impossibilité de se faire durablement confiance.
Ce double bind de la confiance est le cœur secret de la romance et lui dicte son mouvement. De tous les désarrois qu’il occasionne, la déception fait toujours figure de dernière épreuve et offre aux personnages féminins l’occasion d’opérer une transformation du regard. Ce moment particulier où toute la trajectoire du personnage et l’histoire du film avec elle menacent d’être frappés d’absurdité. Le non-sens d’un jeu que l’on n’a pas compris (ou trop tard) faute d’en être réellement partie prenante, d’avoir été manipulée dès le début pour finalement revenir à notre point de départ : avec toute la confusion et la solitude qui lui sont propres. C’est le sens des larmes de Banning à bord de l’avion où elle pense embarquer seule vers une nouvelle et déjà insipide enquête pour assureurs ; c’est le sens de cette dernière image d’Hardy dans la jungle pour Osborne, en proie au désarroi et à la colère, tandis qu’elle le file au sein d’un carnaval de rue aussi envahissant qu’effrayant. Tout ce que les hommes ont à offrir pour racheter cette tristesse et cette déception c’est une place dans cette vie qui s’accorde à leur mensonge, à leur rêve. Que les hommes fassent enfin confiance pour que les femmes partagent leurs vies ; que les femmes reconnaissent le jeu des hommes pour ce qu’il est et acceptent l’espèce de poids qu’ils lui confèrent. Partager le secret, l’illégalité ou une aventure : partager une « vie de cinéma » en somme, quitte à faire un pas de côté hors de ce monde pour cela [8].
Le signe de ce passage à l’ombre du secret, de cette transformation du regard d’Osborne, est à la fois (encore une fois) anecdotique et paradoxale : c’est cet aveugle assis dans un escalier et qu’elle croise en s’engouffrant dans un bâtiment signalé par une boule de billard noire (« 8 »). Cet aveugle qui marque autant par son immobilité la fin de l’agitation qui régnait encore dans la rue qu’un seuil vers un endroit gardé où la lecture des signes (les visions) n’est plus d’aucune aide, si elle l’a jamais été. C’est aveugle qu’Osborne pénètre dans ce bâtiment : aveuglée par toutes ces visions absurdes qui étaient liées à la nuit, autant qu’immunisée contre elles désormais. Prête à délaisser d’un même mouvement le double-jeu des signes, les luttes pour le profit et le pouvoir, le monde des vivants enfin.
VII.
Passer de l’autre côté et rejoindre les fantômes. Prendre place à côté d’eux par amour : tel est le dernier sens de la trajectoire d’Osborne et du film avec elle. C’est par la déception (ce revers de la confiance) que mensonge et amour sont liés, mais il faudra une forme de sacrifice pour enfin sortir de ce cercle infernal et que soient liés amour et mort. Ce sacrifice est avant tout celui du monde des apparences dont il convient de s’écarter en le redoublant : assumer le faux-semblant comme ce qui ne cache rien ; à l’image des hommes pour qui le masque (le secret) ne dissimule jamais qu’un autre masque (l’absence de mystère).
La « 8ème section » est en ce sens pleine de fantômes : de ces individus qui ne sont définis ni par leur place au sein de l’armée ni par leurs noms « propres » ou celui de leur confrérie secrète. Dunbar, Pike, Nunez, Castro sont tous des noms d’emprunts ; de la même manière qu’ils ont emprunté à leurs ennemis ce nom censé les regrouper et les « identifier ». Autant de masques ou d’épouvantails interchangeables et vides qui peuplent le film, à l’image de ce carnaval de rue célébrant le Jour des Morts. Cette fête qui est aussi bien celle qu’Osborne interrompt lorsqu’elle retrouve Hardy et ses coéquipiers, sirotant des bières et se préparant à petit-déjeuner comme si rien ne s’était passé. Leur dernière et pour certains première apparition hors de tout flashback. Des morts revenus une dernière fois saluer Osborne et nous saluer avant de disparaître à nouveau ; ne serait-ce qu’avec la fin du film.
Leur dimension spectrale est directement liée et anticipée par leurs apparitions au sein des visions d’Osborne : ces fantassins oniriques que l’on assassine à plusieurs reprises et de plusieurs manières mais qui reviennent, encore et encore, comme assoiffés, sans mémoire.
VIII.
Fiers d’avoir su s’en sortir encore une fois, remerciant le hasard ou la chance autant que leur sens de la débrouille, ils rient. Ils rient et Osborne se tient devant eux. Elle les regarde et leur dit calmement : « Vous n’existez pas. Vous êtes tous morts ».
───────────────────── [1] "Ils fictionnaient et au même moment ils croyaient à leurs fictions." [2] Et, à des degrés divers, c’est le cas de bon nombre d’ « ouvertures » (ni scène d’exposition, ni prologue au sens strict) chez McTiernan ; citons Last Action Hero (1993), Die Hard with a Vengeance (1995) ou encore The Thomas Crown Affair (1999). La malice – ce mélange d’ironie et de ruse – est une des clés de l’œuvre de McTiernan comme de ses personnages. [3] Déjà dans Predator (1987), des militaires vidaient des chargeurs entiers sur un ennemi invisible au cœur de la jungle. [4] De la même manière que Samuel L. Jackson portant habits, cape et lunettes noirs joue ce rôle d’épouvantail dans le film, dont la réputation bricolée est censée être légendaire et source de terreur chez les cadets. [5] L’ouverture du film trahissait déjà cette idée que Thomas Crown n’a rien à cacher, avec cette vertigineuse descente depuis une vue satellite jusqu’au tissu de la manche de son veston (pure surface), entrecoupée de son entretien avec sa psychanalyste où il ne dévoile rien. On sait d’ailleurs très vite que c’est bien Thomas Crown qui a subtilisé le tableau (et l’a remis en place, dissimulé aux yeux de tous). L’enquête de Banning, là encore, n’est qu’un prétexte. [6] Une autre vision arrive une fois qu’ils sont tous revenus en salle d’interrogatoire mais Pike ne répète pas ce qu’il a dit à Hardy (pourquoi lui mentir puisqu’ils sont de mèche ?), il raconte une histoire pour Osborne. [7] Hardy reconnaît dans les dernières minutes les capacités d’Osborne, même si le compliment à son égard est rapporté par West. Hardy lui propose une place parmi eux mais la réponse d’Osborne ne viendra pas. Ce n’est pas, après tout, pour cette raison qu’elle l’a suivi jusqu’ici. [8] La première et plus radicale occurrence de ce "disparaître ensemble" chez McTiernan se trouve dans Medicine Man (1992) où le Dr Crane (Lorraine Bracco) se retirait dans la jungle avec le Dr Campbell (Sean Connery) ; autant par amour pour l’homme que pour l’assister (croire avec lui) dans sa recherche d’un traitement contre le cancer, à la limite entre science et magie.
0 notes
Text
LA BRÈCHE, par Constance Ogier
Constance Ogier a intégré il y a peu la joyeuse troupe du Feu Sacré comme relectrice. Elle sera l’œil scrutateur de nos futures publications, passant au peigne fin les tapuscrits. Pour fêter son arrivée, elle a accepté de nous laisser publier son premier texte. Un conte de la crypte, au sens propre. Entre poésie, humour noir, petite et grande histoire. Entre Jules Michelet et Jorge Luis Borges. Gooble Gobble, bienvenue à elle !

“Le prévenu est un vieillard sec et jaune” Gazette des Tribunaux du 11 mai 1856
Chaque passant de Paris se souvient avoir croisé, lu, parcouru un de ces panneaux brunâtres de l’histoire de Paris - autrement nommés pelles Starck - qui annoncent le monument visible ou fantôme auquel il faut s’intéresser. Cette fois-ci, en novembre dernier, j’étais plutôt interloquée par les images qui se formaient en moi après la lecture des appositions “inventeur et victime” inscrites côte à côte sur la même plaque. De là est né un désir insatiable - doublé très vite par un long travail de fouille - de connaître et comprendre cet homme.
Le 12 janvier 1856, prenant le contre-pied des vivants qui se contentent de mourir en dehors des cimetières, un homme meurt à l’intérieur même de celui de Montmartre, anciennement dénommé la Barrière Blanche. Ce cimetière citadin, situé dans le nord de Paris, est bordé par la rue Caulaincourt - ministre sous Napoléon Ier - la rue Ganneron - député et chandelier - Joseph de Maistre - fervent anti-révolutionnaire,...Tous ces noms ne nous disent trop rien quand on les découvre, ils ont pourtant leur part de chair dans le tableau imprécis de cette histoire. De nos jours, on s’y promène le dimanche, rare espace de verdure pour y déposer nos regards et nos corps broyés par les secousses et les bruits de la ville. C’est un espace où l’on fait communauté malgré nous autour des morts, comme pour être tout à fait solidaires avec eux dans un silence résilient. Pourtant, au XVIIIe et XIXe siècles, pour des raisons d’hygiène, le cimetière n’est plus accolé aux églises, mais déplacé en dehors de la ville perdant ainsi une place symbolique au sein de la communauté [1].
Depuis Philippe-Auguste jusqu’à la Révolution, des agents communaux, dits les « crieurs des morts », annonçaient à travers la ville munis de clochettes, le nom des défunts et l’horaire des funérailles aux côtés des prix des marchandises et des lieux de noces. Comme s’ils cherchaient à marchander la mort, sans toutefois y parvenir. Ils sont ensuite remplacés par des faire-part et des rubriques nécrologiques dans les journaux qui deviennent le relais de la mort, l’espace où le nom se dit en même temps qu’il se lie au moment du décès. C’est d’une étonnante violence d’inscrire un nom dans une rubrique, comme si cela actait, d’une certaine façon, l'impossibilité de ne plus l’énoncer autre part. La mort de cet homme n’a été qu’un événement isolé dit-on, le cimetière affiche malgré tout une plaque à sa mémoire en guise d’accueil, ou plutôt, reporte sur l’un de ces panneaux dédiés à l’histoire de Paris, une anecdote assez savoureuse; il clame la mort de cet homme en fanfaron :
« Officiellement ouvert le 1er janvier 1825, le Cimetière du Nord est désormais protégé contre les pilleurs de sépultures : il perd ainsi en 1856, l’un de ses conservateurs, M. de Vaulabelle, inventeur d’un système de pièges avec mise à feu, victime de son devoir pour s’être envoyé une décharge mortelle en pleine poitrine ! »
La lecture de cette plaque ne m’a pas satisfaite, je l’admets. Je suis donc allée lire tous les articles qui me décriraient l’événement plus précisément. J’espérais follement un exposé précis de ce « système de pièges avec mise à feu », et rêvais secrètement d’un nouvel homme tué par sa propre invention, un Franz Reichelt oublié de l’Histoire, un rival de l’homme en costume-parachute qui saute de la tour Eiffel. Ma conclusion fut bien autre, et en passant la déception qu’elle m'apporta, elle m’ouvrit tout un pan de l’Histoire.
Qui décida de faire monter les murs du cimetière à deux mètres ? Je n’en sais rien, mais le 20 et 21 juin 1856, lors du procès à la chambre correctionnelle de la Cour Impériale de Paris, dirigé par M. Zangiocomi, un seul mot était sur toutes les lèvres : « la brèche ». Des intrus avaient réussi à faire une trouée dans ce lieu qui n’accueille que de jour : à l’angle du mur qui sépare le cimetière de la rue des Carrières.
Sont véritablement en cause : trente centimètres de mur, trente centimètres manquants sur le pan de mur entre la 8e et 10e division. Qui donc appeler à la barre ? Il m’a semblé très vite que la culpabilité et le meurtre de cet homme se logeaient dans ce vide là, ce vide laissé par le temps, et la peur qu’il provoque chez les hommes. Ces trente centimètres sont tout juste ce qu’il faut pour former l’idée d’escalader le mur qui sépare la ville ouverte et l’espace clos du cimetière. Interrompre le grand silence de mort qui les sépare des vivants. Ce désir de grimper sur le mur, faire glisser son regard et son corps au-dedans, près des morts… qui ne l’a jamais éprouvé ? Déjà, au Moyen-Âge, le cimetière échappe à la loi : protégé par les églises, il est formellement interdit de capturer un fugitif qui se réfugie dans son enceinte. C’est cette fracture, nichée dans la dénomination du cimetière, qui m’a d’abord intéressée : on l’appelle « le cimetière de la Barrière Blanche » ; tout comme au cirque, on nomme « barrière », la petite palissade qui sépare les spectateurs de la piste.
La Barrière Blanche désignait en fait les carrières de gypse sur lesquelles était situé le cimetière, exploitées depuis l’époque gallo-romaine pour le « blanc de Paris ». Le dicton dit qu’il y a plus de Montmartre dans Paris, que de Paris dans Montmartre. Ce blanc provient du gypse, une espèce minérale qui se transforme en plâtre à 120°C et c’est en lui qu’on a coulé Paris. Au Moyen-Âge, l’espèce était tout à la fois adulée et honnie, admirée pour sa couleur où l’on croyait voir se moirer la lune, détestée pour la rouille qu’elle provoque dans les bassins selon les dires des lavandières. Cette barrière est aussi le lieu des exécutions et des fosses communes lors de la Révolution, celui d’effondrements successifs, effondrements qui parlent de frontières, de barrières naturelles ou reconstruites pas les hommes. L’histoire de ce cimetière s’est façonnée des séparations entre deux espaces qu’on a voulu définis, mais qui n’ont cessé de se frotter l’un contre l’autre: la ville et les carrières d’en-dessous, le cimetière et les rues d’à côté…
Le cimetière du Nord est inauguré en 1825. À cette époque, les pillages sont fréquents dans le cimetière, et une défaillance dans le mur d’environ trente centimètres est alors inculpée. Cette faille creuse de jours en jours une peur chez les gardiens du cimetière à qui on assène ne pas en détacher le regard. M. de Vaulabelle, le conservateur du cimetière, leur confère une charge : celle de garder de nuit cette brèche et d’empêcher tout intrus cherchant à entrer au-dedans. Très vite, ils croient apercevoir des formes étranges, bizarres se mouvoir de ce côté-là, et s’imaginent brandir leurs armes, héroïques, sauvant les possessions des disparus, défenseurs élus de la mort et de ses biens. L’interdiction de franchir les portes du cimetière de nuit est enfreinte à plusieurs reprises et durant plusieurs années.
Peu après la révolution de février, en novembre 1848, les ouvriers catalysent tous les comportements inadéquats, transgressifs et dangereux pour le gouvernement. La Revue des deux Mondes fait paraître un discours de Jean-Jacques Baude, ancien préfet sous la monarchie de Juillet, dans lequel il désigne ouvertement les ouvriers de « bandes de bêtes féroces, professant comme une religion le pillage, le viol et l’incendie » ou encore les comparant aux « hordes d’Attila ». L’association des pillages aux ouvriers est d’autant plus rapide que Maxime du Camp publie un article dans La Revue des deux Mondes où il signale, non sans mépris, la présence d’ouvriers à l’orée du cimetière: « Jadis, au temps où bruissaient les Porcherons, il y avait là une sorte de ferme doublée d'un cabaret; les ouvriers venaient s'y amuser le dimanche. [...] Le prix des concessions [...] est assez élevé pour que l'entrée d'un de nos grands cimetières [...] ne ressemble pas à un cabaret de joueurs de quilles. »

Les formes inconnues sont ainsi troquées par ces joueurs de quilles qui sautent par-dessus le mur, à l’endroit exact de la défaillance, pour y voler toutes sortes d'objets sur les sépultures. D’ailleurs, cette image est véhiculée très largement dans toute la sphère sociale. Le théâtre bourgeois s’en saisit immédiatement, et se représentent à Paris des vaudevilles où l’admirable tenue des patrons s’oppose à l’instinct grégaire des ouvriers. C’est ainsi que le frère de M. de Vaulabelle, Léonore, écrit quelques années plus tôt: La propriété c’est le vol, vaudeville satirique sous-titré « folie-socialiste en trois actes et sept tableaux » qui parodie la formule de Pierre-Joseph Proudhon. La déshumanisation des ouvriers s’accompagne d’autres figures et bientôt, des cornes leur poussent. Dans l’esprit des gardiens, la première réponse à la peur fut la nécessité d’identifier un visage, de déceler une identité et la seconde celle de l’éloigner à nouveau de soi, de faire de cette identité un spectre diabolique et par là même inhumain. Il me semble qu’il y a là bien plus qu’un bouc-émissaire. De l’ouvrier on fait un diable, du diable on fait l’ouvrier. Ils ont en commun d’être des écorcheurs. Le désir des couronnes d’épines en bronze et des vierges d’ivoire se mêle à celui du marbre des horloges et des presse-papier bourgeois chinés sur les marchés. Les objets volés sont tout à la fois objets de mémoire et marchandises. Mais quelle place occupe réellement en eux la cupidité ou le désir de propriété ? Dérober aux morts pour réconcilier les espaces : peut-être est-ce le seul trait d’identité qui nous reste de ces voleurs ?
En 1825 et les années qui suivirent, épier cet espace était devenu un enjeu de taille pour les gardiens. Quelques années plus tard, le cimetière est bien gardé. Le conservateur, M. de Vaulabelle, a posté des gardiens qui exécutent une ronde solitaire de nuit. D’abord, ils n’ont qu’un couteau et attendent à vingt-sept ou vingt-huit mètres de la brèche. Ils rôdent autour d’elle, et ne doivent pas en détacher le regard. Ce qui m’a surprise est la précision des distances et des mesures évoquées dans les journaux et en particulier dans la gazette des tribunaux qui retrace le procès. Deux mètres, un mètre soixante-dix; vingt-sept ou vingt-huit mètres. L’exactitude y est pour beaucoup je crois dans l’angoisse frémissante et partagée des pilleurs et des gardiens, obsédés par cette percée qu’ils brûlent de défendre en tremblant. M. de Vaulabelle décide alors d’armer ses gardiens, de les équiper d’armes à feu pour veiller sur ce coin de cimetière. Ce coin présente des traces de passage qui pointent ce pan de mur comme la voie de prédilection des voleurs. Les gardiens du cimetière de Montmartre sont donc postés là, chargés d’un devoir terrible : celui de surprendre les voleurs et de les exécuter. La seule prévenance donnée par M. de Vaulabelle est celle de prononcer le « Qui vive ? » avant de tirer, adresser une dernière interrogation à une ombre méconnaissable et sans lumière. Selon les versions, la consigne donnée est qu’il faut l’adresser trois fois au nouveau venu et attendre une réponse avant de tirer ou, il n’est question que d’une seule occurrence, d’une unique question. Décliner une identité nominale, sinon la mort.
En 1856, aux environs de cinq heures, le 12 janvier, M. de Vaulabelle est tué par un de ses gardiens à la brèche. Tir de carabine. Au « Qui vive ? » de l’homme jaune et sec, gardien ce soir-là, le conservateur du cimetière du Nord s’est tu. Aucune réponse n’a été entendue du dehors, comme de l’intérieur du cimetière. Comme si, l’homme et sa loi, celui qui professait le « Qui vive ? » à son armée, s’était entièrement remis à l’impossibilité de faire corps avec un nom, comme le cimetière lui-même qui a troqué le sien au fil des ans. Cet épisode est raconté avec un certain amusement dans le tome quatre du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle : « Ce fut en faisant lui-même, au milieu de la nuit, une ronde de surveillance, que le conservateur du cimetière de Montmartre, M. de Vaulabelle, frère de l’historien, fut tué, il y a quelques années, par suite de l’observation trop rigoureuse d’une consigne qu’il avait donnée, et dont il ne se rappelait plus les termes. » L’avocat général Barbier a dit lors du procès qu’il fumait sa pipe et marchait d’un pas lent et mesuré: sa ronde n’était qu’une balade auprès des morts. Et pour preuve : il en perd sa main ! Que doit-on entendre dans ce silence ? Une simple désinvolture, un homme évaltonné, mesurant son existence dans l’écart entre ses bouffées de fumée et ses pas ? J’entends dans ce silence un doute, une hésitation à se tenir debout dans un cimetière. J’entends un homme qui ne connaît plus son identité face à toutes ces pierres tombales où les noms sont gravés.
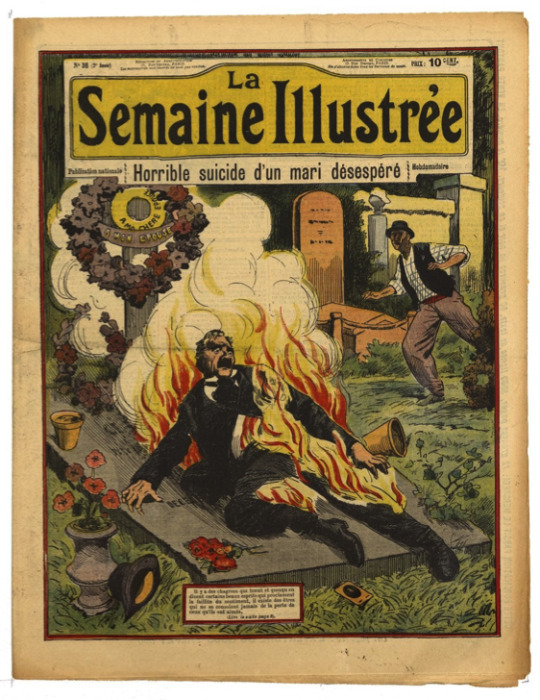
M. Lachaud, défenseur de Mabille lors du procès, affirma que cet événement déclencha la folie de sa femme, une folie hors du cimetière. Bien plus tard, en 1912, dans un autre cimetière parisien, un homme décède dans le secret. Le feu n’est pas vu, contrairement à ce qui est montré sur la Semaine illustrée, il n’y a aucun spectateur à cette scène spectaculaire. L’homme a franchi la barrière blanche, les murs des cimetières et leurs trente centimètres, et s’est immolé sur la pierre tombale de sa femme, encore une pierre qui le séparait du corps de la morte. Les portraits et les statuettes de plâtre ont fondu ce jour-là, ou sont-elles tombées ? Brisées ? On a donné un nom à cet homme : le mari; comme on a donné des noms aux acteurs du fait divers précédent: le conservateur et le vieillard, jaune et sec.
C’est un autre mariage qu’il a exécuté seul, sans témoins, un mariage avec la pierre, avec le gypse qui contient l’os et la peau. On nomme aussi les cimetières « champs au repos ». Le premier homme est mort de la main d’un gardien entre les tombes, « au clair de lune » dira Mabille, et le second de sa propre main sur la tombe de sa femme. Vous me direz que le lieu et le temps ne lient pas deux affaires, d’autant qu’il ne s’agit pas du même cimetière. Mais la cause du décès du premier reste inconnue, mystérieuse, la seconde a une fin. Pourquoi le vieillard jaune et sec a-t-il tiré sur le conservateur du cimetière ? Par peur, oui, par peur. Et pourtant, je veux lui donner une autre fin. Ce qui me questionne n’est pas tant la cause de l’homicide, mais l’absence de réponse du conservateur, qui connaissait la procédure qu’il avait lui-même élaborée. Son silence m’interroge et j’aimerais croire qu’il a embrassé l’identité des voleurs, sûrement sans le vouloir, qu’il s’est épris lui-même de la figure de l’ombre que lui et une grande partie de la société associait sans vergogne au premier opposant au régime impérial. Ce soir-là, M. de Vaulabelle a troqué son nom et sa particule pour redevenir un homme et son ombre.
────────────
[1] Les cimetières étaient consacrés et réservés aux catholiques ayant reçu le dernier sacrement (l’extrême-onction). De nombreux enterrements se déroulaient alors de nuit et en cachette.
0 notes
Text
THOMAS PERINO À BRUXELLES !
Le graveur et maître cartier Thomas Perino, à qui l'on doit Le Tarot Perino, publié par Le Feu Sacré, participe à la quatrième Limited Edition Art Fair à la Villa Empain / Fondation Boghossian du 15 au 17 mars 2024 à Bruxelles. Ceux, familiers des cartes, et de son jeu, reconnaîtront aisément le 10 de deniers du Tarot Perino sur l'affiche de l'événement. Pour l'occasion, Le Feu Sacré a décidé de remettre temporairement en ligne le documentaire qu'avait consacré Warren Lambert à la genèse et l'impression de ce Tarot unique au monde. Le Tarot Perino et le DVD du film sont toujours en vente ici sur notre site.

0 notes
Text
LE RITUEL "VERTIGO", par Pierre Pigot
Continuons sporadiquement sur ce blog à réexplorer la filmographie d'Alfred Hitchcock. Après Rear Window en février : "Vertigo", chef-d’œuvre inépuisable d'exégèses et de remakes cachés ou avoués (mais, au fond, peut-être est-ce la même chose ?). Il est le film des obsessionnel.le.s, de celles et ceux qui pensent que la vie offre des secondes fois. On y revient sans cesse, parce qu'il nous fait croire que revivre est possible. Pierre Pigot nous raconte cette énigme et son rituel.

"Je suis née quelque part par là..." dit Madeleine à Scottie en pointant une des lignes concentriques d'une coupe de sequoia.
I.
Bientôt sur l’écran la spirale de Vertigo va déployer ses crêtes et ses vagues, ses danses et ses abîmes – pour beaucoup une nouvelle fois, pour certains de manière inaugurale. Les brefs blasons anatomiques que déploiera le générique ne s’adresseront pas qu’à ces néophytes : pour les chevronnés du labyrinthe, dès l’instant où le film recommencera à les envelopper de son atmosphère fascinante, la bouche féminine qui reste muette, et les yeux qui guettent anxieusement leurs angles morts, intimeront aussi, respectivement, de retenir tout langage intempestif, et de laisser les images nous guider le long de leurs sentiers anxieux. Alors, tandis que la musique de Bernard Herrmann laissera suspendues ses rosalies hypnotiques, et que les spirales de Saul Bass, coupant l’espace comme des couteaux sacrificiels, surgiront de leur sombre abysse, nous n’aurons plus qu’à pénétrer dans cette forêt d’images, où un rideau de séquoias californiens millénaires semblera un simple écho primordial, et à la laisser nous engloutir. Que la première spirale surgisse de l’œil isolé, et soit littéralement l’expression héraldique de cet œil védique que Hitchcock laissa planer sur l’Occident et ses rites souterrains, ne sera pas même le prélude à une rumination des idées : celle-ci sera obligatoirement repoussée à la fin, telle une précaire illumination qui ne peut nous posséder que lorsque toutes les cartes du jeu semblent avoir été posées sur la table de montage mentale.
II.
Vertigo est un film structuré autour de trois visions, successives et entremêlées, de ce que peut être un rituel : l’enquête, le deuil, le simulacre. Mais ces deux derniers ne sauraient développer organiquement leurs sucs vénéneux et superbes, si le premier ne leur avait préparé un terrain métaphysique de premier ordre. Si l’enquête policière est l’avatar métamorphe dans lequel l’Occident a déversé la majeure partie de ses outils d’exploration du monde et de l’âme, c’est pourtant à travers une modalité précise qu’elle se dévoile comme telle – et dans les premiers temps de Vertigo, cette modalité est tout simplement la filature. James Stewart, policier reconverti en détective privé après le drame qui ouvre le film (et bien entendu les significations de son titre), est chargé, par un ancien ami de jeunesse, de suivre sa femme, qu’il soupçonne d’être hantée par une de ses ancêtres au destin fatidique. Alors, dans les rues de San Francisco, au gré de ses résidences, de ses commerces, de ses musées, de ses monuments, James Stewart suit Kim Novak – il la suit non seulement à la trace, comme un chasseur distinguant des pas de cervidé dans la neige fraîche, mais il en suit aussi les traces, les indices extérieurs dans lesquels semblent constamment se refléter les lambeaux d’une psyché que, en accord provisoire avec le mari inquiet, nous supposons mise en danger par des souvenirs ataviques. C’est dans cette optique que James Stewart (et nous avec lui) ausculte la silhouette d’un tailleur gris, la tache colorée d’un bouquet de fleurs, la spirale d’un chignon blond qui se dédouble sur un portrait peint. Et de manière insensible, tout comme Stewart, nous basculons d’un univers dans l’autre : le San Francisco industrieux et moderne des années 1950, dont le relief escarpé semble lui-même une spirale urbaine, laisse entrevoir des carcasses rescapées de son passé colonial, des ruelles sordides où l’inquiétude se redouble, des lieux déserts où la mort rôde. Dans ce labyrinthe soigneusement orchestré, Hitchcock nous a alors guidé depuis l’épitomé de la modernité (le magasin de fleurs, et son mur-miroir où le simulacre féminin, approché pour la première fois au plus près, ne peut d’abord être distingué que par son reflet, comme la Gorgone sur le bouclier de Persée) jusqu’au lieu où l’âme se retrouve isolée, prête à se dépouiller avant son auto-sacrifice : les eaux primordiales, grises et vertes, qui stagnent à l’ombre du Golden Gate Bridge, ces eaux où le héros, croyant sauver, enclenchera en réalité une double destruction.

L'oeil-spirale du générique imaginé par Saul Bass.
III.
Parce qu’une icône appelle toujours un geste sacrilège, la critique comme les spectateurs n’ont jamais hésité à prendre Vertigo comme objet de leur vindicte revancharde. Aujourd’hui encore, certains trouvent James Stewart trop âgé pour son rôle, et Kim Novak, décidément trop vulgaire pour un personnage qui, sur le papier, appelait un nuancier de subtilités psychologiques. On sait que, pour cette figure féminine autour de laquelle allaient se cristalliser des décennies de recherches inconscientes, Hitchcock souhaitait Vera Miles. Tout avait été préparé pour elle, y compris les costumes (si importants dans le film). Mais il suffit d’observer Vera Miles dans un autre Hitchcock (Psycho, où elle interprète la sœur de la pauvre Janet Leigh) pour comprendre que Vertigo, s’il souhaitait être ce labyrinthe émotif et morbide planté au milieu des collines technicolor d’Hollywood, était destiné à être subverti par le visage animal, hautain, malléable, de Kim Novak. C’est elle qui transforme un James Stewart vieillissant en un nouveau Charles Swann de San Francisco, s’éprenant malgré lui d’une femme « qui n’était pas son genre ». Au filtre d’amour symboliste de Botticelli dont usait Proust, Vertigo substitue la découverte d’un tableau aussi médiocre que fascinant sur les murs d’un musée. Mais c’est dès sa première apparition que Kim Novak contresigne la conjonction stellaire qu’il lui était assigné de devenir : lorsque, dans ce restaurant où James Stewart la découvre à la dérobée, elle se lève, moulée dans son imposante robe de soirée vert émeraude, et qu’elle s’arrête devant la caméra, de profil, sur un fond de tapisserie rouge. Soudain, l’espace d’une ou deux secondes, ce fond rouge devient une aura écarlate, qui semble s���enflammer autour de ce profil de camée antique, rehaussé de cette touche de vulgarité qui lui donne la vie pure. Et ce fond purpurin aussitôt reflue et disparaît, comme le regard espion de James Stewart se retire, avec un dernier plan sur un pan de robe verte qui s’enfuit dans le reflet d’un miroir. A cet instant, nous assisterons, chaque fois que nous le reverrons, à une allégorie dressée par Hitchcock à l’adresse de sa propre obsession, allégorie incarnée par la moins docile, la plus récalcitrante de ses fameuses « blondes hitchcockiennes ». Cette aura qui apparaît et disparaît, c’est celle d’un mythe cinéphilique, qui dissimule un autre mythe, plus ancien, plus profond, celui du simulacre, cette blonde Hélène de Troie fictive pour laquelle, selon Euripide, les héros moururent en vain. La blondeur auréolée de Kim Novak est le lieu où toutes les blondes, passées et à venir, de la filmographie hitchcockienne, convergent dans une même danse érotique : le chignon sadisé de Tippi Heddren, l’iceberg trompeur d’Eva Marie-Saint, le marbre frémissant de Grace Kelly. Et à la suite de cette brévissime allégorie, Vertigo se fera le récit de sa propre destruction et reconstruction, sous les yeux toujours hagards et fascinés de ses spectateurs, qui n’en reviendront jamais qu’on ait pénétré aussi profond et aussi crûment dans un tel repli psychique. C’est au-dessus de cet abîme que cette aura initiale persiste à voler, telle une phalène guettant une lumière enfuie. Comme l’écrivit un jour Goethe dans l’un de ses romans : « Tout commencement est aimable, le seuil est le lieu de l’attente ». Le profil de Kim Novak demeurera cette médaille royale posée au seuil de Vertigo : pure illusion surgie d’une trame fictionnelle en abyme, et sur laquelle nous ne cesserons de nous pencher.
IV.
Aux yeux de celui qui le découvre, Vertigo ne semble être qu’un mystère policier. Pour tous ceux qui y reviennent, encore et encore, c’est une tragédie grecque, dont les rebondissements et la fin sont depuis longtemps connus, mais dont il est toujours difficile d’appréhender avec précision le fond primitif. En partie parce que les catégories cinéphiles ont enroulé autour de ce film une épaisse pelote d’analyses, souvent animées par une souveraine terreur de se retrouver en terrain inconnu ; mais surtout parce que, face à un film de deux heures aussi structuré, aussi incisif jusque dans ses lenteurs calculées, aussi virtuose dans le balisage de ses sentiers qui bifurquent, il subsiste une crainte de percer le mur de la fascination : cet instant où la poésie absolue de l’image se briserait sous la pointe cruelle de l’analyse. Peut-être les grands chefs-d’œuvre du cinéma sont-ils cousins de la grenouille humoristique de Mark Twain : au-delà d’un certain pas, ils ne supportent plus la dissection. Ou alors, ils conservent malgré cela assez de puissance en eux pour que cet outrage semble toujours glorieusement inefficace, que la somme des mots reste toujours inférieure à la totalité des images. Dans Vertigo, les rites que James Stewart va élaborer dans son délire tourneront tous au désastre, nous abandonnant un indéfectible goût de cendre. Mais ces rites ne cessent de se répéter, à chaque projection, que parce qu’il existe un autre rite qui les encadre, nouvelle mise en abyme : celui des spectateurs qui, presque soixante ans plus tard, persistent à se déplacer dans une salle de cinéma pour le voir, parce qu’ils pressentent intimement que c’est la seule manière de rendre justice à l’énigme que nul ne se lasserait de creuser jusqu’à la pellicule. En cette époque sociétale où les rites resurgissent d’autant plus maladroitement qu’on ne cesse de vouloir les assécher, Vertigo apparaît donc comme un rituel dédoublé, une série de rites encadrée par le rite supérieur qui le fait survivre, répété encore et encore, sans que jamais l’œil ne s’épuise. Et c’est grâce à cet œil insatiable qu’une fois encore, ce rituel va recommencer – maintenant.
Ce texte a été rédigé à l’occasion de la projection du film le 25 août 2016, au cinéma Le Petit Casino de Saint-Aignan-sur-Cher dans le cadre des séances "Les Voyeurs".
1 note
·
View note
Text
ELLIOT RODGER, ICARRIE, par Ulrich Conrad
"La Bête", le nouveau film de Bertrand Bonello sorti en salles le 07 février, fait remonter à la surface, dans l'une des époques que traverse son récit, un spectre vieux de dix ans : celui d'Elliot Rodger, l'adolescent responsable de la tuerie d'Isla Vista en mai 2014. L'occasion pour le Feu Sacré de revenir sur la dernière vidéo postée par le tueur juste avant sa virée sanglante. Portrait et analyse de ce Carrie au masculin.

Assis confortablement au volant de son coupé BMW 328i noire, funeste studio motorisé de ses vlogs en série, Black Maria de 193 chevaux au point mort, garée en ce 22 mai 2014 face à la plage de Santa Barbara, Californie, où il attend que le soleil finisse de s’évanouir derrière l’horizon, Elliot Rodger enclenche la prise de vue sur l’écran tactile de son iPhone dernier cri qu’il vient de poser sur le tableau de bord. Venait-il de répéter dans les grandes lignes les principaux points de son oraison filmique avant de lancer l’enregistrement ? Ou bien avait-il si religieusement potassé son script, My Twisted World, ce « manifesto » mis en ligne dix minutes avant son carnage (141 pages de démence misogyne), qu’il avait toute confiance en le flonflon de son flow erratique d’improvisateur guindé et maladroit ?
Pour son dernier prêche, l’image full HD restera légèrement floue : décidément sa patte visuelle – son volant en amorce ayant toujours déréglé la mise au point automatique de l’appareil. Son ultime trouvaille de mise en scène, logique pour ce spectateur privilégié et complaisant de son propre malheur de gosse de riche : un crépuscule dorée digne d’un spotlight géant d’Hollywood – où son père travaille, du reste – qui, à travers le pare-brise, surcadre et irradie le visage de l’adolescent, qui a dû penser, cette veille de son passage à l’acte, que le soleil complice et révérencieux s’éclipsait juste avant lui.
Les ombres des voitures et des passants au loin qui se projettent sur sa bouille de mauvais acteur arrogant forment un obturateur urbain intermittent du plus somptueux effet, épousant son tempo particulier : lent, serein, souverain. Le dispositif de sa vidéo (lui en pleine lumière, les autres réduits à des silhouettes noires) ne laisse plus aucun doute : jusque dans sa résolution meurtrière, Rodger aura infléchi le paysage à ses soliloques de grand prince charmant psychotique. Il aura été au bout de cette victimisation de l’homme bon, doux, raffiné, aimant et oublié qu’il s’ingéniait à modeler ; au bout du revers brutal de son romantisme pleurnichard et châtié qui, arrivé à bout de patience, sera celui du châtiment sans pitié : Elliot Rodger’s Retribution, intitulera-t-il son pamphlet. Sept minutes de monologue sur fond orangé, réitérant l’incompréhension dont il dit avoir été l’objet depuis de trop nombreuses années, et qui devaient l’amener à la nuit rouge et sanglante d’Isla Vista où il fera parler la poudre. Roger, Elliot Rodger !
Ce retournement, seul un homme pathologiquement esseulé en était capable, pour qui son monde, LE monde, pour lui permettre un temps d’y subsister, et au final de lui donner la force de faire périr ses semblables, devait lui donner l’impression qu’il ne tournait que pour lui. S’il s’était détesté avec une répugnance aussi farouche que celle qu’il vouait à la terre entière, il n’aurait jamais commis ses crimes. Contrairement à ce qu’il n’a eu de cesse d’haranguer, ce n’est pas sa haine incommensurable des autres qui lui a fait prendre les armes, mais bien son amour immodéré de lui-même. En marge des coups de feu tirés au hasard au volant de son corbillard bling-bling, de sa mission punitive à la sorority house de l’Université, sa Christine entre les mains, il percutera une dizaines de piétons, de cyclistes, de skateboarders, avec la même inconséquence aveuglée d’ego divin qu’un joueur de GTA. « Well, now I will be a god compared to you, you will all be animals », disait-il d’ailleurs au climax de son selfie d’adieu.
Comme toutes les vidéos qu’il avait publiées jusqu’ici sur sa chaîne YouTube, il avait commencé son laïus plaintif par un sempiternel : « Hi, Elliot Rodger here ! » – sorte de « This is the Zodiac speaking » du tueur anonyme le plus célèbre du nord de la Californie – puis, comme souvent là aussi, ce fut la beauté toxique du monde environnant qui l’avait incité d’abord hypocritement à ouvrir la bouche. Un panorama luxuriant, au choix, d’un parking VIP, d’une vallée, de son quartier, d’un cour de golf, d’un parc ou d’un coucher de soleil – parfois un délicieux vanilla latte de Starbucks en main, et une paire de lunettes Giorgio Armani, elle, invariablement accrochée au col de sa chemise. En une dizaine de complaintes filmées, Rodger a circonscrit la topographie paradisiaque de son grand alibi.
Car son excuse, bien qu’il n’en fit mention nulle part, c’était donc justement son train de vie d’enfant de star pourri gâté qu’il étalait à tout bout de champ. Il faut avoir vu le contenu de son compte Facebook (depuis clôturé) : un autel mégalo et clinquant asphyxiant ; une pornographie narcissique et huppée débridée. Dans son esprit, ce devait être parce qu’il ne lui manquait strictement rien qu’il pouvait alors légitimement s’ériger avec intransigeance et sévérité en chantre du manque, faire de l’amour son caprice suprême ; et parce que sa vie de rêve n’intéressait personne voudra-t-il transformer celle des autres en un cauchemar macabre. Que les autres puissent s’accommoder de vivre sans lui, voilà sans doute ce qu’il leur enviait tant, ce qui lui était invivable – ce qu’il appelait à tour de spleens vidéographiés « a better life ». « Indeed, a too much wonderful life ! » Un scénario digne de Capra filtré par le prisme du ressentiment, ce film préféré des fêtes de Noël aux États-Unis dans lequel un homme sur le point d’en finir (interprété par James Stewart) se voit offrir l’opportunité d’assister à la vie de ses amis s’il n’était pas né. La chance du premier devint l’injustice du second ; le miracle de l’individu, un individualisme destructeur. Au renoncement à la suppression du personnage de Stewart se substitua l’imposition violente de Rodger. L’hiver new-yorkais fit place aux vents chauds de la côte ouest. A l’ombre des palmiers s’écrivait un nouveau chapitre du mariage du Ciel et de l’Enfer…
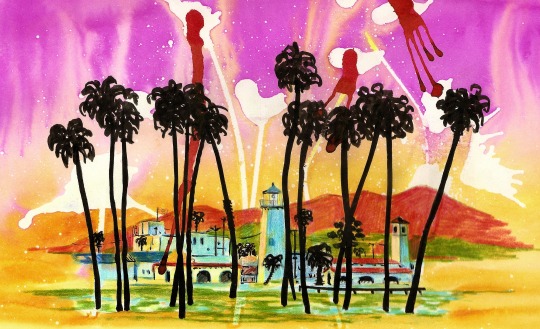
Son drôle de biopic est dorénavant un spectre qui hante depuis maintenant dix ans les tréfonds de la grande Toile – son compte YouTube ayant été conservé, amputé seulement de son apothéose ; un film éculé, rébarbatif, segmenté en séquences brouillonnes et pseudo-méditatives, encadré par deux ponants, laissant à loisir de se replonger en boucle dans cette tournée d’adieu d’éphèbe gâteux, de son improvisation sans pudeur à l’improviste de son geste criminel. Un mélo soigné qui doit son carton post-mortem à son dénouement bâclé, amateur et suicidaire.
La seule compagnie que l’on a pu croiser dans l’une des vignettes de son ego-trip, c’était celle de son demi-frère : Jazz. iPhone à la main, il le suivit occupé à dessiner au sol avec un bout de roche calcaire du haut d’une colline surplombant leur quartier, l’Overlook (sic !), puis, sur son consentement, à jeter l’ustensile rudimentaire en direction des habitations. On entend qu’il lui parle, sans que l’on puisse toutefois distinguer ses mots, le vent qui soufflait en rafale ce jour-là faisant crépiter la membrane du micro intégré de son portable, tel un bruitage naturel et modulable de mitraillette semi-automatique sur cette toile d’ennui pavillonnaire, rendant quasi-inaudible ce moment intime d’une exception, du coup, presque douteuse. Jazz s’éloignait et Elliot le laissait partir dans le fond du plan, panoramiquant plein cadre vers le soleil au zénith au-dessus d’eux pendant une poignée de secondes avant, ébloui et les pixels grillés, d’interrompre la prise. Un malaise sourd, depuis, en revoyant les images… Peut-être ses allers-retours rapides de caméra subjective sur le paysage… Réflexe de tueur inquiet d’être épié… Un côté Hitchcock à la petite semelle : la scène dans Soupçons où Cary Grant veut faire admirer le récif vertigineux (où, endetté, il planifie en réalité de s'y jeter en voiture) à une Joan Fontaine déjà bien suspicieuse… Et ce Icare, n’aimant pas les happy-ends, de confirmer plus tard sur son laptop, dans son mémoire, qu’il prévoyait effectivement après la tuerie de supprimer ce concurrent qui, un jour ou l’autre, lui aurait fait de l’ombre.
S’il prétendait diriger sa vindicte sur tout ce qui l’entourait, le cercle gynophobe étroit de Rodger avait bien un centre, un foyer où bouillait en silence sa rage revancharde, une fillette de dix ans à l’époque qui, à ses yeux, se sera rendue bien plus coupable qu’il ne se le rendra lui-même : il s’agit d’une certaine Monette Moio, mannequin dont le père, comme le sien, officie également à Hollywood. Son père, Peter Rodger, réalisateur de seconde équipe sur le premier volet de la série Hunger Games, en a filmé des ados et leur compétition féroce déguisée en fable bien proprette, leur âme de matamore prête à tout édulcorer en jeu de cirque insurrectionnel. L’élève a dépassé le maître. Le fils a dépassé le père. Et les monstres égotistes, s’ils font une priorité absolue (et impossible à assouvir) qu’on les aime plus qu’ils ne s’aiment déjà eux-mêmes, ne sont en revanche jamais avares d’imputer la faute de leur monstruosité à ceux qu’ils désignent comme plus monstrueux qu’eux. Le véritable monstre est d'abord un incurable irresponsable. C’est pourquoi tout ce qui est innocent lui retourne les tripes. L’innocence est une humiliation qu’il reçoit comme une moquerie indélébile, une provocation permanente. La rivalité entre Rodger et les femmes découle de ce schéma-là. Avec sa peau lisse, l’orbe poupin de son faciès, ses lèvres charnues, à la croisée des genres et des sexes, imberbe comme une fille, combien il devait lui être extatiquement insupportable de contempler son visage dans la glace ! Que cherchait-il en le scrutant et le photographiant sous tous les angles pour ensuite l’archiver minutieusement ? L’horreur de l’hormone… Ce miroir qui devait lui renvoyer une image en creux de l’ennemi et qu’il portait sur sa figure comme une filiation irréversible. La Mort qui prend la relève de la puberté pour lui façonner son masque orgueilleux et psychopathe de minet efféminé. Cette Mort qui travaillait à le faire ressembler à ce qu’il détestait. Si « awesome », « magnificent », « sophisticated », « superior » ! Ce sera son verdict… Le brun corbeau comme couleur de l’eugénisme chic ! Toutes ces blondes crâneuses, pulpeuses, superficielles et grotesques de Californie… Lui aussi, l’« alpha male », revendiquait au fond le droit à être une pétasse comme les autres ! « Quick, un Glock 34, un SIG Sauer P226 pour me refaire une beauté ! » COUIC ! Plus fleur bleu que ces fleurs du Mal dont le soleil semble être passé dans les cheveux, qui lui faisaient dresser la tige ; la reine de bal a toujours une cartouche supplémentaire à jouer, il faut le savoir désormais, dans la chambre de son flingue 9 mm… « Elle m’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout… PAN ! »
Pour la postérité, ce bully badigeonna de jaune son dernier autoportrait, à mi-chemin entre un fond de teint à la carotène de soleil trop mûr et un Bonnard effrayant. Il avait dû préparer toute la journée, encore et encore, son petit rire démoniaque, sa marque de fabrique surjouée qu’il se plaisait à glisser en conclusion de ses punchlines les plus aguerries. Assurément, son rictus stylé devait toujours se lire sur son visage quand on retrouva sa gueule de puceau angélique étalé sur le revêtement pur cuir de son auto cabossée. Le sang avait remplacé la feuille d’or. Les cavalières ne dansaient plus mais gisaient sur le sol. La palabre s’était finalement interrompue. Ce soir-là, la drague avait été mortelle.
Elliot Rodger, ça aura été Carrie au pays du Spring Break.

Illustrations : Guillemette Monchy.
1 note
·
View note
Text
L'HISTOIRE DU RÊVE, par Leos Carax

Holy Motors, 2012.
« Ça se passe dans une riche famille arabe, au temps des Mille et une nuits. Un matin, un petit garçon se réveille et dit à son père : « Papa, j'ai fait un rêve fantastique. » Le père lui dit : « Eh bien mon fils, raconte-moi. » L'enfant lui répond ; « Ah non ! Je ne peux pas te le raconter, mais c'est fantastique. » Le père insiste, l'enfant refuse, le père se fâche : « Si tu ne me racontes pas ton rêve tout de suite, je te déshérite et je te mets sur le marché aux esclaves. » L'enfant s'obstine et il se retrouve vendu à un maître. Son maître en fait un paysan et il travaille d'arrache-pied, si bien qu'au fil des années, il arrive à obtenir la confiance de son maître. Un jour, celui-ci lui offre une propriété et le fait lui-même patron d'autres esclaves. Et le maître lui dit : « Bon tu as réussi, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Tu es un garçon éduqué, intelligent, beau. Comment se fait-il que tu te sois retrouvé sur le marché aux esclaves ? » Le garçon, qui a maintenant une vingtaine d'années, lui répond : « Un jour j'ai fait un rêve fantastique. » Le maître lui demande : « Ce rêve, c'était quoi ? » L'enfant : « Ça, je ne peux pas vous le dire. » Evidemment, le maître se fâche : « Si tu ne racontes pas, je te retire la propriété et tous tes droits et je te refile à l'armée. » Le garçon se retrouve donc à l'armée. Il est amené à faire la guerre, en première ligne. Il gagne des galons, devient général de l'armée du pays et chasse les envahisseurs. Le roi le convoque er lui dit : « Formidable, tu es un héros national. En cadeau, je t'offre mes deux filles. » Le garçon a maintenant 30 ans, rencontre les deux filles du roi, qui sont absolument superbes, et il passe sa première nuit d'amour avec elles et c'est merveilleux. Le matin au réveil, les deux filles lui demandent : « Mais d'où viens-tu, raconte-nous ton histoire. » Le garçon raconte : « Un jour, quand j'étais petit, j'ai fait un rêve et mon père, etc. » Alors les deux filles lui demandent quel était le rêve. Et le garçon leur répond : « J'avais rêvé que je couchais avec deux filles à la fois… »
Cette histoire a été racontée par le cinéaste dans le n°32 de l'hebdomadaire Les Inrockuptibles du 15 novembre 1995.
4 notes
·
View notes
Text
"REAR WINDOW", LE COMPLOT DU STYLITE, par Warren Lambert
Avec sa réputation devenue vite ronflante de film méta sur le cinéma, on en serait presque à oublier que "Rear Window"/"Fenêtre sur Cour" est un grand film d'amour sérieux, un de ceux de la filmographie d'Hitchcock, avec plus tard "Vertigo"/"Sueurs Froides", au sous-texte le plus audacieux, tordu et un tantinet tragique. Avant que ce ne soit une image qu'il faille reproduire pour s'aimer (comme dans "Vertigo"), c'est une image qu'il faut halluciner ensemble pour tomber amoureux. Séance de rattrapage, donc.

Trois panoramas de la cour à trois moments de la journée, réalisés à partir de photogrammes du film.
La caméra happée par ces volets ouverts, ce mouvement circulaire étourdissant qui survole la cour jusqu’à ce front perlé en gros plan de son personnage assoupi, le thermomètre qui dépasse les 90 degrés Fahrenheit... Peut-être Rear Window est parvenu toutes ces années, malgré sa mise en scène toute en lignes claires, à dissimuler le vrai postulat de son incipit : celui d'être la transcription, à l’échelle d’une résidence, d’une poussée de fièvre. Contre la léthargie des corps va s'arbitrer la véracité des images. Les photographies de Jefferies (James Stewart) disposées sur sa table le promettent par le tour d’horizon de morbidité et d’interdit qu’elles opèrent (accident, incendie, essai nucléaire) ; collection d’événements extrêmes dont le meurtre serait la pièce manquante de cet impressionnant tableau de chasse.
Mais cette image, il ne lui suffira pas seulement de la vouloir, il faudra avant tout que les autres y croient, qu’ils croient eux aussi l’avoir vue, en croyant le seul homme dans toute cette affaire qui veuille si suspicieusement avoir raison. C’est selon cette unique modalité, celle de la persuasion, que l’action trouvera – Jefferies étant momentanément infirme – les moyens physiques d’avancer, et avec elle l'histoire d’amour entre lui et Lisa (Grace Kelly). Pour la belle jeune femme, il se jouera effectivement autre chose dans la scrutation des faits et gestes de cet énigmatique Lars Thorwald, dont le prénom épelé par elle à Jefferies au téléphone marquera le point de départ incantatoire de leur romance, cette dernière culminant lors de l'épisode où Lisa se faufilera de l’autre côté de l’écran (enjambant la fenêtre du dit-coupable) pour se passer elle-même la bague au doigt (celle de l’épouse disparue). Que Thorwald découvre cette intruse chez lui et qu'il mime alors maladroitement sur cette pauvre Lisa le meurtre auquel Jefferies aurait rêvé d’assister, voilà le prix à payer envers celui qu’elle aime. La reconstitution supplante la preuve, et l’interprétation l’image. Peu importe l'intervention de la police, pour celle qui, téméraire et obstinée, cherchera le film durant à électriser son homme, les vagissements d’impuissance de Jefferies la regardant crier et se débattre évoqueront bien à s’y méprendre les spasmes du plaisir.
La cour et ses lucarnes agissant telle une caisse de résonance des ambitions comme des craintes des deux personnages vis-à-vis du couple et du mariage, un chantage tacite s’installe peu à peu entre eux sur la base d’un échange de bon procédé : Lisa accréditant le crime spéculé par Jefferies, et Jefferies soumettant à Lisa les épreuves qui s'assureront de ses sentiments envers lui, offrant ainsi à leur idylle, grâce à ce pacte, les meilleures chances d’aboutir. Il n’existe d'ailleurs pas, dans tout l’érotisme latent contenu dans Rear Window, de moment plus jouissif transpirant sur le visage d’ordinaire patibulaire de Stewart que ce reaction shot, dans lequel il s’illumine de l’amour naissant ressenti pour Lisa, à l’écoute de l’excitation que procure chez elle l'adhésion à sa théorie meurtrière. Par son timide sourire benêt, tout s’éclaire en effet : le meurtre promet bien d’incarner la caution de cette union, son facteur déterminant autant que sa condition sine qua non. Rear Window est un drôle de sitcom au sein duquel, en dépit de son happy end, réside cette équation pétrie d’un malaise sourd : l’assassinat vu comme une heuristique sentimentale ; la nécessité du meurtre pour que puisse éclore l'amour.

L'instant où Jefferies tombe amoureux de Lisa.
Malicieusement, du reste, par touches discrètes, le film insinue que le crime pourrait aussi bien se dérouler ailleurs que chez les Thorwald, et cela parmi beaucoup d’autres recoins laissés inexplicablement vierges de toutes projections : un couple occupé la quasi-totalité du film à batifoler le store baissé (ou quelque chose de plus « sinistre », suggère même Lisa) ; une voisine étendue sur un transat, inerte, un journal ouvert recouvrant son visage. Dans ce hammam de visions potentiellement morbides, ce n'est pas un hasard que l’œil de Jefferies s'attarde sur ce couple à la femme alitée et au mari effectuant les cent pas entre le salon et la chambre à coucher. Un couple qui peine à se séparer comme Lisa et lui peinent à se mettre ensemble. Mieux qu’un écran : un miroir, et élu par son regard. Car il y a un alignement dans les destins qui lient aussi bien Lisa et Jefferies à Mr et Mme Thorwald que, par exemple, Miss Lonely Heart – la dépressive du rez-de-chaussée – à ce pianiste niché au dernier étage de l’immeuble d’en face, dont la mélodie envoûtante arrêtera miraculeusement le geste suicidaire.
La vie des autres fonctionne à la manière d’un decorum sentimental de ce que Jefferies est heureux de voir uniquement hors de chez lui, détaché de sa vie pareil à un album photo dont chaque vignette serait ce à quoi il a échappé : célibat douloureux, dénigrement artistique, sollicitude sexuelle. Il devine que la vie du couple Thorwald s'apprête à devenir son présent le plus imminent. C'est pourquoi lorsque ce mari se délectera dans son canapé d’un cigare qu’il n’a sans doute, par le passé, jamais eu la chance de savourer, cette paix retrouvée est bien ce qui alarmera le reporter. En proie aux hésitations de sa propre vie, la quiétude qu’il observe est la rupture la plus insupportable de ce jeu de reflets duquel Jeff pensait, la veille encore, se tenir du bon côté. Privé de ce rassurant et cathartique coup d’avance quant au devenir de son couple, ou pire de sa résolution lugubre, la ténacité dont il devra faire preuve aura pour but de rétablir l’ordre du cadastre amoureux dans lequel s'inscrivait son statut de célibataire endurci.
Dans l'écologie de cette alcôve new-yorkaise, toutes et tous se voient sans se regarder, jouissent sans se toucher, savent sans connaître, mettent à mort sans cadavre, et ce alors que chacun se plaît à rêver d’étreinte ou de liberté, de succès, de répit ou de tranquillité. Le chien inanimé des voisins posé au milieu de la cour figure cet élément sacrificiel, ce pavé dans la mare jeté aux visages des divers locataires, de leurs situations et de leurs aspirations muettes. Leur bref sursaut coïncide alors avec cette seule mort visible de l’intégralité du film, et acculant davantage Thorwald, non en raison de sa simple implication subodorée dans la mort de l’animal, mais parce qu’il n’aura aucunement pris la peine de feindre, avec l’ensemble de la cour, l’affectation polie qu’il était censé témoigner. De ce fait, le cri primal que pousse la propriétaire de la malheureuse bête est l’expression de cette défaillance qui règne dans ce cul-de-sac des passions ; l’indice de son moment de bascule. Il rappelle que les vocalises résonnant sur le visage endormi de Jefferies, et qui annonçaient la première apparition diaphane de Lisa dans la trame de Rear Window, en étaient la version préliminaire : un chant de sirène déjà synonyme de danger.
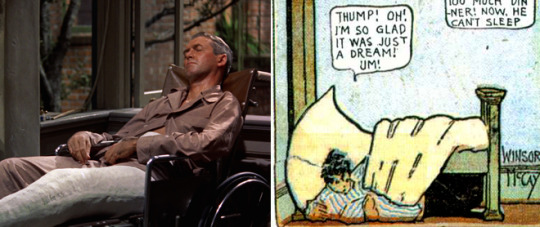
Jefferies et Little Nemo, deux rêveurs et deux éveillés.
Les nuits, pour Jefferies, sont propices aux écarts et aux divagations ; elles sont une voûte urbaine faite pour nourrir ses oracles, cherchant à travers la loupe grossissante de son téléobjectif des réponses dans ce catastérisme tantôt attendrissant, tantôt effrayant. Telle son aide-soignante, Stella (qui clame dans l’une des premières séquences avoir prédit le krach boursier de 1929 sur la base de l’auscultation d’un directeur de General Motors), Miss Torso, Miss Lonely Heart, The Songwriter, tous ces noms affublés par Jefferies lui-même aux visages anonymes peuplant sa résidence, sont le dédale de son grand dessin astral privatif à l’égard de la crise affective qu’il traverse. Il lui aura fallu inventer un monstre (Thorwald) qui incarnerait donc cette crise, qui la séculariserait par un nom civil pour lui prêter les contours de ses accusations, inculpant plus lâche et détestable que lui – gage vivant de l’échec marital qu'il cherche tout du long à démontrer. Sous les pressions répétées de Lisa à venir partager sa vie de globe-trotter, cet opportun assassinat lui permettra un temps de remettre sa décision et son jugement entre les mains d’un autre.
Le duel final avec Thorwald, Jeffries le provoquera en ébranlant d’abord l’insouciance de celui qui lui ressemble le plus ; celui qu’il choisit de réveiller en dernier recours pour effrayer celle qui ne connaît rien du monde hormis les cocktails littéraires et les réceptions mondaines. Celle à qui il jure, s’il devait l’épouser, une aventure sans illusions et sans mensonges, crue de ce qu’elle contient de laborieux et de répugnant. Ce croque-mitaine aux cheveux blancs, invité à traverser à son tour ce méridien invisible qui le sépare de ses spectateurs, à briser le quatrième mur, est cette hallucination collective venue in fine réclamer son brevet d’existence spolié. Le regard-caméra lancé par Thorwald, à la découverte de celui qui intrigue depuis le début contre lui, reste glaçant et pathétique car il marque la perte brutale de cette innocence du mal qui le caractérisait jusqu’ici, averti désormais de cet autre homme qui en sait autant que lui sur la vie qu’il mène. Son regard suit le geste de Lisa qui s'est passée à l'annulaire gauche la bague de l'épouse disparue. Sans mot dire, c'est le meurtrier qui vient de bénir leur union.
Venu bientôt prier un peu de clémence auprès du responsable de cette rencontre interdite, Thorwald poussera Jefferies par la rambarde de sa fenêtre panoramique pour que s’interrompe l'inavouable, l'inimaginable qu'ils vivent alors tous les deux. À l’instar d'un Little Nemo dans les bandes dessinées de Winsor McCay, la chute est la clé de sortie pour Jefferies, en même temps qu'il sonne le glas de cette image que symbolisait Thorwald, cette image délogée de son cadre. Une fois ce dernier enfin arrêté par la police, soudain les lois de la gravitation se reconfigurent : les jeunes voisins tout juste fiancés ont la gueule de bois de leur serment ; la température redevient raisonnable ; une gynécée s’implante au cœur de la chambre d’un rêveur. Ses photographies les plus réussies, Jeff confessa à Doyle, son ami détective, les avoir à chaque fois prises durant ses jours de congés. Celle qui lui aura donné le plus de mal ne requit finalement aucune pellicule. Mais, après tout, ainsi sont peut-être toujours faites les vraies images.

Les idées maîtresses de ce texte sont nées au cours d'une discussion avec Aurélien Lemant, Pierre Pigot et Steven Lambert suite à une projection du film dans le cadre des séances "Les Voyeurs" au cinéma Le Petit Casino de Saint-Aignan, en décembre 2015.
2 notes
·
View notes
Text
ÉCRIRE (II)
Dans ce film méconnu narrant l'écriture de "De Sang Froid" de Truman Capote, on voit ce dernier, interprété par l'excellent Toby Jones, tester sur trois de ses amies une phrase qu'il a entendue de la bouche de Perry Smith (l'un des meurtriers qu'il visite dans sa cellule pour échafauder son livre). Trois versions d'une même phrase ; effectivité du style et compromis avec la réalité.







(Infamous, Douglas McGrath, 2006)
0 notes
Text
ÉCRIRE (I)
Filmer l'écriture, le cinéma s'en sait incapable. Leurs temporalités sont trop contraires. Il n'empêche que, çà et là, cette ambition resurgit le temps d'une scène. Le blog du Feu Sacré tâchera, au gré de visionnages, de répertorier certains de ces éclats. Ici, le prime romancier adulé Pierre Valombreuse dont l'aise de sa vie (bientôt mise en péril de son propre chef) se cristallise dans un outil de traitement de texte.
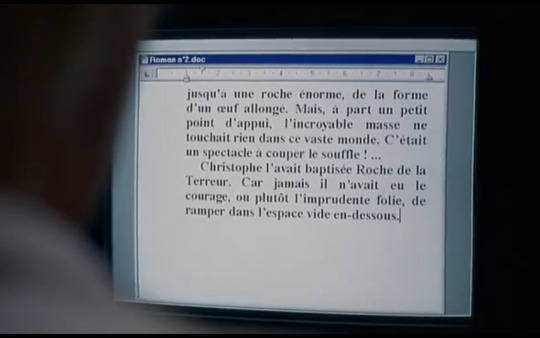



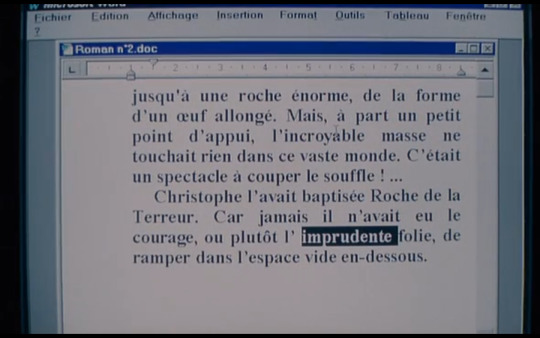


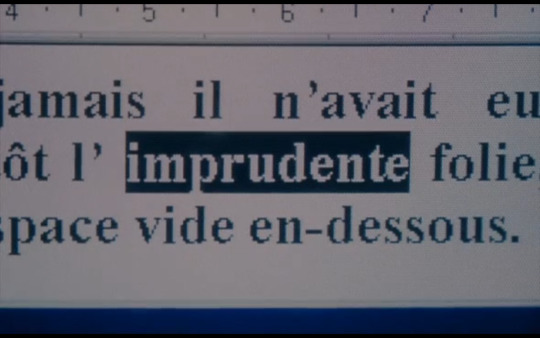

(Pola X, Leos Carax, 1999)
3 notes
·
View notes
Text
TROIS VERSANTS DE JUDAS, Chœur critique sur le Silence de Scorsese (2/2)
Seconde partie de la discussion à trois voix à propos de "Silence" de Martin Scorsese.

Pour lire la première partie, c'est ici.
Steven Lambert : Tu disais, Frédéric, que c’était un film qui n’aurait pas pu être fait à New York, en studio. Qui, dans sa forme très inhabituelle pour Scorsese, ne pouvait lui être inspiré que par le Japon, un pays qui lui demandait de revoir de fond en comble sa manière de filmer…
Frédéric Chandelier : Oui, et que l’on touche vraiment du doigt dans l’exemple de la Nature dont nous parlions tout à l’heure, qui était rarissime jusqu’ici dans son cinéma. Comme les animaux. On avait un rat dans le plan final des Infiltrés. Ici, un lézard tout droit sorti d’un film d’Herzog se faufile sous la pluie le temps d’un insert. Une meute de chats peuple tout un village dévasté… Jusque là, Shutter Island était peut-être la seule exception à cette absence de préoccupation pour la Nature…
S.L : Shutter Island qui se déroule sur une île… comme Manhattan est une île… comme le Japon en est une ! A croire que l’insularité appelle aujourd’hui chez Scorsese à rejoindre quelque chose qui n’est plus individualiste (Belfort, Hughes) mais profondément subjectif.
F.C : Coïncidence étrange : la grotte où Garupe et Rodrigues trouvent refuge une fois débarqués au Japon m’a évoqué immédiatement celle de Shutter Island, excepté qu’il y a deux portes de sorties et qu’elle ne nécessite pas de grimper une falaise pour l’atteindre.
A leur arrivée, en dehors de Kichijiro, leur guide, le premier autochtone qu’ils croisent est clairement assimilé à un spectre, dont on ne sait pendant un court laps de temps s’il est amical ou hostile. La familiarité du territoire pour les japonais se joue en un raccord, où pensant échapper à cet inconnu en rebroussant chemin, ils tombent nez à nez avec lui à l’autre bout, comme par magie. Pourquoi ? Simplement parce qu’il est chez lui !
S.L : On éprouve le même sentiment avec Liam Neeson, la première fois qu’on le revoit en kimono, sa grande silhouette massive et pourtant désincarnée marchant vers nous d’un pas lent, fantomatique. Acteur et personnage ensemble à contre-emploi, et qui n’apporteront aucune lumière à ce pauvre Rodrigues mais vont au contraire le précipiter un peu plus au fond de son trou. Ce masque japonais dessine soudain chez Neeson une grimace. Celle du « bonheur », dont il n’arrive précisément pas à dire le mot quand Rodrigues lui demande s’il est heureux de cette nouvelle vie – bien qu’il nous faille reconnaître qu’elle est la voix de la raison. Pour preuve ces deux phrases magnifiques : « Si le Christ avait été à ta place (devant les paysans suppliciés dans la « fosse ») il aurait agi, il aurait apostasié », et juste après, avant que Rodrigues ne se décide à piétiner l’fumi-e : « Tu t’apprêtes à accomplir l’acte d’amour le plus pénible qui soit. »
Warren Lambert : C’est le mindfuck de cette figure : il fallait l’apôtre du renoncement pour que Rodrigues comprenne que c’était au contraire un pas vers Dieu qu’il faisait en réalité… Si on le regarde visuellement, son apostat est comme un pas de danse, d’équilibriste, il commence sur un pied, comme un héron, et s’achève le corps retombé lourdement au sol, son bras droit entourant encore la plaque. A cette chute muette chorégraphiée au ralenti succède un autre ralenti de la main de l’interprète japonais, qui se lève pour ordonner la fin du calvaire des suppliciés, aussi stylisée et bouleversante que le pied de Rodrigues. Complémentaire.
S.L : Oui, il tombe autant « en renoncement » qu’en adoration. Pour la première fois où il est amené à l’extérieur de sa cage, c’est du reste pour sauver des hommes et des femmes qu’il ne connaît pas, qui sont anonymés par la méthode même de la torture de la « fosse », la tête placée sous une trappe, et qui ont déjà apostasié. C’est sur ce dernier cas qu’on le supplie de sortir de cette comparaison divine, et de se mettre enfin à hauteur d’homme, de marcher réellement avec eux…
W.L : Communier, à ce moment-là, c’est renoncer à leur côté…
F.C : Et renoncer, c’est aimer.
S.L : Cet interprète japonais, voilà encore une figure déguisée du traître. Il est celui qui, maîtrisant la langue, a l’avantage sur les autres, implicitant que la façon de coloniser le Japon est d’abord passée par la langue, par le fait que des japonais aient pu parler une autre langue que la leur, avec toutes les imperfections, les malentendus qui en découlent. A commencer par le mot kirishitan, pour christian.
W.L : Les quiproquos, oui, surtout ! La langue reste le lieu du quiproquo. Cette idée que la détestation nourrie à l’égard des occidentaux a été favorisée par les quiproquos. On pourrait dire : ce qui les dépasse, au-delà de Dieu, c’est le quiproquo de Dieu. On revient à l’anecdote du « son of God » devenu « sun of God ». Le film dans son entier traduit bien, d’ailleurs, cette confusion de la langue : tous parlant anglais, l’anglais étant censé valoir soit pour le portugais, soit parfois, mais c’est flou, pour le japonais, sans indication pour le spectateur des changements de langues. On est loin d’un John MacTiernan dans A la poursuite d’Octobre Rouge ou Le 13ème guerrier, qui, au moyen d’une séquence, nous montrait le glissement entre la langue russe et américaine, ou entre l’arabe et le viking. Pour Silence, j’ai mis très longtemps à comprendre les équivalences qui s’y trouvaient.
S.L : Il y a une scène, à la rigueur, qui pourrait donner la clé de ce choix-là : celle où l’Inquisiteur demande à Rodrigues s’il a compris ce qu’il venait de dire en japonais, traduit seulement pour nous, spectateurs, et à qui Garfield répond : « J’ai vu vos yeux. » Et quand l’Inquisiteur demande en retour ce qu’il y a vu, Rodrigues reste silencieux. On lit juste un petit sourire narquois. Quelque chose qui tient de la provocation.
W.L : On en revient à la communion et au masque. A ce que même un visage aussi lisse est capable malgré tout de faire passer. Scorsese a d’ailleurs pris soin de choisir un comédien pour Inoue-Sama qui insuffle déjà beaucoup d’ironie dans ce personnage : une diction particulière, avec son cheveu sur la langue, ses intonations précieuses, perverses, grotesques ou parfois terrifiantes. Ça crève admirablement l’écran lorsque l’Inquisiteur, à un pic de Rodrigues, expire de dépit si lentement et exagérément qu’il donne l’impression que tout son corps se dégonfle. Que la parole, le souffle, vide son corps... Belfort le faisait aussi avant de prendre la parole face à son auditoire dans la dernière séquence du Loup de Wall Street.
F.C : Dans cette scène, il y a deux jeux d’acteur qui s’affrontent. Deux rapports de force. Deux civilisations. Chez Scorsese, la mort s’est accoutumée à surgir plutôt au coin d’une rue, sur le toit d’un building, dans le caniveau, bref là où tu ne l’attends pas, tandis qu’ici, au Japon, il démontre que c’est une représentation permanente. Je repense au Golgotha des trois paysans au bord de l’eau, qui embrasse à cent pour cent cette théâtralité : on prépare les symboles de l’Occident chrétien mais qu’on laisse se faire submerger par les eaux, dans un lent face à face. Il y a là une vraie mise à distance de son cinéma au moyen de l’élément aquatique, encore une fois.
S.L : C’est le pendant de La Dernière Tentation du Christ, où tu as le désert, la poussière, le sable, et dans Silence, tu as l'océan, les rivières, la brume et la boue.
W.L : Leur point commun, ce qui intéresse Scorsese dans ces Golgotha, c’est l’instant de la mort où les corps s’abandonnent enfin. C’est le dernier plan de La Dernière Tentation du Christ, où la pellicule vient à manquer au moment fatidique de la mort de Christ, parce qu'elle ne peut s’approcher aussi impudemment de cet instant. Le premier à partir au Golgotha dans Silence le fait sur le mot « Paraiso ». Contradiction la plus vivante de ce corps aseptisé, froid, rigide, beau parleur de l’Inquisiteur qui se dégonfle et que nous évoquions à l’instant.
F.C : Une fois que l’on revient aux objets du folklore chrétien, quand le père Ferreira et le père Rodrigues sont chargés de trier ce qui est chrétien de ce qui ne l’est pas, tout à coup ils inventorient l’apparat de la civilisation d’où vient cette religion, alors que le film était parvenu à te le faire oublier : par les lambeaux, les reliques bricolées passées de main en main. Et c’est là que Scorsese reste au fond extrêmement critique sur tout le décorum de la religion catholique.
S.L : Ça se sent par ce doute qui plane au moment de leur inventaire, de la possibilité tacite qu’ils auraient d’en laisser passer quelques uns. Hypothèse bien vite désamorcée puisque le personnage a complètement dépassé le symbole. Il n’en a plus besoin. Il peut être pleinement le Judas de sa propre religion. Il importe peu que les symboles n’arrivent pas jusqu’au Japon, lui y est. Et ce que Kichijiro lui rappellera : qu’il est effectivement le dernier prêtre de l’île.
F.C : A se demander si le personnage de Rodrigues n’a pas pris de la distance sur l’endroit d’où il vient plutôt que sur celui où il vit désormais, matérialisé par cette rigidité des corps, ce dressage physique, alors que tout ce dont ils se sont dépouillés les avait jusque là anéantis physiquement. Comme si les redresser correspondait à un nouveau rapport à leur foi. Qu’il fallait maintenant tenir cette droiture pour ne pas plier sur leur croyance, même si ce n’est pas celle qu’ils étaient venus apporter à ce pays.
S.L : Aboutissant à ce nouveau paradoxe : renoncer, c’est résister ! Un oxymore avec lequel Scorsese joue à plusieurs reprises lorsque les confessions, les baptêmes, les bénédictions semblent se multiplier à un rythme d’enfer, où la gloire de leur mission semble repartir, battre son plein, et qui se brise systématiquement à la scène d’après. Le summum étant atteint lorsque Liam Neeson répond à un Rodrigues idéalisant un Japon qu’il n’a pas connu, et qu’il voit comme l’Eldorado du catholicisme, qu’il n’y a jamais eu 300 000 chrétiens sur l’île, déjà du temps de Ferreira.
F.C : Il est très intéressant ce passage parce qu’il permet le dialogue de deux points de vue sur le seul axe du temps. Or, ce sentiment même erroné de quête, c’est ce qu’il n’y avait plus chez les personnages américains de Scorsese – Belfort et Hughes étant sans doute les exemples les plus jusqu’au-boutistes. Ils étaient ceux qui pouvaient difficilement aller plus haut, plus loin que là où leur folie des grandeurs les avait amenés. Avec Silence, L’élévation remplace l’ascension. C’est peut-être la première fois, en sortant qui plus est de son cadre américano-américain, que Scorsese met en scène quelqu’un qui réussit. Même dans Les Infiltrés, alors que le personnage de Di Caprio arrivait à ses fins, il finissait flingué comme un vulgaire dealer dans un ascenseur.
W.L : C’est le contrepoint total à sa position sur l’immigré de ses précédents films, qui était le point de départ de la quête du héros. Ici, il fait réellement de son déracinement l’accomplissement positif de sa vie. Une chose en tout cas optimiste.
S.L : C’est vrai que Gangs of New York montrait un homme qui revenait dans son pays, y émigrait une seconde fois, et qui n’ayant rien appris des erreurs de son père voudra refaire les mêmes guerres que lui. Or il n’y a pas cette leçon dans Silence, bien que Liam Neeson joue à nouveau cette même figure paternelle. Et tu parlais d’ascension, tu as raison. Moi, je vois vraiment le film à la façon d’une mystique à la Simone Weil !
F.C : Parce qu’on sent que les films plus historiques ou frontalement religieux de Scorsese lui permettent, je crois, de sortir de la circularité de son cinéma : l’obsession, la spirale, le toc…
W.L : Ou alors Dieu comme toc !
F.C : L’ascension lui aura permis de mettre en lévitation ses tendances à tourner en rond, où il a si souvent aimé se perdre. Le phobique Hughes qui peinait à tendre la main vers la poignée de porte d’un chiotte dans Aviator est devenu le centre de tout un film, de celui-ci.
S.L : Sur cette question de la circularité, du concentrique, on remarque que Silence est rempli de moments où Rodrigues ne cesse d’accoster, comme s’il y avait à chaque amarrage une nouvelle île dans l’île, un nouveau pays dans le pays, avec les villageois qui s’agrippent à sa barque comme les morts-vivants d’un Styx de plus en plus infernal.
F.C : Parenthèse : ce côté gigogne de la géographie, tu le retrouvais avec le phare dans Shutter Island – la dernière épreuve de Teddy – qui était également une île dans l’île. Sans oublier que les pensionnaires de l’asile ressemblaient eux aussi à des morts-vivants !
S.L : On pourrait dire que Rodrigues, grosso modo, c’est tout du long quelqu’un qui se croit au Paradis alors qu’il est en Enfer.
W.L : Et cet état d’esprit bascule pour de bon après l’identification à la peinture du Greco à la rivière, où par un morphing et démorphing alternés son visage se superpose à celui du Christ, le faisant éclater de rire, plongeant son visage pour rejoindre cet autre visage en s’ébrouant au-dessus comme un chien fou.
F.C : Ce narcissisme, au sens propre, renvoie explicitement à l’image démiurgique et divine que les autres personnages de Scorsese avant lui ont toujours fantasmé d’eux-mêmes.
S.L : Mais ici tout ça se désamorce par son rire, l’air de dire : « Vous avez cru que je vous refaisais la Passion ? Perdu! ». Que le moment de la possible identification suprême soit le moment de la dérision suprême le dit très clairement. On penserait qu’à un stade d’affaiblissement encore jamais atteint, cette identification lui amènerait une lumière, à ce personnage, eh bien non, elle amènera au contraire une plongée encore plus vertigineuse dans la folie. La tentation chez Scorsese est décidément toujours une fausse piste, détruite ici par le rire, et plus tard face à Neeson par les larmes.
F.C : C’est drôle car c’est le revenant de Gangs of New-York, Liam Neeson, qui lui demande de se taire. Teddy Daniel avait eu droit à la même consigne aussitôt débarqué, et que lui donnait une vieille dame spectrale en posant le doigt sur ses lèvres. Pareil pour le père Ferreira, le silence c’est la règle. Renonce au langage du prêche, semble-t-il lui dire, adopte la voix de l’autre, et garde ce silence qui est ta foi et ton salut. C’est ce qui rend d’autant plus beau cette absence d’ironie, qui arrive, il faut bien le dire, même 28 ans après, au bon moment, à l’heure où la religion est trop inextricablement mêlée au social et à la politique qui se la sont accaparés.
S.L : C’est un film qui fait preuve d’une vraie fidélité à son sujet. Tout le contraire d’un film prosélyte. Il montre combien ce n’est pas simple d’être croyant, que la foi se construit aussi sur la fange.
W.L : Oui, le contraire d’un film tiède. Dieu vomit les tièdes, de toute façon. Et Scorsese aussi. Si c’est à ce point un grand film d’Amour, c’est d’abord parce qu’il est filmé à hauteur de foi.
0 notes
Text
TROIS VERSANTS DE JUDAS, Chœur critique sur le Silence de Scorsese (1/2)
Nous ne venons pas de nulle part. Les films nous prêtent leur mémoire, en échange de quoi nous leur prêtons nos yeux. La discussion qui va suivre a été improvisée à chaud et enregistrée sur un petit magnétophone à cassettes le 11 février 2017 à Montreuil, à la sortie du visionnage enthousiaste de "Silence" de Martin Scorsese. Publiée initialement sur la revue en ligne Sédition, elle devait y amorcer une nouvelle forme de critique : orale, plurielle, impromptue... mais sera finalement restée un prototype. Le Feu Sacré a tenu à la ressusciter du tombeau.

Steven Lambert : Moi qui ai découvert La Dernière Tentation du Christ il y a seulement quelques semaines, j’étais assez étonné de retrouver de troublantes correspondances : un personnage dont le périple est analogue à celui du Christ, et qui est également une histoire sur le renoncement, excepté que dans l’un, c’est par un rêve qu’on le lui offre, et ici par le biais d’une terre étrangère. Silence n’est plus un film sur des visions, sur un homme qui a des visions, mais qui vit à présent parmi elles. Elles ne concernent plus la position d’un individu par rapport à son Dieu, mais par rapport aux hommes. Ou pour le dire autrement : l’onirisme dans Silence est du côté de la Nature. Ce sont les premiers plans, après la cacophonie crescendo d’une jungle en son seul en guise de générique, dans lesquels parmi les fumées des volcans où l’on s’adonne à la torture on comprend tout de suite que nous sommes en Enfer, les « Enfers » même, selon le nom donné à ce mont par les habitants eux-mêmes. Un doublé, avec le début de Shutter Island et son cargo qui accostait sur l’île depuis la brume.
Warren Lambert : Ce renoncement qui, à l’instar de nombreux films de Scorsese, était présent à la fin de Shutter Island lorsque DiCaprio acceptait non seulement de s’être perdu, d’être incapable de réellement guérir, et pour finir d’être emmené à la salle où il s’apprête à subir une lobotomie. Le tout exprimé au moyen d’une seule réplique très ambiguë, comme un verset ésotérique à elle seule : « Qu’est ce qui serait le pire – vivre comme un monstre ou mourir comme un homme bien ? »
Frédéric Chandelier : Je m’étais rendu compte de ce nœud-là en travaillant sur Aviator, à savoir que, de plus en plus, les contradictions que pose Scorsese chez ses personnages amènent à cette perte de la raison ; le fait qu’ils se confondent avec ce en quoi ils croient, et qui est dans un même élan ce à quoi ils doivent en effet renoncer. Ce nœud se traduit formellement au moyen d’un élément ou d’un environnement liquide, aqueux, moite. En insistant qu’à la croisée de ces questions demeurera avant tout celle de la chair, et sur laquelle Scorsese n’a jamais triché : un sacrifice de la chair doit être un sacrifice de la chair. Cette orientation très nette de son cinéma depuis les années 2000, je dirais qu’il l’exprime en revanche narrativement par la filiation, le lignage.
Ce tiraillement est un vieux rêve qu’il avait essayé précédemment d’aborder de front avec A tombeau ouvert – mais présent, on le sait, au fond, depuis Taxi Driver – et auquel DiCaprio a apporté un nouveau souffle, ne serait-ce qu’avec l’importance de la genèse, de l’enfance d’Howard Hughes, puis le fait d’être ensuite jeune père dans Shutter Island, etc. Il y a à chaque fois l’idée que la folie a partie liée à la salvation et inversement, que toutes deux prennent souvent racine dans une duplicité, dans ce moment où un homme éprouve une difficulté existentielle vis-à-vis de son reflet (Shutter Island et sa fiction curative ; Les Infiltrés et son binôme siamois flic/mafieux ; ou Aviator et les névroses annihilantes du milliardaire). C’est pour cette raison que je trouvais au départ dommage que les personnages d'Andrew Garfield et Adam Driver finissent à ce point séparés. Mais ce qui, à l’arrivée, a une grande force lorsque Driver refait surface, puisque ce sont aussi deux rapports au Japon que l’on sent très différents pour chacun, qui auront été deux destins absolument distincts dans le pays.
S.L : Et qui reste cohérent avec le dépouillement auquel le père Rodrigues va devoir consentir, de son chapelet jusqu’à son nom, avec comme seule relique, comme seul souvenir, cette minuscule croix en bois qu’un paysan japonais a confectionnée et dont il lui fera cadeau, cachée au creux de ses mains dans son cercueil dans le dernier plan du film. C’est un personnage qui donne tout, et à qui l’on prend tout. Mais où, à force de tout lui prendre, on lui aura finalement redonné quelque chose.
F.C : C’est un personnage qui finit par comprendre comment arriver à s’adapter à l’hostilité qu’il sent partout autour de lui, sans pour cela renier ses principes. Et s’il parvient à la fin à devenir un pur personnage scorsesien, joué qui plus est par un acteur novice dans l’univers du réalisateur, c’est vrai que tout du long on sent que rien n’est jamais joué d’avance pour lui. Qu’il doit, et sur les deux niveaux, celle de la fiction comme celle du film, à son tour, gagner ses gallons.
W.L : Je repensais à la comparaison que fait l’Inquisiteur au père Rodrigues en parlant du Japon comme d’une épouse stérile, pour métaphoriser, comme plus tard avec l’image du marécage, la futilité de leur mission. Il y a cette belle scène ou Kichijiro, le traître à répétition, sorte de Judas burlesque, revient le voir alors qu’il est installé – calfeutré serait plus exact – avec femme et enfant, et qu’il lui demande une dernière fois de le confesser. C’est tourné comme une scène d’infidélité, avec une amante qui, en lui dévoilant son amour, raviverait sa flamme – Rodrigues s’empressant d’ailleurs de fermer la porte pour ne pas risquer qu’on les entende. Cette manière d’érotiser la confession, de replacer le geste rituel banni dans un geste d’amour en approchant fébrilement la main vers le crâne de celui qui n’aura eu de cesse de le trahir puis de revenir, comme il se laisserait aller à une caresse interdite, c’est le pendant du piétinement apostasique, teinté de résignation et de ferveur, auquel s’est livré plus tôt le père Rodrigues. Ce n’est pas pour rien que si elle est l’ultime demande de confession formulée par Kichijiro, elle est surtout la seconde et dernière fois après l’apostasie du prêtre où l’on réentendra la voix du Christ s’adresser à lui.
S.L : Ce rapport aux images qu’on piétine pour abjurer sa foi, les intérieurs, les cages successives de Rodrigues, tout cela pose le parti pris du film face à la souffrance, au martyre, et qui est bien entendu similaire à la position d’un spectateur. Silence raconte l’histoire d’un homme qui regarde des images violentes, insoutenables, injustes, et qui, malgré tout, miraculeusement, arrive à conserver et maintenir une forme d’amour en lui. Cela va de paire avec le renoncement dont on parlait, déjà présent dans La Dernière tentation du Christ, et qui fait ici l’objet d’un renversement positif. Tout comme Kichijiro et sa demande de confession qui sera soudain une piqûre de rappel bienveillante de sa foi enfouie, venu d’un personnage un peu ingrat à nos yeux comme aux siens, c’est Judas dans La Dernière tentation du Christ qui dans le rêve de la fin de vie paisible du Christ, retiré loin de la douleur des hommes, le sommera d’accepter son sacrifice. C’est le même geste : la énième trahison à répétition de Kichijiro sera paradoxalement, cette fois-ci, ce qui maintiendra en éveil la foi du prêtre.
F.C : Gangs of New-York avait à l’époque posé une ligne claire sur la façon de voir cette figure de Judas. Celui qui trahira Amsterdam (DiCaprio), son ami d’enfance, qui avouera au Boucher qu’Amsterdam est le fils du Prêtre (joué par Liam Neeson), finira crucifié à même un grillage sur une place publique, agonisant aux yeux de tous, posé là par ceux à qui il a fourni les renseignements, et qui lui feront payer plus durement que les autres de leur avoir vendu son meilleur ami, d’avoir trahi son camp.
W.L : Borges a écrit que le vrai Christ est davantage à chercher dans Judas. Ici Kichijiro, c’est un ivrogne, un pouilleux, moins qu’un « démon » dira Rodrigues, un moins que rien juste bon à demander pardon, et pourtant ce sera son ami le plus fidèle. Ce running gag de la confession, c’est en même temps un pacte qu’ils établissent secrètement. Tant que Rodrigues lui accordera la confession, sa foi ne faiblira pas.
Cette fragilité-là, tu la ressens directement, je trouve, dans l’aspect physique, vestimentaire des personnages, qui alterne entre loqueteux et apprêté, qui leur fait par intermittence retrouver une certaine dignité pour les rejeter le plan d’après dans la fange.
S.L : Parce que c’est un miroir qui épouse l’état de leur foi ! Quand il sont à leur meilleur ils resplendissent, et lorsqu’ils butent à nouveau, stagnent ou rechutent, leur mise redevient bourbeuse, leurs cheveux défaits, leurs visages davantage creusés et sales. Ce rythme binaire épouse le film en entier, y compris dans les différentes prisons à ciel ouvert dans lesquelles on enferme Rodrigues, et qui le retiennent moins qu’elles le protègent, en définitive. Il est un privilégié, soumis à aucune torture sinon celle de regarder. La grande force dont il fait preuve, c’est qu’en dépit du spectacle horrible auquel il assiste, il n’y a de tout le film aucun sentiment de vengeance pour les bourreaux qui sourd en lui, aucun instant où la haine prendrait le dessus.
W.L : C’est cette idée de l’endurance. Ne pas détourner le regard. La violence qu’il voit doit uniquement lui servir à se faire violence. Liam Neeson le lui dit à la fin, avant qu’il n’apostasie : « Allez-y, priez ! Priez, mais les yeux ouverts. »
Cette endurance se sent également dans la longueur de la crucifixion au bord de l’océan, où le dernier des trois paysans met un jour de plus pour mourir que le Christ en mît pour ressusciter.
Liam Neeson, encore, lui révèlera au moment de leurs retrouvailles que la confusion du langage sur « son of God », que les convertis prirent pour le mot « sun of God», « Daïnichi », désignant à son ancien disciple le soleil, installa LE quiproquo métaphysique primordial entre les deux civilisations, puisque si le soleil se lève tous les jours, aux yeux des japonais le fils de Dieu en faisait alors autant. Pour nous déciller, Rodrigues et nous, il y a cette idée géniale, premier degré, de nous faire contempler le soleil en gros plan, l’astre qu’il est impossible, optiquement impossible de regarder en face.
C’est de la sorte que l’on nous pointera, l’air de rien, la place de la Nature dans la mystique orientale, et du côté de laquelle tous les partis pris sonores du film se placent (absence de musique, travail d’une richesse ahurissante sur le son, générique de début et de fin composés de chants de cigales).
Tu parlais de visions : la mort, ce sera ça ses visions au père Rodrigues ! (Le prêtre repensera d’ailleurs dans sa cellule au paysan décapité devant lui et au père Garupe noyé pour sauver une jeune paysanne ; ce sont elles les images qui le poursuivent, le tourmentent.) Égrainées comme un chapelet ou plutôt perlées goutte par goutte comme l’incision que l’Inquisition japonaise opère derrière l’oreille des suppliciés de la « fosse », pendus par les pieds, et dont le goutte à goutte du sang les empêche de perdre connaissance et de mourir trop rapidement… Cette incision, comme un stigmate déplacé du flanc droit à l’oreille, caché, distinctif, ce signe de ralliement qui est ce par quoi débute Gangs of New York : l’entaille sur la joue du père d’Amsterdam, qui en profite pour bien rappeler à son fils que le sang doit impérativement rester sur la lame.
S.L : C’est ça ! Dans Silence, il s’agit de ne pas reculer sur l’idée que cet Amour-là s’enracine dans un monde de souffrance…
F.C : D’où le côté cause/conséquence de la foi ! Ceux qui n’ont pas craché sur la croix meurent sur la croix dans la scène suivante. On leur fait vivre l’image de leur foi, en dehors presque d’un aspect punitif. C’est le choix qu’on leur laisse : « Si vous avez le courage de croire, vous devez aller jusqu’au bout. »
Et tu as raison de parler de privilège. Qui torture ? Les maîtres. Qui regarde ? Les maîtres. Il y a donc cette question de classe qui recouvre cette souffrance, dont le père Rodrigues est, quoi qu’on en dise, complètement exempt. Son renoncement, ou sa promesse, dont le silence sera celui d’un ancien dissident qui aurait capitulé, le rangera dans la frange des privilégiés, lui permettant plus tard, contre toute attente, de gravir l’échelle sociale.
S.L : C’est ce qui en fait, sur ces deux lectures, un film sur la pesanteur. On part de l’église au Portugal, du haut des marches que descendent les deux prêtres, appuyé par un plan en point de vue de Dieu, pour arriver dans le « marécage » nippon, selon les mots de l’Inquisiteur et de Ferreira, visible ensuite par la chute sur la plaque filmée au ralenti, puis enfin dans la scène qui suit l’apostasie, dans laquelle Rodrigues est surcadré par une fenêtre du dojo ouverte à l’étage dans laquelle s’inscrit son visage immobile, impassible, comme une icône morte. « Paul l’apostat ! », lui crient alors des enfants depuis la rue en contrebas.
F.C : Ce qui est beau à ce moment-là, comme à la fin quand la caméra traverse les flammes pour rentrer dans le cercueil, partie chercher la croix sculptée dans les mains d’un Rodrigues recroquevillé comme un bouddha, c’est que Scorsese joue sur les deux iconographies, les mêle, celle bouddhiste et l’autre chrétienne. Dans le plan final, on a ainsi la seule virtuosité réellement scorsesienne où la caméra traverse le feu, ce feu qui finit par éclairer le corps, avec la peau qui redevient translucide. Comme un fœtus.
Si l’on repense une minute à Aviator, son prologue fonctionne en symétrie avec l’épilogue de Silence, avec ce baptême du corps de l’enfant Hughes dans la baignoire, lavé par sa mère, ce baptême censé non pas le mettre au monde mais l’en préserver (« Quarantaine » lui fera-t-elle épeler comme un surnom), et ce second « baptême », au milieu du film, dans sa salle de projection, nu à nouveau, replié là encore comme en fœtus, avec défilant sur sa peau des images de crashs d’avions en flammes qui semblent raviver ses scarifications de grand brûlé.
Toute cette période depuis DiCaprio, bien qu’elle fasse écho dans certains thèmes aux films inoubliables de Scorsese qui seraient supposés être les pôles immuables de ses obsessions, est, à mon avis, vraiment à considérer telle une nouvelle genèse. A l’heure d’aujourd’hui, je le vois de la sorte, il pourrait y avoir quelque chose qui va de la baignoire d’Howard Hughes au cercueil du père Rodrigues.
W.L : Tu nous racontais à ce propos une anecdote assez dingue que j’ignorais, à savoir que les scènes coupées de Gangs of New York avaient été brûlées par les frères Weinstein, les producteurs, et que la version originale qu’elles constituaient, à jamais perdue, faisait environ cinq heures. On pourrait y voir encore un lien ?
F.C : Le feu dans Aviator est partout. Venant après ce film-genèse sur l’Amérique qu’est Gangs of New-York, et sur le trauma d’une version détruite par les flammes donc, j’imagine que oui… Autre exemple qui me revient en tête : après sa rupture avec Katherine Hepburn, tous les oripeaux du corps social de Hughes, ses costumes, ses chemises, sont déchirés puis jetés dans un grand feu purgeant. C’est l’inhumation de sa carcasse clinquante de milliardaire, de la même façon qu’il enlèverait des peaux mortes ! Même chose lorsqu’on le fait se raser pour son procès, après que sa barbe, ses cheveux et ses ongles aient poussé négligemment, il s’agira, à l’inverse, de lui réapprendre les gestes du social.
S.L : Il y a la même chose dans Silence, où la barbe du père Rodrigues est la dernière étape avant sa pleine intégration à la caste japonaise. Et, quelque part, on retrouve ça chez Scorsese lui-même, qui a longtemps porté la barbe avant de maintenant se présenter publiquement toujours fraîchement rasé !
F.C : Et tu sais que ça été pris très au sérieux déjà à l’époque, puisque je me souviens avoir lu quelque part qu’il avait fait de nombreuses unes de magazines… Et puis, il ne faut pas oublier que son premier court-métrage, The Big Shave, est intégralement sur un homme qui se rase, qui se rase jusqu’au sang. C’est son problème avec l’âge adulte derrière. L’histoire d’un homme qui, en voulant être plus glabre qu’un imberbe, en sur-lissant son visage, en arrivait au stigmate ! Il y a une idée qui se dessinerait là, qui ferait que dès qu’un homme se laisse pousser la barbe, pour Scorsese, il serait dans l’expérience, et que la sagesse qu’il apprend au bout se son chemin de croix l’amènerait à revenir à quelque chose de plus poupin, enfantin…
S.L : Lisse comme un masque…
F.C : Oui, parce que tous les personnages savent qu’ils mentiront mieux à visage découvert !
S.L : La duplicité tout à coup vue, a contrario, comme quelque chose de lisse, mais dont un feu crépite en silence à l’intérieur, bout sous la peau, continue de l’animer.
W.L : A vous écouter, je me faisais la réflexion que c’était certainement la raison pour laquelle Silence s’attarde davantage sur le derme des suppliciés, leur peau rougie, chauffée, brûlée, ou alors asséchée, gorgée d’eau. Rodrigues évoque en voix off le corps de Mukachi dont l’inhumation renvoie des fumées blanches tellement il est imbibé de flotte. Cette descente de croix marquante du corps de Mukachi, pietà nocturne d’une délicatesse folle dans sa mise en scène, par ailleurs symptomatique dans son traitement de la place particulière qu'occupe la violence dans Silence, à rebours total du style scorsesien habituel. C’est une violence qui, à chaque étape, est tout de même infligée avec un respect incroyable, à la japonaise, la rendant pour cette raison encore plus tragique. L’écœurement de Rodrigues face à elle participe à constituer notre propre épreuve face au film, notre écœurement s’imbriquant dans le sien, ou depuis le sien, et devant nous amener, comme il en a été pour lui, à penser autrement notre rapport à la foi.
La suite dans quelques jours...
0 notes
Text
GILBERT SORRENTINO
Pourquoi Sorrentino ? Peut-être parce qu'en ce début d'année 2024, ce blog du Feu Sacré s'est placé tout à fait fortuitement sous les astres de la fiction, genre plutôt délaissé dans nos publications et que Sorrentino, lui, n'a eu de cesse que de triturer, malmener, pervertir, subvertir. Et peut-être est-ce parce que Sorrentino est si inclassable dans cet exercice que seule une maison sœur de celle du Feu sacré a osé jusqu'ici rendre disponible en français une partie de son œuvre. Pour les âmes curieuses, voici donc un entretien ayant eu lieu par correspondance entre décembre 2004 et janvier 2005. Il a été initialement publié dans un ouvrage consacré à l'auteur aux Presses Universitaires de Rennes.
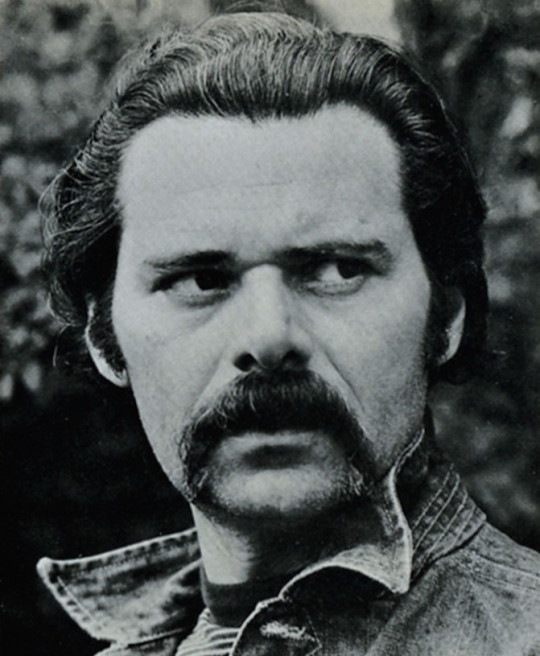
Il semble y avoir une tension constante dans votre œuvre entre, d’une part des cadres structurels préconçus et des contraintes imposées, et d’autre part la prolifération du langage. Peut-on penser que c’est une réaction de l’intellect à l’excès ou à la perte de sens induits par les possibilités infinies des combinaisons verbales ?
Par « prolifération du langage », je suppose que vous voulez dire une sorte d’exfoliation des choses, c’est-à-dire les éléments, les signifiants ou simplement les noms. J’aime les listes parce que lorsqu’elles sont ouvertes, en terme de sujet, elles sont infinies. L’idée de quelque chose d’infini, couplé, si on peut dire, avec une contrainte rigoureuse, est une fascination sans limite – surtout si la liste – la prolifération – est contenue dans une contrainte formelle. Je ne sais pas si c’est une « réaction de l’intellect » ou pas, mais c’est quelque chose que j’ai fait pendant une bonne partie de ma vie d’écrivain. C’est peut-être une façon de contrôler l’incontrôlable, ou de faire semblant de le contrôler. Une superbe mise en ordre de choses semble un monde sous contrôle, même si le contrôle cesse d’exister hors de la mise en ordre. Mais c’est bien cela l’art, de toute façon, du moins je crois : un monde sous contrôle qui feint d’être une représentation d’un monde sans contrôle. Mais tous les écrivains savent que ce n’est qu’une feinte.
Estimez-vous que votre œuvre est devenue plus sombre au fil du temps : je pense à l’empreinte de la mort dans Petit Casino ou à la tonalité nostalgique des dernières pages de The Moon in Its Flight, par contraste avec la veine comique et exubérante de Salmigondis ou de Blue Pastoral ? Faut-il y lire un pessimisme grandissant ?
Je ne crois pas. Je pense que mon œuvre a toujours été sombre et pessimiste. Comment, sinon, qualifier Le Ciel change et Steelwork ? Et je crois que Salmigondis, malgré sa dimension comique, est fondamentalement « l’histoire » d’un écrivaillon de troisième ordre qui perd la raison à force de se faire des illusions sur son talent. The Moon in Its Flight, une histoire des années soixante-dix, est certainement sombre. Peut-être qu’en vieillissant je suis plus résigné au mystère du pilonnage de la vie.
Quelle place donnez-vous au recueil The Moon in Its Flight ? Est-ce une sorte de regard rétrospectif sur toute une carrière ?
Non, je ne crois pas, car j’écris encore et j’ai écrit d’autres nouvelles depuis sa publication, et j’ai aussi terminé un nouveau roman, et je travaille à un autre. Je crois que le « regard rétrospectif », c’est une idée du lecteur. Les écrivains, du moins ceux que je connais, regardent rarement en arrière parce que, une fois le travail terminé, cela devient profondément ennuyeux d’y repenser. Le livre (le récit ou le poème) en cours d’écriture est toujours plus intéressant.
Il semble que vous ayez cessé d’écrire de la poésie ces vingt dernières années. Est-ce dû à la recherche d’un nouveau langage de la fiction, capable de passer outre les barrières des genres ?
J’écris des poèmes occasionnellement, mais après m’être appliqué, pendant tant d’années, aux problèmes que pose la fiction, écrire un poème exige une sorte de préparation, un autre « état d’esprit », si vous voulez, et écrire un poème me fait tout drôle, comme si je n’en n’avais jamais écrit auparavant. Quant à « passer outre les barrières des genres », je crois que c’est possible en poésie aussi bien qu’en prose. La raison pour laquelle je me suis tourné vers la prose est assez simple : il y avait des choses que je voulais faire, du point de vue formel, et qu’il était plus facile de faire en prose, ou, sinon plus facilement, du moins avec plus d’effet. Mais je n’ai pas l’impression d’avoir abandonné la poésie. Bien sûr, il m’arrive de me demander s’il y a dix personnes sur dix mille qui savent lire la poésie, ou qui font la différence entre Yeats et Bob Dylan – et les autres s’en fichent.
L’image du ruban de Möbius conviendrait-elle pour décrire votre œuvre ? Est-ce qu’elle pourrait rendre compte avec justesse de ses retours, révisions, distorsions ?
Pourquoi pas.
Pourriez-vous expliquer la place de l’érotisme dans vos romans, au-delà de sa signification thématique, comme de dénoncer la pression religieuse par exemple ?
L’érotisme est présent dans mon œuvre pour plusieurs raisons – pour montrer l’amour, l’appétit sexuel, la faiblesse, la stupidité, le sacrifice, le pouvoir, etc. Je l’utilise aussi comme niveleur, d’une certaine façon, une manière détournée de dire, sans dire, que nous sommes tous les mêmes dans l’acte sexuel. Je me rappelle que quand j’étais enfant, nous regardions ce que nous appelions alors des « bibles de Tijuana » : c’était des petits livres de huit pages, avec pour « vedettes », pour la plupart, des personnages de bandes dessinées dans des aventures pornos. Mais parfois l’artiste (si l’on veut) qui créait ces livres avait l’idée de représenter des stars de cinéma ou des gens connus, de l’actualité, de la politique, ou d’autres domaines, dans des situations de frénésie charnelle. Pour moi, à douze ans, c’était une révélation de voir que des personnes réelles – des vraies – faisaient cela ! Je ne crois pas que je me le formulais comme cela, mais c’était là, dans ma tête. C’est curieux, mais je crois que j’utilise l’érotisme de cette façon-là : Tiens ! Mais c’est ta vieille instit., au lit avec – qui ça peut bien être ? – ma parole, c’est Donald Rumsfeld ! L’érotisme, pour insister sur notre humanité commune : tous complices dans le sexe.
Que pensez-vous du rapport qu’entretient le langage avec la réalité et le monde ? La déviation, dans le langage, est-elle un phénomène strictement linguistique avec lequel jouer ? Ou est-ce une affaire de perception ? Ou bien le monde ne serait-il qu’un chaos dont seul un langage chaotique peut rendre compte ?
Je suis d’accord avec l’idée que le langage ne peut pas véritablement représenter la réalité, mais dans la mesure où c’est tout ce dont disposent les écrivains, c’est la seule chose qu’ils peuvent utiliser. Tous les écrivains connaissent les étranges transformations qui se produisent, au cours de l’acte d’écriture, quand on est en train d’essayer, consciencieusement, de dire quelque chose qui soit aussi honnête que possible : presque immédiatement, l’écriture commence à dériver, à s’éloigner de la description objective, et à devenir elle-même. Et puis l’écrivain doit travailler sur la réalité de la matière écrite, et plus il la travaille, plus il s’éloigne de ce qu’il croyait vouloir dire. La « trilogie parisienne » de Beckett est une base pour toute réflexion sur la relation de l’écrivain au réel.
Pour rebondir sur le même sujet, que pensez-vous de ce que dit Wallace Stevens sur l’exactitude en littérature, qui serait « exactitude par rapport à la structure de la réalité » ?
Je suis d’accord avec Wallace Stevens, et sa remarque me fait penser au propos de William Carlos Williams qui dit que parfois, on est attiré par un vers en poésie, à cause de ce qu’il dit. Il écrit ceci : « Qu’est-ce que cela peut faire, ce que dit le vers ? » Si Hamlet est une grande pièce, c’est parce que le personnage, et ceux qui lui donnent la réplique, brillent dans le langage de Shakespeare, et sûrement pas parce que nous sommes fascinés par un homme incapable de prendre une décision. Ce qui nous fascine, c’est que l’incapacité d’un homme à prendre une décision soit rendue dans une forme linguistique sublime.
Vous avez souvent recours à des notions scientifiques, d’astronomie ou d’optique. Mes connaissances scientifiques sont limitées, mais, puis-je me risquer à comparer votre écriture, dans son processus, à la théorie de la lumière de DeBroglie, et dire que les mots jouent le rôle des photons dans la propagation de la phrase, comme des particules en mouvement qui concentrent toute l’énergie ?
Je n’ai aucune idée de ce qu’est la théorie de DeBroglie. Tous les mots, si c’est possible, devraient avoir l’énergie de la phrase entière. Hemingway est celui qui parvient le mieux à écrire comme cela – et c’est pourquoi Pierre, Paul et Jacques peuvent se servir de ses mots simples et ne produire que du tapioca. Hemingway comprend l’énergie que contient un seul mot. Moi aussi, j’essaie de faire des phrases qui permettent aux mots d’être plus que des éléments qui « racontent une histoire » ou qui font accéder à la partie « littéraire » de la phrase ou du paragraphe – la métaphore, le symbole, ou la comparaison tape-à-l’œil, ou la combinaison de prédicats, pour citer Barthes.
Dans un précédent entretien, vous mentionniez votre intérêt pour l’Oulipo. J’ai été tentée de dire que vous partagiez l’opinion de Calvino sur la littérature, selon laquelle elle ne serait qu’une série de transformations et de permutations infinies, à partir d’un nombre fini d’éléments et de fonctions. Est-ce que je me trompe ? Comment situez-vous votre pratique littéraire par rapport à celles de Harry Mathews, Queneau ou Georges Perec ? Par exemple, y a-t-il, comme dans l’œuvre de Perec, une clef biographique dans les motifs récurrents que vous utilisez ?
J’ai utilisé des procédés oulipiens dans une grande partie de mon œuvre, et je me suis intéressé aux contraintes formelles, quelles qu’elles soient, bien avant d’entendre parler de l’Oulipo. Oui, je crois comme Calvino que la littérature est fondamentalement une série de changements infinis – si on veut – à partir d’un petit nombre d’éléments. L’Oulipo donne accès à bon nombre de ces changements, mais il n’est pas nécessaire de les effectuer ou de le découvrir, au demeurant. Je ne pense pas que je sois un adepte des pratiques oulipiennes comme le sont Perec et Mathews. J’utilise souvent des procédés semi-oulipiens, ou alors, si j’utilise des procédés oulipiens pour accéder à une construction particulière, je change ou dilue le procédé à ma convenance. Il faut bien dire, évidemment, que Mathews et Perec eux aussi utilisent des procédés semi-oulipiens. Ce que je veux dire, je crois, c’est que les contraintes, c’est très bien, tant qu’elles produisent quelque chose qui est ou qui peut être de la littérature. Sinon, ce ne sont que des procédés ratés. Il n’y a pas de clef biographique dans les motifs récurrents de mon œuvre, et pourtant un lecteur attentif ou un chercheur scrupuleux n’auront aucun mal à les trouver, j’en suis sûr.
Plusieurs des livres de Gilbert Sorrentino ont été traduits en France et édités par les Éditions Cent Pages.
1 note
·
View note
Text
UNE CAGE DANS L'ARÈNE, par Nicolas Tellop
Quand nous avons croisé Nicolas récemment, il nous avoua être arrivé au bout d'un cycle. Après Franquin, Corto Maltese, Snoopy, Salvadori, Fleischer, Vonnegut Jr. et bien d'autres auxquels il avait dédié de nombreux essais, tous passionnés, érudits et sensibles, l'homme ressentait de plus en plus une fringale de fiction, une carence d'invention pure. Tous ces artistes qu'il avait côtoyés lui avaient donné faim ! Nous sentions une imagination mûrie de longue lutte tapie derrière cette volonté d'émancipation, prête à bondir, toutes griffes dehors. Quelques jours plus tard nous arrivait par mail ce texte au titre gigogne, accompagné d'une illustration rugissante signée Frederik Peeters. La messe était dite, et le repas servi.

Pour Xavier Mauméjean
César, le prisonnier, ne réagit pas à l’arrivée des visiteurs. Parmi eux, il reconnaît un de ses geôliers, le vieux Anfons, qui s’assied parfois de l’autre côté des barreaux pour lui parler. Il lui raconte sa vie tant aimée de pêcheur, son arthrose qui l’a contraint à rester à terre, son entrée au service de M. Ramband, dans la prison de César. Anfons prétend que César et lui sont deux déracinés. Alors le vieux radoteur le plaint autant qu’il se plaint lui-même, et parfois il verse une larme avant de quitter les lieux en silence.
De son côté, César ne dit jamais rien. Il se contente de regarder le vieux Anfons avec des yeux de glace. Il est alors au summum de sa sociabilité. Le reste du temps, César pose sur les autres gardiens un regard débordant de haine et de sauvagerie. Et quand il fait les cent pas dans sa cellule, il laisse entrevoir l’étendue de sa puissance et de son agressivité, heureusement contenues derrière les barreaux d’acier. Ces hommes sont la raison pour laquelle il a perdu sa liberté à jamais, il en est persuadé. S’il en avait l’occasion, César les tuerait, et ne ferait pas d’exception pour Anfons. Mais pour l’heure, il reste allongé et observe ses visiteurs approcher.
— Voici donc notre César ! s’exclame fièrement un homme plutôt gras, pour tout dire assez appétissant.
— Ainsi donc, M. Ramband, vous me garantissez sa férocité ? demande un petit homme en chapeau melon dont la silhouette évoque une épingle à nourrice.
— Vous ne trouverez nulle part ailleurs brute plus sanguinaire que notre César !
Le petit homme à tête d’épingle toise César comme si c’était une crotte sur le trottoir.
— Une montagne de muscles et un cerveau d’une intelligence suprême, entièrement dédié à la violence et au meurtre, poursuit M. Ramband, qui connaît son métier.
— Intelligence suprême… rétorque le petit homme. Il s’est quand même laissé capturer !
M. Ramband se penche vers son interlocuteur, qu’il menace d’écraser de sa panse respectable. Ses yeux brillent de malice, son sourire s’étire avec gourmandise. S’il dégustait un grand vin, il ne rayonnerait pas moins.
— C’est le vice incarné, mon bon monsieur. Le jour où on lui a mis la main dessus, trois hommes sont morts. Et un quatrième ne mange plus qu’à l’aide d’une paille.
— Mon client exige une créature sanguinaire, renchérit le petit homme qui tente de prendre ses distances avec la bedaine de M. Ramband. Une machine à tuer.
— C’est notre César tout craché ! Si on lui ouvrait la porte de sa prison, il ferait un massacre dont nous ne serions que les premières victimes !
En disant cela, M. Ramband affiche une béatitude digne d’un menu de fête. Le petit homme s’approche des barreaux et fixe sur le prisonnier un regard las. Soudain, à l’aide de sa canne, il frappe un grand coup sur l’acier. César se redresse brusquement, pointe des yeux furieux sur son persécuteur et ouvre grand une gueule aux crocs acérés, comme autant de poignards en ivoire. Son rugissement est tel que chiens, chats, rats et oiseaux, présents à un kilomètre à la ronde, s’enfuient sans demander leur reste. Le petit homme a, quant à lui, reculé d’un pas.
— Pouvez-vous le livrer à San Sebastían pour le mois prochain ? demande-t-il.
— C’est comme si c’était fait, mon cher monsieur, répond M. Ramband, radieux, alors qu’il réajuste son postiche sur son crâne.
Avec un feulement sourd, César observe ses visiteurs, la gueule encore à moitié ouverte. Alors qu’il s’éloigne avec les deux hommes, le vieux Anfons sourit au tigre et lui fait signe de se calmer. César le tuerait comme les autres, oui, il le tuerait, s’il le pouvait.
***
José Elósegui n’apprécie rien tant que d’emprunter le tramway d’Aimara, qu’il a inauguré l’année précédente. C’est la principale raison pour laquelle il donne rendez-vous, le plus souvent possible, à l’extérieur de l’hôtel de ville. Après avoir remonté une partie du Boulevard, il grimpe à l’intérieur de son tramway avec souplesse et élégance, et inspecte du regard l’ensemble de la voiture. Chaque fois que le conducteur fait retentir sa cloche, le maire de San Sebastían soupire. Il aimerait tant actionner lui-même tous les mécanismes de cette merveilleuse machine, particulièrement la cloche d’avertissement qui résonne pour lui comme une injonction au rêve. S’il le demandait, le conducteur serait ravi de le laisser faire ce « ding-ding » envoutant, mais José n’ose pas. Peut-être qu’à la fin de son mandat, il s’autorisera ce petit plaisir.
Quelques minutes après, ding-ding, José arrive déjà à destination. Il quitte à regret le tramway pour remonter l’Avenida de la Libertad jusqu’au numéro 11, au Royalty, où il a réservé un salon privé. L’y attendent quelques amis, des conseillers municipaux, et le directeur de la Plaza del Chofre.
Ce dernier a pour projet d’organiser l’événement de la saison estivale. Il en parle depuis des mois, mais n’a encore rien révélé. Aujourd’hui, le directeur a une annonce à faire ; cette idée prédispose José à un mélange de rêverie et d’inquiétude.
San Sebastían projette dans toute l’Europe l’image du luxe balnéaire. La ville est d’autant plus à la mode qu’elle est la résidence d’été de la famille royale espagnole et la destination de villégiature du tout Madrid. Sans parler des Basques français, nombreux à traverser la frontière. Selon José, l’explication tient en trois mots : « tourisme de plage ». Mais le directeur de la Plaza del Chofre, la grande arène néo-mudéjar qui concurrence désormais celle d’Atocha, n’est pas de cet avis. Il ne se baigne jamais dans l’eau de mer, qu’il trouve trop froide.
— Mes chers amis ! commence le directeur d’El Chofre, la moustache frétillante. Il était temps que je puisse partager avec vous la nouvelle qui va marquer San Sebastían à jamais !
Il se tait un instant et observe le salon, pour mesurer son effet.
— Mes chers amis, poursuit-il, je vais organiser une corrida comme le Guipúzcoa n’en a jamais vu ! Une corrida qui va opposer un taureau…
Il s’interrompt pour balayer de nouveau l’assemblée du regard tout en lustrant les extrémités de sa moustache.
— … à un tigre !
José se redresse sur sa chaise.
— Un tigre ? s’exclame-t-il, tandis que chacun commente l’annonce avec son voisin.
— Un tigre, mon bon Elósegui ! J’en rêve depuis si longtemps ! Mon père me racontait souvent avec émotion ce jour du 12 mai 1849 où il a eu la chance d’assister à Madrid à l’affrontement entre un taureau et un tigre. J’ai toujours nourri le désir secret d’organiser un jour, à mon tour, pareil combat. Eh bien je peux vous dire que ce sera chose faite, ce dimanche 24 juillet !
— Alors que la saison estivale battra son plein, l’interrompt José.
— Quel meilleur moment ? interroge le directeur de la Plaza, visiblement blessé. Pour faire sensation, c’est ce que l’on appelle une occasion en or !
— À supposer qu’un tel numéro soit du goût des estivants. Vous n’ignorez pas leur raffinement…
— Mais, mon bon Elósegui, on parle d’un spectacle de rois ! Du divertissement préféré de Felipe II !
— Où donc allez-vous nous dénicher un tigre ? intervient un des conseillers de José, railleur.
— Mais je l’ai trouvé ! Il est en route en ce moment même !
La révélation provoque un brouhaha assourdissant. Certains répercutent leur enthousiasme, d’autres évoquent des analogies avec les jeux du cirque de la Rome antique. José aimerait prendre congé. Dans sa tête, il entend un son familier. Ding-ding. Tout le monde descend. Mais, résolu à faire face à ses responsabilités, le maire demeure d’apparence plus maître de soi que jamais.
— Ainsi, vous avez tout prévu ?
— Mais oui, mon bon Elósegui ! Deux des meilleurs ingénieurs de la province, les señores Sarasola et Carrasco, sont en train de mettre la dernière main à une cage de vingt mètres de diamètre, aux barreaux forgés dans un acier spécial, plus robuste encore que celui des jardins zoologiques. C’est dans cette enceinte qu’aura lieu le combat entre les deux titans. Vous voyez, mon bon Elósegui, tout a été pensé dans les moindres détails !
— Je suppose que oui… Mais vous auriez pu m’en parler plus tôt.
— À quoi bon ! s’exclame le directeur. Je n’avais pas encore de tigre !
Dans le même temps, un des intimes de José, un vieux dandy du nom d’Enrique, se penche vers lui avec sollicitude.
– Estimez-vous heureux, mon cher, que le père de notre bon ami n’ait pas assisté au combat qui a eu lieu à Madrid, il y a six ans, entre un taureau et un éléphant.
***
Hurón rumine à la fois d’énormes bouchées de roseaux et de salicornes, et la façon dont il pourrait empaler son maître, le riche éleveur Antonio López Plata. Souvent, comme aujourd’hui, le fringant Andalou vient chevaucher son fier Cartujano blanc dans ce morceau marécageux du Guadalquivir, sur lequel règne Hurón, avec pour seul étendard son pelage negro azabache, presque violet. Sous le soleil, le corps de la bête brille, et c’est comme si l’obscurité s’avérait capable, à son tour, d’éblouir.
Parfois, lorsque sa mauvaise humeur culmine, le taureau charge dès que le cavalier s’approche. Mais ce jour-là, Hurón se contente de le fusiller du regard. Son cœur de brute s’emballe à l’idée qu’il pourrait faire coup double en éventrant aussi le canasson. Hurón secoue son cou puissant, faisant danser ses cornes au-dessus de lui. De loin, Antonio croit voir la mort lui adresser un sourire cruel. Il arrête son cheval, Dominó, qui pousse un hennissement de soulagement.
– Hurón ! crie Antonio. Je suis venu te dire que tu allais affronter un adversaire à ta mesure ! Tu pars demain, pour le nord ! J’espère que tu me feras honneur… Et je ne doute pas que tu y prendras du plaisir.
Sur ses mots, il fait accomplir un demi-tour à Dominó, et tous deux s’éloignent au galop, bientôt invisibles aux yeux du taureau. Le regard de Hurón reste braqué dans la direction qu’ils ont prise. Il continue de ruminer.
***
« Demain, le spectacle prodigieux, captivant et tant attendu du combat entre le tigre et le taureau aura lieu dans les arènes ! », articule Rafaël Hidalgo, d’une voix plus forte que nécessaire, et non moins hésitante. C’est à l’attention de son petit frère, Guillermo, qu’il lit l’article paru dans El Correo le jour-même. Tous deux attendent leur tour pour accéder aux corrals d’El Chofre, où ils vont pouvoir admirer la vedette du moment : César. Guillermo et Rafaël n’ont encore jamais vu de tigre.
Rafaël poursuit la lecture de l’article qui annonce l’événement. Le taureau Hurón est âgé de cinq ans. Il pèse une demie-tonne, soient quarante-quatre arrobas. Il dispose d’une carrure imposante et d’une paire de cornes propre à en faire un adversaire sérieux, y compris pour un tigre. Le journaliste prétend ne pas avoir pu soutenir le regard noir de la bête.
— Ça existe, demande Guillermo, un taureau qui a pas le regard noir ?
— T’occupe, lui répond son frère. C’est écrit par un écrivain. Un écrivain, il faut que ça fasse des mots qui sonnent bien à l’oreille, même si ça dit pas grand-chose.
Tandis qu’ils pénètrent dans les corrals, Rafaël continue sa lecture sous le regard attentif de Guillermo. César a été capturé en Afrique. Il pèse deux cents kilos de muscles et a été vendu sept mille francs par un marchand de bêtes marseillais. Depuis quelques jours, le tigre est exhibé à la curiosité des habitants de San Sebastían. Guillermo fait une moue dubitative.
— Le maître, il dit que les tigres, ça ne vient pas d’Afrique, mais du Bengale. C’est pour ça qu’on dit que ce sont des tigres du Bengale.
— Qu’est-ce qu’il en sait, le maître ? réplique Rafaël. Il a déjà été au Bengale ? Il a déjà été en Afrique ? Je suis sûr qu’il a même jamais été jusqu’à Madrid. Et d’abord, qu’est-ce qui te dit que le Bengale, c’est pas en Afrique ?
— C’est à côté de l’Inde.
— Écoute Guillermo, tu crois qui tu veux, le maître ou l’écrivain. Mais tu réfléchis trop, ça c’est pas peut-être.
C’est vrai que Guillermo réfléchit beaucoup. Sous la tignasse noire et frisée, son cerveau turbine. Il veut toujours tout savoir, mais aussi tout voir. Ses grands yeux marron luisent d’un appétit d’ogre. Et lorsque la réalité échoue à le rassasier, il se repaît d’imaginaire.
Enfin, les deux frères arrivent devant la cage au tigre. Nerveux à cause du nombre des estivants venus s’offrir un frisson, César ne cesse de tourner entre les barreaux. Parfois, il retrousse les babines et émet un son rocailleux qui n’a pas grand-chose à voir avec une formule de bienvenue. L’espace d’un instant, César plonge ses yeux froids comme l’acier de sa cage dans ceux de Guillermo, tandis que Rafaël entraîne déjà ce dernier pour laisser leur place aux visiteurs suivants. Le petit garçon ne pensait pas que c’était si gros et si grand, un tigre du Bengale. César le regarde s’éloigner. S’il le pouvait, il tuerait ce petit garçon, ainsi que tous les hommes et femmes qui défilent de l’autre côté, celui de la liberté.
— Dis Rafaël, pourquoi on fait se battre un taureau et un tigre ?
— Et pourquoi pas ?
— Dans la réalité, ils se seraient jamais rencontrés.
— Tu réfléchis trop, Guillermo.
C’est bien là son seul défaut.
***
Quand on fait entrer César au centre du ruedo, il reste interdit quelques secondes. Mais rapidement, il aperçoit les barreaux qui cernent son environnement. Encore une cage. Elle est juste plus grande que les précédentes. Alors qu’il longe le périmètre dans le maigre espoir de trouver une issue, il découvre de l’autre côté plus d’hommes qu’il n’en a jamais vus jusque-là. Si César savait compter et s’il en avait le temps, il s’apercevrait que l’arène aux dix-mille places est pleine à craquer. Et si toutefois la distinction avait un sens pour lui, il pourrait encore remarquer que la haute-société est bien représentée dans les gradins, et que le peuple est lui aussi venu en nombre. Hommes, femmes et enfants ont le regard rivé sur lui, et parmi eux, celui de Guillermo plus que tout autre. José Elósegui, lui, pense avec une certaine nostalgie au trajet qu’il a fait en tramway pour venir à El Chofre.
Il est 19 heures. Les deux précédentes corridas sont quasiment passées inaperçues. Le public retient son souffle pour le combat à mort entre César et Hurón. Les parieurs locaux placent tous leurs espoirs sur le taureau, tandis que les Français plébiscitent le tigre.
Soudain, César entend le bruit caractéristique d’une porte en acier qui se referme. Il fait volte-face et aperçoit un monstre énorme au regard mauvais, noir comme la nuit, la tête surmontée de ce qui ressemble à une paire de crocs démesurés. L’esprit vif et pratique du félin tire la seule conclusion qui s’impose : il est foutu.
Mais pour l’instant, aucun des deux animaux ne bouge. Tout se joue dans le regard de chacun, celui des spectateurs surexcités, celui des deux bestiaux qui se toisent. Il est manifeste que, si personne n’agit, César et Hurón ne se battront pas. Le directeur de la Plaza fait signe à ses hommes d’aller donner un coup de pouce aux deux mastodontes. Pétards et cailloux se mettent à pleuvoir dans la cage. Il n’en faut pas davantage à Hurón pour se précipiter sur son adversaire, le seul être vivant à portée de corne sur lequel passer sa rage. César bondit sur le côté et se met à courir autour du taureau. Effrayé par un pétard qui explose à ses moustaches, le tigre désorienté vire trop brutalement et se retrouve à la merci de Hurón. Mufle écumant de bave, le cruel animal en profite pour essayer de l’éventrer mais ne parvient qu’à le secouer comme un prunier. Après avoir été projeté en l’air, César s’écrase lourdement au sol où il est piétiné par le monstre cornu. Tout en grondant, le fauve taillade de ses griffes les pattes de son ennemi et mord un jarret jusqu’à l’os, les crocs labourant fiévreusement la chair. Outré, Hurón s’écarte de sa victime en laissant dans son sillage une trainée de sang. Avant de battre en retraite à son tour, César griffe profondément le géant de nuit à la tête. Blessé au flanc, il se recroqueville contre les barreaux. La créature qui s’oppose à lui est aussi forte qu’elle en a l’air. La seule chance qu’il a de s’en sortir est de garder ses distances.
Hurón considère avec étonnement l’adversaire qui lui fait face. Il a beau lui arriver à hauteur du poitrail, le combattant n’en offre pas moins une résistance remarquable. Qu’est-ce que c’est, d’ailleurs ? Aucune importance, la fureur du taureau le submerge. Sa rage est incommensurable, au point qu’il ne sent pas encore ses blessures. Hurón meugle en creusant le sable de ses sabots rageurs.
Devant un tigre qui fait le mort et un taureau qui semble ne pas vouloir l’achever, le public proteste. Il en veut pour son argent, le tumulte s’amplifie. Le président d’El Chofre se demande s’il en a été de même à Madrid le 12 mai 1849. Sur son ordre, des hommes s’attaquent à César, le plus accessible des deux combattants. À travers les barreaux, ils le rouent de coups de matraques et le piquent avec des lances. Quelques pétards éclatent, César rugit, réussit à saisir un gourdin qu’il broie dans sa gueule, puis arrache d’un coup de patte une lance des mains d’un assaillant.
Alors que le tigre s’écarte des barreaux, Hurón lui fonce dessus comme un canon qui serait parti en même temps que le boulet. Paniqué, César pousse un rugissement terrible. Une de ses pattes s’est brisée sous les sabots du taureau. Dans la violence de son attaque, le noir animal a ramené le tigre vers le bord de la cage, laissant l’empreinte de ses coups de boutoir sur plusieurs barreaux. Dans un suprême élan de férocité, César saute au cou de Hurón et y plante crocs et griffes, entaillant profondément le cuir sombre. Les yeux fous, le taureau parvient non sans mal à projeter son assaillant sur l’une des portes de la cage et le charge. De justesse, le tigre s’écarte, Hurón heurte la porte et la défonce entièrement.
Le combat s’arrête. Les deux animaux ont trouvé intérêt plus pressant : leur liberté.
Un vent de panique souffle sur l’arène. Tout le monde comprend que, si les barreras suffisent à protéger le public des assauts d’un taureau, ils n’offrent en l’occurrence qu’un piètre obstacle. Le tigre s’y dirige déjà et, dans un instant, aura franchi le callejón. Les miquelets chargés d’assurer la sécurité du spectacle épaulent leur fusils Mauser. Ils font feu sur les bêtes. Dans le public, gagné par une hystérie sans pareille, plusieurs dizaines d’hommes armés dégainent leur pistolet et se joignent à la fusillade. Durant plusieurs minutes, le chaos est total. Les balles fusent dans tous les sens, ricochent sur les barreaux d’acier ainsi que sur le sable pour finir par atteindre plusieurs spectateurs. Non loin de lui, Guillermo voit avec effroi un homme traversé par un projectile au flanc et s’effondrer en crachant beaucoup de sang. Plus tard, il apprendra son nom : un certain Jean-Pierre, directeur d’une usine de bougies d’allumage de la région.
De son côté, José Elósegui tente de faire sortir ceux qui l’entourent hors de l’arène. Le comte Julio Urquijo, député conservateur de Tolosa et homme de lettres, est atteint au poignet, tandis que le marquis de Pidal est blessé au visage. À l’autre bout des gradins, un Américain du nom de Livingstone reçoit une balle dans l’épaule et tombe à la renverse sur une Donostienne qui deviendra l’année suivante sa femme. À son tour, Guillermo est touché à la tête. Le petit garçon perd connaissance.
***
« Pauvres de ceux qui sont partis se détendre et se sont retrouvés fusillés ! », articule Rafaël, d’une voix plus forte que nécessaire, mais non moins hésitante. Il lit des extraits d’El Correo du 26 juillet pour son petit frère, encore alité à la Maison de Secours de la ville. La balle a effleuré le crâne de Guillermo qui est resté de longues heures inconscient. « Nous sommes allés à une fête et nous sommes revenus d'un enterrement », poursuit Rafaël, alors qu’une infirmière s’approche de Guillermo pour prendre sa température. Une liste de victimes est donnée et le petit garçon a l’honneur d’être cité. Selon Rafaël, ça valait le coup d’être touché. Au sein de la vingtaine de victimes, un homme d’affaire, Juan Pedro Lizarriturry y Nogués, a trouvé la mort ce soir-là, frappé au ventre. Il vient alourdir un bilan qui compte deux autres décès.
L’agonie de César, dont la pauvre carcasse ne ressemblait plus qu’à une passoire, a été abrégée par un spectateur descendu dans le ruedo pour lui tirer une balle dans la tête. Le fauve a connu la faveur de mourir libre. Hurón n’a été mis à mort que le lendemain matin. Il ne tenait déjà plus debout, mais restait de fort mauvaise humeur.
— Vous croyez qu’ils ont beaucoup souffert ? demande le petit garçon à l’infirmière, qui lui paraît être une personne compétente en la matière.
— Qui ça ? répond la jeune femme occupée à lire le thermomètre.
— Le monsieur, et puis le tigre et le taureau.
L’infirmière sourit à Rafaël et lui caresse la joue.
— Ne pense pas à ça, lui dit-elle. Tu réfléchis trop.
— Tu vois, chuchote Rafaël alors que la jeune femme s’occupe d’un autre patient, c’est ce que je te répète tout le temps.
Et c’est vrai, mais c’est plus agréable quand c’est l’infirmière qui le dit.
***
Mélancolique, José Elósegui regarde par la fenêtre de son bureau. Le maire n’a pas dormi depuis la catastrophe. Les journaux rejettent la faute sur les autorités locales, c’est-à-dire lui. Pas un mot sur le directeur de la Plaza del Chofre. Comment s’appelle-t-il, déjà, celui-là ? Jamais moyen de s’en souvenir. Il lui avait remis un rapport rédigé par ses deux ingénieurs. Tout va pour le mieux, mon bon Elósegui. Tu parles, il n’aurait pas dû l’écouter. Le rapport mentionnait un point faible dans la construction de la cage : les portes. Le directeur machin-truc n’y avait pas prêté attention, parce que, selon lui, on n’a jamais vu un tigre ou un taureau ouvrir une porte ! José soupire. C’est décidé, il démissionne. Depuis la fenêtre, il écoute les vagues qui viennent mourir sur la Concha. Elles amènent avec elles un autre bruit, plus discret.
Ding-ding.
0 notes