Text
Uncle Vanya - Theater Play
Photographer

Uncle Vanya / ワーニャ伯父さん
Japan-Vietnam Contemporary Theater Joint Project Vietnam Internation Theater Festival 2019 (日本・ベトナム現代演劇共同プロジェクトベトナム国際演劇祭2019)
Direction (演出) : SUGIYAMA Tsuyoshi (杉山剛志)

















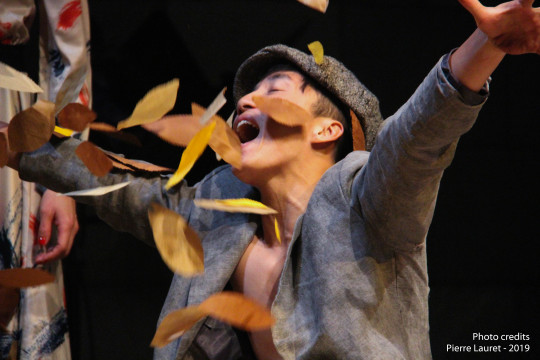









0 notes
Text
« お月さまのうた » video
Director, camera operator, video editor

Takahashi Norie (高橋のりえ) - 「お月さまのうた」
Street performance in Shibuya (渋谷) - 2018-11-21
Directed, filmed and edited by : Pierre LAURET
Music : “お月さまのうた” by Norie TAKAHASHI, from the album “眠りにつく前に”
youtube
TAKAHASHI Norie (高橋のりえ)
Twitter : https://twitter.com/_ntooo
Instagram : https://www.instagram.com/_ntooo/
0 notes
Text
« Terrific Tips » MV
Video editor, sound

Staircase Paradox - Terrific Tips MV
Starring : Maiya GOSHIMA
Directed and filmed by : Maxime LAURET
Sound and Editing : Pierre LAURET
Mixing : Nicolas DEFEUDIS
Production : Kernel Panic Records & oh no!
Special thanks : Constant Voisin
Music : “Terrific Tips” by Staircase Paradox, from the EP “Landmines Have Feelings Too”
youtube
Staircase Paradox
Facebook : https://www.facebook.com/spdxmusic/
Website : http://www.staircaseparadox.com
0 notes
Text
void void
Director
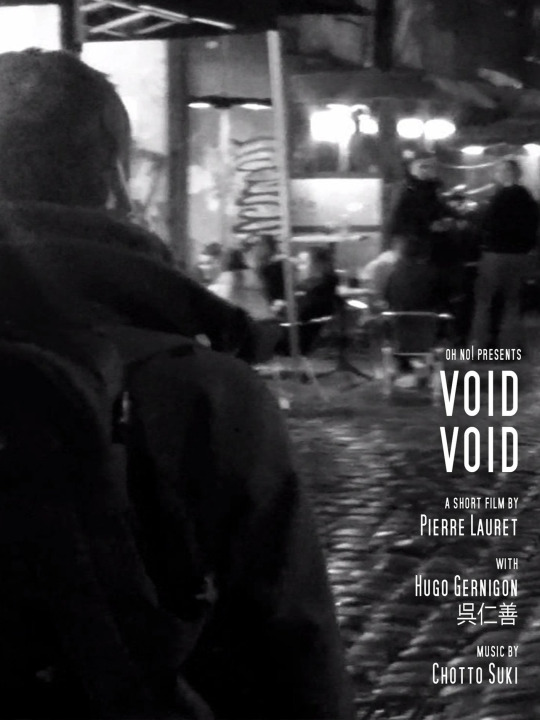
Written and directed by : Pierre LAURET
With : Hugo GERNIGON, 呉仁善
Produced by : Oh No!
Mix by : Nicolas DEFEUDIS
Music by : Chotto Suki
Special thanks to : Maxime LAURET, Zoé ROGEZ, Thomas MENARD
youtube
0 notes
Text
Interview : MIYAZAKI Daisuke
Interviewer, writer

MIYAZAKI Daisuke : « Parler des faibles et des minorités est un des sujets les plus importants de l’art. »
Au hasard d’une petite salle de cinéma situé dans le quartier de Shibuya à Tokyo – le Uplink – le réalisateur MIYAZAKI Daisuke présentait l’un de ses derniers long-métrages, Yamato (California). Porté par l’actrice KAN Hanae (The Chrysanthemum and the Guillotine, Love and Other Cults, Nobody Knows), le film traite de nombreux sujets de société pour le moins tabous au Japon, tels que la situation sociale des métisses, la précarité de certaines populations dans l’archipel ou encore les bases états-uniennes.
Journal du Japon est allé à la rencontre du réalisateur pour échanger autour de son film mais aussi de la réalité sociale de la société japonaise et de la représentation cinématographique qu’il en existe.

Sakura vit avec sa mère et son frère à Yamato, près d’une base militaire états-unienne. Fascinée par la culture hip-hop, elle écrit des rimes dans son temps libre mais s’avère incapable de performer sur scène. Un jour, Rei, la fille du copain états-unien de la mère de Sakura, débarque à l’improviste à Yamato. Après une certaine méfiance, les deux jeunes filles commencent à se lier d’amitié.
Journal du Japon : Bonjour MIYAZAKI Daisuke. Votre film Yamato (California) aborde de multiples sujets tabous au Japon et peu usuels dans le panorama cinématographique de l’archipel. Quelles sont les origines de ce projet et pourquoi avoir décidé de parler de cela ?
MIYAZAKI Daisuke: Tout d’abord, je voulais tourner un film dans ma ville natale, Yamato. Parler de sa ville natale c’est un peu une tradition pour un artiste. Yamato est une ville de banlieue banale et ennuyeuse dans les environs de Tokyo qui est l’une des plus pauvres au Japon et où vivent ensemble de nombreuses ethnies différentes. Il n’y a rien de spécial ou de cinématographique, mais il y a cette base militaire états-unienne au centre. Il y a aussi le fait d’avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années lors de mon enfance. Je pense que tout cela a joué et influencé ce choix de thèmes.
L’une des autres thématiques principales est le monde de la musique, notamment le hip-hop. On peut retrouver par exemple le rappeur Norikiyo ou le groupe de rock GEZAN. Est-ce que les différents artistes apparaissant dans le film sont représentatifs de la scène musicale de Yamato ?
Norikiyo est un rappeur du groupe célèbre de hip-hop appelé SD JUNK STA qui représente la région de Sagami dans laquelle Yamato se situe. Lil’Yukichi, le beatmaker et rappeur qui a composé la musique du film, vient de Yokosuka qui est dans la même préfecture que Yamato (ndlr : Kanagawa). Yokosuka est notamment connue pour sa base navale géante que l’on peut voir dans Cochons et Cuirassés de IMAMURA Shohei. Quant à GEZAN, c’est un peu différent puisqu’ils viennent de Osaka.

Comment est-ce que les Japonais considèrent le hip-hop qui représente au Japon une contre-culture fortement influencée par les États-Unis ? Est-ce que, de la même manière, le cinéma états-unien vous a influencé dans votre conception du film ?
Encore beaucoup de monde considère le hip-hop comme de la musique de gangsters. Récemment cela a un peu changé pour devenir de plus en plus considéré par les jeunes générations comme une musique rebelle, un peu comme l’était le rock’n’roll avant. Sinon, je suis assez influencé par le cinéma états-unien, de ses débuts à aujourd’hui. Je pense que je peux affirmer sans exagérer que mon style de cinéma est à 80% issu du cinéma américain. Lorsque l’on est réalisateur il n’y a aucune manière d’éviter le cinéma français ou états-unien.
Les scènes où votre actrice principale, KAN Hanae, rappe constituent les points centraux de votre film. Comment avez-vous travaillé ces parties ?
Dans un premier temps, j’ai moi-même écrit les paroles. Ensuite, elle les a un peu modifiées pour que ça reflète un peu plus son personnage de Sakura, mais aussi sa vraie vie en tant que KAN Hanae, à savoir une métisse coréenne au Japon.
Les occidentaux ne connaissent que généralement très peu le racisme japonais envers les métisses, les zainichis (ndlr : Japonais d’ascendance coréenne), les burakumins (ndlr. Minorité la plus importante au Japon constituée de descendants des classes de parias à l’époque féodale), etc. Pourquoi pensez-vous qu’il est encore compliqué au Japon de parler ouvertement de ces sujets ou de faire de l’art dessus ?
La plupart de ces minorités viennent d’une structure sociale qui, comme dans les autres pays, était basée sur un langage « argent égale Dieu ». Et cela dure jusqu’à aujourd’hui à cause de la pression qui existe dans ce petit pays insulaire qu’est le Japon. Personnellement, je pense que cela ne fait pas vraiment sens et je ne ressens aucun tabou à parler de ces sujets. Dans l’histoire de l’humanité, tout le monde a souhaité pouvoir vivre ensemble, égaux et équitablement. Mais dans un monde post-postmoderne comme aujourd’hui, les gens ne souhaitent désormais que ce qu’ils sont d’ores-et-déjà. Ils protègent ce qu’ils ont déjà et ce qui leur est fondamental comme leur nationalité, leur classe sociale, leur couleur de peau, etc. Et ils usent aisément de la violence pour prouver cela. C’est regrettable et j’ai l’impression que l’humanité retourne à un stade proche de la scène d’ouverture de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley KUBRICK, bien qu’il nous reste de la compassion… nous restons humains.

Vous mentionniez précédemment le fait que KAN Hanae soit une métisse coréenne au Japon. Dans Yamato (California) bien que vous abordiez divers sujets de discrimination, vous n’abordez qu’une unique fois le racisme anti-coréen lors d’une courte scène où Sakura croise une manifestation nationaliste dans la rue. Pourquoi avoir décidé d’aborder que brièvement ce sujet et pourquoi avoir choisi KAN Hanae comme actrice principale ?
Je l’ai vraiment choisie un peu par coïncidence. À vrai dire, je ne suis pas réellement ce type d’artiste libéral qui se plaint fortement à propos de la politique dans son travail et qui ne crée qu’un sentiment de culpabilité chez son public. La politique se cache toujours dans et derrière nos vies de tous les jours. Je préfère donc montrer ces choses petit à petit et ensuite le public peut ramener ces sujets dans sa propre vie.
Le personnage de Sakura semble vivre dans une famille de classe moyenne inférieur qui ne peut pas se permettre énormément. On peut voir aussi que vous parlez aussi de l’attitude de certains Japonais avec les démunis et les sans domicile fixe. Quel est la situation de la pauvreté au Japon et quelle représentation le cinéma en fait-elle ?
L’écart entre les riches et les pauvres s’est réellement agrandi en une vingtaine d’années. Parmi les pays développés, le Japon se classe en deuxième place derrière les États-Unis en matière de différences entre les riches et les pauvres. La totalité de mon entourage et moi-même avons pu voir nos vies devenir drastiquement pauvres ces vingts dernières années. Il y aujourd’hui de nombreux enfants qui vivent dans des familles qui ne peuvent pas leur donner la chance d’aller à l’école primaire. Mais cet aspect n’est quasiment pas montré dans les médias et cette image de pays riche oriental que les pays occidentaux affectionnent reste encore assez forte.
KORE-EDA Hirokazu a gagné une Palme d’or au Festival de Cannes en 2018 pour Une Affaire de famille. Le film parle de la situation précaire de certaines familles japonaises mais ce prix à Cannes semble avoir été quelque peu occulté, comme si ce sujet était dérangeant et qu’il ne proposait pas une belle image du Japon. Est-ce que le gouvernement et les médias essayent en quelque sorte de cacher ces sujets ?
Je ne pense pas. C’est simplement que le cinéma d’art et essai s’est affaibli ces vingts dernières années et les gens ne s’intéressent plus autant au Festival de Cannes ou à la Berlinale dorénavant. Aussi, KORE-EDA montre dans ses films une fausse image orientale de notre pays au travers d’un point de vue de classe moyenne supérieure travaillant depuis une perspective de réalisateur de chaîne de télévision que les européens affectionnent peut-être, mais dans laquelle les les Japonais n’arrivent pas à se projeter. Le triste aspect c’est qu’il est le réalisateur le plus connu dans le monde occidental et qu’il réalise ses films selon ce que le public occidental veut voir au lieu de montrer ce qu’il se passe réellement au Japon. Dès lors, il existe un écart immense entre le succès d’un film et les réactions du public.

Ces dernières années, de jeunes cinéastes ont émergé avec des films abordant des sujets de société au Japon tels que l’homosexualité, la pauvreté, le féminisme, etc. Je pense par exemple Japanese Girls Never Die de MATSUI Daigo ou encore The End of Anthem de HIGASHI Kanae. Est-ce que quelque chose serait en train de changer avec une jeune génération et les artistes essayeraient de plus en plus de parler de ces sujets ?
Tout d’abord, je m’excuse je n’ai pas vu les deux films mentionnés. Cependant, ce que je peux dire c’est que parler des faibles et des minorités est un des sujets les plus importants de l’art. Par conséquent, peu importe si c’est un film commercial ou un film indépendant, si c’est faux ou si c’est vrai. On devrait continuer à montrer ces films et se référer à eux jusqu’à qu’ils deviennent un type d’expression trop « politiquement correct ».
Habituellement, on entend généralement parler de la base militaire d’Okinawa qui semble être la plus problématique au Japon. Pouvez-vous nous parler un plus de cette base de Yamato et avez-vous fait des demandes d’autorisations pour tourner là-bas ?
Comme je le disais, cette base est presque par coïncidence dans la ville où j’ai grandi et vécu. Néanmoins, c’est vrai que le gouvernement essaye plutôt que les gens restent concentrés sur les problèmes à Okinawa au lieu des bases situées autour de Tokyo pour éviter certaines tensions. Pour ce qui est des autorisations, même si j’obtenais des autorisations de tournage japonaises pour filmer dans les rues, les États-Unis n’autorisent pas les tournages à l’intérieur et autour de leurs bases. Par conséquent, j’ai eu des problèmes tous les jours avec la police locale et la police militaire états-unienne. On me disait généralement « votre tournage est parfaitement légal au Japon, mais la situation est compliquée ici donc s’il vous plaît partez ». Heureusement au final je n’ai pas été arrêté, je pense que je me débrouillais assez bien en jouant une sorte de jeu avec eux (rires). Après, il y a eu aussi le problème des avions états-uniens. Ceux que l’on peut entendre dans le film ont été ajouté en post-production. En réalité le bruit de ces avions est beaucoup plus fort et plus régulier. Du coup, on a eu pas mal de difficultés lorsque l’on enregistrait des dialogues sur le tournage.
Depuis Yamato (California) avez-vous travaillez sur d’autres projets ? L’industrie du cinéma a-t-elle changée à votre égard suite à ce film ? Il y a-t-il des conséquences sur votre carrière ?
J’ai terminé deux films depuis et je travaille sur différents autres projets. Par rapport à l’industrie du cinéma, en général trouver un producteur au Japon est toujours un peu compliqué surtout lorsqu’il s’agit de cinéma d’art et essai, mais il faut dire que ça devient de pire en pire. Il y a dix ans, l’industrie comprenait des films de gros, moyens et petits budgets. Il y a cinq ans, elle ne comprenait plus que des gros et petits budgets. Mais aujourd’hui, il ne reste que des gros budgets et des micros budgets. Je n’attend plus grand chose de la réalisation de films désormais. La réalisation a détruit ma vie mais j’ai juste l’espoir de pouvoir continuer à créer des films autant que possible. La caméra peut être un iPhone ou quoique ce soit et les acteurs pourront être mes amis. Mais j’espère juste être capable de créer quelque chose qui fait sens chez quelqu’un, qui fait ressentir à quelqu’un qui souffre que peut-être il y aura des meilleurs jours. Et bien sûr j’espère qu’un jour je pourrais montrer mes films en France !

Tout en espérant de notre côté aussi que MIYAZAKI Daisuke pourra un jour projeter ses films en France, nous tenons à le remercier pour son temps et son amabilité.
Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.
0 notes
Text
Le Miroir du 38ème parallèle
Writer
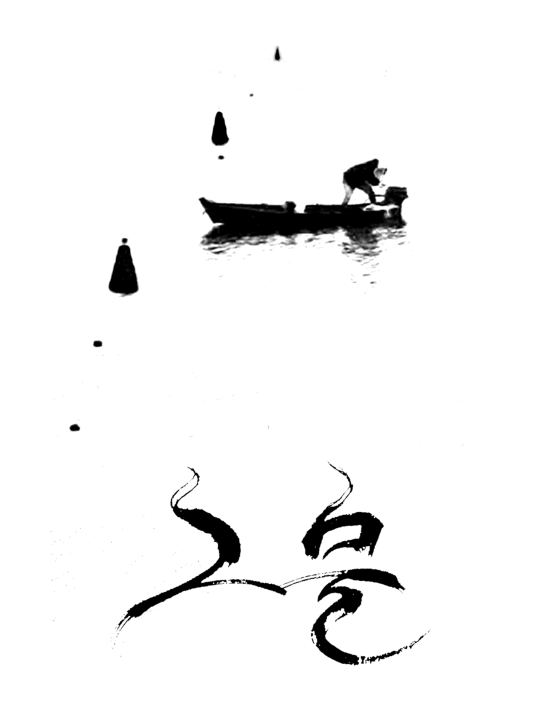
Le Miroir du 38ème parallèle
Au nord, en République Populaire de Corée, la lignée du mont Paeku assoit durablement son autorité, la doctrine du Juche1 et la politique de Songun2.
Au sud, en République de Corée, la démocratie a progressivement pris le pas depuis 19793 et une économie de marché assumée a fait du pays l'un des quatre dragons asiatiques4.
Entre les deux, le 38ème parallèle nord scinde la péninsule de Corée tel l'éternel souvenir d'un conflit n'ayant jamais trouvé de conclusion5.
Dessinée lors des accords de Yalta et réinstaurée en 1953 à l'issue de la Guerre de Corée, l'absurde frontière du 38ème parallèle nord prend la forme d'une zone tampon sur-militarisée, ironiquement nommée « zone démilitarisée ». Celle-ci dresse une démarcation claire entre ces deux pays fondamentalement opposés. Pour autant, bien qu'elle soit depuis plusieurs siècles le théâtre de conflits d'intérêt géographiques, économiques et politiques de puissances extérieures, la péninsule de Corée ne devrait pas être déchirée de la sorte. Conséquence symptomatique de la Guerre Froide, cette scission vient avant toutes choses diviser un peuple coréen aspirant à la réunification pour qui « la Corée est une. Par sa géographie, son peuple, sa langue et sa culture.»6
Mais cette réunification arbore aujourd'hui des traits d'utopie. Il semble en effet compliqué de ramener l'unicité à cette péninsule où, depuis soixante-dix ans, les communications entre nord et sud coréens sont fortement prohibées. Au fil des décennies, des premières marques de différenciations sont progressivement apparues et ont rendu quasiment abscons les termes « Corée » et « coréens » tant il devient compliqué aujourd'hui de parler de la péninsule ou du peuple dans leur entièreté. Un « autre-coréen » semble alors avoir fait son apparition.

« Le drame de la situation coréenne repose pour beaucoup sur l'incompréhension mutuelle entre les deux pays»
KIM Ki-Duk7
Selon le point de vue, qu'il soit du nord ou du sud, cet « autre-coréen » se situe pour chacun, de l'autre côté du 38ème parallèle. Dans cette lutte idéologique que chacun veut impérativement remporter, les gouvernements de chaque Corée apprennent à leur population respective à haïr sans faille cet autre-coréen à coup de propagande religieusement prêchée en le rendant responsable de tous les affres qui accablent la péninsule. C'est d'ailleurs par la propagande sud-coréenne que YUN Jero présentait la Corée du Sud dans Madame B., Histoire d'une Nord-Coréenne. Lors d'un plan aérien de Séoul, le jeune réalisateur laissait entendre en extradiégétique le discours anti-Corée du Nord qu'un enfant avait prononcé lors d'un concours oratoire que le gouvernement sud-coréen avait organisé autour du thème « aimer la Nation ». De ces soixante-dix années de séparation rythmées par un prosélytisme assumé visant à diaboliser cet « autre-coréen » résulte inexorablement un racisme aveugle pour l'inconnu venu de par delà le 38ème parallèle.
Si au cinéma ce racisme a pu mener à des situations comiques comme le quiproquo alcoolisé de Night and Day de HONG Sang-Soo, il est aussi à l'origine de séquences âpres pour le spectateur. C'est le cas dans Futureless Things de KIM Kyung-Mook lorsqu'une cassière de commerce de proximité se fait ouvertement humilier en place publique lorsque son accent dévoile ses origines nord-coréennes. De même, aux vues de l'accueil que les sud-coréens – notamment les services de renseignement - réservent à Madame B., protagoniste principale du documentaire éponyme de YUN Jero susmentionné, on en vient rapidement à se demander si celle-ci a trouvé l'eldorado tant espéré qu'elle était venue chercher de l'autre côté de la frontière.
De la confrontation avec cet « autre-coréen » résulte aussi une forme d'effet miroir permettant de faire ressortir les défauts de chacune des deux sociétés coréennes. Dès lors, le cinéma sud-coréen peut avoir recours à cet inconnu venu du nord pour ébranler le manichéisme surréel mis en place par les États-Unis et le monde occidental autour du conflit inter-Corées. De plus, la Corée du Nord brillant d'elle-même internationalement au travers de ses nombreuses exactions et de ses pieds-de-nez aux Droits de l'Homme, aux Conventions de Genève et aux diverses directives de l'ONU, il semble bien vain aujourd'hui de continuer d'avoir recours au cinéma pour l'affubler de ses nombreux torts. À l'inverse d'Evan GOLDBERG et de Seth ROGEN qui pensaient trouver une certaine originalité avec une vision grotesque et simplifiée du conflit inter-Corées dans L'Interview qui tue !, certains réalisateurs voient dans cet « autre-coréen » l'occasion de se livrer à une forme d'auto-critique.
Dans Entre deux rives, KIM Ki-Duk suit le parcours de Nam Chul-Woo, un pécheur nord-coréen ayant dérivé jusqu'en Corée du Sud après s'être retrouvé coincé dans un filet de pêche. Bien que le projet ait été initié suite à un désir de mettre en scène des événements datant des années 1970, le réalisateur sud-coréen s'avère parfaitement conscient que le regard que porte son personnage nord-coréen sur la Corée du Sud peut s'avérer lourd de sens. Dès les premières minutes du long métrage, c'est de manière assez évidente que les futures tribulations du pécheur sont annoncées. Un garde frontière nord-coréen l'informe que le courant pousse vers le Sud et lui demande s'il serait prêt à abandonner sa barque si elle venait à tomber en panne. Le spectateur prend alors rapidement conscience que les diverses péripéties intéressent bien moins KIM Ki-Duk que l'attitude que vont adopter les sud-coréens face à ce nouveau venu et le regard que celui-ci va porter sur ce pays qu'il ne connaît qu'à travers l'amer regard de son gouvernement .
Si le fait d'ouvrir le film sur un panorama du lac servant de frontière entre les deux pays depuis la rive sud-coréenne semble parfaitement anodin lors d'un premier visionnage, il s'avère que ce plan présente dès les premières instances le point de vue de KIM Ki-Duk. Le réalisateur rappelle de la sorte qu'il vient de Corée du Sud et que son regard est irrémédiablement influencé, comme en témoigne l'une des piques lancées aux dirigeants nord-coréens lorsque le protagoniste principal et sa femme s'adonnent aux plaisirs de la chair sous les regards bienveillants de KIM Il-Sung et KIM Jong-Il.

Rapidement le long métrage cesse toutes formes d'évidence téléphonée pour suivre les nombreux jours d'interrogatoire que subit le pécheur durant lesquels les privations de sommeil et autres tortures morales sont légions. Lorsqu'il a pour la première fois l'occasion de découvrir la Corée du Sud, Nam Chul-Woo tente de rester fidèle à son motto en fermant les yeux pour ne rien voir de ce pays, par peur d'avoir quelque chose à raconter et regretter lors de son retour au Nord. Dès lors que le nord-coréen se retrouve obligé de poser son regard sur le pays du matin calme, Entre deux rives présente un sombre portrait d’un pays où le capitalisme est censé avoir apporté prospérité, bonheur et liberté.
« Plus grande est la lumière, plus grandes sont les ombres. »
Oh Jin-Woo, le garde chargé à la fois de la sécurité et de la surveillance de Chul-Woo à propos de Séoul dans Entre deux rives de KIM Ki-Duk.
Si Chul-Woo est d'abord ébaubi par ce pays de commerce aux grands magasins qu'il découvre au travers de Myeong-dong, un quartier de Séoul principalement touristique et commercial. C'est au fil de ses pérégrinations que l'envers du décors se dévoile à lui. Venant d'un pays technologiquement moins avancé et en proie régulièrement à la famine, c'est avec une certaine consternation que le Nord-Coréen découvre des rues où nourriture, ordinateurs portables et autres déchets jonchent le sol. Son épopée sud-coréenne prend définitivement une autre tournure lorsqu'il expérimente la capitale de nuit et vient prêter main-forte à une prostituée rouée de coups par des hommes passablement ivres. Faisant preuve d'un étonnement certain, Chul-Woo interroge à plusieurs reprises ses interlocuteurs sur la difficulté de la vie en Corée du Sud au travers de phrases témoignant d'une certaine candeur, telle que « Dans un pays aussi libre que le vôtre, qu'est-ce qui est si dur ? » ou « Pourquoi doit-elle vendre son corps dans un pays aussi riche ? ». C'est d'ailleurs avec la même candeur que Oh Jin-Woo répond au pécheur nord-coréen en lui rappelant que « la liberté ne garantie pas le bonheur ». Si les plus circonspects accuseront KIM Ki-Duk de faire preuve d'un certain manque de finesse, ces différents propos s'avèrent néanmoins intéressants lorsque l'on les imagine destinées à un gouvernement sud-coréen se cachant volontiers derrière cette chimère qu'est le terme « pays développé ».
Si les errances séoulites de son personnage principal constituent le climax de Entre deux rives, elles ne s'avèrent pas être les seules critiques que KIM Ki-Duk fait de son pays. Bien que cela ne soit probablement pas dû à l'intention du réalisateur, le fait de croiser le chemin de JEONG Ha-Dam dans le rôle d'Azalé, une jeune fille emplie de mystère rappelant celle qu'elle interprétait à la perfection dans Steel Flower de PARK Suk-Young, vient fortement rappeler que la Corée du Sud est un pays où nombreux sont les laissés-pour-compte.

C'est aussi les différentes attitudes des Sud-Coréens qui intéressent KIM Ki-Duk. Si le jeune Oh Jin-Woo est à l'écoute de l'histoire de Chul-Woo et souhaite, en accord avec la volonté de celui-ci, l'aider à retrouver sa famille, il fait bel et bien figure d'exception. En croisant le chemin de trois autres agents des services secrets sud-coréens, le Nord-Coréen se confronte à trois types de comportements différents. Alors que l'un souhaite simplement renvoyer Chul-Woo au Nord après avoir établi qu'il n'est pas un espion, les deux autres font preuve de moins de modération. Persuadé qu'un Nord-Coréen est dénué de quelconque discernement, le chef des services secrets s'offre la sainte mission de « sauver » chaque personne venue du Nord. Lors d'une discussion pour inciter Chul-Woo a faire défection, il ira jusqu'à l'accuser de ne rien savoir de la liberté à cause du lavage de cerveaux et ne cherchera aucunement à respecter la volonté de celui-ci en refusant catégoriquement d'organiser son retour en Corée du Nord.
Cependant, c'est en réalité le dernier inspecteur qui viendra estomaquer les spectateurs et l'intégralité des autres personnages. Allant jusqu'à choquer son chef, il recevra l'ordre d'avoir un esprit patriotique en arrêtant de se défouler tel un chien enragé. De ses premiers mots à l'écran - « C'est lui ? Il a bien la tête d'un espion » - à son ultime apparition chantant avec une émotion certaine l'hymne sud-coréen, cet inspecteur témoignera sans faille de sa haine aveugle pour tout ce qui vient du Nord. C'est par ailleurs à partir de ce personnage que KIM Ki-Duk construit son propos lorsque plus tard dans le film, un inspecteur nord-coréen a recours aux mêmes pratiques que son homologue sud-coréen en cherchant à intimider Chul-Woo et en l'obligeant à retranscrire à la main de multiples fois une même histoire.
D'un côté comme de l'autre, on reproche au pécheur nord-coréen de ne pas avoir abandonné sa barque. En usant d'un tel parallèle dans sa mise en scène, le réalisateur vient critiquer de manière plus virulente la Corée du Sud. Sans pour autant aller jusqu'à comparer les agissements de son pays aux crimes perpétrés par le Nord, KIM Ki-Duk dévoile un 38ème parallèle ayant un effet miroir où les deux parties de la péninsule partagent de multiples points communs. Ce miroir se met en place dès que Chul-Woo est autorisé à rentrer en Corée du Nord. Après avoir retiré l'intégralité de ses vêtements – qui lui avaient été donnés par les services secrets sud-coréens – le pécheur agit de la même manière de chaque côté de la frontière en hurlant « Vive la République Populaire de Corée ! BANZAI ! BANZAI BANZAI ! » sans que l'histoire ne nous dise s'il agit par conviction ou par volonté de simplement se protéger. Témoignant ainsi de l'étau que cette guerre idéologique met en place, Chul-Woo est pris au piège au centre d'un cauchemar kafkaïen dans lequel les gouvernements respectifs cherchent à nourrir leur propagande en trouvant d'un côté de la frontière un espion et de l'autre une erreur de la Corée du Sud.

Ce miroir met alors en avant l'absurdité de cette situation inter-Corées où un peuple moins impliqué qu'il n'y paraît s'avère pris en otage. À l'issu de ses deux interrogatoires, les inspecteurs sud et nord-coréens arrivent à la conclusion similaire que Chul-Woo ne possède aucune valeur idéologique. De la même manière que Madame B. qui agissait uniquement dans le but d'apporter le bonheur à sa famille, Chul-Woo avait rapidement annoncé que « (sa) famille (l)'importe plus qu'une idéologie ». Mais KIM Ki-Duk semble vouloir dire qu'il est quasiment impossible de survivre dans cette péninsule de Corée lorsque l'on ne fait pas un choix entre l'une des deux doctrines prêchées. Le titre original et le titre international de Entre deux rives – « Geumul » et « The Net »8 - s'avèrent alors parfaitement en lien avec le film tant Chul-Woo et le peuple coréen sont pris au piège dans ce conflit.
Le titre français du film fait lui aussi étonnement sens. C'est lors d'un final chargé de sens qu'un Chul-Woo détruit par une guerre idéologique embarque sur son canot malgré l'interdiction que lui impose le régime communiste nord-coréen. Après s'être tourné vers chacune des rives en hurlant « Arrêtez de jouer avec ma vie », nul ne sait si le pécheur va simplement poser ses filets comme il l'affirme ou s'il effectue une fuite, cette fois-ci planifiée, vers le Sud. Le périple de Chul-Woo s'achève alors entre les deux rives du lac, là où les eaux de la zone démilitarisée symbolise d'une certaine manière une péninsule réunifiée où ne pas prendre partie dans cette guerre idéologique est possible.
En supprimant le manichéisme du conflit inter-Corées, KIM Ki-Duk en amène un bien plus justifié. D'un côté ceux cherchant à simplement vivre et espérant la réunification et de l'autre ceux menant une guerre sans réel sens enlisant la situation. Naturellement, c'est dans le premier groupe qu'on retrouve un Chul-Woo qui au cours de son expérience en Corée du Sud a préféré agir humainement avant d'agir idéologiquement. Avant de choisir d'observer les choses de manière binaire à s'interroger si les individus sont du nord ou du sud, si les divers objets symbolisent le communisme ou le capitalisme, le pécheur nord-coréen a simplement préféré offrir innocemment son manteau à la prostituée sud-coréenne destinée à déambuler en sous-vêtement dans les rues de Séoul ou de braver l'interdit pour simplement offrir une peluche de Corée du Sud à sa jeune fille.
Résonnant avec l'excès de candeur où Oh Jin-Woo et Nam Chul-Woo s'étaient surpris à espérer des retrouvailles dans une péninsule réunifiée, KIM Ki-Duk montre avec son Entre deux rives – et l’entièreté de son long métrage – que ce conflit, tout aussi complexe soit-il, semble avoir perdu son objectif final de Corée unie et en paix. Pour ce faire, le réalisateur fait appel à la candeur et l'optimiste de trois de ses personnages, Nam Chul-Woo, sa fille et Oh Jin-Woo. Outre le pécheur coréen qui a un traitement différent en raison de son statut de protagoniste principal, ces personnages s'avèrent aussi être ceux qui représentent la jeunesse des deux pays. Comme le mentionnait LEE Hee-Ho9 dans Corée, l'impossible réunification « Je suis sur qu’on parviendra un jour à l’unification. Le changement dépend de la volonté de ceux qui ont le pouvoir. Je pense que mes petits-enfants, enfin mes arrières-petits-enfants vivront dans une Corée réunifiée. », la réunification concerne bien plus les jeunes générations ayant de nombreuses années en Corée à vivre que celles des actuels dirigeants et acteurs actifs de ce conflit idéologique. Avec son dernier plan – sans doute l'un des plus puissants du film -, KIM Ki-Duk fait appel au Jeong lorsque la jeune fille du pêcheur relève son regard vers la caméra et place son espoir dans cette nouvelle génération qui pourra être à même d'amener la réunification.
1 Idéologie autocratique théorisée en majeure partie par HWANG Jang-Yop et mise en place en Corée du Nord par KIM Il-Sung. De base communiste, elle prend théoriquement la forme d'une société autonome politiquement, économiquement et militairement.
2 Politique dans le prolongement de la doctrine du Juche offrant une place prioritaire à l'armée au point de l'inclure dans certaines prises de décision sociales et économiques.
3Année de l'assassinat par la police secrète sud-coréenne, la KCIA, de PARK Chung-Hee, ancien président à vie de Corée du Sud.
4 L'expression « quatre dragons asiatiques » désigne la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour en raison de leur croissance industrielle exceptionnelle lors de la seconde moitié du XXème siècle.
5 En l'absence de ratification d'un traité de paix à l'issu de la Guerre de Corée, les deux pays belligérants principaux sont encore officiellement en guerre, bien qu'un pacte de non-agression ait été signé le 27 juillet 1953.
6 Pierre Olivier François, Corée, l’impossible réunification, 2013.
7 Interview de KIM Ki-Duk pour le webzine East Asia lors de la promotion de son film Entre Deux Rives, 2016.
8 Une fois traduit en français, les deux titres signifient « le filet » / « la nasse ».
9 Veuve de l’ancien président sud-coréen KIM Dae-Jung.
Critique publiée dans le MagGuffin n°19.
1 note
·
View note
Text
« Same Old Game » live
Co-director, editor

Burnout Kids - Same Old Game (live session au Centre Ken Saro Wiwa)
director : Maxime Lauret & Pierre Lauret
production : oh no! & Burnout Kids
camera operator : Maxime Lauret & Pierre Lauret
sound record & mix : Nicolas Defeudis
editor : Pierre Lauret
music : “Same Old Game” by Burnout Kid
youtube
Burnout Kids
Facebook : https://www.facebook.com/burnoutkidsofficial/
Instagram : https://www.instagram.com/burnoutkidsmusic/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzfLX-w-xxIZlzaBU7biV4w
0 notes
Text
Portrait : KURAMOCHI Ibuki
Writer

KURAMOCHI Ibuki : Une unicité à la conquête du monde
À l’occasion de son passage dans la capitale en 2017 pour la seconde édition de Paint Your Teeth In Paris, Journal du Japon avait brièvement présenté la jeune artiste KURAMOCHI Ibuki lors de son retour sur l’événement. Pour autant, l’artiste voit depuis plusieurs années sa notoriété mondiale croître, avec notamment des performances et expositions à Taïwan, en Australie, en Italie ainsi qu’un passage dans l’Hexagone lors de la 17e édition de la Japan Expo Paris. Ainsi, il est désormais temps de consacrer un portrait digne de ce nom, à cette artiste qui combine, entre autres, le live-painting, le body-painting et le butō.

Un art en continuelle maturation
Bien qu’il soit d’usage de débuter un portrait en précisant l’année et le lieu de naissance de la personne concernée, il semble d’autant plus important de le préciser lorsqu’il s’agit de KURAMOCHI Ibuki. Née en 1990 dans la préfecture de Gunma, l’artiste a grandi dans une région montagneuse située au nord de Tokyo qui a particulièrement influencé son art. Dans cet environnement où la nature prédomine, KURAMOCHI Ibuki a développé une réflexion artistique majeure aux ascendances shintō et s’est intéressée très tôt au dessin et à la peinture.
Cependant, c’est à l’âge de 12 ans qu’elle s’est sentie pour la première fois transportée par l’art, lors d’un voyage familial dans la ville de Nara. Face à la série de peintures de HIRAYAMA Ikuo représentant la Route de la Soie, KURAMOCHI Ibuki a alors compris la puissance artistique que la peinture pouvait dégager. Dans le travail du peintre, elle y a retrouvé un motif qu’elle avait d’ores et déjà côtoyé au sein de la nature de Gunma, celui de la vie et de la mort ainsi que les rapports qu’entretiennent ces deux concepts.
Par la suite, elle s’est rendue au Asagaya College of Art and Design à Tokyo pour y étudier l’art contemporain. Bien qu’aujourd’hui la majeure partie de ses œuvres soient réalisée avec des pinceaux et de l’encre sumi, à l’époque, son travail s’axait principalement sur l’usage de crayons à papier. Durant ces études, elle réalisa sa première performance lors du Design Festa, un événement d’art populaire au Japon où elle y reçut de nombreux retours positifs de la part de l’audience. Présentant d’ores-et-déjà des éléments qui caractériseront l’art de KURAMOCHI Ibuki, cette performance de live-painting a été réalisée entièrement avec de l’acrylique noire et blanche sur une toile de presque 4,5 mètres.
Ce n’est que plus tardivement que KURAMOCHI Ibuki intégra le butō à ses performances. Lors d’une exposition du peintre Francis BACON, elle découvrit en vidéo cette danse apparue au Japon dans les années 1960 alors que le kabuki et le nō semblaient incapables de proposer de nouvelles choses. Impressionnée, elle décida d’apprendre le butō au Kazuo Ohno Butoh Dance Studio à Yokohama auprès de OHNO Yoshito, qui n’est autre que le fils de OHNO Kazuo, l’un des créateurs de cette danse.

©Frédéric COUNE
Une unicité aux influences multiples
Outre la révélation face aux peintures de HIRAYAMA Ikuo ainsi que celle à l’exposition de Francis BACON, KURAMOCHI Ibuki a développé un art qui trouve son origine dans de multiples influences. Au cours des différentes interviews qu’elle a eut l’occasion de donner, de nombreux noms sont mentionnés tels que William BLAKE, KAWANABE Kyosai ou encore MARUE Suehiro. Cependant, il faut principalement citer Éloge de l’ombre de TANIZAKI Jun’ichirō qui accompagne la jeune artiste dans chacun de ses déplacements à l’étranger pour des expositions ou des performances. Ce roman, signé par l’un des auteurs les plus reconnus du Japon, constitue une influence majeure pour KURAMOCHI Ibuki de part la richesse de sa représentation de la culture japonaise ainsi que de l’expression japonaise wabi-sabi qui, pour simplifier, réfère à la beauté des choses dites imparfaites, impermanentes et/ou incomplètes.
Cependant, l’élément le plus caractéristique des performances et œuvres de KURAMOCHI Ibuki se situent dans son travail du contraste entre le noir et le blanc, parfois accompagné de rouge. Dès lors, il devient évident de voir les influences de Aubrey BEARDSLEY, de Shin Taga ou encore SESSHŪ Tōyō, le célèbre moine bouddhiste spécialisé dans le lavis et la peinture à l’encre. Cependant, chez KURAMOCHI Ibuki, ce contraste vient représenter son rapport à la vie et à la mort qu’elle a développé depuis son enfance dans la préfecture de Gunma. L’artiste va jusqu’à théoriser son usage des couleurs en renvoyant le rouge au sang, le blanc à la vie et le noir à la mort. Si le fait que le noir correspond au néant et à la mort semble effectivement acquis par tous, le blanc lui signifie la vie en renvoyant à la couleur du lait maternelle qui – avant la naissance de l’enfant – s’avère n’être que du sang de la mère, soit le rouge. Ainsi, le travail de KURAMOCHI Ibuki se concentre autour de la représentation de l’intervalle que représente la vie d’un humain entre sa naissance et sa mort, et cela dans un pur élan shintoïste.
De même, il est important de parler du rapport à la musique qu’entretient KURAMOCHI Ibuki. Citant régulièrement les noms de Claude DEBUSSY, Michael NYMAN, Steve REICH ou encore Bjork, elle commença très rapidement à accompagner ses prestations de musique pré-enregistrée. Cependant, progressivement, ses prestations furent de plus en plus caractérisées par des collaborations avec divers artistes musicaux. Si à l’origine, elle était principalement accompagnée de musiciens japonais jouant du shamisen, du koto et du shakuhachi, sa récente popularité mondiale lui a permis de diversifier ses performances et de multiplier les collaborations aux sonorités plus variées.
Enfin, l’art de KURAMOCHI Ibuki peut se présenter par les vêtements qu’elle porte lors de ses performances. Ayant principalement usage de vieux kimono, ses tenues vestimentaires varient fortement en alternant entre les 200 pièces de sa riche collection – dont certains qu’elle a peint entièrement à la main – et qu’elle accompagne d’accessoires plus contemporains allant parfois chercher aussi dans des styles plus occidentaux. À cela, elle ajoute un maquillage blanc inspiré de celui que les geisha portaient pour affirmer l’aspect principalement japonais de son art. Dès lors, lorsque cette combinaison entre peinture, tenue vestimentaire, danse et musique s’opère en direct, l’audience peut décerner un certain érotisme entre onirisme et abstraction qui se dégage des performance de KURAMOCHI Ibuki.

Spirit of eyes – KURAMOCHI Ibuki
C’est de part son développement progressif pour devenir un mélange savant d’influences et d’arts venus de différents horizons que le travail de KURAMOCHI Ibuki se caractérise aujourd’hui par son unicité. Ce caractère unique, l’artiste l’a par ailleurs toujours porté en elle au travers de son prénom « Ibuki » qui – au Japon – est très peu répandu et s’avère unisexe.
Après des performances mondiales, avec notamment la Japan Expo Paris en juillet 2016 et son exposition au Little MOCA Art Gallery à Taïwan en septembre 2017, KURAMOCHI Ibuki s’affirme de plus en plus comme une artiste aboutie créant un pont culturel entre le Japon et le reste du monde qui saura, on l’espère, très prochainement revenir dans l’Hexagone pour d’autres performances.
Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.
2 notes
·
View notes
Text
Interview : MOON So-Ri
Interviewer, writer

Moon So-Ri, une femme coréenne
À l’occasion de son passage en novembre à Rennes pour la pièce L’Empire des lumières de Arthur Nauzyciel, nous avons rencontré l’actrice et réalisatrice Moon So-Ri. Révélée au cinéma dans les films Peppermint Candy et Oasis de Lee Chang-Dong, elle s’est fait connaître en France avec notamment Im Sang-Soo (Une femme coréenne, The Housemaid), Park Chan-Wook (Mademoiselle) ou encore Hong Sang-Soo (Hahaha, In Another Country, Hill of Freedom).
Pierre Lauret : The Running Actress, votre première réalisation, est un film de fiction vous mettant en scène dans votre propre rôle. Pourquoi ce choix ?
Moon So-Ri : Déjà en tant qu’actrice, il me semblait important de m’interroger sur mon statut de personnalité célèbre en Corée du Sud. La réalisation de The Running Actress découle de cette même interrogation. Il était nécessaire de prendre une distance pour mieux comprendre la personne que je suis. Il y avait aussi une volonté de partager une certaine empathie avec les personnes travaillant dans le cinéma. Pour autant, je ne voulais pas laisser le grand public sur la touche. J’avais tout à fait conscience que, souvent, ça ne fonctionne pas quand des cinéastes tentent de parler du monde du cinéma, l’histoire échappe au grand public. Avec The Running Actress, je voulais atteindre quelque chose de parlant et d’universel à partir de cette réflexion.

PL : Que cela soit dans The Running Actress ou dans les films dans lesquels vous avez joué comme Mademoiselle de Park Chan-Wook ou Bewitching Attraction de Lee Ha, vos personnages s’interrogent souvent sur des questions liées à la beauté, à leur propre image ainsi qu’à leur âge. Est-ce quelque chose qui vous inquiète personnellement ou s’agit-il de quelque chose d’important en Corée du Sud ?
MSR : Pour mon premier long-métrage en tant qu’actrice, Peppermint Candy de Lee Chang-Dong, j’ai passé une audition où on m’a demandé « est-ce que tu es suffisamment belle pour avoir le premier rôle ? ». Aujourd’hui, je ne suis plus forcément confrontée à cela. Mon second long-métrage, Oasis de Lee Chang-Dong, posait par ailleurs cette question fondamentale, « qu’est-ce que c’est la beauté ? » Je pense qu’il est important d’en parler dans la société sud-coréenne d’aujourd’hui. On peut se demander, notamment chez les femmes, qu’est-ce que la beauté et où se situe-t-elle. En Corée du Sud, la chirurgie esthétique est très courante, de manière presque maladive. Et il me semble que mon rôle en tant que personnalité, mais aussi en tant qu’artiste, est d’amener les gens à y réfléchir, à s’interroger sur la diversité des valeurs de beauté.
PL : Dans The Running Actress, vous parlez notamment d’une sorte de remplacement par de plus jeunes actrices. Dans vos derniers films visibles en France, Mademoiselle de Park Chan-Wook et Vanishing Time d’Um Tae-Hwa, vous tenez des seconds rôles. Comment avez-vous vécu ce « remplacement » ?
MSR : Ça arrive à tous les acteurs de rater une audition. Je pense que même Meryl Streep a dû passer par là. En tant qu’actrice il y a des hauts et des bas. À un moment, je me suis demandé si c’était le déclin de ma carrière. Pourtant je sens aussi que ça remonte. C’est une compétence assez importante de pouvoir savourer ces moments-là et de chercher à faire autrement, de trouver comment s’en tirer. C’est quelque chose que j’ai vécu. Après, je suis toujours ouverte à n’importe quel rôle, important ou non. Je m’intéresse surtout au projet et au réalisateur. Par exemple, pour Vanishing Time, Um Tae-Hwa m’a écrit longuement pour me demander de participer à son film. Il y avait beaucoup de passion dans sa lettre, presque de l’amour (rires). J’ai accepté pour cela et parce que je connais aussi très bien Kang Dong-Won, l’acteur principal. En fait, il y a mille raisons pour rater ou ne pas choisir un film, mais il y en a aussi mille pour accepter d’y jouer.

PL : Que cela soit votre film, Forever the Moment de Yim Soon-Rye, dans lequel vous jouez, ou Jamsil de Lee Wan-Min, il existe du cinéma par des réalisatrices en Corée du Sud qui propose des femmes en personnage principal. Est-il compliqué de monter de tels projets ?
MSR : Il n’y a pas de discrimination envers les femmes dans le système cinématographique en Corée du Sud. Dans les écoles de cinéma par exemple, il y a beaucoup d’étudiantes qui aspirent à être réalisatrices. Cependant, dès le monde professionnel, il y a plus d’hommes que de femmes, à l’instar de la plupart des domaines. Une certaine solidarité masculine règne dans les grandes écoles de cinéma, de même qu’entre les personnes venant d’une même région. Cette solidarité est aussi financière, si bien que les femmes sont beaucoup plus obligées de se débrouiller individuellement pour réaliser leurs projets.
PL : Dans vos films, et dans l’ensemble du cinéma coréen, on voit récemment de plus en plus de films où les personnages principaux féminins s’émancipent, que cela passe par le divorce, l’adultère, les départs vers l’inconnu, etc. Est-ce représentatif de la société coréenne actuelle ?
MSR : Ces films-là restent assez mineurs et ne sont quasiment que des films indépendants. Dans le cinéma commercial, les rôles masculins sont encore assez importants puisque ce sont souvent des films d’action ou des polars. Les femmes y ont souvent des rôles assez accessoires ou sont des victimes qui cherchent à se venger. Le cinéma indépendant traite quant à lui de plus en plus, et de mieux en mieux, des femmes ou des caractères féminins. La société coréenne y est véritablement incarnée, même si le caractère non commercial de ces productions ne favorise pas leur rayonnement. J’essaye de faire des films qui soulèvent cette question aussi, mais je suis à la recherche, comme je le mentionnais, d’un équilibre pour ne pas m’éloigner du grand public.

PL : En France, Hong Sang-Soo divise fortement à ce sujet. Certains le trouvent très misogyne alors que d’autres le trouvent d’une certaine manière féministe. À votre sens, comment s’inscrit-il dans le paysage cinématographique sud-coréen ?
MSR : Il est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, car je connais un peu trop Hong Sang-Soo (rires). En général, les hommes apprécient beaucoup ses films, les voyant comme une juste incarnation de la psychologie masculine. Ses films ne sont pas féministes dans le sens où ils adoptent un point de vue masculin. Mais je pense qu’il travaille, avec compréhension et empathie, au sein d’une réflexion assez profonde sur la psychologie humaine. Il faut distinguer les films féministes et les films avec une empathie pour les femmes : les films qui aiment les femmes.
PL : Vous êtes actuellement en France puisque vous jouez dans L’Empire des lumières, une pièce de théâtre de Arthur Nauzyciel. Lors du question-réponse à l’issue de l’une des représentations, vous reveniez sur une scène de ménage à trois pour parler de la libération sexuelle en Corée du Sud. Le cinéma aussi a abordé récemment ce sujet avec par exemple Mademoiselle de Park Chan-Wook qui traitait de relations homosexuelles. Est-ce que la libération sexuelle est considérée différemment dans l’art que dans la société sud-coréenne ?
MSR : La génération de mes parents était très stricte, sévère et conservatrice. Il y avait beaucoup d’oppression. J’ai fait comme je pouvais, mais j’étais moi aussi formatée par leur éducation. Peut-être que la génération d’après essaye de sortir davantage de ce système. En Corée du Sud, on ne peut toujours pas mentionner ses désirs sexuels quand on est une femme, alors que les désirs masculins sont chose normale. J’aimerais beaucoup que les réalisatrices sud-coréennes parlent plus de cette liberté sexuelle féminine et de son importance. Mais aujourd’hui, elles parlent davantage de la nature et des animaux (rires).

PL : Les projets auxquels vous avez participé sont souvent assez engagés. Le féminisme n’est pas le seul sujet important abordé dans votre carrière puisque l’on retrouve notamment les questions du handicap dans Oasis de Lee Chang-Dong ou les relations avec la Corée du Nord dans L’Empire des lumières. Sous le gouvernement Park Geun-Hye, vous étiez sur la liste noire mise en place par le ministère de la Culture. Comment cela a-t-il influé sur votre carrière ?
MSR : Il est encore un peu délicat de parler de cela aujourd’hui. Je me suis arrêtée volontairement à cette période, car j’étais enceinte. Avec mon mari, lui aussi réalisateur, nous avons passé un moment assez difficile. Ce que je peux dire, c’est qu’on est au XXIe siècle et on a pu voir à quel point un état peut faire des choses enfantines. On est descendu très bas. Après, il est effectivement possible que mon point de vue politique influence mes choix, bien que cela ne soit pas mon unique objectif. Actrice est un métier qui incarne et parle à l’être humain. Aussi est-il important de porter une attention particulière à la vie de personnes ignorées ou abandonnées. Avec le cinéma ou le théâtre, on peut réaliser ce qui ne peut se faire avec la politique ou l’économie. C’est ma manière d’influencer et de parler à voix haute dans le monde.
Entretien réalisé le 17 novembre 2017. Nous remercions infiniment Moon So-Ri pour son temps et sa gentillesse, Lee Hyun-Joo pour sa précieuse traduction, ainsi que Nathalie Solini pour avoir rendu cette interview possible.
Critique publiée dans le MagGuffin n°16
2 notes
·
View notes
Text
Montre tes nippons
Writer

Festival du Film de Fesses : Paris et les postérieurs japonais
« Montre tes nippons » – Tel sera le mot d’ordre dans les cinémas du Quartier Latin de Paris – Reflet Médicis, La Filmothèque et Les 3 Luxembourg – du 28 juin au 1er juillet à l’occasion de la cinquième édition du Festival du Film de Fesses. Alors que Facebook censure de manière absurde la page du festival et témoigne à nouveau de sa pudibonderie, Journal du Japon a souhaité jeter un petit coup d’œil – discret – à cette rétrospective du cinéma érotique japonais des années 1960 à nos jours.
Postérieur #1 : KUMASHIRO Tatsumi
La programmation de cette cinquième édition du Festival du Film de Fesses s’arc-boute principalement autour du réalisateur KUMASHIRO Tatsumi, véritable pilier du cinéma érotique japonais. Surnommé “Le Roi des Roman Porno de la Nikkatsu”, KUMASHIRO est un réalisateur très prolifique qui a notamment signé une douzaine de films entre 1972 et 1974 et qui s’est imposé comme un des cinéastes au succès le plus constant dans l’histoire du cinéma japonais.
C’est lorsque la Nikkatsu a commencé sa nouvelle ligne éditoriale axée sur l’érotisme – le Roman Porno – pour empêcher le public de fuir vers la télévision, que KUMASHIRO a tiré son épingle du jeu pour devenir le réalisateur le plus émérite et accompli du studio. Bien qu’il soit né en 1927 – et ainsi l’un des réalisateurs les plus âgés du milieu -, KUMASHIRO fait parti des cinéastes ayant le mieux capté le Japon des années 1970, où les désenchantements des échecs révolutionnaires composaient l’essence même de la société japonaise.
Le cinéma féministe, libertaire et anti-autoritaire de KUMASHIRO Tatsumi sera exploré au cours d’une courte rétrospective de six films par le Festival du Film de Fesses. On peut notamment noter la présence de Sayuri, strip-teaseuse, l’une de ses réalisations les plus reconnues et ayant connu un véritable succès. Interprétant là son propre rôle, ICHIJO Sayuri – l’une des strip-teaseuse les plus célèbres de l’époque – amène le spectateur à découvrir la réalité de la vie des travailleurs du sexe dans le Japon des années 1970.

Rue de la joie (Jeudi 28 Juin – 20h00 – La Filmothèque)
La vie de cinq filles de joie dans une maison close de Tamanoi, célèbre quartier des plaisirs de Tokyo.
La femme aux cheveux rouges (vendredi 29 Juin – 14h00 – La Filmothèque)
Kozo et Takao, deux ouvriers, abusent de la fille de leur patron. Leur vie va se transformer au contact d’une femme aux cheveux rouges, qu’ils recueillent au bord de la route un jour de pluie.
Désirs humides (Vendredi 29 Juin – 15h30 – La Filmothèque)
Hosuke, petit proxénète trouve un porte-feuille rempli de billets et décide de quitter Kamagasaki pour partir en voyage. Sur la route, il rencontre Meiko, qu’il persuade de devenir strip-teaseuse et s’installe avec elle dans le théâtre où travaille sa première amante, Yuko.
Sayuri, strip-teaseuse (Vendredi 29 Juin – 20h30 – La Filmothèque)
Dans les cabarets populaires d’Osaka, la jeune Harumi s’entraine avec une candeur stupéfiante pour devenir une grande strip-teaseuse, et rêve de supplanter la célèbre Ichijo Sayuri.
Extase de la rose noire (Samedi 30 Juin – 18h15 – La Filmothèque)
Juzo, minable réalisateur de pornos clandestins, se retrouve bien embêté lorsque Meiko, son actrice principale, tombe enceinte et lui annonce qu’elle veut faire une pause.
Les Amants mouillés (Dimanche 1er Juillet – 18h00 – La Filmothèque)
Après une longue errance à travers le Japon, le jeune Katsu revient dans son village natal pour fuir les représailles des yakuzas. Il y commence des aventures avec Katsu, sa patronne délaissée par son époux, ainsi qu’avec Yoko qu’il épie faisant l’amour.
youtube
Postérieur #2 : YAMAMOTO Eiichi
Nuit Eiichi Yamamoto (Samedi 30 Juin – 00h00 – Les 3 Luxembourg)
Le temps d’une nuit aux 3 Luxembourg, le Festival de Film de Fesses propose de voir – ou revoir – trois des grands classiques de l’animation signés YAMAMOTO Eiichi : Les Milles et une nuits, Cleopatra et Belladonna la sorcière (ou La Belladone de la tristesse). Connu notamment pour son travail chez Mushi Production aux côtés de TEZUKA Osamu, YAMAMOTO est sorti de l’ombre avec la série Le Roi Léo en 1965, bien qu’il réalise depuis 1962. De 1969 à 1973, YAMAMOTO réalise une série de trois films érotiques – indépendants les uns des autres – réunis sous le nom « Animerama » et signe ainsi les premiers films d’animation pour adulte au Japon.
Si les trois films comportent de nombreuses similarités telles que l’usage du rock psychédélique en bande originale ou un érotisme reposant principalement sur la suggestion, Belladona la sorcière se démarque fortement de ces deux contemporains par ses allures expérimentales composant un véritable « trip » psychédélique à l’érotisme certain. Cependant, la nuit proposée par le Festival du Film de Fesses sera aussi de voir sur grands écrans les deux volets des Animerama, bien moins accessibles dans l’Hexagone.
Les milles et une nuits
Aladin est un jeune vendeur d’eau de Bagdad sans le sou, qui tombe amoureux d’une esclave nommée Miriam. Ils passent une nuit délicieuse ensemble, mais sont séparés par des bandits. Miriam mourra quelque temps après, laissant Aladin désespéré. Quinze ans après, ce dernier devient roi et cherche alors à se venger.
Cleopatra
Trois hommes s’embarquent dans une machine à remonter le temps, jusqu’à l’époque de Cléopâtre et de l’Égypte ancienne. Mais bien loin de l’idée qu’ils s’en faisaient, ils débarquent dans un monde où les artifices et l’érotisme règnent.
Belladonna la sorcière
Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l’espoir d’obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna.
youtube
Autres postérieurs
Outre ses succinctes rétrospectives autour des œuvres de KUMASHIRO Tatsumi et de YAMAMOTO Eiichi, le Festival du Film de Fesses garnit sa programmation « Montre tes nippons » de nombreux autres grands noms du cinéma japonais. Au menu, ADACHI Masao, MURAKAMI Ryū, SONO Sion ou encore TANAKA Noboru.
Abnormal Family (Vendredi 29 Juin – 17h15 – La Filmothèque)
La vie d’une famille se complique lorsque le frère aîné Koichi ramène Yuriko, sa nouvelle épouse à l’appétit sexuel vorace. Kazuo, son jeune frère, voit en elle une source de libération sexuelle.
Si sur le papier un hommage à OZU Yasujiro en version érotique peut surprendre, force est de constater que SUO Masayuki transpose cela avec brio sur pellicule. Abnormal Family est le premier long-métrage de ce réalisateur qui se fera connaître en 1996 avec Shall We Dance ? et témoigne d’ores et déjà de ce qui fera l’essence de son cinéma.
Inflatable Sex Doll of the Wastelands (Vendredi 29 Juin – 18h45 – La Filmothèque)
Un détective privé est engagé pour retrouver une femme qui aurait été assassinée dans un snuff movie. Cette femme s’avère bel et bien vivante et le détective aspiré dans une liaison torride avec elle, en vient à questionner son sens de la réalité.
Écrit et réalisé par YAMATOYA Atsushi, scénariste sur La Marque du Tueur de SUZUKI Seijun, Inflatable Sex Doll of the Wastelands est film expérimental avec notamment Tatsumi Noriko – surnommée « la première Reine des pink eiga » – dans le rôle principal et le pianiste jazz YAMASHITA Yosuke à la musique. Bien qu’il s’agisse d’un premier film à la réalisation pour YAMATOYA, Inflatable Sex Doll of the Wastelands est devenu l’un des films majeurs des années 1960 au Japon.
Guilty of Romance (Vendredi 29 Juin – 22h00 – La Filmothèque)
Izumi est mariée à un célèbre romancier romantique mais leur vie semble n’être qu’une simple répétition sans romance. Elle décide alors de suivre ses désirs et accepte de poser nue et de mimer une relation sexuelle devant la caméra. Un jour, le corps d’une personne assassinée est retrouvé dans le quartier des «love hotels».
Il est convenu aujourd’hui que SONO Sion est l’un des réalisateurs les plus appréciés de la rédaction de Journal du Japon. Avec Guilty of Romance en 2011, SONO signe un film entièrement à la gloire de sa femme et muse KAGURAZAKA Megumi. Explorant le quartier de Maruyama-Cho à Shibuya dans Tokyo – connu pour ses love hotels -, Guilty of Romance se dresse tels des limbes emplies de couleurs où le sens même d’émancipation est poussé à son paroxysme. L’occasion de redécouvrir ce film sur grand écran, bien qu’il soit regrettable que la projection propose la version internationale du film qui est amputée de trente minutes par rapport à la version originale.
youtube
Gushing Prayer (Samedi 30 Juin – 14h00 – La Filmothèque)
Les lycéens Yasuko, Yôichi, Kôichi et Bill veulent échapper à ce monde étouffant et aliénant qui les écrase en s’adonnant au sexe collectif : ils espèrent forger leur propre vie loin d’une société adulte corrompue.
Lorsque l’on s’intéresse au cinéma érotique ou au cinéma politique japonais, il est difficile de passer à côté de ADACHI Masao. Proche collaborateur de WAKAMATSU Koji, il en est généralement le scénariste mais a occasionnellement enfilé la casquette de réalisateur. Connu pour son ancrage politique dans l’extrême-gauche, on retrouve son nom – ou son pseudonyme Izuru Deguchi – dans les films les plus politiques de l’époque tels que La Pendaison de OSHIMA Nagisa ou Va, va, vierge pour la deuxième fois de WAKAMATSU Koji. En tant que réalisateur, c’est son A.K.A. Serial Killer qui est principalement connu puisqu’il y développe la « Théorie du paysage ». Ce réalisateur très politisé et très théorique pourra alors être découvert sur grand écran avec Gushing Prayer, l’un de ses derniers films en 1971 avant de rejoindre l’Armée Rouge Japonaise au Liban.
Fleur Secrète (Samedi 30 Juin – 16h15 – La Filmothèque)
Senzô Tôyama, patron d’une importante société, demande à son jeune employé Makato, impotent depuis son adolescence, d’enlever sa femme Shizuko afin de l’initier aux plaisirs interdits.
Avec Fleur Secrète, KONUMA Masaru propose en 1974 la première adaptation d’un roman de DAN Oniroku en Roman Porno. Dans la continuité de ce film, de nombreux films de la Nikkatsu adapteront les histoires du plus grand écrivain SM du Japon. Non content de lancer une série d’adaptations, Fleur Secrète a eu aussi comme effet de propulser TANI Naomi – actrice principale du film – comme figure principale du Roman Porno japonais.
Funérailles des roses (Samedi 30 Juin – 18h00 – Le Reflet Médicis)
Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar Genet où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, drag-queen plus âgée et matronne du bar.
En proposant Les Funérailles des roses de MATSUMOTO Toshio, le Festival du Film de Fesses met en avant l’une des œuvres les plus importantes du cinéma queer japonais mais aussi l’un des films les plus innovants visuellement du cinéma japonais. Épousant à la perfection l’ère du temps en jonglant entre performances de rue, discours sur le cinéma, questionnements sexuels et identitaires tout en offrant des descriptions documentaires de la vie des drag-queens au Japon, MATSUMOTO a réalisé avec Les Funérailles des roses l’un des films les plus importants du cinéma japonais des années 1970.
youtube
Marché Sexuel des filles (Samedi 30 Juin – 20h00 – La Filmothèque)
La vie difficile des prostituées du quartier pauvre de Kamagasaki à Osaka à travers l’histoire de Tome, dix-neuf ans, qui, tout comme sa mère, une rivale, vend ses charmes.
Le Marché Sexuel des filles de TANAKA Noboru est aujourd’hui est l’un des Romans Porno de la Nikkatsu les plus connus en France. Ouvertement pessimiste, le film réalisé en 1974 est l’une des principales fulgurances du réalisateur qui s’est illustré en 1975 avec La Véritable histoire d’Abe Sada. Si l’interprétation de SERI Meika est l’une des plus marquantes des films issus de la Nikkatsu à cette période, le film de TANAKA est tout aussi marquant tant il témoigne avec aisance la richesse du cinéma érotique japonais des années 1970 qui trouvait l’équilibre parfait entre cinéma pour adulte et cinéma politique.
Tokyo Décadence (Samedi 30 Juin – 22h00 – La Filmothèque)
Douée pour la langue des signes, Ai, 22 ans, est au chômage. Elle accepte de devenir hôtesse pour une agence spécialisée dans les échanges sado-masochistes.
Par le passé, Journal du Japon vous avait d’ores et déjà parlé de Tokyo Décadence de MURAKAMI Ryū lors de l’article Tokyo Décadence : Errances sexuelles d’une ville sans espoir. « Enivrant brûlot érotique », Tokyo Décadence est un long-métrage que MURAKAMI Ryū – romancier de formation – adapte de sa propre nouvelle Topaz qu’il avait publié en 1986. A l’image de son style littéraire, Tokyo Décadence est un film froid suivant les errances nocturnes de Ai allant de rendez-vous sado-masochistes en rendez-vous sadomasochistes. MURAKAMI signe ici une ode acerbe d’un « Japon pourri » où il ne réside désormais ni avenir ni espoir.
youtube
Body Trouble (Dimanche 1er Juillet – 15h45 – La Filmothèque)
Un matin, un jeune homme dépressif nommé Hiromi se réveille dans le corps d’une femme. Déchiré entre le genre et le sexe, il cherche à tâtons une nouvelle façon de vivre.
Si le cinéma réalisé par des femmes n’est aucunement un genre – et ne sera jamais un genre –, Body Trouble est un film érotique japonais réalisé en 2014 par HAMANO Sachi qui, en utilisant simplement l’astuce scénaristique menant un homme à se réveiller dans le corps d’une femme, apporte un regard nouveau dans le cinéma érotique japonais. En présence de la réalisatrice, la séance sera l’occasion d’échanger avec une cinéaste évoluant dans l’actuelle industrie du cinéma japonais.
Wet Woman In The Wind (Dimanche 1er Juillet – 20h00 – La Filmothèque)
Kosuke, un acteur de théâtre qui a décidé de vivre en ermite au fond d’une forêt, se retrouve harcelé par Shiori, une jeune serveuse envahissante qui ne veut plus le quitter.
Si Journal du Japon était déjà revenu sur Wet Woman In The Wind à l’occasion de son article Roman Porno : Film rose nouveau cru à l’occasion de son retour sur les cinq films en hommage au Roman Porno pour les 45 ans de la Nikkatsu, le Festival du Film de Fesses permet aux spectateurs parisiens de (re)découvrir le film après son passage à l’édition 2016 de l’Etrange Festival. Réalisé par SHIOTA Akihiko, l’un des réalisateurs principaux de ce qu’on appelle parfois « nouvelle vague japonaise des années 1990 », Wet Woman In The Wind est un hommage à KUMASHIRO Tatsumi et son Les Amants Mouillés. Dimanche 1er Juillet, les deux films – celui de SHIOTA et celui de KUMASHIRO – viendront conclure cette cinquième édition du Festival du Film de Fesses.

En somme, un programmation riche en saveur et qui annonce un weekend de quatre jours d’ores et déjà extatique. Cinéphiles et amateurs de fesses pourront dès lors réviser leurs classiques du cinéma érotique japonais qui est l’un des plus éclectiques et inventifs. Cependant, la cinquième édition du Festival du Film de Fesses n’est pas uniquement composé la rétrospective « Montre tes nippons » et nous vous invitons grandement à aller vous rincer l’œil avec le Septième Art, notamment – comment résister – à la projection Samedi 30 Juin au Reflet Médicis du sublime La Saveur de la Pastèque du taïwanais Tsai Ming-Ling que le Festival du Film de Fesses propose en odorama !
Programme détaillé : https://www.lefff.fr/programme
Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.
1 note
·
View note
Text
« Gravity » live
Co-director, editor

Burnout Kids - Gravity (live session au Centre Ken Saro Wiwa)
director : Maxime Lauret & Pierre Lauret
production : oh no! & Burnout Kids
camera operator : Maxime Lauret
sound record & mix : Nicolas Defeudis
editor : Pierre Lauret
music : “Gravity” by Burnout Kids,
youtube
Burnout Kids
Facebook : https://www.facebook.com/burnoutkidsofficial/
Instagram : https://www.instagram.com/burnoutkidsmusic/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzfLX-w-xxIZlzaBU7biV4w
0 notes
Text
Raise Your Arms and Twist!
Writer

Raise Your Arms and Twist! Documentary of NMB48 de FUNAHASHI Atsushi : Le Crépuscule des idols
Présenté dans la section « Kanata, au-delà du miroir » à l’occasion de la douzième édition du Kinotayo, festival de cinéma japonais contemporain d’Ile-de-France, Raise Your Arms and Twist! Documentary of NMB48 de FUNAHASHI Atsushi était l’un des deux seuls documentaires de la sélection du festival.
Bien que le sujet des idols soit souvent absent de la ligne éditorial, FUNAHASHI Atsushi nous donne ici l’opportunité de palier à ce manque et de revenir sur un sujet aussi passionnant que dérangeant dès lors qu’il est abordé d’un point de vue sociologique et exempt de toutes notions d’adulation.

Idols et 48 Group : Origine et concept
Figure de proue de l’imagerie pop au pays du Soleil-Levant, les idols sont un concept souvent peu ou mal compris ici, en Occident. Tout d’abord, le terme diffère du sens que nous lui apposons usuellement puisqu’au Japon, les idols renvoient à une activité professionnelle dans le monde de l’entertainment. Bien que prenant généralement la forme de girls band féminins sur-médiatisés et composés d’adolescentes, il existe en réalité autant de types d’idoling que d’idols, en somme, une infinité si l’abus de langage le permet. Usuellement connus pour leur musique, les idols apparaissent aussi bien dans le monde de l’actorat ou du mannequinat que dans l’industrie musicale. En somme, une simplification mènerait à accepter la chose suivante : l’idoling est un ensemble d’idols apparaissant dans les diverses strates de l’entertainment avec comme principal motto l’image renvoyée. Il va sans dire que, malgré l’appartenance à ce monde du show-business, les idols ne sont pas nécessairement synonyme de célébrité, de richesse ou de succès.
C’est à la suite du succès au Japon des chanteuses yéyé françaises dans les années 1970 que le concept d’idoling se développe pour acquérir aujourd’hui une place prépondérante dans la société japonaise. Le premier groupe qu’il faut mentionner est celui de Candies (1972 – 1978) qui marque l’apparition du wotagei, un ensemble de danses et de techniques d’encouragement par des fans extrêmes à destination de leurs idols favorites. Dans les années 1980, c’est le producteur AKIMOTO Yasushi qui se fait représentant du premier âge d’or de l’idoling avec Onyanko Club (1985 – 1987), un groupe à l’effectif changeant, atteignant une cinquantaine de membres, divisé en de nombreux sous-groupes. Après un léger déclin de popularité durant les années 1990, le producteur Tsunku relance l’idoling en reprenant le concept d’Onyanko Club avec, en 1997, la création du groupe Morning Musume qui devient, en 1999, avec son single Love Machine le groupe le plus populaire au pays du Soleil-Levant. Malgré un léger déclin de popularité à partir de 2001, Morning Musume rafle de nombreux records, dont celui de longévité pour un groupe d’idoling grâce à un système de remplacement des membres quittant le groupe : 40 membres ont ainsi marqué 13 générations du groupe en 20 ans d’existence. Au début du nouveau millénaire, Tsunku atomise le marché de l’idoling en créant un grand ensemble d’idols, le Hello!Project, qui réunit l’intégralité de ses productions et qui, par conséquent, comporte trois des plus grands succès du milieu : Morning Musume, °C-ute et Berryz Kōbō.
youtube
Cependant, rien n’est éternel au pays des idols et en 2005, profitant de la baisse de popularité de Morning Musume, AKIMOTO Yasushi renouvelle l’idoling en lançant le groupe AKB48 depuis le quartier d’Akihabara à Tokyo. Initialement composé de 20 jeunes adolescentes, le groupe s’impose rapidement grâce au concept de « idols you can meet » qui apporte une certaine promiscuité entre le public et les membres, notamment lors de handshakes où les fans peuvent échanger et serrer la main de leurs membres préférées. Trustant le haut des ventes, AKB48 est un tel succès qu’AKIMOTO Yasushi lance le 48 Group, un ensemble de « groupes sœurs » délocalisés, qu’il créé sur le même modèle que AKB48, avec SKE48 en 2008 à Nagoya, NMB48 à Osaka en 2010, HKT48 à Fukuoka en 2011 ou plus récemment avec NGT48 à Niigata en 2015, et STU48 à Setouchi en 2017. L’appel de l’argent ne se faisant que peu sentir, le producteur porte le concept à l’étranger avec JKT48 en 2011 à Jakarta ou SNH48 en 2012 à Shanghai – ce dernier ayant fait scission et créé ses propres « groupes sœurs » à travers la Chine : BEJ48, GNZ48, SHY48. Par ailleurs, AKIMOTO Yasushi est allé jusqu’à assurer sa main mise sur l’entertainment japonais en créant lui-même la concurrence du 48 Group en créant le Sakamichi Series, composé de Nogizaka46 et de Keyakizaka46 et qu’il base toujours sur le même système.
Bien que l’appellation de cet ensemble ne soit pas officielle, depuis 2011 un ensemble de documentaire « Documentary of … », commandé et réalisé en interne, vient présenter en profondeur les différents groupes signés AKIMOTO Yasushi. Aujourd’hui, les groupes SKE48, NMB48, HKT48, JKT48 et Nogizaka46 ont eu le droit à leur documentaire respectif et AKB48 en compte cinq de produits. Cependant, il faut constater que mis à part Kanashimi No Wasurekata Documentary of Nogizaka46 qui se distinguait par sa forme et son esthétique, seul Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 se démarque par son analyse de cette industrie, par la profondeur de sa réflexion et par son sens artistique notable.
youtube
FUNAHASHI Atsushi, Osaka et NMB48
Ce n’est pas un hasard si Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 est passé en 2017 par de prestigieux festivals tels que les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal ou le Hong Kong International Film Festival, puisque le réalisateur n’est autre que FUNAHASHI Atsushi dont nous parlions déjà au sujet des témoignages cinématographiques sur la catastrophe du Tohoku.
FUNAHASHI Atsushi a commencé sa carrière avec Echoes en 2001. En 2006, il signe Big River avec ODAGIRI Joe, qui lui offre l’opportunité d’être diffusé dans des festivals comme le Busan International Film Festival en Corée du Sud ou à la Berlinale en Allemagne. En 2012 puis 2015, FUNAHASHI Atsushi témoigne d’un message politique certain, sans être pour autant dans une logique purement contestataire, avec le diptyque Nuclear Nation où il suit la vie des rescapés de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.
S’il peut paraître étrange qu’un tel documentariste ait été à la tête du projet Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48, on peut tout de même mettre en avant le fait que FUNAHASHI Atsushi est originaire d’Osaka. Basé à Namba, le quartier des loisirs d’Osaka, les NMB48 entretiennent aussi un rapport privilégié à leur ville d’origine. Contrairement à ses « groupes sœurs », le groupe dépend bien moins de sa fanbase nationale que de celle de la capitale du Kansai. Et FUNAHASHI Atsushi a bien conscience de cela puisque rapidement, il le caractérise à l’image et au son dans son documentaire. En plus de filmer les idols qui s’expriment entre elles en kansai-ben – patois du Kansai –, le réalisateur ancre fortement leur histoire dans leur ville en illustrant abondamment le quartier dans lequel elles évoluent, ce qui représente un contre-pied par rapport au style des cinq Documentary of AKB48 qui eux, n’illustrent que bien peu le quartier d’Akihabara à Tokyo.
Cependant, bien que l’on ait affaire à un réalisateur qui ose des choses, FUNAHASHI Atsushi dissimule difficilement la différence entre son propos et ce semble provenir d’un cahier des charges. Ainsi, malgré la volonté de montrer l’unicité de NMB48, le documentaire met un peu trop le groupe en parallèle des AKB48. Dès lors, cette opposition, que l’on suppute être entre le réalisateur et les producteurs, va jusqu’à infuser l’esthétisme du film où stock-footage (Ndlr : images d’archive) et plans originaux se distinguent fortement.

Nietzsche-senpai : idoling et philosophie
Après la scène d’ouverture sur une version live de Kamonegix – le huitième single des NMB48 – dans un stade rempli, FUNAHASHI Atsushi donne rapidement le ton de son documentaire avec une citation de Friedrich NIETZSCHE lue par l’idol et aspirante philosophe SUTŌ Ririka. Si le parallèle jouant sur le terme idol peut sembler facile dans un premier temps, la compréhension du documentaire repose intégralement sur l’ensemble des interventions de cette membre détaillant en quoi l’idoling est un lieu propice aux questionnements sur soi. Car FUNAHASHI Atsushi ne peut critiquer librement cette industrie et ses travers avec un documentaire financé par les pontes du milieu, ici AKIMOTO Yasushi. Ainsi, c’est au spectateur de faire l’effort de recouper les propos de SUTŌ Ririka avec les images d’idols chantant, dansant, répétant, pleurant, rigolant ou simplement exprimant leur ressenti sur leur place dans le groupe.
L’esthétisme de ces intermèdes philosophiques en fait aussi de parfaites clefs de lecture dans ce documentaire aux fausses allures de présentation de groupe. SUTŌ Ririka étant filmée sur un bateau remontant un fleuve, les ponts surplombant ce dernier viennent par moments dissimuler la lumière du soleil, plongeant la jeune idol et la caméra dans un noir quasi total. Dès lors, cette idée de visible et de non-visible, vient rappeler la dure loi de l’idoling où « la course aux fans » est prônée entre les groupes mais aussi entre les idols même composant ces groupes. Car dans l’idoling, seules les plus populaires sont sur les devants de la scène. Ainsi, derrière les noms de YAMAMOTO Sayaka, JONISHI Kei, SHIROMA Miru, YAGURA Fūko et de WATANABE Miyuki, c’est une quarantaine de membres des NMB48 qui demeurent dans leur ombre.

Ainsi, tout au long de Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48, il est aisé de prendre fait et cause pour ces idols dans l’ombre qui, la faute à leur popularité très restreinte, ne peuvent participer aux singles et à la majeure partie des activités du groupe. Pourtant, l’intelligence du documentaire de FUNAHASHI Atsushi ne s’arrête pas là puisqu’il choisit de donner la parole à de nombreuses membres, comme les autres Documentary of … , mais aussi aux familles de celles-ci, aux managers, aux fans et aux membres ayant d’ores et déjà quitté le groupe pour poursuivre leur carrière, ce que ne faisaient pas nécessairement les autres Documentary of …. C’est alors une vision totale de l’industrie et de ses conséquences qui s’offre aux spectateurs et qui, une fois recoupée par les propos de SUTŌ Ririka, livre un triste constat.
À tous les niveaux de l’idoling, une questionnement vivace de soi s’opère. En plus de ces « petites » membres, Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 dévoile que les membres importantes vivent les mêmes doutes, mais à une échelle différente. La figure principale du groupe, YAMAMOTO Sayaka, explique qu’elle a connu, elle aussi, ces positionnements de fonds de scène lorsque AKIMOTO Yasushi a entrepris durant des singles de mettre des membres de tout le 48 Group sous la bannière de AKB48. De même, les membres YAGURA Fūko et SHIROMA Miru qui, la faute à une popularité quasi similaire, sont sans arrêt mises en confrontation alors qu’elles n’entretiennent aucune animosité l’une envers l’autre. Enfin, c’est aussi les fans qui sont bien souvent diabolisés et caractérisés comme des pervers ou des personnes malades qui ont enfin le droit à la parole, ce qui offre des témoignages intéressants sur les rapports que les fans entretiennent avec leurs idols favorites et sur leur rapport à leur passion.
youtube
Bien qu’il soit un important documentaire sur le sujet, on peut regretter le fait que Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 ait été réalisé avant le scandale de SUTŌ Ririka annonçant son mariage sans mentionner son départ du groupe ce qui va à l’encontre des règles du loveban régissant l’idoling japonais, et avant que la membre JONISHI Rei soit hissée sur les devants de la scène dans une tentative voyante de « remplacement de sa sœur » JONISHI Kei qui venait de quitter le groupe.
Par ailleurs, le film de FUNAHASHI Atsushi s’avère être le seul documentaire méritant d’être vu dans cette sélection 2017 du Kinotayo. On peut par conséquent ouvertement critiquer la diffusion restreinte mise en place par le festival – une séance unique le samedi à 13 h30 – alors que le film mérite à lui seul d’être visionné de multiples fois pour saisir la richesse d’information sur l’idoling qu’il contient.
Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.
0 notes
Text
Kinotayo 2017, partie 2
Writer

Kinotayo 2017, partie 2 : MATSUI, dernier rempart avant la débâcle
Voilà maintenant trois années consécutives que Journal du Japon se rend au Kinotayo à Paris pour faire le point sur le cinéma contemporain japonais, et force est de constater lors de cette douzième édition que le festival perd de sa superbe d’année en année. Lors de notre premier retour sur la sélection 2017 et de notre critique de Perfect Revolution – film en compétition cette année – nous émettions d’ores et déjà certaines réserves au sujet du palmarès et de la capacité du festival à se placer comme représentant honnête de l’état du cinéma contemporain japonais.
Ces critiques auraient été de simples regrets si le festival n’avait pas fait preuve de sérieuses lacunes en matière de sélection. Entre un énième documentaire sur un personnage atypique à Fukushima et de nombreux films trop sirupeux pour contenter les plus exigeants, il va sans dire que cette édition avait son lot de déceptions. Il est toutefois de rigueur d’admettre que des films tels que Rage de LEE Sang-Il ou Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue de ISHII Yuya ont constitués d’agréables surprises. De même, si l’absence l’an dernier de A Bride for Rip Van Winkle de IWAI Shunji – réalisateur définitivement boudé en France – s’avérait aberrante, le Kinotayo compense cette année ses erreurs passées avec la sélection de Japanese Girls Never Die de MATSUI Daigo, l’un des cinéastes japonais les plus prometteurs du moment.
Nous reviendrons plus en détail ultérieurement sur Rage de LEE Sang-Il et Documentary of NMB48 : Raise your arms and twist de FUNAHASHI Atsunashi au cours d’articles dédiés, terminons donc tout d’abord notre tour d’horizon de la programmation de cette douzième édition du Kinotayo.
Oh Lucy! : L’Herbe est plus verte chez Josh HARTNETT
Après un passage par la Semaine de la Critique pendant le Festival de Cannes, Oh Lucy de HIRAYANAGI Atsuko s’annonçait comme le film grand public de ce Kinotayo 2017. En adaptant son propre court-métrage de fin d’études ayant raflé une trentaine de prix dans des festivals internationaux, HIRAYANAGI Atsuko signe avec Oh Lucy! son premier long métrage. Avec une intrigue se déroulant entre les États-Unis et le Japon, Oh Lucy! possède ce caractère biculturel qui n’est pas sans rappeler Map of the Sounds of Tokyo de Isabel COIXET ou Lost In Translation de Sofia COPPOLA. Le film suit les aventures de Setsuko – a.k.a. Lucy – quittant Tokyo pour le Sud californien à la recherche de sa nièce Mika et de John, son professeur d’anglais duquel elle s’est éprise.
Malgré la présence de KUTSUNA Shiori, la véritable qualité d’Oh Lucy! réside dans son casting. Grâce à la présence d’une TERAJIMA Shinobu emplie de sincérité et d’un Josh HARTNETT dont la classe et la prestance ne finiront jamais de nous étonner, le film d’Atsuko HIRAYANAGI surprend par sa crédibilité. De surcroît, ayant fait ses études aux États-Unis, la réalisatrice se sert de ses expériences pour apporter un certain réalisme dans les interactions entre Japonais et États-Uniens.
Cependant, si dans sa propre vie HIRAYANAGI Atsuko a pu trouver aux États-Unis un paradis lui ayant permis de fuir la morosité de son Japon natal, le traitement cinématographique de cette histoire aux allures de « l’herbe est plus verte ailleurs » semble un peu facile. Si KIKUCHI Rinko quittait un Tokyo grisâtre pour un Minnesota tout aussi grisâtre dans Kumiko, the Treasure Hunter de David ZELLNER, Setsuko nous mène, quant à elle, vers une Californie ensoleillée recouverte d’un étalonnage des plus clichés lorsque l’on traite des régions sud des États-Unis. Bien que le troisième acte du film vienne apporter un peu de couleurs dans cette ville qu’est Tokyo, Oh Lucy! reste un film grand public qui porte en lui toutes les facilités scénaristiques que cela implique.
Soleil d’Or ex aequo de ce Kinotayo 2017, Oh Lucy! sortira le 31 janvier sur les écrans français grâce à Nour Films.
youtube
Japanese Girls Never Die : La Mélancolie d’Haruko Azumi
Après les sublimes Our Huff and Puff Journey et Wonderful World End, MATSUI Daigo revient avec Japanese Girls Never Die – auquel nous préférerons désormais le titre Haruko Azumi is Missing – et signe l’un des films les plus touchants de cette édition du Kinotayo, mais aussi du cinéma japonais de ces dernières années. Porté par un casting cinq étoiles, on note notamment le retour tant attendu de l’actrice AOI Yū dans un rôle principal lui permettant de livrer une des performances les plus touchantes de sa carrière. De la même manière, TAKAHATA Mitsuki réalise l’exploit de rendre attachant et attendrissant un personnage de fille extravertie au style fantasque, là où KOMATSU Nana nous avait laissé de profonds stigmates dans l’exécrable Destruction Babies.
À la manière de ses films précédents, MATSUI Daigo affirme son statut de réalisateur au montage millimétré et au propos chiadé. Aidé par la chronologie éclatée qu’il met en place, il compose une véritable ode féministe au travers d’un portrait désenchanté – et néanmoins empli d’espoir – de femmes japonaises. Haruko Azumi, une jeune employée de bureau de 27 ans, disparaît mystérieusement un jour. Peu à peu, son portrait devient viral après qu’un groupe de street-artists ait choisi d’utiliser son avis de recherche comme pochoir. Bien qu’atypique dans la filmographie du réalisateur, Haruko Azumi is Missing traite malgré tout des milieux estudiantins que MATSUI Daigo affectionne. Coïncidant étrangement avec la disparition de la jeune femme, un gang de lycéennes se met à sévir en ville, décidant de prendre leur revanche sur tous les hommes croisant leur chemin.
En moins de deux heures, le réalisateur questionne la place de la femme dans le Japon contemporain, mais s’interroge aussi sur le pouvoir que l’art et les réseaux sociaux peuvent avoir, notamment vis-à-vis de l’émancipation de ces dernières. Au travers de Haruko Azumi, MATSUI Daigo suit ces femmes ne pouvant se résoudre à une société leur ayant taillé un chemin à suivre passant irrémédiablement par le mariage et le fait d’avoir des enfants.

Enfin, Haruko Azumi is Missing est aussi un portrait générationnel. Chez elle, Haruko voit quotidiennement sa mère tenter d’entretenir sa grand-mère sénile alors que son mari est totalement inactif. Que cela passe par une simple « guerre de la télécommande » ou par son manque d’implication domestique, Haruko brise à sa façon le conformisme familial. A contrario, Haruko se confronte lors de ses pérégrinations à des générations plus jeunes qui s’avèrent tout aussi désenchantées que la sienne, à l’instar de l’innocence brisée d’une jeune fille de sept ans ou de lycéennes trouvant leur liberté dans un certain nihilisme vis-à-vis de la société.
En somme, MATSUI Daigo livre ici le film le plus conséquent de sa jeune carrière qui s’avère être un véritable chef-d’œuvre du cinéma contemporain japonais. Injustement reparti sans récompense du Kinotayo 2017, le film atteste que le réalisateur est définitivement l’un des plus prometteurs de ces dernières années. On regrettera par ailleurs que les mouvements féministes occidentaux préfèrent faire l’éloge de films artistiquement insignifiants comme Wonder Woman de Patty JENKINS plutôt que de véritables œuvres faisant preuve d’une réelle intelligence telle que Haruko Azumi is Missing. Preuve, encore une fois, que si le cinéma japonais est de plus en plus reconnu, il reste néanmoins une cinématographie minoritaire internationalement.
youtube
The Long Excuse : Un air de déjà-vu
Distribué dans les salles de l’Hexagone dans la foulée du festival, The Long Excuse est un fier représentant des films auquel il serait possible d’attribuer le « label Kinotayo ». Doté d’une fausse photographie chiadée qui s’avère finalement vide de sens, le film de NISHIKAWA Miwa n’est jamais désagréable, mais ne laisse cependant aucun souvenir impérissable. Suivant le parcours de deux maris confrontés à la mort de leurs femmes respectives dans un accident de bus, le film devait marquer le retour de FUKATSU Eri sur les écrans français après son incroyable performance dans Vers l’autre rive de KUROSAWA Kiyoshi. Cependant, les aléas routiers obligeant, celle-ci disparaît des écrans après cinq petites minutes de film, laissant ainsi le spectateur pendant deux heures avec un MOTOKI Masahiro aseptisé et un TAKEHARA Pistol tentant vainement de jouer dans un registre tire-larmes.
À l’image de son casting, The Long Excuse est un film convenu au traitement convenu et à l’organisation tout aussi convenue. Le scénario du film, écrit par NISHIKAWA Miwa elle-même et adapté de son propre roman, emprunte des sentiers éculés de la représentation du deuil au travers de ce mari égocentrique ayant perdu sa femme qu’il trompait. N’atteignant jamais les émotions souhaitées, la réalisatrice semble vouloir marcher sur les plates-bandes de son mentor KORE-EDA Hirokazu avec qui elle a commencé comme assistante-réalisatrice pour After Life. The Long Excuse met effectivement en scène une enfance qui détiendraient une innocente vérité et symboliseraient un avenir à protéger, mais n’atteint jamais la finesse de KORE-EDA.
Malgré son Soleil d’Or ex-æquo, The Long Excuse s’avère très peu aventureux, faisant parfois preuve de quelques longueurs. Si le spectateur exigeant et avisé n’y trouve qu’une indifférence jamais horripilante, le quidam pourra potentiellement y trouver un certain plaisir. Il reste néanmoins important de préciser que MAG Distribution réalise un travail important pour le cinéma japonais en France en distribuant un film qui ne possède pas de grands noms et qui n’est pas passé par des festivals significatifs en France comme le Festival de Cannes ou la Berlinale.
youtube
Close-Knit : Un sujet important pour un film insignifiant
Comme chaque année, le Kinotayo a son lot de films aux sujets « durs » dénonçant plus ou moins vivement certaines réalités. Comme chaque année, il est nécessaire de rappeler que parler de sujets importants ne garantit pas le fait de réaliser un film qualitativement bon, contrairement à ce qu’une certaine frange de spectateurs puisse penser. Sans être un affront cinématographique, Close-Knit de OGIGAMI Naoko s’avère être un film impalpable que l’on oublie plus rapidement qu’il se découvre. Deux heures durant, la réalisatrice qui a commencé sa carrière par un passage à la Berlinale en 2003 avec Yoshino’s Barber Shop, traite de l’acceptation des LGBT dans la société japonaise.
Tomo, une jeune fille de 11 ans, vit avec sa mère qui ne s’occupe quasiment pas d’elle. Alors que cette dernière la quitte une nouvelle fois pour partir avec un homme, Tomo se réfugie chez son oncle et rencontre alors Rinko, une femme transgenre, en qui elle voit peu à peu la mère qu’elle souhaitait avoir.
Avec Close-Knit, OGIGAMI Naoko tente de montrer les difficultés auxquelles Rinko se confronte dans sa vie quotidienne, mais sans que l’on sache réellement pourquoi, le film semble traiter à la volée ces questions. Bien que la dureté des propos à son encontre ou que le harcèlement scolaire d’un jeune enfant cherchant son identité sexuelle soient clairement visibles à l’écran, jamais ils ne marquent, ne choquent ou n’émeuvent. De plus, le choix de IKUTA Tōma dans le rôle de Rinko amène à se demander si un jour les personnages transgenres au cinéma pourront enfin être joués par des acteurs transgenres.
En somme, Close-Knit est un film au sujet important qui, à cause d’un traitement cinématographique qui n’ose rien, n’atteint jamais le résultat escompté. De plus, le film est alourdi par les poncifs du cinéma contemporain japonais aux allures de carte postale, allant jusqu’à la traditionnelle scène sous les cerisiers en fleur. Il faut avouer que OGIGAMI Naoko a de surcroît la malchance d’arriver dans les festivals français la même année que Jane de CHO Hyun-Hoon – mettant lui aussi en scène un personnage transgenre – qui faisait preuve d’un véritable sens de la photographie ainsi que d’une intelligence et d’une beauté assez rares.
youtube
Trace of Breath : Une salade de trop à Fukushima
Que cela soit Memories of the Lost Landscape et The Horses of Fukushima de MATSUBAYASHI Yoju, Les voix silencieuses de Lucas RUE et SATO Chiho, ou encore Alone In Fukushima de NAKAMURA Mayu, il existe aujourd’hui pléthore de documentaire revenant sur la catastrophe de Fukushima et ses conséquences depuis 7 ans. Traces of Breath de KOMORI Haruka est l’un d’eux, où le spectateur suit SATO Teīchi, un vieil homme ayant tout perdu dans le tsunami de 2011, et qui aujourd’hui produit et vend ses propres semences agricoles à Rikuzentakata. Ce personnage atypique s’avère être devant la caméra de KOMORI Haruka un véritable puits de connaissance sur la nature et la région. Il a par ailleurs écrit un livre en anglais et en chinois pour partager son expérience et ses peines depuis mars 2011 ainsi que de rendre hommage aux victimes.
Bien que l’intention soit louable – aussi bien pour KOMORI Haruka que pour SATO Teīchi –, ce type de documentaire est devenu par la force des choses un véritable fléau pour le cinéma contemporain japonais. Chacun voulant aller de son petit hommage, ce qui – encore une fois – est somme toute louable, on peut voir de plus en plus de personnes, qui ne sont pas nécessairement des cinéastes, venir documenter la situation dans la région.
Le processus est bien souvent le même et les films arborent les mêmes caractéristiques en matière d’esthétisme et de forme. Dès lors, les portraits de personnes atypiques – souvent âgées – ayant choisi de rester dans région pour préserver une faune et une flore ou simplement promouvoir une agriculture locale abondent, mais sans pour autant soulever aucune question, problématique ou sujet autre que nous dévoiler ces personnes au caractère généralement bien trempé. De plus, ces documentaires semblent emprunter inconsciemment le sentier voulu par le gouvernement japonais, en occultant – ou en ne les interrogeant pas – les risques de la région.
Si ce retour ne s’applique spécifiquement à Traces of Breath, mais traite d’un ensemble de films, c’est parce qu’il devient épuisant de voir encore et toujours le même film où seuls les intervenants et « légumes plantés » changent. Pour autant, aux vues de Friends after 3.11 de IWAI Shunji – encore lui – il est possible de réaliser un documentaire intelligent, intéressant et émouvant sur le 11 mars 2011 et ses conséquences. Le problème de Traces of Breath et ses compères se situe ainsi définitivement dans leur forme et non pas leur sujet.

En somme, le Kinotayo 2017 n’offrait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour garder un souvenir impérissable de cette édition. Malgré les fulgurances de génie signées MATSUI Daigo et LEE Sang-Il, c’est un bien triste portrait du cinéma contemporain japonais auquel nous avons assisté. Si l’on ajoute à cela une organisation et une communication qui laissent à désirer, il n’était pas vraiment étonnant de voir la salle du Club de l’Étoile rester à moitié vide. Cependant, comme nous nous refusons de dresser des retours trop négatifs, félicitons le Kinotayo pour nous avoir permis de retrouver AOI Yū et Josh HARTNETT sur les grands écrans.
Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.
0 notes
Text
Brève histoire de cinéma
Writer

Affaires de genres au pays du matin calme : Brève histoire de cinéma
Dans la langue française, le terme « genre » possède de multiples sens. Au cinéma, il désigne une « catégorie d’œuvres artistiques de même style, de même sujet, etc. »1. Du point de vue des sciences humaines et sociales en revanche, il renvoie à une « construction sociale qui hiérarchise les hommes et les femmes » et dont résulte « des conventions culturelles, des rôles sociaux, des comportements, des représentations sociales et la division sexuelle du travail et du pouvoir »2.
À la recherche d’un cinéma perdu
À l’instar de Rome, une cinématographie nationale ne se construit pas en un jour. Par conséquent, il est essentiel de connaître et d’analyser son histoire pour comprendre au mieux les formes que celle-ci adopte aujourd’hui. D’autant plus que le cinéma sud-coréen s’avère singulièrement problématique puisqu’il est, à ce jour, quasiment dénué de films de patrimoine visibles. Bien que la Korean Film Archive tente depuis 2007 de palier à ce manque en procédant à de nombreuses restaurations et en composant un fond d’archive, il s’avère compliqué d’en tracer une histoire exhaustive. Ainsi, les connaissances disponibles reposent principalement sur des écrits et des témoignages de l’époque dont l’exactitude est aisément discutable, en raison de la victimisation coréenne3.
Outre la fragilité des premières pellicules, l’occupation japonaise de la Corée est une des causes premières de cette absence de patrimoine. Initiée en 1905 par un protectorat et officialisé en 1910 par un traité d’annexion, la présence nippone empêche le cinéma coréen des premiers temps d’avoir ses propres balbutiements et va jusqu’à lui mettre une muselière en 1929 avec l’institutionnalisation d’une censure. Toutefois, cette occupation n’a pas eu pour seul effet de brimer le cinéma de la péninsule coréenne puisque lors de la capitulation du Japon en 1945, les forces en place ont potentiellement occasionné la perte de nombreux films par le biais de destructions ou de rapatriements des bobines.
Il est néanmoins possible d’établir certaines dates et événements clefs. En 1919, un film d’une dizaine de minutes, La Juste Vengeance (Yonsoeguk), est projeté lors d’une représentation théâtrale et devient la première fiction coréenne. En 1923, les deux premiers longs métrages de fictions coréens, Promesse d’amour sous la lune (Dalbich salang-ui yagsog) et L’Histoire de Chun Hyang (Chunhyangjeon) sont réalisés par Yun Paeng-Nam. Ces premiers films témoignent d’une tendance à produire du cinéma de propagande et des adaptations de contes qui s’explique par le contexte politique et religieux du pays. En 1930, l’étau japonais se resserrant un peu plus sur la péninsule, un certain nombre de Coréens fuient vers Shanghai où le cinéma est alors en pleine croissance. De ce fait se développe un cinéma coréen délocalisé et anti-japonais s’essayant notamment au genre du drame.
À la suite de la capitulation du Japon en 1945 la Corée est libérée mais s’avère complètement ruinée économiquement. Le cinéma coréen ne connaît donc pas à cette époque de croissance significative malgré l’apparition d’un mouvement composé de films muets en 16mm se réjouissant de cette liberté retrouvée. Cet élan s’arrête subitement avec la Guerre de Corée qui éclate en 1950 et condamne la production cinématographique nationale annuelle à un chiffre nul jusqu’en 1953. D’autant que, le front se déplaçant régulièrement le long de la péninsule, le patrimoine culturel coréen – qu’il soit cinématographique, littéraire, architectural, etc. – subit de nombreuses pertes irrémédiables. Enfin, lors de la signature de l’armistice et l’adoption du 38e parallèle comme frontière entre les deux Corées en 1953, le Sud se voit privé d’une partie de son passé. Pyongyang, historiquement capitale culturelle de la péninsule, devient la capitale du Nord.

The Hand of Fate (Unmyong-ui son) de Han Hyong-Mo, 1954.
De 1954 à 1993, un cinéma sous le signe des dictatures
En 1954, Han Hyeong-Mo marque la reprise de la production cinématographique coréenne avec The Hand of Fate4 (Eunmyongui son) et signe par la même occasion le premier film de la péninsule arborant le préfixe « sud ». Mettant en scène l’infiltration d’une espionne nord-coréenne, le film est de surcroît le premier film anticommuniste réalisé en Corée du Sud. Véritable maelström de genres en mêlant comédie, romance, drame et espionnage, The Hand of Fate initie aussi un geste de cinéma « alors identifié comme ‘une fusion des genres’, [qui] va imprégner la quasi-totalité du cinéma sud-coréen jusqu’à nos jours »5.
Sous l’influence du président Rhee Syngman, le cinéma doit à cette époque se mettre dans le même sens de marche que l’État et contribuer à la transposition de l’ancienne vision anti-japonaise des années 1930 vers le nouvel ennemi communiste. Le gouvernement supprime alors les impôts pour l’industrie du cinéma et crée la Korean Film Unit pour mettre en place un véritable cinéma de propagande qui, dans la lignée de The Hand of Fate, se base sur le principe de fusion des genres. On retrouve notamment à cette période Han Hyeong-Mo en 1956 avec Hyperbole de la jeunesse (Chongchun ssanggogseon), une romance humoristique sur fond de pauvreté causée par la guerre ou encore une satire historique de Lee Byung-Il, Le jour où elle s’est mariée (Shijibganeun nal). Dans la même logique, Piagol de Lee Kang-Cheon marque en 1955 l’une des premières censures politiques du pays. Le long métrage aux allures de docu-fiction, alternant entre moments de drame et de comédie, suit les aventures d’une guérilla nord-coréenne. En l’absence de contre point de vue sud-coréen rendant quasiment héroïques les individus du Nord, le film est interdit de distribution pour « atteinte à la loi sur la sécurité nationale ». Si la diversité des réalisations proposées pâtit grandement de cette conjoncture, le chiffre de production quant à lui explose et laisse apparaître deux noms commençant à creuser nettement leur sillon : Shin Sang-Ok et Im Kwon-Taek.
Les années 1960 et 1970 sont marquées par une Corée du Sud sombrant dans la dictature à la suite du coup d’État de Park Chung-Hee en 1961 et l’instauration d’un état d’urgence débouchant sur l’adoption de la Constitution Yusin en 1972. Dans la continuité de la politique de Rhee Syngman, le cinéma sud-coréen est de plus en plus surveillé et voit, tout comme la population, sa liberté lui échapper dans le but de produire des films encore plus nationalistes. Pour assurer sa mainmise sur les sociétés de production, l’État met en place durant cette vingtaine d’années des lois particulièrement contraignantes. Des normes financières et techniques sont alors imposées et une obligation de produire plus de 15 films nationaux par an minimum pour pouvoir continuer son activité est instaurée. Cette politique s’avère efficace et sur les 71 sociétés de production en 1961, il n’en reste que 16 en 1962. Les petites compagnies sont astreintes à fermer et les restantes doivent fusionner entre elles. Si Im Kwon-Taek se plie à la volonté de l’État en réalisant des films anticommunistes ou de promotion de la nouvelle constitution, Shin Sang-Ok lui se voit privé de ses capacités de production et de réalisation en 1974 par un décret gouvernemental. La carrière - et la vie – de ce dernier connaît un tournant en juillet 1978, lorsqu’il se fait enlever avec sa femme par la Corée du Nord, bien que les conditions brumeuses peuvent laisser penser qu’il s’agissait d’une évasion.

Winter Woman (Gyeo-ul-yeoja) de Kim Ho-Sun, 1977.
Durant la seconde moitié des années 1970 apparaît aussi la politique implicite des 3 S (Sex, Screen and Sport) dans le but de détourner l’attention de la population des difficultés du quotidien et d’avorter les volontés de contestations. Les films d’hôtesses, nouveau genre de mélodrame, se révèlent alors et s’offrent comme sujet principal la sensualité des femmes et la beauté de leurs corps. Le cinéma de Kim Ho-Sun est le plus représentatif de cette politique à l’instar de Winter Woman (Gyeo-ul-yeoja) en 1977 mettant en scène l’histoire d’Yi Hwa, une jeune fille décidant d’offrir son corps à tous les hommes qu’elle rencontre après avoir mené quelqu’un au suicide en refusant de coucher avec lui. Toutefois, a posteriori, Yeong-ja’s Heydays (Yeongja-ui jeonseong sidae) s’avère être le plus intéressant de cette période et de la filmographie du réalisateur. Malgré la censure de l’époque, le film réussit à présenter le sexe comme une affaire politique et une fuite du quotidien en montrant que son exploitation est une conséquence de la modernisation et l’industrialisation accélérée sud-coréenne.
Cependant, cette fin de décennie se conclut par l’assassinat de Park Chung-Hee et le coup d’État de Chun Doo-Hwan en 1979 menant la Corée du Sud vers une loi martiale en 1980. Cette loi martiale marque le pays par ses dérives particulièrement violentes, notamment la répression du soulèvement de Gwangju6 qui laissera au pays de profonds stigmates dont le cinéma s’imprègne encore aujourd’hui. Le cinéma de cette époque, quant à lui, se concentre principalement sur des adaptations littéraires jusqu’en 1988, où l’arrivée de la démocratie et d’une nouvelle constitution permettent un assouplissement de la censure et une réémergence des petits studios indépendants.

Yeong-ja’s Heydays (Yeongja-ui jeonseong sidae) de Kim Ho-Sun, 1975.
Une nouvelle démocratie pour un nouveau cinéma
Sur fond de crise économique, le cinéma sud-coréen des années 1990 et du début des années 2000 se procure dans cette nouvelle démocratie une liberté d’expression cinématographique dévoilant une défiance totale envers les institutions, bien souvent corrompues. Bien que les mélodrames et les films sur le conflit Nord-Sud persistent, apparaît un cinéma militant et révolté s’interrogeant sur la place des individus dans la société. De jeunes cinéastes se révèlent comme notamment Lee Myung-Se, Jang Son-Woo ou encore Park Chan-Wook. Les protagonistes du cinéma sud-coréen cessent alors d’être des martyres inspirés du christianisme et du bouddhisme pour devenir de véritables anti-héros, acteurs actifs de cette société défaillante. Les forces de l’ordre deviennent les principales victimes de ce cinéma après des années de censure où « évoquer la police revenait immanquablement à parler de l’ordre dictatorial, des couvre-feux et des contrôles militaires. Cette contrainte permettait également de passer sous silence la corruption alors notoire dans l’administration policière »7. De la même manière, la reconnaissance et les condamnations des exactions lors du soulèvement de Gwangju en 1980 viennent suinter dans le cinéma sud-coréen comme en témoignent de nombreux films au succès importants tels que A Petal (Ggotip) de Jang Sun-Woo, Peppermint Candy (Bakha satang) de Lee Chang-Dong, Le Vieux jardin (Oraedoen jeongwon) d’Im Sang-Soo.

My Sassy Girl de Kwak Jae-Young, 2001
En bonne santé et fortement soutenu par les entreprises privées espérant des retombées économiques conséquentes, le cinéma sud-coréen s’ouvre à l’international durant les années 2000. Bien que connaissant un succès médiocre en Corée du Sud, cette internationalisation se fait par les nombreuses sélections en festival des réalisateurs Kim Ki-Duk et Hong Sang-Soo. Profitant de la fragilisation du cinéma hongkongais, cette ouverture passe aussi par la multiplication des coproductions avec la Chine, comme Failan de Song Hae-Sung et Musa, la princesse du désert de Kim Sung-Soo s’offrant respectivement les stars Cecilia Cheung et Zhang Ziyi en 2001. Les comédies romantiques, maître incontesté en matière de ‘fusion des genres’, ne sont pas en reste non plus avec notamment les succès de l’iconique My Sassy Girl de Kwak Jae-Young en 2001 et d’Oasis de Lee Chang-Dong en 2002. Cependant, c’est le cinéma contestataire qui brille de mille feux avec notamment les nombreuses récompenses en festival de Park Chan-Wook pour Sympathy for Mister Vengeance en 2002 et Old Boy en 2003. Ces prix ouvrent les portes de l’international à de nombreux réalisateurs comme Bong Joon-Ho avec Memories of Murder en 2003 et The Host en 2006, Kim Jee-Woon avec A Bittersweet Life en 2005 ou Na Hong-Jin avec The Chaser en 2008. Exaltant une liberté fébrile en raison de ses origines contestataires8 depuis bientôt 20 ans et tout aussi caractérisé que ses contemporains par la ‘fusion des genres’, le ‘polar coréen’ est aujourd’hui le principal représentant international du cinéma sud-coréen et de son histoire.
1 Dictionnaire du logiciel Antidote 8v3.
2 Centre National de la Recherche Scientifique, www.cnrs.fr
3 Les années d’occupation japonaise en Corée ayant laissé un fort ressenti chez les Coréens, il est très probable que les témoignages et les textes soient sujet à des accentuations et des occultations de certains faits pour nourrir un sentiment anti-japonais.
4 Avant sa restauration le film était connu sous le nom The Hand of Destiny.
5 « Cinéma d’Asie, d’hier, et d’aujourd’hui » de Frédéric Monvoisin, Armand Colin, 2015, p.87
6 Aussi connu comme mouvement pour la démocratisation de Gwangju. Il s’agit d’un soulèvement étudiant et syndicale entre le 18 et 27 mai 1980 à Gwangju, au sud du pays, en réaction à un état de siège autorisant les arrestations politiques et la fermeture d’universités. Le mouvement atteindra des pics de participation de 150 000 manifestants faisant face à près de 700 soldats de l’armée les assiégeant. Le bilan officiel de cette répression militaire est de 200 morts, bien que les chiffres soient contestés par les organisations de défense des Droits de l’Homme.
7 « Le Cinéma asiatique » de Antoine Coppola, Images Plurielles, 2005, p. 266
8 Bien que le pays soit aujourd’hui une démocratie, l’ancienne présidente Park Geun-Hye (2013 - 2017) avait tout de même établi, avec sa ministre de la culture et son directeur de cabinet, une liste noire comptant près de 10 000 artistes considérés comme non-favorables à son gouvernement.
Critique publiée dans le MagGuffin n°14.
0 notes
Text
Itw: F. DESCHAMPS & Y. YANG
Interviewer, writer

« MIEUX COMPRENDRE LES AUTRES ET LES AUTRES CULTURS POUR MIEUX SE COMPRENDRE » avec Fabianny Deschamp et Yilin Yang.
À l’occasion de la sortie le 06 décembre du long-métrage français Isola de Fabianny Deschamps, le MagGuffin a rencontré la réalisatrice du film et son actrice principale Yilin Yang. Souhaitant non seulement explorer plus en détails le cinéma singulier de Fabianny Deschamps, le MagGuffin a tenu à réaliser cet entretien tant le travail de la réalisatrice venait illustrer les mots qui ouvraient notre dossier dédié à l’Autre : « Gloire à l’Autre ! »
MagGuffin : Tout d’abord, pourriez-vous nous présenter un peu votre parcours ?
Yilin Yang : Au départ je viens du théâtre. Je suis venue en France pour étudier le théâtre à l’Université Sorbonne-Nouvelle après avoir étudié l’anglais pendant quatre ans à Taïwan. Je comptais rentrer directement après mes études mais j’ai rencontré le metteur en scène Richard Demarcy qui m’a engagée dans sa troupe alors que je n’avais aucune formation professionnelle de comédienne. Le fait de jouer était un peu un rêve inachevé de l’enfance et Richard Demarcy m’a donnée cette chance. Parallèlement aux tournées avec lui, je me suis formée à partir de 2005 dans une école professionnelle de comédiens, l’École Claude Mathieu dans le XVIIIe à Paris, et en 2008 j’ai commencé à travailler sur des projets de télévision et de cinéma. Cela fait 12 ans maintenant mais tout cela n’est qu’un hasard de la vie qui s’avère extrêmement chanceux pour quelqu’un que l’on pourrait qualifier de « comédienne d’ethnie ».
MG : En quoi votre carrière a été influencée par le fait d’être une « comédienne d’ethnie » ?
YY : Au cours de ma carrière j’ai eu la chance d’avoir des réalisateurs et des réalisatrices, comme Fabianny, qui m’ont offert des rôles non-typés. Il y a eu aussi le metteur en scène Malik Rumeau qui m’a engagée pour jouer dans des spectacles de textes classiques comme Molière ou Victor Hugo. Je suis très reconnaissante de ces personnes car c’est finalement assez rare. Il est regrettable que les comédiens d’ethnie soient catégorisés de la sorte. Après, c’est un peu valable en France pour les autres profils comme les blondes, etc. Je pense que c’est plus un problème d’imagination en général qu’un problème lié aux comédiens d’ethnie. Jusqu’à très récemment, j’étais dans une agence spécialisée pour comédiens asiatiques tenue par Claude Masson et les directeurs de casting l’appelaient presque toujours pour des personnages dits de « composition clichée ». Cette année, je suis entrée dans l’agence VMA, l’une des plus importantes en France, et le premier casting que j’ai passé était pour un personnage qui s’appelle Patricia Legrand, qui n’est pas du tout typé. J’étais vraiment surprise car c’était la première fois que pour un casting, le rôle n’était pas asiatique. Au final, mon objectif c’est de simplement faire en sorte d’être la seule à jouer comme je le fais, même lorsque la composition du personnage s’avère complètement banale.
[Fabianny Deschamps se joint à nous.]
MG : Fabiannny Deschamps, pourriez-vous, vous aussi, nous présenter votre parcours ?
Fabianny Deschamps : Après avoir étudié les arts plastiques et le théâtre, je me destinais à la mise en scène théâtrale mais le cinéma est arrivé comme un heureux accident. Après m’être mise à écrire des nouvelles et des scénarios, je suis devenue chef décoratrice sur des courts-métrages puis assistante de réalisation jusqu’à ce que je commence à réaliser mes propres films. Le choix de faire du cinéma vient du fait que de tous les arts, il était pour moi le plus étranger et pour lequel j’avais le moins d’intérêt. Je n’étais pas très cinéphile à l’époque, je n’allais quasiment jamais au cinéma. De plus, j’avais un tel bagage artistique au niveau du théâtre que cela en devenait presque paralysant à 21 ans pour dégager une pratique, une écriture sans être écrasée par le poids des « pères ». Mon choix de faire du cinéma vient du fait que je sois totalement illégitime à cet endroit et que je n’y avais aucune grammaire préétablie.
MG : Est-ce que votre parcours a influencé votre manière de concevoir vos films ?
FD : Le fait de venir du théâtre amène dans mon travail une théâtralité omniprésente où je n’essaie aucunement d’épouser une forme de naturalisme. Mes courts-métrages étaient entièrement des films de studios où l’artifice, revendiqué en permanence, me permettait d’évoquer des choses du réel au travers d’un spectre différent. Avec New Territories, mon premier long-métrage, j’ai souhaité me lier un peu plus avec l’actualité du monde et être au sein de ce monde, tout en conservant mon univers. J’ai donc sorti ma caméra des studios et abordé la réalité du monde au travers d’un dispositif fictionnel.

New Territories vu par Pierre Lauret.
MG : Fabianny Deschamps, vous avez réalisé deux longs métrages, New Territories et Isola. Yilin Yang, en plus de jouer dans ces deux films, nous avons pu aussi vous voir dans La Vie de château de Modi Barry et Cédric Ido ainsi que dans Voyage en Chine de Zoltan Mayer. Peut-on dire que la thématique de la rencontre des cultures est intrinsèquement liée à vos choix de projets ?
YY : C’est amusant parce que je n’ai jamais vraiment réfléchi là-dessus. Je suis comme la plupart des comédiens, je fais au cas par cas. Peut-être qu’inconsciemment oui, car c’est mon propre parcours quelque part. Cependant d’un autre côté, inévitablement c’est mon profil et mon ethnie qui imposent cela. Après ça me plaît énormément, puisque, dans mon intérêt artistique personnel le sujet de l’immigration m’interpelle. Essayer de comprendre ce qui amène quelqu’un à quitter son sol natal pour aller ailleurs, c’est quelque chose qui m’attire fortement.
MG : Cette idée est par ailleurs aussi très liée à Taïwan et à son cinéma...
YY : C’est vrai ! Souvent, on me met dans ce grand panier qu’est le panier « asiatique », mais Taïwan reste un pays très particulier. Il y a eu énormément de passages et d’échanges avec les cultures étrangères. C’est une île et comme toutes les îles, c’est un point de rencontre. D’une manière générale, à Taïwan, nous avons un gros questionnement sur l’identité, ou du moins sur les identités. Ça amène naturellement à essayer de mieux comprendre les autres et les autres cultures pour mieux se comprendre.
FD : Cela permet aussi de réaliser à quel point les cultures se ressemblent lorsqu’elles sont rapprochées entre elles. Je trouve cela très intéressant et effectivement mon travail en est totalement imprégné. Par exemple, les mythologies sont les mêmes. L’image du tremblement de terre qui se trouve dans Isola est trouvable dans toutes les religions, que ça soit l’apocalypse biblique, dans le Coran, etc.
MG : New Territories mettait en scène une sorte de rapport de force entre deux cultures où l’une finit par écraser l’autre. À l’inverse, Isola semble être beaucoup plus dans la recherche d’harmonie et de conciliation entre les cultures. Quel changement s’est opéré dans le processus de réflexion pour aboutir à une conclusion plus positive ?
FD : Le propos de New Territories n’est pas exactement autour de deux cultures qui se confrontent. Il y a de ça mais c’est surtout un film sur deux cultures que le capitalisme cherche à opposer et à instrumentaliser pour parvenir à ses fins : dominer. Alors que dans Isola, il y a quelque chose s’approchant d’une tentative de retour à un impossible monde inspiré de la Tour de Babel. Une espèce de monde premier où tous les êtres cohabiteraient sans que les échanges ne passent nécessairement par le langage ou les religions. Que sont les croyances aujourd’hui et comment les renouvelle-t-on ? Voilà ce que Isola interroge. Le personnage que Yilin Yang interprète, Daï, est à la recherche d’un moyen de résister à la violence du monde et c’est là l’origine des croyances.
YY : De mon point de vue de comédienne, je pense que cette différence entre les deux films vient aussi de la manière dont ils ont été fait. Sur New Territories, je n’ai pas eu la chance de jouer avec Eve Bitoun qui joue la française. Nous nous sommes rencontrées dans la vie mais jamais artistiquement. Par conséquent, elle devait tourner avec quasiment aucun élément de mon personnage alors que j’ai travaillé ma voix-off sur les images que je voyais d’elle. Donc quelque part, la voix de mon personnage s’impose sur le personnage de Eve. De l’autre côté, Isola était beaucoup plus cosmopolite. Le chef opérateur et son assistant étaient Tunisiens, l’assistante de Fabianny est Italienne, Yassine Fadel qui partage la tête d’affiche avec moi est Marocain, les autres acteurs sont Italiens, et nous travaillions tous ensemble. Peut-être que cette harmonie vient de là.
MG : Lors de l’écriture et des tournages de New Territories et Isola, comment avez-vous outrepassé les problématiques liés justement aux langues ?
FD : Je n’ai pas de problèmes à faire tourner des acteurs dans une langue étrangère. Après, il faut trouver un protocole de tournage. Dans les deux films, tous les acteurs sont francophones mais j’aurais très bien pu faire appel à un interprète. Ce qui m’intéresse dans l’idée de tourner dans une langue que je ne maîtrise pas, c’est qu’en matière de direction d’acteur, je travaille sur quelque chose de moins intellectualisé. Je dois rentrer dans un rapport à l’acteur quasi organique et instinctif. C’est une manière justement de se libérer du langage pour obtenir une vérité ou une sincérité qui se place comme un mode d’expression plus universel.
YY : Pour ma part, c’est assez jouissif de jouer avec des partenaires qui parlent une langue que je ne comprends pas. Ça oblige une écoute et ça renforce l’échange dans le jeu. Sinon, d’un point de vue pratique, nous avons eu pas mal de travail sur table avant de tourner les scènes avec Yassine pour affiner les dialogues du scénario.
MG : Par conséquent, est-ce que vos acteurs ont eu une certaine marge de manœuvre pour créer leur propre personnage dans New Territories et Isola ?
FD : Les deux films sont très écrits. Pour New Territories, je me suis documentée pendant deux ans et j’ai dû entrer dans un jeu d’identification pour écrire ce fantôme chinois. Pour Isola, Daï est un personnage que j’ai inventé spécialement pour Yilin Yang.
YY : L’élément central de l’interprétation de Daï, c’était la solitude. À partir de là, je pouvais rire, je pouvais pleurer. Finalement, Fabianny guide la ligne dramatique principale, mais elle se nourrit aussi beaucoup de nos échanges. De même, de mon côté, New Territories n’était pas juste un travail de doublage mais un véritable parcours et de longues recherches d’interprétations du personnage. J’espère que ça s’est entendu.
FD : L’engagement des acteurs dans le processus est très important car les parties documentaires impliquent un champ d’improvisation indéniable. Pour Isola, nous nous étions énormément préparées avant le tournage pour essayer de circonscrire toutes les situations que nous pouvions rencontrer dans le dispositif documentaire et essayer de trouver les réponses que pourrait amener le personnage. Cependant, nous ne pouvions pas tout prévoir. Notamment dans les camps de réfugiés quand les bateaux arrivent et que les gens posent pied à terre. Tout cela, nous y avons assisté au présent et nous ne savions pas ce qui allait se passer la seconde d’après. Il y a donc un lien de confiance avec l’acteur qui est essentiel et gigantesque.
YY : Ces scènes de débarquement de réfugiés ont été très dures pour moi. Nous avions beau nous être préparées et savoir que ça allait être compliqué, une fois dans le bain tout est différent. Je n’arrivais plus à jouer face à cette réalité qui est extrêmement envahissante et violente. Finalement, ça collait avec Daï puisque, comme dans le reste du film, elle est dans une recherche désespérée. Mais je dois avouer que j’étais complètement perdue dans cette vague de migrants. Je sentais que même si j’avais la force de jouer, ça aurait été malhonnête.
FD : Dans Isola, il y avait tout de même des instants de pure fiction, dans la grotte notamment. Ces scènes très théâtrales ont été tournées en 5-6 jours. Ça a été vraiment intense. Nous avons tourné environ 15 heures par jour avec Yassine Fadel enfermé dans sa cage et nous tous enfermés dans cette grotte. Il y avait quelque chose qui n’était pas très loin d’un état de performance.

Isola dessiné par Kim Peacock
MG : Pensez-vous que nous pouvons parler de cinéma guérilla pour New Territories et Isola ?
FD : Je pense que oui : ce sont des films qui n’ont pas attendu de bénédiction institutionnelle pour exister et qui véhiculent ces idées de clandestinité et de manipulation du réel. Les deux ont été tournés avec un appareil photo car nous n’avions pas d’autorisation de tournage. Pour New Territories, le sujet étant censuré en Chine, nous nous sommes faites passer pour des touristes prenant simplement des photos à droite à gauche. Pour Isola, c’était différent car les opérations de sauvetage se font dans des zones militaires extrêmement encadrées par les préfectures locales. Grâce à des soutiens autour du film, nous avons pu demander des cartes de presse pour entrer sur les bases militaires mais à aucun moment nous avons dit que nous tournions un film de fiction. Notre clandestinité était donc partielle.
MG : Fabianny Deschamps, votre court métrage La Lisière se déroulait dans une sorte d’espace noir comme détaché du monde, Isola se déroule sur une île dans la méditerranée et New Territories sur les Nouveaux Territoires séparant l’île de Hong-Kong et la Chine continentale. Est-ce que l’idée d’entre-deux est essentielle dans votre filmographie ?
FD : L’idée de La Lisière était de déplacer la relation et le lien que j’avais avec des gens de mon entourage vers un terrain inconnu et illégitime. En jouant à des jeux érotiques avec ces personnes avec qui je n’entretiens habituellement aucun lien de la sorte, nous essayions de rencontrer l’autre autrement. C’était un projet incongru et assez inconfortable. Cet inconfort est assez récurrent dans mon travail et il m’intéresse beaucoup. Quelque part, je cherche un territoire de cinéma où nous serions comme dans des limbes. Un entre-deux monde qui s’associe logiquement à quelque chose entre la vie et la mort. Alors pour New Territories c’est très évident mais quelque part ça l’est aussi pour Isola. Les personnages de Hichem et Daï sont un petit peu des fantômes qui vivent dans un hors-monde et qui le traverse comme s’il n’avait plus de prise sur eux. Effectivement, c’est mon territoire préféré car il est infini. Il s’auto-délimite et se recrée en permanence. Je pense aussi que chaque spectateur à l’intérieur de son questionnement peut refaire son propre chemin à l’intérieur de cet entre-monde.
MG : New Territories et Isola ont été soutenu par l’ACID1. L’ACID est un peu cet « autre » du cinéma français, un cinéma en marge.
YY : Je me place d’un point de vue de comédienne mais l’ACID, c’est une ambiance très agréable et amicale. Je suis contente car mon baptême du Festival de Cannes, c’était avec eux. Les films qu’ils soutiennent sont souvent des propositions très audacieuses avec beaucoup de prises de risques. Et cela, c’est, de manière générale, ce qui manque dans beaucoup de films.
FD : C’est un cinéma en marge mais qui résiste pour exister à l’intérieur du marché. L’ACID est quelque chose de très important pour la diversité créative et pour moi de fait. Ils sont arrivés à un moment où je passais au long-métrage et je n’arrivais pas à financer un projet que je n’ai finalement jamais réalisé. Autour de moi ça bruissait et les gens me disaient : « Peut-être que tu n’es pas faite pour le cinéma et les longs-métrages mais pour les galeries d’art ». Il y avait cette fatalité là et c’est quand j’ai rencontré l’ACID il y a 7-8 ans que j’ai rencontré des altérités, des gens qui n’avaient rien en commun dans la manière d’aborder le cinéma. Cependant ils partageaient la même volonté de répondre par un positionnement esthétique fort à cette uniformisation des écritures cinématographiques dictées par les lois du marché. C’est une famille très importante pour moi car ils m’ont donné la force de passer au long-métrage avec New Territories en me disant que malgré tout, il y avait une autre manière de faire des films, en étant un peu en dehors de l’industrie sans être nécessairement contre.
Entretien réalisé le 23 octobre 2017. Nous remercions Yilin Yang et Fabianny Deschamps pour leur temps, leur disponibilité et leur bonne humeur.
1 Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion.
Critique publiée dans le MagGuffin n°13.
0 notes
Text
Lettre au MagGuffin
Ghostwriter

Lettre au MagGuffin par Thomas Traubert
Un dimanche 10 septembre, à une heure tardive dans le quartier de Shimokitazawa à Tokyo, j'ai entrepris de réunir l'ensemble de mes notes et impressions ayant accompagné mon voyage japonais. Cher lecteur, ne juge pas trop durement les élucubrations suivantes, elles ne sont que le fruit d'une tentative désespéré de poser des mots sur des ressentis épars et spontanés.
Encore environ trois heures de vol me sépare de Tokyo et une certaine impatience commence à se manifester. Bien que ce soit la première fois que je me rende dans la capitale japonaise, j'ai une étrange sensation de l'avoir déjà arpenté maintes fois. Comme si le cinéma, la musique, la littérature ou encore la photographie m'avaient permis, depuis l'autre côté du globe, d'explorer cette ville au caractère si singulier.
Avec River du réalisateur HIROKI Ryūchi, j'avais visité Akihabara. Avec City Lights, Volume 2: Shibuya du musicien Nicolay, j'avais visité Shibuya, Ueno ou encore Omotesando. Avec les photographies de MORIYAMA Daidō, j'avais visité Shinjuku. Avec Miso Soup du romancier MURAKAMI Ryū, j'avais visité Kabukichō. Et pour conclure ce listing impulsif qui aurait pu continuer encore longtemps, j'avais simplement visité la quasi-intégralité de Tokyo avec Tokyo Reverse, la slow TV du collectif SÅNDL.
Cependant, ce n’est pas cette approche purement formelle des quartiers qui me donne ce sentiment de connaître Tokyo. Mes différentes pérégrinations artistiques prenant pour cadre spatial cette ville semble porter en elle une chose commune que mes lacunes en matière de sémantique m’empêchent de définir précisément. Comme une énergie, une essence, un esprit, une personnalité, une ambiance, une atmosphère, une aura, un caractère que l’on retrouve dans chacune de ces œuvres. Pour autant, la chose est claire à mes yeux : Tokyo cache subtilement une saudade qui me parle, qui me plaît, qui m'intrigue.
Cette chose que j'associais irrémédiablement à la capitale, je la trouvais dans les poèmes de Richard BRAUTIGAN dans Journal Japonais et Tokyo-Montana Express, dans les amours estudiantins de IWAI Shunji dans April Story ou encore dans l'innocente monomanie de Miyuki dans Tokyo Trash Baby de HIROKI Ryūichi. Mais c'est principalement dans le Tokyo nocturne qu'elle se faisait le plus visible comme les envolées romantiques de Have A Nice Day! ou les longues nuits blanches du Passage de la nuit de MURAKAMI Haruki et de Midnight Diner de MATSUOKA Koji.
En somme, l'art m'avait simplement appris que Tokyo est l'un des bastions principaux de la postmodernité. Encore environ trois heures de vol me sépare de celle qui a le pouvoir de transformer les anecdotes de la vie quotidienne en manifestation d'un romantisme artistique des plus purs.
Après avoir expérimenté quelque peu la capitale, je réalise que l'art ne m'avait pour ainsi dire pas menti. Bien que je me perde quotidiennement dans l'immensité de la gare de Shinjuku, ils m'avaient transmis suffisamment de connaissances pour ne pas que je me sente tel un étranger égaré dans celle que j’appellerai le temple des parapluies perdus. Néanmoins, tout ne pouvait pas être aussi simple que cela. Tokyo s'avère extrêmement polymorphe, si bien que je ne sais plus où donner de la tête pour comprendre les origines de cette saudade.
Tout en me mettant en route pour rejoindre des amis à Kabukichō, je commence à réunir dans ma tête les éléments essentiels qui caractérisent Tokyo à mes yeux. Elle doit posséder quelque chose de particulier, que d'autres villes n'ont pas, pour que tant d'artistes fassent le pèlerinage jusqu'à elle pour y trouver un renouveau artistique, ou du moins une certaine singularité le temps d'une œuvre.
Aussi évident que cela puisse sonner, Tokyo est avant tout une terre de sons et de lumières. Le bien-nommé segment Street Noise issu du tout aussi bien-nommé projet Tokyo Blood du cinéaste ISHII Sogo aborde d'ailleurs la ville de la sorte en la résumant simplement à ses couleurs, ses sons, son ambiance. C'est par ailleurs la mine ébahie d'un Bill MURRAY arrivant à Shinjuku en taxi dans Lost In Translation qui vient confirmer que MURAKAMI Haruki ne se trompait pas en décrivant Tokyo comme « une mer de néons multicolores » dans Le Passage de la nuit.
De la même manière, lorsque Kindan No Tasūketsu parle d'un « immense monde de son » dans leur chanson Great World of Sound, il n'est pas idiot d'y voir une allégorie possible de la ville. C'est effectivement l'ambiance sonore de Tokyo qui était venue me frapper en premier. Je ne sais pas si cela est dû à la faible fréquentation de voitures, mais il est agréable de ressentir cette quiétude reposante au sein d'une effervescence palpable. Isabel COIXET a par ailleurs bien compris cette importance du son urbain tokyoïte aux vues de son médiocre Map of the sound of Tokyo qui, malgré de nombreux défauts, transposait efficacement l'ambiance de la ville à l'écran.
Enfin, à titre personnel, il me semble inimaginable de traiter artistiquement de Tokyo sans mentionner ses trains. HOU Hsiao-Hsien pense sûrement de la même manière puisqu'ils servent d'introduction à la ville dans Millennium Mambo et qu'il les sacralise dans Café Lumière jusqu'à offrir un magnifique plan final où pas moins de cinq trains se croisent en moins d'une minute. Jamais bruyant et jamais dérangeant, il me semble aujourd'hui parfaitement logique que le personnage interprété par ASANO Tanadobu s'affaire à capter l'univers sonore de ces trains dans cet hommage taïwanais à OZU Yasujirō, tant ils font preuve de musicalité à côté des RER parisiens.
Il semble difficile de parler de Tokyo sans parler de son lien immuable avec ceux qui l'habitent. Souvent symbolisé au cinéma par cette masse informe traversant le célèbre carrefour de Shibuya, il est essentiel de connaître les japonais pour comprendre la capitale.
La représentation artistique des japonais m'a souvent taraudé. Depuis bien longtemps, je me suis fait à l'idée que le cinéma américain et européen peine souvent à se détacher de ses poncifs qu'il affectionne tant. Et cela m'attriste de voir que même des auteurs consacrés et parfois adulés comme Gus VAN SANT peuvent faire preuve de maladresse eux aussi en ayant recours à des clichés éculés depuis bien longtemps à mes yeux. Je me souviens encore avoir ressenti un certain malaise face au kamikaze de l'appréciable Restless ou de m'être violemment indigné face au père de famille de l’exécrable Nos Souvenirs qui, non content de se dévouer corps et âme à son travail, faisait preuve d'un spiritualisme low cost entrant en conflit avec la rationalité américaine. Une telle représentation me ramène inlassablement à cette vision occidentale qui me débecte au plus haut point : « les japonais sont si polis », « non mais what the fuck Japan ? », « Le Japon, c'est un pays entre tradition et modernité ».
Si de tels propos tirent une partie de leurs origines dans une certaine forme de réalité, il reste néanmoins bien plus complexe de représenter ce peuple. En France, tout le monde, ou presque, s'accorderait à dire qu'il s'avère compliqué de représenter l'ensemble des français sous une seule et même bannière sans faire de généralités. Dès lors, il semble important d'appliquer la même règle au Japon et aux autres pays du monde.
Un jour seulement à Tokyo avait suffit pour détruire le piédestal que l'art m'avait fait construire pour les salarymen et les lycéennes avec notamment les projets Solaryman et Schoolgirl Complex de AOYAMA Yuki. Si pour moi, ils possédaient une aura particulière dans les lieux publics du pays du soleil levant, ils s'avèrent être assez transparent et ne dénotent pas particulièrement dans la vie de tous les jours. Si j'arrive à concevoir pourquoi les salarymen représentent au travers de leur stoïcisme le capitalisme nippon, les raisons qui ont hisser la lycéenne en tant que figure d'émancipation, de liberté et d'indépendance m'échappent totalement.
Ma fréquentation des lieux underground tokyoïtes me permet aussi de réaliser cette différence qui existe entre l'art et ce qu'on pourrait appeler le « japonais lambda que l'on croise dans le métro », si un tel abus de langage m'est permis. Dans ces clubs et bars, je rencontre chaque soir diverses personnes qui, se sentant bloquées dans une société où il est difficile de s'exprimer à souhait, trouvent dans l'art une opportunité de déverser leur réelle personnalité avec plus ou moins d'exubérance. Alors que je me remets tout juste d'un concert où une personne récite sa poésie avec véhémence sur l'hymne nord-coréen ou sur les chants de Daesh lors d'un événement Paint Your Teeth, ces soirées où le tout à chacun du monde underground a l'opportunité de partager artistiquement ce qu'il a dire ou montrer, j'entends soudainement quelqu'un avouer : « la journée je me déguise en salaryman. Je dois attendre d'être ici pour être réellement moi. ». Dès lors, je réalise qu'il est incongru de définir un peuple dans son ensemble ou du moins de le tenter, et qu'on ne peut que simplement s'intéresser aux individus un à un.
Aujourd'hui, je rencontre pour la première fois Soo-Young dans la banlieue sud de Tokyo. Rapidement, je commence à voir en elle ce que Chris MARKER semblait avoir vu en Koumiko dans Le Mystère Koumiko. Simplement d'origine coréenne, Soo-Young était née au Japon et y avait vécu toute sa vie. Sa langue natale était le japonais et sa culture l'était tout autant. Troisième génération d'immigrés au Japon, elle ne peut pas prétendre officiellement à autre chose qu'à la nationalité coréenne.
Bien qu'ayant connaissance de la difficulté d'être coréens au Japon, c'est avec une certaine inculture que je découvre les événements qui ont jalonnés sa vie et qui attestent d'un racisme farouche et aveugle. Elle me raconte que depuis petite on l'invite régulièrement à « rentrer dans son pays », si bien qu'à 18 ans, elle avait décidé de se rendre en Corée pour tenter d'y vivre et fuir cela. Ne parlant pas coréen et ne connaissant que vaguement les us et coutumes, elle s était confronté à nouveau à un racisme âpre l'invitant là encore à « rentrer dans son pays ». Elle était soudainement devenue japonaise.
Si cette situation ne me surprend guère dans les faits, rencontrer quelqu'un la vivant quotidiennement vient littéralement exploser ma vision du concept de nationalité, qui était d'ores et déjà bien friable. Son avis sur la question est assez clair aussi puisqu'elle m'affirme régulièrement « Je me fous de ce qu'indique mon passeport. Je ne suis ni japonaise, ni coréenne. Je suis simplement Soo-Young ».
Si le propos semble empli de candeur tout en restant néanmoins chargé de sens, je voyais dans celui-ci une réponse claire dans ma recherche de représentation artistique de Tokyo. Au cinéma, au théâtre, ou en littérature, ma définition d'un bon personnage ne pouvait pas simplement se reposer sur une nationalité ou une culture d'origine. Un bon personnage avait un parcours qui lui est propre, un caractère qui lui est propre, etc.. Et sa culture et nationalité sont simplement des compléments qu'il choisit d'adopter ou non et ainsi se définir en tant qu'individu. C'est cela qui rendait à mes yeux un personnage le plus réaliste possible.
De ses constats qui semblent plus ou moins ineptes une fois passés à l'écrit, Soo-Young me fait aussi réfléchir sur les langues usitées par des personnages. Au cinéma notamment, une langue n’a pas uniquement à vocation d'être comprise par les spectateurs mais bien en fonction d'un contexte. Comme dans la réalité, ce contexte n'est pas uniquement lié à des questions géographiques mais plutôt à une problématique de confort personnel comme en témoignait Soo-Young : « Pour moi, c'est plus facile et naturel de parler japonais, mais pour autant, l'anglais est une langue qui m'offre une liberté de parler sans me soucier de certains codes et tabous que je peux avoir en japonais ».
Voilà que je réunis et synthétise mes réflexions ayant accompagné mon séjour tokyoïte et, bien qu'elles m'aient obnubilé durant deux semaines, je trouve qu'elles s'avèrent par moment légères et qu'elles restent bien trop souvent en suspens en l'absence de réponse précise. Au final, il n'y a peut-être pas de bonnes manières de représenter une ville dans l'art. Tokyo est complexe, mais la représenter semble l'être encore plus. Tout est une question de point de vue quelque part. Pour moi, Sofia COPPOLA et son Lost In Translation est aussi honnête que Abbas Kiarostami et son Like Someone In Love dans leur représentation de Tokyo. Régulièrement, j'entends des critiques sur le film de l'américaine car il serait bourgeoisement méprisant de la culture japonaise. Si je ne suis pas en totale opposition avec cette vision, je trouve néanmoins que le film tire sa force de la sincérité de sa réalisatrice et des personnages. Coincés dans ce Park Hyatt Hotel, ces derniers se perdent dans un pays qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne sentent pas le besoin de le découvrir. Je préfère que Sofia COPPOLA me parle de cela plutôt que d'essayer de saisir une quelconque réalité japonaise. Pour représenter une ville, il suffit peut-être simplement d'être en accord avec sa manière de la percevoir.
En somme une réponse bien légère pour une problématique qui mériterait plusieurs années d'études. Mais ce texte est peut-être plus une mouture de réflexions invitant à chacun de s'interroger sur ces questions de représentation, de nationalité, etc... Pour moi, Tokyo n'est pas un eldorado de réponse mais bien une ville qui stimule les réflexions. Porté par un terrible sentiment de solitude se mélangeant avec la synergie et l'effervescence qui se dégage de la capitale japonaise, je sens que la saudade tokyoïte commence à m'atteindre et qu'elle me pousse à m'interroger encore et encore. Mais tout cela n'est peut-être que simplement dû à ma position d'étranger dans une ville éloignée en tout point de mon Paris natal.
« À Tokyo, il y a une force qui n’existe nulle part ailleurs. À Tokyo, il y a une chaleur humaine qui n’existe nulle part ailleurs. Je n’ai pas vraiment parcouru le monde, mais ce Tokyo c’est la ville de l’abondance. Pas sur le plan matériel. Ici, il y a une profusion que je ressens toujours. Je cours tout le temps, je suis crevé, le temps passe très vite, mais malgré tout, c’est la ville qui me permet de décupler mon désir d’expression »
Still The Water, KAWASE Naomi
Image par UGAYA Hiro
Critique publiée dans le MagGuffin n°12.
0 notes
Text
« One Too (piano) » MV
Video editor, additional camera

Staircase Paradox - One Too (piano) MV
director : Maxime Lauret
production : oh no!
camera operator : Maxime Lauret
additional camera operator : Pierre Lauret
editor : Pierre Lauret
music : “One Too (piano)” by Staircase Paradox, from the EP “Hand Shaking Heart Stopping Moment”
youtube
Staircase Paradox
Facebook : https://www.facebook.com/spdxmusic/
Website : http://www.staircaseparadox.com
Label : http://www.kernelpanic-records.com/
0 notes