#chrismarker
Explore tagged Tumblr posts
Text

The Spiral of Time, Glasgow, 2024.
The spiral of memory and action is never linear. Perhaps one truly has to step back into the future.
#BlackandWhite#Spiral#Vertigo#ChrisMarker#Glasgow#iPhone13#iphoneography#Time#Memory#Future#UnitedKingdom
2 notes
·
View notes
Text



La Jetée, 1962. Chris Marker.
12 notes
·
View notes
Text
youtube
Chris Marker's enthralling, globehopping essay is perhaps the finest first-person documentary, one that can leave you rivetingly unmoored. Ostensibly, we're following a world traveler as he journeys between locations, from San Francisco to Africa, from Iceland to Japan. A female narrator speaks over the images as if they were letters home ("He wrote me...") even though the episodes play out right in front of us. Each viewer is bound to have their own favorites: The playful, near-subliminal opening shot of three Icelandic girls walking down a rural road; the Japanese temple dedicated to cats (a very Marker place to visit); the illuminating aside on Hitchcock's Vertigo. The doc feels like a diary that's being written, reread and transposed to celluloid simultaneously, reinventing itself from moment to moment. You'll be mesmerized.
0 notes
Text
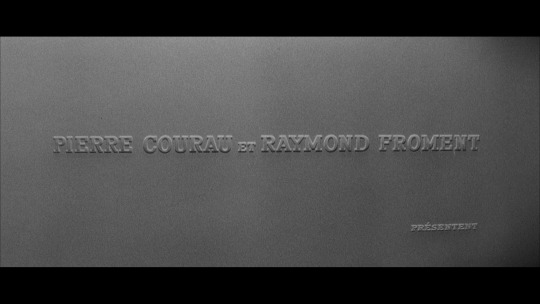


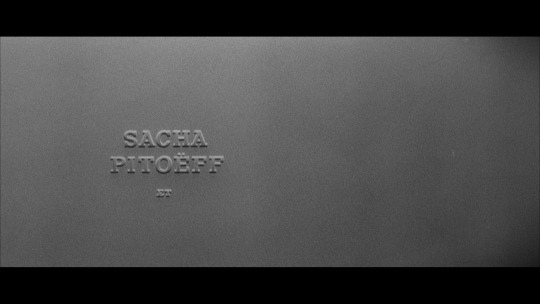
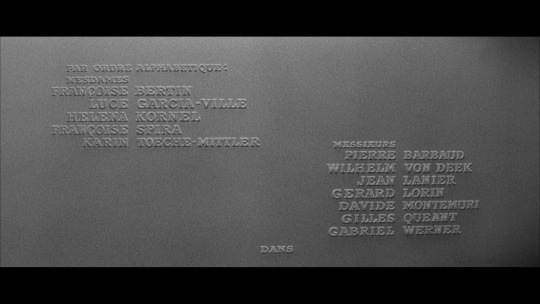
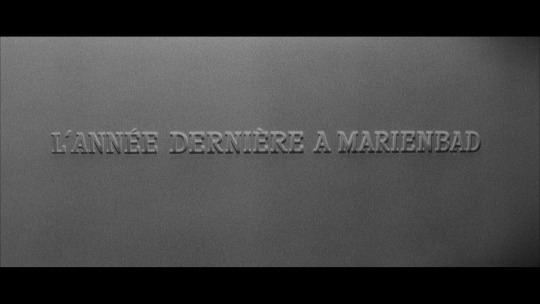
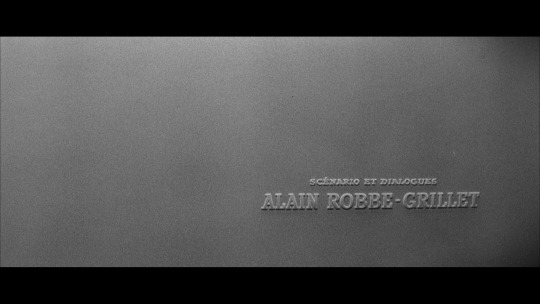


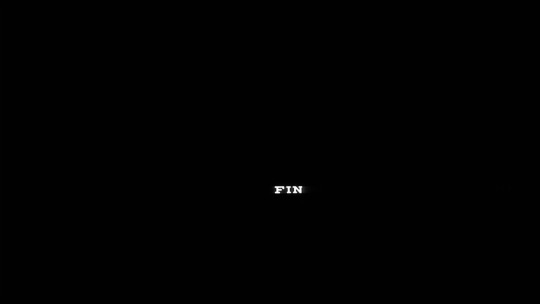

#alainresnais#alain#cinema#alainfashion#jeanlucgodard#alainpassard#alaine#agnesvarda#nouvellevague#alainuniversity#photography#france#truffaut#surrealism#alainmilliat#chrismarker#wimwenders#samualbeckett#peterhandke#jacquymesrivette#abstraction#michealangelantonioni#italy#spain#alainmikli#bellatarr#existentialism#fellini#germany#europeanart
0 notes
Link
Merci à Boris Nicot pour ses "Notes sur Sans Soleil" qui accompagnent ici la sortie du numéro AMOUR (2023) de La mer gelée.
4 notes
·
View notes
Photo

La Jetée, 1962 #ChrisMarker https://www.instagram.com/p/CXJ2nM8tN2g/?utm_medium=tumblr
4 notes
·
View notes
Photo










CSS EXTRA CREDIT / Junkopia
Chris Marker (w/Frank Simeone and John Chapman), 1981
2 notes
·
View notes
Photo

Chris Marker, Sans Soleil, 1983
67 notes
·
View notes
Text
LES BARRISSEMENTS IMPUBLIABLES, par Warren Lambert
A l’automne 2018, la revue Hippocampe publiait de lui, dans son numéro 15, l’essai poétique “Hallali à Hollywood”, lequel inaugurait une série de textes animaliers archivant la féerie autant que la terreur. Après cette étude des cervidés, Warren Lambert offre aux éditions Le Feu Sacré ce second portrait de bêtes, dédié aux pachydermes.

« Regarde... Il nous déteste tous. Il trouve que les hommes puent. »
Pierre, à propos d'un éléphant, dans Pola X de Leos Carax.
Les histoires d'éléphant sont les plus tristes du monde. Elles donneraient toutes des contes à tenir hors de portée des enfants. Aucun d'eux ne fermerait les yeux si on les lui racontait afin qu'il trouve le sommeil. Jumbo, Mary, Topsy, Tyke, il n'y aurait que les noms qui changeraient. Qui sait d'ailleurs si leur cruauté ne finirait pas elle non plus par le lasser, tant ces histoires ont en commun une sorte d'atavisme tragique : l'exil, la captivité, le travail forcé, les coups, la révolte et la mort. À la limite, leur happy end serait quand tout ce calvaire s'interromprait enfin. Mais quel parent sain d'esprit souhaiterait que son bout de chou grandisse avec chaque soir le récit de cette hécatombe faite envers le plus grand animal que la terre ait porté ? Et s'il voulait s'y prendre autrement, le consoler, lui redonner péniblement un peu d'espoir, comment alors lui expliquer qu'autrefois, il y a longtemps, bien longtemps, une petite fable naquit en Asie dans laquelle le pachyderme était pourtant l'image parfaite que donnaient de la réalité les sages et les anciens ?
Difficile à croire, en effet.
Raison de plus pour la lui raconter...
Dans un village habitaient six aveugles qui, bien entendu, n'avaient jamais vu d'éléphant. Un jour, un spécimen traversa le village, et on amena naturellement les six aveugles afin qu’ils puissent y apposer leurs mains. Chacun placé à une partie du corps de l'animal, tous en arrivèrent à une conclusion différente. Le premier, caressant le ventre et sa peau craquelée, s'écria : « Je vois ! Un éléphant, c'est comme un mur ! ». Le second, attrapant une des défenses d'ivoire, dit aux autres : « Non, c'est comme une lance ! ». Le troisième, lui palpant la trompe : « Mais non, c'est comme un serpent ! ». Le quatrième, tâtant une de ses quatre énormes pattes : « Pas du tout ! C'est comme un arbre ! ». Le cinquième, lui tirant une de ses larges oreilles : « N'importe quoi ! C'est comme un éventail ! ». Quant au dernier, à l'arrière, lui tenant la queue : « Qu'est-ce que vous dites ? Un éléphant, c'est comme une corde ! ». Les autres villageois gloussèrent de ce cadavre exquis que formait leur joute, puis consentirent à leur expliquer le tour qu'ils venaient de leur jouer. On leur fit remarquer que, d'une certaine façon, tous avaient tort mais que, d'une certaine façon aussi, chacun avait raison. Que la réalité était, en somme, une construction collective. Bon. Soit. Mais qu'en poussant un peu plus loin les leçons de cette expérience, cette dernière leur apprenait surtout que la réalité était d'abord chose vivante, incoercible, pachydermique ; possédant ce don particulier de ne pouvoir être exprimée qu'au moyen d'autres images. Que la réalité ne renvoyait finalement jamais qu'à une autre, qui, pour elle-même être décrite, ne renvoyait à son tour qu'à une troisième, etc., etc., etc.

Javier Teillez, Letter on the blind for the use of those who see, 2007.
L'histoire à présent finie, ce parent croirait sans doute avoir bien fait, mais, à observer minutieusement la bouille de son bambin, il reconnaîtrait là un silence et un regard qui ne trompent pas. Diable ! Il aura voulu se montrer rassurant, et peut-être aura-t-il finalement porté le coup de grâce. En distinguant les deux petites rides tracées au milieu du front par ses sourcils froncés, il devinerait que les questions se bousculent dans sa tête : comment jadis cette belle idée a-t-elle pu donner lieu à un tel martyre ? Pourquoi les hommes ne comprenaient-ils pas qu'ils choisissaient de vivre une vie qui s'accorde au sort qu'ils réservent à la réalité ? Et si l'éléphant a un jour été pour nos ancêtres cette excroissance mouvante du monde, d'où leur venait cet acharnement depuis à le traquer, l'asservir et, au final, le faire disparaître ?
Soudain, ce parent sut quoi lui répondre. Comment s'y prendre. Il allait renverser le problème. Même si elle était fausse, il commença par lui demander s'il connaissait cette légende selon laquelle les éléphants auraient une peur panique des souris. L'enfant acquiesça et, un bref instant, l'adulte s'en voulut de continuer à jouer comme tout le monde avec sa crédulité. Mais tant pis. Ce soir, c'était pour la bonne cause. Il lui dit, tout de go : “Vois-tu, les souris, c'est nous. Les souris, c'est avant tout le besoin qui nous est propre de rogner petit à petit ce qui nous dépasse.” Un complexe de Goliath. Et puisqu'on venait d'en parler récemment en classe à son chérubin, il en profita pour lui rappeler que c'était à La Fontaine que l'on devait d'avoir introduit ce futur proverbe arguant que nous vivions dans un monde où les montagnes accouchaient bien souvent de souris. Et qu'à nouveau, c'était faux. Ou disons, là encore, seulement à moitié vrai. Car ce que La Fontaine omit d'ajouter, c'était bien cette autre versant de la réalité, tout aussi terrible que le premier : que nous vivions dans un monde où les souris ne naissaient pas uniquement des montagnes, elles les dévoraient. Que plus c'était gros, moins il fallait que ça passât, justement. Que tout ce qui en réchappait relevait donc purement et simplement du miracle, et que cela devrait suffire à convaincre même la plus agnostique d'entre toutes ces souris. Derrière ces circonlocutions, il cherchait à lui dire qu'au milieu de cet outrage constant fait au visible, le monde continuait chaque jour d'appartenir aux rescapés.
Dans les années 1990, l’auteur de bande dessinée Art Spiegelman avait d'ailleurs fait avec Maus, à partir d'une population de souris, un succès planétaire sur l'extermination des Juifs d'Europe durant la seconde guerre mondiale. Des chats campaient soldats de la Wermacht et officiers de la Gestapo. Comme un Tom et Jerry pour adulte propulsé en plein Troisième Reich. Comme si revenir sur le traumatisme majeur du XXème siècle impliquait par pudeur, par crainte, d'avancer sous le masque des animaux ; de réduire l'échelle physique des victimes du génocide afin de pouvoir mieux en appréhender le retentissement ontologique, en décupler, en centupler sa démesure et sa folie ; défigurer, “animaliser” l'humain pour mieux s'approcher de sa monstruosité.
Dans l'une des toutes premières versions de ce futur best-seller, qui prenait là aussi la forme d'un dialogue au moment du coucher entre un père et son fils, Spiegelman avait baptisé ce dernier Mickey, en référence, bien sûr, au rongeur célèbre inventé par Walt Disney en 1928, d'ores et déjà depuis des décennies la mascotte et l’emblème de tout ce qui aura été soustrait de violent aux contes pour enfants que s'était approprié son créateur. Drôle d'ironie, n'est-ce pas ? Car, qu'on le veuille ou non, il y a bien une qualité du mensonge fait aux enfants à prendre en compte. Sacha Guitry disait qu'il fallait toujours soigner un mensonge, que c'était un hommage rendu à la personne que l'on trompait.
Ce serait le cas de « Murderous Mary », cette éléphante condamnée à mort par pendaison après avoir tué un pseudo-dresseur engagé deux jours avant son exécution. La seule image qui nous restera d'elle est celle de ce jour fatidique. Truquée, paraît-il. Or, même si elle était avérée, la supercherie ne lui enlèverait rien. Au contraire, elle ne ferait que redoubler son horreur – comme pour Maus. Et des souris, ce 13 septembre 1916, il y en avait toute une foule à ses pieds – soigneusement laissée hors cadre par le photographe. Pas loin de deux mille cinq cents, s'accordent à dire les comptes-rendus de l'époque, venues assister au spectacle d'un pachyderme qu'on arrache à la gravité terrestre pour les dernières minutes de son existence. Dumbo, l'éléphant qui vole, projeté vingt-cinq ans plus tard, trouve là son pendant macabre originel. Une créature de cinq tonnes pour laquelle l'ingénierie humaine déploya des moyens dignes d'Hollywood. L'énorme chaîne d'acier au bout de laquelle se balançait Mary ce jour-là, ce sont ces câbles qu'un siècle plus tard tout spectateur regardera ébahi dans les bonus Blu-ray de ses films d'actions préférés. Cette machinerie de poulies et de cordages avec laquelle on réalise les cascades les plus invraisemblables, et qui permet précisément de défier toutes les lois terrestres. Gommez maintenant numériquement sa potence, et Mary aussi donnerait l'impression de décoller, puis de flotter. La magie du cinéma est parfois ramassé toute entière dans un simple trucage avec la mort. Autrement dit, il suffirait d'un minuscule mensonge supplémentaire, accompli par la main d'un Mandrake numérique, pour que d'inimaginable cette scène bascule dans l'imaginaire. C'est peut-être ça, au fond, la faiblesse que serait Dumbo – et Disney en général : miser sur la force paradoxalement rédemptrice du mensonge.

Exécution par pendaison de “Murderous Mary”, le 13 septembre 1916.
Un curieux destin a voulu que les mises à mort d'éléphants aient sans cesse flirté avec une performance artistique morbide. Par sa taille, son poids, sa majesté, c'est comme si tout concourrait à voir chez le pachyderme le rival suprême des temps modernes et de son bulldozer industriel, technique et économique. « Artistique » est certes un mot qui peut faire froid dans le dos au vu de l'atrocité de pareilles manifestations, mais la notion de performance, elle, est en revanche indéniable, et cela avant tout chez leurs commanditaires. Raison pour laquelle le document (qu'il soit photographique ou cinématographique) semble avoir été comme un réflexe irrésistible, plus insensé encore que l’événement dont il témoigne.
Treize ans avant Mary, c'était à Topsy, une éléphante atterrie depuis son Asie natale dans un cirque de Luna Park à Coney Island, d'être exécutée cette fois sous l’œil des caméras d'un des papes de l'ère industrielle, touche-à-tout à la fois du cinéma et des télé-communications : Thomas Edison. L’exécution de Topsy avait alors pour toile de fond une concurrence féroce entre deux grandes compagnies pour rafler le marché américain de l'électricité : celle de George Westinghouse et celle de Tomas Edison, ce dernier défendant mordicus l'utilisation du courant continu pour alimenter les villes en dépit de la lourdeur et de la fragilité du matériel requis, accroissant considérablement les risques pour la sécurité publique. Afin de faire taire la polémique, Edison profita de ce fait divers qui défrayait alors la chronique à propos de cette éléphante incontrôlable – et que les autorités souhaitaient abattre de toute urgence – pour proposer ses services. Sa stratégie fut vicieusement retorse, car ce n'était pas le courant continu, son bébé, qu'il souhaitait promouvoir avec ce coup de pub déplorable (et donc user pour assassiner l'animal), non, Edison entendait se servir à la place du courant alternatif prôné par son rival, et ainsi démontrer aux yeux de tous sa dangerosité notoire. Il l'avait testé auparavant sur des chats, des chiens, un cheval, et même sur un homme, William Kemmler, en 1890 (le premier cobaye de la chaise électrique aux États-Unis). En ce 4 janvier 1903, on l'autorisa ainsi à reproduire son geste sur le plus grand mammifère terrestre. On passa par conséquent une aussière autour du cou de Topsy, reliée à un poste électrique. On attacha à ses pieds des sandales de bois garnies de cuivre, puis on lui administra une décharge de 6.600 volts à travers tout le corps, qui laissa s'échapper en guise de seule plainte, sur l'archive muette qui nous est parvenue, une épaisse fumée blanche. La scène dura environ deux minutes, au bout de laquelle Topsy s'écroula sur le flanc. Topsy mourut, mais le petit jeu d'Edison allait bientôt se retourner contre lui, le courant alternatif étant en effet définitivement adopté quelques années plus tard à travers tout le pays. Edison voulut illuminer une nation tout entière, mais il restera dans l'Histoire comme son bourreau de l'ombre, cantonné aux allées lugubres des couloirs de la mort des prisons américaines. L'agent conducteur (pour reprendre le jargon électrique) du revers sombre de la modernité. Un faux-prophète, dissimulé sous les traits du novateur et du progressiste, et un éclaireur de l'enténèbrement.
Depuis cette mise à mort hautement symbolique, telle l'inauguration sacrificielle d'un nouveau règne, on peut s'évertuer à chercher les traces au cinéma de la tutelle dorénavant auratique du pachyderme, ne faisant plus peser qu'entre les hommes cette double histoire de torture et d'injustice qui fut la sienne. Joseph Merrick, surnommé « Elephant man », dont David Lynch tira un film de sa courte vie en 1980, serait sans conteste l'enfant monstrueux de ce legs en devenir. Il s'éteint quelques mois à peine avant l'exécution à la prison d'Auburn de William Kemmler. Raillé, rejeté, exhibé dans les foires ambulantes avant d'être pris sous l'aile du Docteur Frederik Treves, qui put lui assurer une place de résident permanent à l'Hôpital de Londres, il trouva finalement le repos un soir en s'allongeant dans son lit, alors que de par sa tête protubérante il savait ne pouvoir s'endormir qu'assis. Ultime sursaut d'appartenance à cette race humaine qui l'avait pourtant si rudement éprouvé. Pour Merrick, on peut dire que l'Homme a été son dernier conte, une berceuse à laquelle, un 11 avril, il s'est autorisé à croire pour la seule et unique fois de sa vie. Pas de doute : Ganesh, c'était lui. Cette divinité à tête d'éléphant chevauchant une souris de la cosmogonie indienne. Une divinité reliant, non plus en termes d'opposition mais d'équivalence, le microcosme et le macrocosme, la splendeur et le vil, le bon et la vermine, l'évidence et le secret. Ganesh est la divinité de la libération de ces antagonismes. Ou, pour être plus exact, de leur juste proportion dans l'équilibre du monde, c'est-à dire, au fond, de leur transcendance mutuelle.
Le scénariste Alan Moore fit de Joseph Merrick un personnage de prime importance dans la psychologie du tueur de From Hell, la bande dessinée qu'il consacra à Jack L’Éventreur. Bien qu'intermittente, Merrick est une présence déterminante dans la caution que confère l'auteur à Gull, l'atroce assassin de Whitechapel choisi par Moore, pour justifier ses crimes. Merrick est un monstre élevé au rang de dieu par un barbare, voilà le portrait absurde que dresse From Hell de cette société nouvelle qui émerge au XIXème siècle. Pour moi, enfant des années 1990, c’est Babar, l'éléphant habillé en homme du conte créé par Cécile et Jean de Brunhoff en 1931 – un éléphant qui devient roi en son royaume grâce à son passage par la civilisation humaine –, qui porte jusque dans le nom de son héros (Babar/barbare) le positivisme forcené, oublieux, de l’histoire vraie de Merrick.

Joseph Merrick, dit “Elephant Man”, 1889.
Cet engrenage amorcé par Moore comme reflet de la lente dégradation de l'Occident, qui plus est en l'associant à une histoire criminelle mondialement célèbre dont l'identité de son coupable demeurait inconnue, le cinéaste Alan Clarke, en 1989, la poursuivit en n'empruntant plus à l'éléphant que son nom vernaculaire. Une tautologie par laquelle il baptisa justement une fiction minimaliste et sanglante, pur concentré de faits divers réels ayant eu lieu dans la région de Belfast au moment du conflit entre protestants et catholiques. Une succession de ballades meurtrières dont le caractère invraisemblable tient, contre toute attente, à son dépouillement extrême (absence de dialogue, de figurants, de motivation, de contextualisation) et à son principe de répétition confinant presque à un burlesque noir, brutal et malaisant. La mise en scène, effectuée entièrement à l'aide d'une Steadycam, est gracieuse et aérienne, la caméra lévite autour des personnages quand bien même c'est la lourdeur des corps criblés de plombs que ceint invariablement son élégante chorégraphie. Elephant, donc, est ce théâtre à ciel ouvert où la liberté extrême est ici synonyme de libération des pulsions. « Calm like a bomb », pour reprendre une chanson du groupe Rage Against The Machine. Plus les scènes se succèdent – son spectateur comprenant bien vite leur fatal dénouement à toutes –, moins elles nous paraissent réelles. Comme une mauvaise blague racontée en boucle, avec sa chute connue d'avance inlassablement rabâchée. L'effet d'accumulation ne participe pas à mieux cerner ce qui s'y trame, au contraire, à chaque nouveau forfait commis le sens nous glisse un peu plus entre les doigts. Si Elephant est une fable, c'est celle d'un seul mot (son titre), d'un seul son (ses coups de feu). Une suite de déflagrations, aussi imposante et inéluctable qu'une charge d'éléphant. Des barrissements d'amorces et de poudre. L'éléphant, dans Elephant, est l'image d'un réel trop énorme pour y croire. Un réel bigger than life à la vue de tous, suscitant malgré tout une profonde, flagrante, insondable indifférence.
Ce réel derrière la fiction de Clarke, cette littéralité de la métaphore de son titre, d'autres images, celles de la fuite de l’éléphant Tyke sur l'île d'Hawaï en 1994, course-poursuite ponctuée par une centaine de projectiles tirés par la police dans le but de neutraliser l'animal, filmée par des caméras amatrices sous le chapiteau du Neal S. Blaisdell Center où elle se produisait comme par celles des télévisions locales dans les rues de la capitale d'Honolulu, ces images sont le dernier cauchemar en date où l'éléphant a resurgi à l'homme comme le nez au milieu de la figure de son horreur hélas indomptable. Sa priorité étant alors de tuer ce “Mal” à la seconde où il n'a plus la mainmise dessus, dès qu'Il devient publiquement le miroir grossissant de la sienne propre. La sauvagerie au secours du sauvage.
Et pourtant, oui pourtant, l'éléphant aurait pu danser : Chris Marker a montré qu'il le pouvait dans son court-métrage Slon Tango ; il aurait pu feindre à merveille toutes les morts par lesquelles on le fit passer : Douglas Gordon le lui fit jouer dans son installation vidéo Play Dead ; il aurait pu disparaître comme par magie : Haruki Murakami avait réussi ce prodige dans sa nouvelle Un éléphant s'évapore ; il aurait pu, enfin et surtout, mener nos songes : Winsor McCay, le père de Little Nemo, en avait truffé à de nombreuses reprises ceux couchés sur papier de son éternel rêveur...
Mais peut-être son véritable don n'a jamais été aussi bouleversant que dans le conte que lui consacra l'écrivain Marc-Edouard Nabe, intitulé Un éléphant mémorable. Le récit d'une chasse à l'éléphant blanc, gibier imprenable et seul de son espèce dans toutes les Indes, perpétrée par Lord Carnage, un braconnier aguerri venu de son Angleterre natale pour décimer ce Moby Dick de la jungle. Une de ses balles atteignant l'animal, non du sang mais une bile visqueuse et blanchâtre s’épanche de son corps gargantuesque. Un drôle de liquide dans lequel Lord Carnage peut brusquement revoir les souvenirs les plus intimes de son existence. Or cette mémoire dont il a appris à chasser les plus douloureux moments, ou les plus inavouables, voilà qu'un éléphant les lui rappelle par une provocation insupportable. Tuer la bête devient alors une véritable quête de l'oubli. Un oubli primordial, nécessaire, réconfortant. Une fois jetés à terre, abreuvant le sol, les fragments de sa vie sont pour à jamais perdus. La course du mastodonte à travers les contrées verdoyantes et touffues en pays hindou va bientôt, se hâte-t-il, le rendre amnésique. Dans un ultime face-à-face, l'éléphant s'offre à son bourreau à qui ne reste plus, comme un poisson rouge, que le souvenir le plus récent dans sa cervelle. Cette première blessure qu'il lui fit lançant le compte à rebours de sa mémoire, Lord Carnage comprend qu'il ne peut le tuer pour de bon qu'en se supprimant lui-même. Il se retire donc dans une des alcôves ombragées de la forêt et, se tirant une balle de fusil dans la bouche, ne put assister à la chute de son mythique adversaire en un fracas de poussière...
Notre parent n'avait pas tout à fait achevé l'aventure de Lord Carnage que son rejeton s'était déjà assoupi, et cela sans connaître le point d'orgue du sortilège liant son chasseur suicidaire à sa proie séculaire. S'il y a des choses qu'il est préférable de taire à des tout petits avant un certain âge, il y en a d'autres qu'ils peuvent tout simplement ne pas avoir envie d'entendre. Depuis qu'on lui racontait des histoires, c'était comme ça, l’enfant avait pris l'habitude d'en manquer les fins. Ainsi chaque nuit il pouvait échafauder sous son crâne le moyen pour que demain ait lieu. Il apprendrait bien vite, n’importe comment, que chaque jour était à l'image d'une vie entière. Que grandir consistait à savoir, et davantage encore que la veille, qui, réellement, trompait son monde. Il s'agissait avant tout de rétablir des secrets et de débusquer les faussaires. Grandir était trouver ses propres proverbes.
Ce soir-là, il comprit que plus tard il voulait être une souris qui accoucherait d'éléphants.

Embryon d’éléphant, Ouganda, 1966, par Peter Beard.
#warrenlambert#Elephant#éléphant#éléphants#Dumbo#Jumbo#WaltDisney#AlanMoore#Jacktheripper#jackléventreur#from hell#DouglasGordon#ChrisMarker#DavidLynch#Nabe#MarcédouardNabe#MobyDick#JohnMerrick#JosephMerrick#ElephantMan#MurderousMary#Maus#ArtSpiegelman#AlanClarke#harukimurakami#lefeusacré#thomasedison#williamkemmler
7 notes
·
View notes
Text
What if we recall the mysterious presence we do not remember?

A reflection on the essence of human memory, explaining the failure to remember one’s memory's complexities, and how the understanding of global histories is influenced as a result.
Sans Soleil is a French experimental/documentary film directed by Chris Marker in 1983.

Chris Marker’s perception of time and movement reflects not only on Sans Soleil but also one of his works called La Jetée, autobiographical project, which illustrates reality and time as a self-delusion of one(self). Sans Soleil and La Jetée have so many parallels as Markers’ poetry like narrative and how frame and editing utilized. Unlike La Jetée, Sans Soleil is made up of stock footage, excerpts from Japanese films and series, selections from other films (Vertigo, etc.), as well as Marker's documentary footage which moves audience from mind to mind between the Far East, Africa, and America. While New Wave directors never break from the influence of fiction and documentary literature, other directors tend to attempt to transcend the ugliness of politics with the poetry they've sprinkled within. Marker concerns about not only the future war but also the possibility of forgetting what the world has done and what has left. His political commentary relies on history, its depiction and oblivion of injustice in both societies. Starting with poverty, back and forth demonstrating the contrast of Japan and Africa. Throughout Sans Soleil two concepts have clashed: mass production, inhuman atmosphere and poverty. Therefore, his commentary on capitalism strengthen the notion of “lonely in crowd” understanding. How should we look at horror films in Japan from the same perspective and do those who make us experience the most disturbing moments of terror just compose of a cultural feeling? All this battle, drought, bureaucratic order...
Marker's ability to change those national features when he travels from one society to another suggests that he sees himself in Africa as a European marxist, in Japan as an American obsessed with science and technological creativity, and in the United States as a French surrealist, a naturalized visitor of some kind.

There is a French word, ésprit de l’escalier : the feeling of worrying about what to say after the right moment to say it has gone. Even he mentions about memories being dissolved by time like words and ‘wound of separation’ “…With time, the wound of separation loses its true dimensions…”
Marker sees the very act of contact as a collaborative operation, forcing as their personal mise-en-scène on us. Splitting into different voices and personal facilitates not only a dialogue between them all, but also a conversation between them all and the viewer (especially with gazes and sounds).

The continuation between scenes supported by sounds, editing and montage techniques which has same montage techniques like La Jetée, such as using the repetitive images with dissolve transition to get rid of the stillness of the images and create a smooth dynamic between scenes.
Marker especially points out the dreams and collective unconscious through shared cultures and experiences in history. It can be observable that Marker tend to work on realities, dreams and memories to experience them to rewrite.

“The dream works as dreams are supposed to, so when I am awake I find myself still seeking that mysterious presence.”
3 notes
·
View notes
Photo

Le chef-d’œuvre de Chris Marker, La Jetée en coffret collector aux éditions @potemkinefilms disponible au rayon Cinéma de la @librairie_mollat #chrismarker #lajetee #lajetée #cinema #cinéma (à librairie mollat) https://www.instagram.com/p/CJTXnEMHE_V/?igshid=xmfnxstr21ak
1 note
·
View note
Photo

3 notes
·
View notes
Photo

#chrismarker https://www.instagram.com/p/CAlcf5RhkaN/?igshid=1oi41tocxwnzr
3 notes
·
View notes
Video
youtube
December Seeds
2 notes
·
View notes




