#panoptique surveillance
Text
Surveillance et discipline
Surveiller et punir ? A l'heure du numérique, une société disciplinaire en vue ? #Foucault #1984 #SIC
Nos sociétés sont aujourd’hui sous surveillance. Par les drones, les caméras de surveillance, nos empreintes numériques.
Cette surveillance a une histoire. Maîtriser les comportements dans une société démocratique ou pas. Et surtout discipliner la société, en la connaissant ; la mesurant. Pour le bien du “bien vivre” ensemble, ou pour la contrôler.
C’est l’histoire de la surveillance, écrite…

View On WordPress
#est on surveillé#examen et surveillance#panoptique surveillance#résumé surveiller et punir foucault#sanction disciplinaire#surveiller et punir fiche de lecture#synthèse surveiller et punir#techniques de discipline
0 notes
Text
SÉANCE #11 - "Sousveillance citoyenne : un combat contre le capitalisme de surveillance"

Aujourd'hui, nous vivons dans une ère du capitalisme de surveillance. Cela signifie que nous sommes sous le regard omniprésent des algorithmes des GAFAM qui suivent nos moindres actions sur le web. Cependant, dans ce panoptique numérique, nous allons présenter une contre-culture qui ne cesse de prendre de l'ampleur : la sousveillance citoyenne.
« Si vous voulez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain, pour toujours. La morale à tirer de cette situation dangereuse cauchemardesque est simple : ne laissez pas cela se produire. Tout dépend de vous. ». Voici une citation de l'écrivain George Orwell, numéro de son chef-d'œuvre, 1984. Ce cri d'alerte datant de 1949 décrit parfaitement notre rapport actuel avec le numérique. Cette botte peut être affiliée aux gouvernements qui surveillent les populations par le biais du numérique ou aux grandes entreprises américaines de la technologie qui exploitent nos présences numériques pour accroître leurs profits. Les géants du numérique comme Google, Meta, ou Microsoft capitalisent sur nos existences numériques, façonnant nos réalités, nos habitudes, et nos interactions sociales selon leurs intérêts commerciaux.
La sousveillance citoyenne est la résistance à cette "botte". Selon Camille Alloing, la sousveillance "désigne alors les capacités données à chaque citoyen de faire usage des dispositifs numériques pour "regarder d'en bas" les différentes formes de pouvoirs étatiques ou commerciaux." Ce mouvement permet l'avènement de héros modernes tels qu'Edward Snowden ou Frances Haugen. Ces lanceurs d'alerte défient ainsi la surveillance numérique des États et des grandes entreprises technologiques, éveillant également le grand public sur les méthodes de surveillance numérique de masse.
Dorénavant, les citoyens s'adonnent à la sousveillance numérique, par exemple en utilisant les médias sociaux pour dénoncer les dérapages de la police. Cependant, ce mouvement citoyen n'est pas exempt de critiques. On peut donc s'inquiéter de la création d'une culture de la méfiance généralisée. Ainsi, établir un équilibre entre la protection de la vie privée et la responsabilité sociétale devient un objectif incontournable.
En fin de compte, on peut constater que la sousveillance citoyenne s'élève comme un véritable contrepoids face à l'avènement du capitalisme de surveillance. Ce mouvement citoyen doit permettre de redonner du pouvoir en tant qu'individus dans un monde hyperconnecté. La sousveillance offre un authentique espoir de liberté, une volonté de reprendre le contrôle de nos récits numériques.
Sources :
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2016-3-page-68.htm
0 notes
Text
youtube
Marie-lyne Bezille
14 h · YouTube ·
"Des uniformes, des masques, des numéros, des déguisements, tous les atours de la déshumanisation sont présents dans Squid Game. Cette fiction peut faire penser à de nombreuses théories philosophiques. On peut rapidement évoquer la surveillance façon Michel Foucault mais aussi l’architecture panoptique dont parle Bentham. On y retrouve certainement aussi la fabrique du consentement, l’idée de servitude volontaire, aussi celle d’obéissance. On ne peut pas s’empêcher en effet de penser aux expériences faites par Milgram sur ces sujets-là.
Mais au-delà de tout cela, cette dystopie met aussi la lumière sur les 1% des 1% les plus riches d’une planète, qui, ne sachant plus quoi faire de leur argent et de leur vie, s’adonnent à des jeux cruels, pervers, et pourquoi pas, mortels."
1 note
·
View note
Text
Le marginal plein de sève qui monte socialement par les femmes et par le travail (l'un appelant l'autre), le Martin Eden, le Georges Duroy, le Jed Martin, est mal barré. Le management, le système d'exploitation, n'admet pas l'homme total autrefois appelé Kalos Kagatos. Dans une prison à surveillance panoptique il n'y a que des individus compartimentés. Dans une société d'aliénation il n'y a que des experts et des spécialistes, qui sont en fait des infirmes intellectuels et des amputés de l'intuition, des hommes parcellaires, jamais des hommes complets. La grâce de la rencontre tardive de Soral avec Michel Clouscard réside à la fois dans l'oeuvre du dernier philosophe marxiste sérieux aux prédictions toutes avérées vraies sur le libéralisme libertaire, que dans son statut d'ancien athlète de haut niveau. "Vérifie les paroles par les actes" recommandait Sénèque à Lucilius. Dans un monde si pauvre en exemples vivants, l'être d'exception est un demi-dieu et il n'y a aucune honte à admirer qui vous est supérieur.
A l'opposé, Houellebecq tient de Baudelaire la figure de l'albatros, du déshérité virtuose intellectuel, mais inapte à la vie pratique, cabossé par la brutalité d'un système à la fois très méchant et très simple.
Mais pourquoi des hommes supérieurement intelligents, qui ont tout pour réussir s'embarrassent-ils d'un niveau de conscience élevé donc douloureux? C'est que les "réussites" que le monde leur propose, les fameuses situations, sont de très pâles gratifications en regard de leur brûlant idéal. Finalement que veulent nous dire les tièdes? Rien d'autre que "Relâches toi aujourd'hui dans le plaisir que permet ton statut enviable". Quelle question veulent nous poser les tièdes? "Pourquoi ne te places-tu pas plutôt du côté des plus forts?". Les combats des hommes libres sont en creux des reproches aux renoncements de l'homme de meute, et il vous déteste pour cette raison: sans le savoir vous l'insultez. Et finalement ce n'est pas le succès ou l'insuccès qui est reproché à Houellebecq et à Soral mais bien d'avoir gardé la pureté .
2 notes
·
View notes
Photo

“Par l’effet du contre-jour, on peut saisir de la tour, se découpant exactement sur la lumière, les petites silhouettes captives dans les cellules de la périphérie. Autant de cages, autant de petits théâtres, où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt.”
Foucault, “Le panoptisme” in Surveiller et Punir, p233
6 notes
·
View notes
Text
Ce qui se passe, ce sont des mots (Beckett), ainsi dans le roman 1984 d’Orwell, la surveillance panoptique de Big Brother ne s’applique qu’à une minorité de sujets (celle qui par son maniement de la langue est encore capable de contrarier l’idéologie dominante) la majorité de la population ayant déjà été rendue inoffensive par son état de sous-développement langagier, cela ne nous questionne-t-il pas la régression accélérée du système éducatif après plus de trente ans de réformisme forcé, dont – est-il besoin de le rappeler? – la gauche au pouvoir a été le principal artisan?
Ni gauche, ni droite, nitroglycérine.
2 notes
·
View notes
Text
@larosezen, bonjour et bonne année ! Je suis vraiment navré.e d’être aussi en retard pour ton cadeau, mais je n’avais pas internet (ni même l’eau chaude, le chauffage et l’électricité pendant un temps, c’était un peu le bazar). J’espère que tu as passé d’excellentes fêtes de fin d’années et que mon cadeau te plaira assez pour que tu me pardonnes toute cette attente. Meilleurs voeux pour l’année qui s’annonce !
Douces nuits
Fandom: The Man From U.N.C.L.E.
Category : Gen
Relationships : une pincée de Gaby/Illya/Napoléon
Characters : Gaby Teller, Napoléon Solo, Illya Kuryakin, Alexander Waverly
Istanbul, 24 décembre 1963 :
Au cœur de l'action tout avait été plus facile. Ils étaient tous les trois les instruments (les agents) d'une volonté unique : arrêter Victoria. Si on avait demandé à Gaby de décrire leur relation à cet instant, elle aurait parlé en termes de mécanismes, de composants de moteur. Quelque chose d'élémentaire, de familier et d'intuitif.
Dans les heures qui avaient suivi le règlement brutal et définitif de la question Vinciguerra, les choses avaient été encore plus simples. Elle pensait ne jamais revoir ni Illya, ni Napoléon. Il lui avait suffit d'éviter soigneusement le regard du second et de n'échanger avec le premier que quelques phrases, quelques touches passionnées qu'elle pensait emmener avec elle dans ce que lui réservait Waverly (quoi que cela puisse être) et le tour était joué.
Elle n'aurait jamais prévu que ce qu'il lui réservait, justement, c'était plus de temps passé en présence des deux hommes, c'était la recréation d'une équipe efficace mais fragile, c'était Istanbul.
Une mission de surveillance peu riche en émotion, où ils passent le plus clair de leur temps enfermés dans un grenier ayant vue sur l'hôtel particulier d'un baron de la drogue. La pièce est pourvue de deux fenêtres pour trois, d'un matériel d'écoute pour trois, d’un plafond en pente contre lequel Illya et Napoléon ne cessent de se cogner et d’un poêle qui ne marche pas. Illya se déplace autour de Gaby en prenant soin de ne jamais la toucher, comme un ours inquiet d'abîmer une poupée de porcelaine. Napoléon, lui, fait comme si rien n'avait changé entre eux trois et Gaby ne sait pas comment dire qu'elle est désolée. Désolée de les avoir trahis, désolée d'avoir jeté Napoléon dans les griffes d'oncle Rudi, désolée surtout de savoir au plus profond d'elle-même que si tout était à refaire, elle ne changerait aucun de ses choix. Elle n'a jamais été douée pour les excuses.
Il fait nuit et beaucoup plus froid qu'elle ne l'aurait cru possible à Istanbul. La neige tombe doucement depuis maintenant deux jours. C'est entre vingt-trois heures et minuit, lorsque Gaby se lève pour aller cherche la bouteille de raki achetée un peu par hasard ce matin, qu'a lieu leur petit miracle de Noël. Car au même moment les deux hommes sortent de leur veste qui une boîte de loukoums hors de prix et qui un pot de terrine aux truffes déniché Dieu sait où.
Gaby sert trois verres minuscules, observe Napoléon et Illya qui la regardent sans rien dire. Elle se sent soudain libérée d'un grand poids.
- A quoi trinquons-nous ? Demande-t-elle.
- A nous, répond Napoléon.
Ce qu'ils font, Gaby découvrant qu'elle n'aime pas le raki.
- Eh bien, sourit Illya. Joyeux Noël, je suppose.
Florence, 25 décembre 1967 :
Waverly est livide au bout du fil. Cela s'entend à sa façon d'articuler. Trop furieux pour crier, ou pour l'invectiver, il se contente d'énoncer clairement, méthodiquement, les conséquences de leur échec. Des dégâts matériels énormes. Un informateur mort. Sept agents UNCLE dont la couverture est compromise. Des milliers de vies en danger.
Gaby jette un coup d’œil à ses deux collègues et constate qu'ils se sont inconsciemment agencés comme ils le font d'ordinaire dans le bureau de leur supérieur. Napoléon harmonieusement installé dans un fauteuil, cherchant (et pour une fois échouant dans les grandes largeurs) à distiller un air d'assurance nonchalante. Illya debout presque au garde-à-vous, surveillant à la fois la porte et les fenêtres tel un panoptique. Il ferme et referme ses poings, se haïssant probablement de n'avoir pas été assez aux aguets, pas assez réactif, de n'avoir pas pu empêcher... Et elle-même, appuyée comme toujours contre le mur, focalisée sur les paroles de Waverly. Mais ses paroles sont différentes cette fois et Gaby croirait presque entendre la voix de son père (l'adoptif, le vrai).
- Je ne pense pas avoir besoin, continue-t-il, de réitérer l'urgence de la situation. Cela ne ferait qu'insulter à la fois votre sens du devoir et votre intelligence. Reprenez-vous en mains, agents. Je n'aurais pas placé un tel fardeau sur vos épaules si je ne vous avais pas pensé capable de le supporter.
Gaby hoche la tête avant de se souvenir qu'elle est au téléphone :
- Je vous recontacterai quand la menace aura été éliminée.
- Vous avez toute ma confiance. Oh, et joyeux Noël, je suppose.
Elle a déjà raccroché.
Shanghai, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 :
Leur cible est un homme de cinquante-sept ans, un peu trapu, très ambitieux, qui n'aime pas les soviets. Qui n'aime vraiment, vraiment pas les soviets, comme il le répète ad nauseam, sa voix rebondissant sur les murs de tôle.
Gaby ne voit pas l'expression de l'homme, il lui tourne le dos ; pas plus qu'elle ne voit Napoléon, qu'elle sait derrière elle, prêt à la couvrir du mieux qu'il peut. Mais elle ne voit pas non plus le hangar, ni les conteneurs entreposés, ni même les poutrelles glacées, glissantes, grinçantes, sur lesquelles elle avance subrepticement depuis tout à l'heure. Elle ne voit qu'Illya, ses traits blafards, la sueur sur son front, ses mains crispées sur son abdomen, la couleur du sang.
Leur cible parle toujours. Parle et parle et parle et Gaby fait un pas après l'autre, ignorant son vertige puisqu'elle ne voit pas le vide, puisqu'elle ne voit qu'Illya. Illya qui ignore leur présence, Illya qui se croit seul face à une mort certaine.
Leur cible parle et Gaby voudrait lui crier des encouragements. « Continuez » a-t-elle envie de hurler. « Continuez donc ! Expliquez-nous plus en détail comment vous avez immédiatement soupçonné Illya à cause de son accent russe, redites-nous à quel point on ne peut pas leur faire confiance, reparlez-nous de votre vie, de tout ce qui a nourrit votre haine, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez surtout pas de parler. »
Elle est presque au-dessus de lui, plus que quelques centimètres à parcourir pour atteindre son but et Gaby soudain voit tout, pas seulement Illya, plusieurs mètres en-dessous d'elle, mais aussi le sol (plusieurs mètres en-dessous d'elle) et cet homme qui parle encore (plusieurs mètres en-dessous d'elle) et Napoléon, trop lourd pour les poutres, dont le visage a, lorsqu'elle se retourne vers lui, cet air inexpressif, comme coulé dans la cire, qui lui vient parfois dans les situations de vie ou de mort.
- Mais l'heure tourne, dit l'homme en-dessous d'elle, et j'ai encore beaucoup à faire. Joyeux Noël, je suppose.
Il lève son arme.
Gaby saute dans le vide.
Paris, 24 décembre 1975 :
L'arbre de Noël est aux sapins ce qu'Illya est aux hommes, ce par quoi Gaby entend « absolument gigantesque ». Des cadeaux y ont étés entassés au cours de la soirée et une grande femme vêtue de cachemire noir les sélectionne les uns après les autres pour lire à voix très haute le nom inscrit dessus.
Le présent qu'elle vient de soulever est léger et souple, Gaby reconnaît immédiatement le paquet qu'elle a emballé avec Illya dans du papier gris perle et n'est donc pas surprise quand Napoléon est appelé à son tour.
Si on avait dit à la Gaby d'avant-guerre qu'elle réveillonnerait avec la crème de la crème, le haut du panier de l'avant garde artistique parisienne, elle aurait cru en sa bonne étoile et travaillé dur pour que cette prophétie se réalise. Si on avait dit la même chose à la Gaby d'après-guerre, elle aurait haussé les épaules et serait retournée à ses voitures. Ce soir-là, pourtant, ce sont bien les artistes les plus courus de Paris qui se pressent autour d'elle et la traitent comme l'une des leurs. Leur mission actuelle (intégrer le cercle d'amis d'un peintre soupçonné d'espionnage) s'est révélée beaucoup plus simple et agréable que prévue.
Illya se fait passer pour un danseur-chorégraphe, Napoléon pour un collectionneur et Gaby, elle, assemble des sculptures immenses avec de vieilles guimbardes désossées. Elle y a vite pris goût et s'est plus d'une fois surprise à griffonner les esquisses d’œuvres futures dans les brouillons de ses rapports.
Elle ne saurait dire lequel d'entre eux a eu l'idée de les faire passer pour un trio polyamoureux, tant ce mensonge leur est venu aisément. Il est efficace dans ce milieu qui tente désespérément d'être à la page et démontre une indulgence sans faille pour tout ce qui est considéré comme « excentrique »... et ils savent tous les trois se montrer très convaincants. Gaby essaye de ne pas trop s'inquiéter de cette constatation, de l'aisance avec laquelle ils parviennent à fonctionner en couple (trio? trouple ? ménage à trois ? bref). Pour l'instant elle savoure, on verra plus tard.
Elle ne sait pas trop non plus qui, d'Illya ou d'elle, s'est mit le premier en tête de refaire la garde-robe de Napoléon dont les tenues sont bien trop vieux-jeu pour infiltrer un milieu aussi branché. Il se détache d'eux, vêtu d'un pantalon chenille et d'une chemise décontracté qui lui donne l’air jeune, un peu naïf. Il ouvre son cadeau : un manteau de laine bleue marine à boutons argentés, coupe parfaite, signé Pierre Cardin. Chic mais moderne, choisi par Gaby et Illya parce qu'ils savent que Napoléon en appréciera la qualité mais sera gêné par son côté informel. Il l'enfile et parade un peu sous les compliments de l'assemblée puis revient enlacer ses partenaires.
- Vous êtes deux monstres, chuchote-t-il. Je me sens complètement nu dedans.
- Je doute que ton costume d'Adam soit aussi bien taillé, répond Illya du tac au tac.
Gaby se force à boire une gorgée de champagne pour ne pas ricaner.
- Deux monstres, répète Napoléon. Mais je vous souhaiterai malgré tout un joyeux Noël, je suppose.
Une fois la mission terminée, lorsque le pantalon et la chemise refont place aux costumes trois-pièces, le manteau reste.
Dresde, 25 décembre 1979 :
Elle revient à elle par à coups, par vagues. Rien qu'à l'oreille, elle sait qu'elle est dans un hôpital. Elle se souvient de s'être faite tirer dessus. Après ça, pas grand chose. Elle a mal à peu près partout et se demande si c'est normal. Ne devrait-elle pas être sous anti-douleurs ? Cela la décide à ouvrir les yeux.
Elle voit d'abord le plafond, blanc piqueté de bleu, crasseux. Puis le mur d'en face, orné d'une horloge (il est donc cinq heure du matin) et d'une guirlande. Puis, à sa droite, la porte vitrée qui donne sur le couloir. Enfin, lorsqu'elle tourne la tête du bon côté, Illya et Napoléon endormis l'un contre l'autre sur des chaises en plastique.
Napoléon a de plus en plus de cheveux gris, soulignés sans pitié par la lumière des néons. Illya a des rides de rire au coins des lèvres et des yeux. Ils sont sales, tous les deux, et mal rasés, leurs vêtements boueux et froissés. Gaby les trouve beaux. Lorsqu'ils s'éveillent et la regardent, l'affection la submerge :
- Eh bien, sourit-elle. Joyeux Noël, je suppose.
#je ne sais pas trop si tu fêtes noël#mais je ne connais pas assez bien les autres fêtes hivernales pour écrire dessus pour l'instant#j'espère que ça ira#the man from uncle#mine
12 notes
·
View notes
Photo

Surveillance
On ne protège pas une sociéte en ne la surveillant que pour la conditionner à l'être encore davantage demain.
Dans ces espaces surveillés, la démocratie n'y est plus que d'apparat autant que d'apparence.
Spéculation faciale : panique dans le panoptique.
https://dia.so/2Nl
6 notes
·
View notes
Text
PORNOPTICON
BIBLIOGRAPHY
Agrest, Diana, “Architecture from Without: Body, Logic, and Sex,” Assemblage 7 (October 1988), pp. 28-41.
Agrest, Diana, Patricia Conway, and Leslie Kanes Weisman (eds.), The Sex of Architecture (New York: Abrams, 1997).
Bajac, Quentin and Didier Ottinger (eds.), Dreamlands. Des parcs d’attractions aux cités du future (Paris: Centre Pompidou, 2010).
Bancel, Nicolas et al., Zoos humains. De la Vénus Hottentote aux reality shows (Paris: La Découverte, 2002).
Banham, Reyner, Age of Masters: A Personal View of Modern Architecture (New York: Harper and Row, 1966).
Baudrillard, Jen, “Disneyworld Company,” Libération, March 4, 1996.
—, Utopia Deferred, Writing for Utopie, 1967-1978 (New York: Semiotext(e), 2006).
Bentham, Jeremy, Panopticon Writings (New York: Verso, 1995).
Birkin, Lawrence, Consuming Desire: Sexual Science and the Emergence of a Culture of Abundance, 1817-1914 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988).
Bruno, Giuliana, “Bodily Architectures,” Assemblage 19 (December 1992), p.106.
—, “Site-seeing: Architecture and the Moving Image,” Wide Angle 19.4 (1997), pp. 8-24.
Bueno, María José, “Le panopticon érotique de Ledoux,” Dix-huitième siècle 22 (1990), pp. 413-21.
Butler, Judith, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (New York: Routledge, 1993).
—, Excitable Speech: The Politics of the Performative (New York: Routledge, 1997).
—, Giving an Account of Oneself (New York: Fordham University Press, 2005).
—, the Psychic Life of Power: Theories on Subjection (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997).
Califia, Pat, Public Sex: The Culture of Radical Sex (Pittsburgh: Cleis Press, 1994).
Case, Sue Ellen, Feminism and Theater (London: Macmillan, 1998).
Cass, Jeffrey, “Egypt on Steroids: Luxor Las Vegas and Postmodern Orientalism,” in Medina Lasanky and Brian McLaren (eds.), Architecture and Tourism: Perceptions, Performance and Place (Oxford: Berg, 2004).
Chapman, Michel, “Architecture and Hermaphroditism: Gender Ambiguity and the Forbidden Antecedents of Architectural Form,” Queer Space: Centers and Peripheries, Conference Proceedings, Sydney (2007), pp. 1-7.
Colomina, Beatriz, “Architectureproduction,” in Kester Rattenbury (ed.), This is Not Architecture: Media Constructions (New York: Routledge, 2002), pp. 207-21.
—, “Media as Modern Architecture,” in Anthony Vidler (ed.), Architecture: Between Spectacle and Use (New Haven: The Clark Institute/Yale University Press, 2008).
—, “The Media House,” Assemblage 27 (August, 1995), pp. 55-56.
—, Privacy and Publicity: Architecture as Mass Media (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996).
Colomina, Beatriz (ed.), Sexuality and Space (New York: Princeton Architectural Press, 1992).
Debord, Guy, The Society of Spectacle, trans. Donald Nicholson-Smith (New York: Zone Books, 1995).
DeJean, Joan, The Reinvention of Obscenity (Chicago: University of Chicago Press, 2002).
Deleuze, Gilles and Félix Guattari, Mille plateau. Capitalisme et schizophrénie 2 (Paris: Minuit, 1980).
—, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia II (London: Continuum, 1987).
Derrida, Jacques, Monolingualism of the Other, Or the Prosthesis of Origin, trans. Patric Mensah (Stanford, CA: Stanford University Press), 1998).
de Sade, Marquis, “Projet de création de lieux de prostitution, organisés, entretenus et dirigés par l’État,” in Joseph F. Michaud, Biographie Universelle (Graz: Akademische Druck-U. Verlagsanstal, 1968).
Downey, Georgina and Mark Taylor, “Curtains and Carnality: Processual Seductions in Eighteenth Century Text and Space,” in Imagining: Proceedings of the 27th International Sahanz Conference, 30 June-2 July 2010 (New-castle, New South Wales).
Eisenstein, Sergei M., “Montage and Architecture,” Assemblage 10 (1989), pp. 110-31.
Fludernik, Monika, “Carceral Topography: Spatiality, Liminality and Corporality in the Literary Prison,” Textual Practice 13.1 (1999), pp. 43-47.
Foucault, Michel, Abnormal: Lectures at the Collège de France, 1974-75 (New York: Picador, 2003).
—, The Archeology of Knowledge (New York: Pantheon Books, 1972).
—, “Des espaces autres,” Revue d’Archittetura cronache e storia 13.150 (1968), pp. 822-23.
—, “Des espaces autres,” Revue d’Architecture (October 1984), pp. 46-49.
—, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. A. Sheridan (New York: Vintage, 1979).
—, Dits et écrits (Paris: Gallimard, 1994).
—, Essential Works, ed. Paul Rabinow and James D. Faubion (London: Penguin, 2001).
—, Foucault: Ethics, Subjectivity, Truth, ed. Paul Rabinow, trans. Robert Hurley et al. (New York: New Press, 1997).
—, Histoire de la Sexualité, 1. La volonté de savoir (Paris: Gallimard, 1976).
—, The History of Sexuality (New York: Vintage, 1990).
—, Il faut défendre la société, Cours au Collège de France, 1976 (Paris: Seuil, 1997).
—, L’archéologie du savoir (Paris: Gallimard, 1969).
—, Le pourvoir psychiatrique, Cours au Collège de France 1973-74 (Paris: Seuil, 2003).
—, “Les hétérotopies,” in Le corps utopique. Les hétérotopies (Paris: Lignes, 2009), pp. 28-29.
—, Les mots et les choses (Paris: Gallimard, 1966).
—, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-79 (Paris: Seuil, 2004).
—, Naissance de la clinique (Paris: PUF, 1963).
—, The Order of Things (New York: Routledge, 2001).
—, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980).
—, Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, ed. L.H. Martin, H. Gutman, and P.H. Hutton (London: Tavistock, 1988).
—, Les machines à guérir. Aux origines de l’hôpital moderne, 2d ed. (Brussels: Mardaga, 1977).
Foucault, Michel and Jeremy Bentham, Le panoptique, précédé de L’œil du pouvoir, entretien avec Michel Foucault (Paris: Belfond, 1977).
Haraway, Donna, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, (New York: Routledge, 1991).
Hayles, N. Katherine, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (Chicago: University of Chicago Press, 1999).
Ingraham, Catherine, “Utopia/Heterotopia,” course description, Columbia University, 1989.
Koolhaas, Rem, Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, 2d ed. (New York: Monacelli Press, 1994).
Lebensztejn, Jean-Claude, Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation (Cambridge MA: The MIT Press, 2003).
Le Brun, Annie, Les châteaux de la subversion, suivi de Soudain un bloc d’abîme, Sade (Paris: Gallimard, 2010).
Lyon, David, Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond (London: Willan Publishing, 2006).
Manovich, Lev, “The Poetics of Augmented Space,” Visual Communication 5.2 (2006), pp. 219-40.
Marin, Louis, Utopies: Jeux d’espaces (Paris: Éditions de Minuit, 1973).
Martin, Reinhold, The Organizational Complex: Architecture, Media, and Corporate Space (Cambridge MA: The MIT Press, 2005).
McLeod, Mary, “Other Spaces and Others,” in Diana Agrest, Patricia Conway, and Leslie Kanes Weisman (eds.), The Sex of Architecture (New York: Abrams, 19960, pp. 15-28.
McLuhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man (New York, Signet, 1964).
Mulvey, Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” Screen 16.3 (Winter 1975), pp. 6-18.
Otero-Pailos, Jorge, Architecture’s Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010).
Pollock, Griselda, Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time, Space and the Archive (New York: Routledge, 2007),
Preciado, Beatriz-Paul, Pornotopia: An Essay on Playboy’s Architecture and Biopolitics (New York: Zone Books, 2014).
Rheingold, Howard, “Teledildonics: Reach Out and Touch Someone,” Mondo 2000 (Summer 1990), pp. 52-54.
Singley, Paulette, “The Anamorphic Phallus within Ledoux’s Dismembered Plan of Chaux,” Journal of Architectural Education 46.3 (February 1993), pp. 176-88.
Sprinkle, Annie, Post-Porn Modernist: My 25 Years as a Multimedia Whore (San Francisco: Cleis Press, 1998).
Stone, Allucere Rosanne, The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996).
Strange, Carolyn and Alison Bashford, Isolation: Places and Practices of Exclusion (New York: Routledge, 2003).
Triclot, Mathieu, Philosophie des jeux video (Paris: Zones, 2011).
Venturi, Robert, Denise Scott Brown, and Steven Izenour, Learning from Las Vegas, 2d ed. (Cambridge MA: The MIT Press, 1977).
Vidler, Anthony, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely (Cambridge, MA: The MIT Press, 1992).
—, Claude Nicolas Ledoux, Architecture and Utopia in the Era of the French Revolution (Basel: Birkäuser, 2005).
—, The Writing on the Walls: Architectural Theory in the Late Enlightenment (New York: Princeton Architectural Press, 1987).
Vigarello, Georges, Histoire du viol, XVIe-XXe siècles (Paris: Seuil, 1998).
Vigarello, Georges (ed.), Histoire du corps (Paris: Seuil, 2005).
Virilio, Paul, “Improbable Architecture,” Semiotexte (1991), pp. 69-100.
—, “The Overexposed City,” in Neil Leach (ed.), Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory (London: Routledge, 1997), pp. 381-90.
Virilio, Paul, and Sylvère Lotringer, “After Architecture: A Conversation,” Grey Room 3 (Spring 2001), pp. 32-53.
Wallenstein, Sven-Olov, Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture (New York: Columbia University Press, 2009).
Wigley, Mark, “The Architectural Brain,” in Anthony Burke and Therese Tierney (eds.), Network Practices: New Strategies in Architecture and Design (New York: Princeton Architectural Press, 2007), pp. 30-53.
—, “Prosthetic Theory: The Disciplining of Architecture,” Assemblage 15 (August 1991), pp. 6-29.
—, “Towards a History of Quantity,” in Anthony Vidler (ed.), Architecture: Between Spectacle and Use (Williamstown, MA: Clark Art Institute, 2008).
—, “Untitled: The Housing of Gender,” in Beatriz Colomina (ed.), Sexuality and Space (New York: Princeton Architectural Press, 1992), pp. 327-89.
Williams, Linda, Hard Core: Power, Pleasure, and the Frenzy of the Visible (Berkeley: University of California Press, 1989).
Williams, Linda (ed.), Porn Studies (Durham, NC: Duke University Press, 2004).
Zahn, Johanes, Oculus artificialis Teledioptricus, in Hans-Dieter Lohneis, Die deutschen Spiegelkabinette (Munich: Tuduv, 1985).
43 notes
·
View notes
Text
La Sauvage

Titre : La Sauvage
Autrice : Jenni Fagan
Roman contemporain
Maison d’édition : Métailié
Disponible en version papier et numérique - 320 pages
Âge conseillé : jeunes adultes
Résumé
Anais s’est violemment débattue pour échapper à la police et elle a blessé une commissaire de police, qui se trouve dans le coma. Elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé, sa jupe est tachée de sang. Elle est dans le fourgon qui l’amène dans un de ces centres pour adolescents difficiles conçus au XIXe siècle comme un panoptique, destiné à ce que les prisonniers soient toujours visibles par les geôliers.
Anais a connu de nombreuses familles d’accueil, et elle a l’impression d’être un sujet de laboratoire, de faire l’objet d’une expérimentation. Mais elle a 15 ans, est intelligente, belle et insoumise. C’est surtout une enfant qui a été abandonnée, ou pire, par tous les adultes qu’elle a rencontrés.
Dans ce centre d’hébergement elle va vivre avec d’autres adolescents. Isla l’anorexique, pratiquant l’automutilation, séropositive et mère de deux jumelles, et Natasha qui l’aime, veut l’emmener ailleurs avec elle et se prostitue pour gagner l’argent de l’appartement où elles vivront ensemble. Les garçons sont tout aussi perdus et perturbés. Les travailleurs sociaux qui les surveillent sont dépassés ou indifférents. Là elle va décider de mettre fin à l’expérience et de recouvrer sa liberté.
Identités représentées :
Personnage principale neuroatypique (?) / deux filles en couple en secondaire / (peut-être d'autres ?)
Thématiques présentes :
Délinquance, adolescence, violence, addictions
La lutte d'adolescent•e•s pour s'en sortir dans un centre "pour ados difficiles". On suit leurs histoires persos et leurs histoires au centre. La thématique lgbt+ n'est pas au cœur de l'histoire, elle n'en est qu'un élément parmi beaucoup d'autres.
TW / CW : (ultra)violences en tout genre / drogues
Avis de Mayke
Ce livre peut être vraiment difficile, je déconseille aux personnes sensibles, mais autrement il m'a énormément plu, autant par le fond que par la forme.
#malades/Handicap#homosexualité#Homosexualité féminine#lesbienne#la sauvage#jenni fagan#handicap#adolescence#témoignage#survie#tendresse#drogue#violence#coma#délinquance#orphelins#jeune adulte#YA#addictions#neuroatypique#NA#lgbt
3 notes
·
View notes
Text
L’homme sans gravité - Charles Melman
« Nous passons d’une culture fondée sur le refoulement des désirs, et donc la névrose, à une autre qui recommande leur libre expression et promeut la perversion. »
« Nous avons affaire à une mutation qui nous fait passer d’une économie organisée par le refoulement à une économie organisée par l’exhibition de la jouissance. Il n’est plus possible aujourd’hui d’ouvrir un magazine, d’admirer des personnages ou des héros de notre société sans qu’ils soient marqués par l’état spécifique d’une exhibition de la jouissance. Cela implique des devoirs radicalement nouveaux, des impossibilités, des difficultés et des souffrances différentes. »
Sur l’exposition de Mannheim :
« Le procédé technique mis au point par notre « artiste » autorise donc en toute impunité et pour les meilleurs motif, dans la convivialité, une jouissance « scopique » de la mort. Et donc le franchissement de ce qui était hier aussi bien interdit qu’impossible. La disparition du caractère sacré que peut avoir la mort va dans le sens de cette abolition de tout transfert dont je parlais. Une société qui en vient à prendre plaisir au spectacle de la mort est à tout le moins inquiétante. Vous voyez comment l’abolition de ce qui était la portée habituellement festive, l’instance source des réjouissances, des agapes, de l’enivrement, de la danse, des rencontres, des coups de folie et pour laquelle la figure de Dyonisos servait de référence, au profit d’un spectacle rassemblant des foules autour des images de la mort, a un côté prémonitoire qui mérite de retenir l’attention des psychanalystes et des ethnologues. »
« S’il y a donc une découverte de Freud, c’est bien ceci : notre rapport au monde et à nous-même est mis en place non par un objet, mais par le manque d’un objet, et d’un objet d’élection, essentiel, d’un objet chéri, puisque, dans la figuration oedipienne par exemple, c’est de la mère qu’il est question. Nous sommes les seuls dans le règne animal dont la possibilité de réalisation sexuelle est organisée par une dysfonctionnel, puisque le choix de l’objet est réglé non par une identification des traits caractéristiques du partenaires, partenaire de sexe opposé, ou des odeurs spécifiques, mais par la perte, le renoncement à l’objet aimé. Il faut cette dysfonctionnements pour que chez l’être parlant le sexuel puisse s’accomplir, il faut qu’il ait accès à un semblant, à un fac-similé. »
« Ce n’est pas moi qui viendrai vous rappeler le destin que connaît aujourd’hui la figure paternelle, la façon dont, de manière tout à fait surprenante tant elle est inscrite dans la mode, nous nous employons à venir la châtre, comment elle est de plus en plus, ladite figure, interdite, malmenée, dévalorisée. Je suis heureux qu’un projet de loi ait vu le jour pour permettre enfin en France aux pères de prendre un congé après la naissance de leur enfant. Mais cette nouvelle possibilité, paradoxalement, les astreint à ce qui sera encore une fonction de type maternel. »
« La limite ne serait-elle pas plutôt effacée, pulvérisée ?
Oui, absolument. Elle est si aisément franchie qu’elle en est effacée.
Elle s’auto-avale se fait disparaître comme limite. Et cela n’est pas sans évoquer ce dont vous venez de parler et qui semble tout à fait d’actualité, l’exigence de présentation plutôt que de présentation, et donc du même coup de transparence.
C’est qu’est devenu le cinéma. Il ne signifie plus rien, il montre, il dévoile, il exhibe.
Ce qu’on constate aussi bien avec la fascination pour l’expérience de « Loft Story » »
« Voilà qui participe de cette économie nouvelle. Le regard qui est aujourd’hui cette sorte de tortionnaire devant lequel rien ne peut être dissimulé. Notre journalisme soit-disant d’investigation se complaît fréquemment dans le fouille-merde et l’exhibition. A la grande joie, semble-t-il du lecteur heureux d’apprendre que tel homme puissant a une maîtresse : la belle affaire ! Qu’il ait une vie privée ou qu’il n’en ait pas, en quoi est)ce que ça intéresse ou détermine son action politique et les positions qu’il a pu prendre ? Il y a de l’infantilisme en même dans cette panscopie. On connaît cette fameuse histoire du panoptique de Bentham. Ce type génial avait parfaitement prévu le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons : il suffit d’un regard, d’un surveillant, pour voir l’ensemble ; il suffit pour le surveillant d’être à cette place et de jouir d’une vue panoramique sur le destin de ses contemporains comme si celui-ci présentait quelque intérêt. »
« Au fond, c’est comme si on croyait, avec ce type de fonctionnement nouveau, et les possibilités nouvelles qu’il ouvre, pouvoir quitter la métaphore, ne plus habiter le lasagne, ne plus être embarqués d’office dans la parole.
Le français tend à devenir plus iconique que verbal, l’image - revenons-y - ne fonctionne plus comme représentation, mais comme présentation. Il conviendrait que les linguistes s’intéressent à cette langue en train de constituer sur internet, la langue qui sert aux échanges entre internautes qui ne se connaissent pas. Un langage à base d’anglais évidemment est en train de se néoformé.
(…)
Une novlangue donc, tout à fait actuelle. Mais qui aurait quelles caractéristiques ?
Celle d’être un lange exacte, c’est-à-dire de se référer chaque fois à l’objet précis - un mot/une chose- qui réunit les internaute. Que l’on parle de moto ou de timbre-poste, ou que l’on échange des propos érotiques, l’objet présentifié est là, c’est lui qu’on célèbre et c’est autour de lui qu’on se regroupe. Le langage est sans équivoque, il est direct et cru. »
Un sujet compact
« Voilà encore un trait de la nouvelle économie psychique : il n’y a plus de division subjective, le sujet n’est plus divisé. C’est un sujet brut. Parler de sujet divisé, c’est dire déjà qu’il s’interroge sur sa propre existence, qu’il introduit dans sa vie, dans sa façon de penser, une dialectique, une opposition, une réflexion, une façon de dire « Non! ». Aujourd’hui nous ne voyons plus guère l’expression de ce qui serait la division subjective.
Il y a place pour un sujet, mais un sujet qui a perdu sa dimension spécifique. Ca n’est sûrement plus le sujet interne, qui lui donnait un certain recul, un coup d’oeil sur sa vie, sur le monde, ses relations, et des choix possibles. C’est devenu un sujet entier, compact, non divisé. »
« Pour accéder à la satisfaction, il n’est plus nécessaire de passer par le dysfonctionnement que j’évoquais et qui est bien entendu source de névrose. »
« Pourquoi, d’ailleurs, n’aurions-nous pas le droit de trouver dans notre environnement ce qui peut nous satisfaire, et cela quelles que soient nos meurs ? Si un couple homosexuel désire se marier, à quel titre viendrait-on s’y opposer ? Si un transsexuel demande un changement d’identité, à quelle autorité feriez-vous référence pour le refuser ? Ou si une sexagénaire veut avoir un enfant, au nom de quoi l’éconduire ? Dans la situation actuelle, dès lors qu’il y a en vous un tel type de souhait, il devient légitime, et il devient légitime qu’il trouve sa satisfaction. »
« Justement, allons-nous refuser de supporter les conséquences d’être - comme vous venez de le rappeler - des « animaux dénaturés » ? Si, comme nous l’enseigne la psychanalyse, ce n’est pas l’objet, mais le manque d’objet qui est organisateur de la spécifié humaine, si cet objet - cette chose que la mère sert le plus souvent à métaphoriser - doit être perdu pour que l’humain puisse émerger et si, comme vous le soutenez, le lieu de la limite est mis en place par cette perte, y contrevenir équivaudrait du coup à réaliser un inceste. Est-ce que vous entérinez, de ce fait, la formule selon laquelle nous sommes dans une société incestueuse ?
Le dire ainsi ferait problème. Il est clair, en tous cas, que nous sommes dans une société où la fabrication d’objets aptes à satisfaire les orifices corporels est devenue une sorte d’exigence et rencontre évidemment la faveur collective. Ce sont des objets merveilleux, capables en effet de saturer jusqu’à l’épuisement les orifices visuels et auditifs. »
« C’est vrai, c’est plus complexe, puisque effectivement, il n’y a plus à passer par la réalisation. Voilà qui éclaire bien ce que vous dîtes par ailleurs du père, de la remise en question de sa légitimité. Vous rappelez, à juste titre, que la figure qu’il prend est du côté de l’interdit, de l’empêcheur, du perturbateur. Il n’est plus du tout entendu comme celui qui a la charge de nouer le désir à la Loi, comme le disait Lacan. »
(// Rebel without a cause)
« La fonction du père est de priver l’enfant de sa mère, et ainsi de l’introduire aux lois de l’échange ; au lieu de l’objet chéri, il devrait composer plus tard avec un semblant. »
« (Le père) est seul et tout l’invite en quelque sorte à renoncer à sa fonction pour simplement participer à la fête. La figure paternelle est devenue anachronique. »
« Le désir, normalement, est organisé par un manque symbolique. Mais le manque qui se met en place dans la relation au semblable est seulement imaginaire. Pour être symbolique, il lui faudrait être en rapport avec quelque instance Autre où il trouverait sa justification. Si le désir ne se supporte plus d’un référent Autre, il ne peut plus se nourrir que de l’envie que provoque la possession par l’autre du signe qui marque sa jouissance. Il devient alors un simplet accident social, que le paritarisme doit d’ailleurs réparer : car il est scandaleux qu’il y en ait qui aient plus que d’autres. Un grand journal du soir français a publié les sommes que les dirigeants de grandes entreprises perçoivent grâce à leur stock-option. Il les a publié avec la volonté de jeter ces gens en pâture à ses lecteurs : « Vous voyez ! Quelle injustice ! Ils gagnent tant d’argent alors que vous-même avez un simple salaire… » C’est l’envie même provoqué par ces revenus qui est en jeu, la question n’est pas de les juger. Ce qui est scandaleux, c’est qu’il puisse y avoir de l’envie, et donc du même coup du désir. Il faudrait même arriver à expurger l’envie !”
« Au lieu de respecter le fait qu’il y ait de l’envie, qu’il y ait du désir, ce qui après tout est le grand moteur social et le grand moteur de la pensée, on assiste aujourd’hui à une dénonciation de toutes les asymétries au profit d’une sorte d’égalitarisme qui est évidemment l’image même de la mort, c’est à dire de l’entropie enfin réalisée, de l’immobilité. Vous voyez, on en revient à l’exposition dont nous parlions tout à l’heure, au voeu de mort fondamental qu’il y a derrière toute cette affaire, à ce souhait que tout s’arrête. »
« Par un singulier renversement, ce qui est devenu virtuel c’est la réalité, dès lors qu’elle est insatisfaisante. Ce qui fondait la réalité, sa marque, c’est qu’elle était insatisfaisante, et donc toujours représentative du défaut qui la fondait comme réalité. Ce défaut est désormais relégué à un pur accident, à une insuffisance momentané, circonstancielle, et c’est l’image parfaite, autrefois idéale, qui est devenue réalité. »
« Vous évoquez des sujets flexibles, c’est-à-dire des sujets qui n’ont plus d’assise…
Dans la mesure où ils ne disposent plus de ce lieu, justement, ils sont capables de se prêter à toute une série de domiciliations. Ce sont devenus d’étranges locataires, capables d’habiter des positions a priori parfaitement contradictoires et hétérogènes entre elles, aussi bien dans les modes de pensée que dans les choix de partenaires - y compris s’agissant de sexe du partenaire ou de sa propre identité. Car au fond, pourquoi serions-nous condamnés, par notre naissance, à un parcours déterminé, à l’image de celui des astres, une fois pour toutes ? Pourquoi n’aurions-nous pas un parcours non seulement en zigzag mais éventuellement autorisant des ruptures, des hiatus, des changements de direction, plusieurs vies en une. »
« La carence des identifications symboliques ne laisse pour recours au sujet qu’une lutte incessante pour conserver et renouveler des insignes dont la dévaluation et le renouvellement sont aussi rapides que les évolutions de la mode, et ce, alors que lui-même est inexorablement livré au vieillissement, comme sa voiture. »
« Pour maintenir néanmoins le jeu du désir et éviter qu’il ne vienne s’écraser ou s’étouffer sur l’objet propre à la satisfaire, il n’est pas rare que cet objet se trouve dédoublé, qu’il y en ait deux. Les ménages à trois, c’est vrai, ne datent pas d’hier, mais c’est n’est pas tout à fait d’eux dont il s’agit. »
« Des langages où la valeur iconique revêt une importance majeure comme dans l’alphabet chinois ou japonais, par exemple, où un signe peut être lu à travers soit son expression phonétique, soit son expression imagée, c’est-à-dire à travers ce qu’il désigne, ce dont il est l’objet. »
« Le signe renvoie à la chose. Le signifiant ne peut renvoyer qu’à un autre signifiant ; c’est cette cavale du signifiant qui entretient le désir de « la chose » qui, dès lors, manque. »
« Pour le névrosé, tout objet se présente sur fond d’absence, c’est ce que les psychanalystes appellent la castration. Le pervers, quant à lui, va mettre l’accent exclusivement sur la saisie de cet objet. »
« Mais les pervers, quant à eux, se trouvent pris dans un mécanisme où ce qui organise la jouissance est la saisie de ce qui normalement échappe. Ils s’engagent de ce fait dans une économie singulière, ils entrent dans une dialectique, très monotone, de présence de l’objet en tant que total - objet absolu, l’objet vrai, véritable - et puis de son manque, de son absence. »
« Le refoulement est alimenté, entretenu par ce qui est au départ un refoulement originaire, lui-même organisé par la chute, par la disparition, par l’éclipse de cet objet. »
« La perversion devient une norme sociale. Je ne parle pas ici de la perversion avec sa connotation morale, mais de la perversion avec une connotation clinique fondée sur l’économie libidinale que nous venons de décrire. Elle est aujourd’hui au principe des relations sociales, à travers la façon de se servir du partenaire comme d’un objet que l’on jette dès qu’on l’estime insuffisante. »
« Il s’agit en quelque sorte d’une nouvelle relation à l’objet, qui fait que celui-ci vaut non pas par ce qu’il représente, par ce dont il est le représentant, mais par ce qu’il est. La représentation, jusqu’ici, est normalement acquise une fois pour toute : vous êtes un homme, ou une femme, vous avez cette dignité d’homme ou de femme quel que soit votre âge. Dans certaines cultures, cette représentation se renforce même avec l’âge puisqu’on est supposé gagner en sagesse, en savoir et expérience quand on devient vieux. Et puis vous avez une autre relation, qui est fondée non plus sur la représentation mais sur l’être de l’objet. Cet objet ne vaut que tant que son être est source de bénéfices. Dès qu’il se révélera défectueux, il s’imposera comme un objet totalement dévalorisée devant être envoyée à la casse. »
« Vous ne pouvez plus fantasmer sur le train une fois que le fantasme - au sens le plus courant du terme - est là, mis sur l’affiche. Il y a sûrement un tas de gens qui ont pris le train en y voyant une possibilité de rencontre, de déplacement justement, en se disant qu’ils seront autres à l’occasion de ce voyage et qu’ils croiseront des gens eux-mêmes autres, éloignés de leur petit sol familier… Mais avec cela sur l’affiche, le fantasme est mort. »
« Il s’agirait donc d’une économie du signe, et non plus du langage, du signifiant. Le signe renvoie à la chose, alors que le signifiant renvoie à un autre signifiant. Le mot qui fait signe renvoie directement à ce qui est désigné alors que le mot comme signifiant renvoie sans cesse à un autre mot. La représentation est devenue le signe de l’objet plus que sa métaphore. »
TOXICOMANIE
« Vous disiez que la toxicomanie quittait, sans le savoir, une économie psychique pour une autre. Que cette économie psychique qu’il quittait, c’était l’économie propre au langage, celle qui était mise en place par le langage, et qu’il la quittait pour une économie régie par le signe. Et que c’était cette mutation qui allait le rendre étranger au lien social, dans la mesure où c’est le discours, c’est-à-dire ce qui est soutenu par le langage, qui établit le lien social.
Ce qu’on appelle, d’un point de vue psychique, la pauvreté du toxicomane tient en effet à ce que les métaphores et les métonymies chez eux ne fonctionnent plus. On est dans un langage de signe. Tout y fait signe.
LE PHARMAKON
« Il y a ce très beau concept ancien, que notre pharmacopée a évidemment oublié, le pharaon sur lequel Jacques Derrida a d’ailleurs écrit un très bel article. Avec le pharaon, ce qui était pensée, c’est qu’il y a toujours un objet - ou plusieurs - susceptibles de guérir une maladie et qui, en même temps, est un poison. Autrement dit, l’objet susceptible de guérir notre insatisfaction - insatisfaction vis-à-vis du monde, est un poison. Il suffit de se rappeler ce concept pour s’interroger sur la place de la drogue : médicament absolu qui guérit tous les maux - l’opium et la morphine sont des remèdes que des grandes cultures ont utilisés - et qui tout autant nous dispense de l’existence. Se droguer, c’est expérimenter une espèce de mort. Ou plutôt les drogués sont des morts vivants, ou des vivants morts.
Ce qui revient à dire que le fonctionnement du désir humain n’est pas congruent avec le confort, ou la recherche du confort…
Vous êtes aimable de me le rappeler, mais je crois que c’est une évidence, voire une banalité qu’il est facile de vérifier. En se déplaçant dans n’importe quelle région, on voit très bien comment les existences ont cherché à s’organiser dans une sorte de clôture confortable, avec la petite maison bien protégée, bien chauffée, à l’abri, à l’écart, avec un rapport à l’autre, je ne dirai pas qui est établi une fois pour toutes, mais où finalement la relation sexuelle devient parfaitement secondaire. En revanche, le désir, c’est l’inconfort maximum. S’il n’y a pas d’inconfort, il n’y a pas de désir. L’inconfort, cela veut dire qu’il n’y pas ce qu’il faut, que ce n’est pas comme il faut. »
COMMENT SORTIR DE L’ADOLESCENCE ?
Vous semblez avancer que dans cette nouvelle économie psychique, l’impératif d’entropie est plus intense, plus exigeant, et qu’il n’est pas à la même place que dans un cadre social organisé par le refoulement. Si je rappelais l’inconfort du désir, c’est que pour vous puissiez peut-être vous interroger à propos de l’adolescence, qui n’a pas toujours représenté un grand chapitre de notre histoire individuelle, comme aujourd’hui. L’adolescence, ce n’est au fond que long temps pendant lequel le sujet passe de l’enfance à l’âge adulte. Dans le dernier livre de Houellebecq, Plateforme, les première pages comment par : « Mon père est mort, il y a un an… On ne devient jamais réellement adulte. » L’adolescence, c’est justement ce temps où celui qui n’est pas encore vraiment sujet va consentir à occuper - ou au contraire à refuser de d’occuper - la place de sujet et assumer son désir. La nouvelle économie psychique risque, d’après ce que vous dîtes, d’avoir pour conséquence qu’il sera plus difficile de trouver sa place de sujet.”
LA DETTE
« Cette fille ne doit rien à personne. Or, le problème de la dette symbolique aujourd’hui, par une opération intéressante, c’est qu’elle se renverse, le débiteur devenant créditeur. On connaît l’exemple de ces pays du tiers monde dont les gouvernements, ne pouvant payer la dette, sont obligés de chercher des crédits supplémentaires pour réussir un tant soit peu rembourser quelque chose ! Cette gamine, c’était exactement ça… D’abord, elle ne devait rien à personne, si ce n’est qu’elle avait eu le mois précédent une facture pour son téléphone portable de 8 000 euros. Ce qui veut dire que si sa mère n’avait pas payé la note, elle se serait retrouvée en prison ! Elle se mettait dans la position où faute d’un don, elle risquait de mourir dans sa chambre. Elle n’irait même pas à se prostituer, parce que se prostituer serait entrer dans un mécanisme d’échange véritable. La dette de départ, la dette symbolique, était annulée. Elle savait ce qu’était le partage, mais pas l’échange. Et quand je lui ai dit « mais vous allez en boite, ça coute de l’argent » elle m’a répondu « on rentre avec des amis, on ne paye pas » « Et ensuite vous rentre à la maison, vous mangez quand même ? Oh dans la journée je dors, je mange un oeuf, un peu de pain quand j’en ai. C’est pourquoi je dis que c’est quelque chose de grave. »
« TOUT EST DU. »
LA RESPONSABILITE DU SUJET
« Doit-on penser qu’on pourrait avoir affaire aujourd’hui à un sujet non responsable ? Ce qui rejoindrait le voeu actuel de se faire reconnaître à la moindre occasion comme victime…
Vous avez raison. Le sujet n’est pas responsable dans la mesure où sa détermination subjective ne relève plus de ce qui serait une aventure singulière, d’un choix singulier, mais d’une participation à l’hystérie collective. Du même coup il lui apparaît tout à fait légitime de penser qu’il doit son parcours, son destin, à des circonstances collective et extérieures. La même collectivité lui doit donc réparation de tout ce qui lui manque, puisque c’est niais, par elle, qu’il a été conçu.
Ce que vous dîtes s’est trouvé justifié par le fameux arrêt Perruche : si je ne suis pas bien né, si je suis handicapé, la société me doit réparation. C’est un peu affolant. »
J’ai reçu une femme récemment, d’un certain âge, dont le parcours n’avait pas été très heureux. Elle s’adressait à moi dans l’attente d’une réparation. Et elle se montrait agressive en constatant que je ne m’employais pas à « réparer » ses malheurs : le fait que son mari lui ait laissé des dettes, qu’elle ne trouve pas de travail, que sa fille se montre ingrate… Elle était dans le champ de la revendication.
(…)
Il n’y a pas de réponse. Quand cette femme vient chez moi, c’est avec à la fois cette espèce de plainte douloureuse et une sorte d’étonnement, de surprise, de courroux parce que je ne lui prescris pas le pharmakon. »
LA VIOLENCE
« La violence apparaît à partir du moment où les mots n’ont plus d’efficace. A partir du moment où celui qu parle n’est plus reconnu. Dans un couple, la violence commence quand l’autre refuse de reconnaître, en celui qu’il a en face de lui, un émetteur de paroles, vivant et de bonne foi. Vivant, donc, ayant sa propre économie, ses propres contraintes. Et considéré, quel que soit le désaccord, comme de bonne foi. Dès lors que cette reconnaissance n’a pas lieu, l’autre n’est plus reconnu comme sujet, la violence survient. Vous évoquiez devant moi une rencontre entre deux écrivains israéliens et un palestinien, et vous disiez que malgré leurs lectures totalement différentes, incompatibles des événements du Moye-Orient, ils s’étaient reconnus chacun de bonne foi. Voilà une formidable contre-exemple. O chacun reconnait que l’autre est pris dans une sitatuation où il ne peut pas faire autrement que ce qu’il fait, ou dire autre chose que c’est qu’il dit, qu’il n’a pas le choix en tant que sujet. Mais dans cette époque où nous vivons, de plus en plus souvent, il n le sujet n’est pas reconnu parce que, initialement il n’est pas mis en place. Alors, la violence survient à tout bout de champ, pour tout et pour rien. Une espèce de violence qui est devenue un mode banal de relation social. »
« On ne se parle plus, on fait la guerre. »
« Mais pourtant aujourd’hui on a plutôt libéré le désir sexuel !
On l’a tellement libéré… qu’il est en train de sombrer. Ce qui se passe, quand on parle de libération sexuelle, n’est plus de l’ordre du désir. Celui-ci est en train de passer au second rang après un tas de jouissances beaucoup plus faciles à satisfaire, beaucoup plus économiques. On pourrait voir une ruse magnifique de « l’histoire » dans ce phénomène : cette dénonciation du père pendant des années quand il s’agissait en fait de dénoncer tout simplement le désir sexuel. »
« Ce monde propice à une satisfaction qui n’implique aucune « médiation et ne passant pas par le travail n’a pas manqué de représenter pour notre humanité une sorte d’idéal, un paradis perdu, diront les chrétiens, puisque ce serait par une chute impliquant une déchéance, liée à la punition divine, que nous serions sortis de ce jardin d’Eden où tout était ainsi à notre disposition. »
« Nous avons affaire avec le langage à un système d’éléments - les signifiants - qui, se renvoyant les uns aux autres, ne signifient rien en eux-mêmes. Le désir de l’animal humain, qui passe obligatoirement par le langage, s’organise donc autour de ce qui est dès lors une perte, puisque ce système n’est pas fermée, n’est jamais complet, jamais terminé. Aucun objet ne sera donc susceptible de venir parfaitement combler et satisfaire le désir humain, tout comme aucun mot ne saurait être l’équivalent d’une chose. »
« Le symbole, c’est comme nous le rappelait Lacan, cette moitié de pièce de monnaie qu’un interlocuteur vient proposer à l’autre dans l’attente que celui-ci y mettre l’autre moitié, de telle sorte que les deux réunies forment une seule pièce, une pièce complète. »
« Quand vous voyez des jeunes gens se promener dans la rue avec leurs casques pour soi-disant écouter de la musique, vous avez vraiment le sentiment d’assister à une sorte de tentative mécanique de produire un bruit hallucinatoire permanent. Comme si, ne supportant plus le silence de l’Autre, nous devions entrer dans un monde où, sans cesse, il y aurait des voix, et des voix qui ne sont pas sans conséquences puisqu’elles vous submergent. On voit bien, en observant leurs mimiques, ou même le rythme qu’elles marquent que ces personnes sont effectivement sous influence. On les voit prises dans une espèce de jouissance masturbatoire parfaitement autistique que suscite ce système hallucinatoire artificiellement créé. La relation à autrui est forcément minorée et désinvestie par rapport à la relation à ce système vocal. »
« Le sujet est habité par un inconnu qui vient déranger l’ordre de son monde et dire : « C’est pas ça, la satisfaction n’est pas celle que je veux. » Il y a un désir qui m’anime et que j’ignore, et qui est cependant structuré, qui n’est pas n’importe quel désir, ni une fantaisie. Tel est l’inconscient freudien.
Quoiqu’il en soit, il y a aujourd’hui, dans notre clinique, un « homme libéral », un sujet nouveau »sans gravité », dont la souffrance va, bien entendu, être elle-même différente. On observe de nouvelles expressions cliniques de la souffrance, car celle-ci, malgré le bonheur que la nouvelle économie psychique est supposé nous assurer, vient nous rappeler qu’il y a toujours quelque part un impossible, qu’il y a toujours quelque chose qui cloche. Et je vous donnerai comme exemple celui de ce deux jeunes hommes que je reçois, la quarantaine l’un et l’autre, qui appartiennent tous les deux à un milieu cultivé et qui ont un problème : ils ne peuvent pas tenir en place. Alors il y en a un, charmant comme tout, mais qui ne peut pas tenir en place à côté de sa femme et de ses gosses, il est constamment obligé de partir, de s’en aller. On ne peut pas dire qu’il n’aime pas sa femme, même s’il n’éprouve plus beaucoup de désir pour elle, et il garde beaucoup de tendresse pour ses enfants. Alors il est tout le temps ailleurs, et puis il revient comme au bout d’un élastique, mais c’est surtout pour les gosses, puis il est désolé de ce qui se passe. Il en est confus, il n’en est pas heureux, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il évident qu’avec les autres femmes qu’il rencontre, il ne réalise absolument pas quoi que ce soit qui lui permettrait de tenir une place.
(…)
Nous voyons qu’il s’agit là d’un effet de cette nouvelle économie psychique, qui ne ménage effectivement plus ce lieu où un sujet peut tenir, ce lieu où un sujet peut trouver son hein, son chez soi. »
« Ce à quoi l’homme aspire, c’est l’enfer » disait Lacan. L’homme veut réaliser son fantasme, et la réalisation de ce fantasme, c’est l’enfer. Il n’y a de choix qu’entre le semblant de la réalité et le réel de l’enfer. »
LE PATRONYME
« Ainsi, en France, on vient d’autoriser le sujet à choisir son patronyme ! Un sujet de réflexion pour les psychanalystes ! Qu’en pensez-vous ?
On a légiféré sur le patronyme comme s’il s’agissait d’une question secondaire, comme n’importe quelle autre. Comme si on se disait : pourquoi faire endosser par le nouveau venu dans la famille une histoire, des dettes, des devoirs, des obligations, tout cet univers signifiant déjà là que le patronyme lui colle avant même qu’il ait eu le temps de crier. Peut-être que s’il crie, d’ailleurs, l’enfant, c’est pour cela ! Parce qu’il a compris qu’il porte déjà un sacré poids. Il est intelligent, il réagit tout de suite ! Nous nous sommes affranchis du patriarcat, paraît-il, alors pourquoi pas le matronyme plutôt que le patronyme ? Personne, pourtant, ne remarque que le matronyme, dans le cas présent, n’en est pas un, c’est toujours un patronyme puisque c’est le nom du père de cette femme.
(…)
Nul ne se demande ce que cela implique comme déterminations humanisantes pour l’enfant de venir s’inscrire dans une lignée, dans une mémoire, et d’avoir à l’endosser notamment par la nomination. »
« Je vous rappelle ce propos de Lacan : « Le prolétaire est serf non du maître, mais de sa jouissance » Cette phrase est d’une richesse considérable. Eh bien, ce que nous voyons aujourd’hui, c’est précisément cela : il n’y a plus de maîtres, dans nos cultures, le patron, c’est la jouissance. De telle sorte qu’on assiste, si vous me permettez ce commentaire ironique, à une étonnante victoire prolétarienne que Marx n’avait pas prévue : la prolétarisation de l’ensemble de la société. Tous prolétaires ! Tous serviteurs ! Tous des captifs, des obéissants vis-à-vis de la jouissance ! »
« C’est à l’évidence l’excès qui est devenu la norme.
Et un excès qui n’est pas vécu sur le mode ponctuel d’une transgression.
Qui, non seulement, n’est pas vécu sur le mode d’une transgression, mais qui l’est sur le mode d’une prescription : la prescription de l’excès comme tel. »
« Un libertinage de masse. »
« Le don comme origine de l’échange. »
« La reconnaissance selon le modèle ancien était acquise une fois pour toutes : lorsque vous vous étiez fait reconnaître par un certain nombre de qualités, votre « passage » vers un certain statut était admis et définitif. Le sujet capitaliste, aujourd’hui, court sans cesse après cette reconnaissance, exposé à tous les aléas du devenir propre à l’économie, c’est-à-dire risquant de se ruiner, de se retrouver en prison, bref de disparaître. »
« La participation à la vie de la société, le lien social, ne passe plus par le partage d’un refoulement collectif, ce qu’on appelle les us et coutumes, mais, au contraire, par un ralliement à une sorte de fête permanente, où chacun est convié. Ce qui est aujourd’hui est à la charge du sujet, c’est de se maintenir dans la course à la jouissance. Condamné à la jeunesse perpétuelle, il ne s’en porte pas bien, car cette jouissance, qui lui est imposée n’est plus régulée à partir d’un lieu Autre. Plus rien ne vient témoigner de son acmé et de sa détumescence. Et le sujet en ressent un certain désarroi et souffre dès lors d’un manque de repère. Comme s’il se demandait : qu’est-ce qu’on me veut ? »
« Le seul service que peut plus que jamais rendre le psychanalyste, c’est de faire exister ce lieu de recel, ce lieu vide qui permet à un sujet d’organiser sa parole, qui est autrement incohérente, ce dont il souffre. La surprise du sujet c’est de venir parler sur un divan à quelqu’un qui ne lui répond pas et de constater que cette parole dont il est le support se met à s’organiser.
Ce qui permet de redessiner un contour du sujet.
Et du même coup lui redonner une place. De telle sorte que, désormais, lorsqu’il arrivera chez l’analyste, il lui arrivera - le cas est fréquent - de sortir ses clés de sa poche en pensant que là il rentre chez lui. »
« A la question énigmatique qui se pose à tout sujet , « Que suis-je ? », nous voyons donc ce qu’il convient de répondre : en fin de compte, ce qui constitue mon être, c’est cet objet foncièrement perdu, hors réalité, fruit de la prise dans le langage, qui sera le roc réfractaire sur lequel butera le flux des signifiants - des mots pour le dire trop simplement - en même temps qu’il viendra fonder pour le sujet sa part définitivement et secrète, puisque de lui-même ignorée.
Voilà le dispositif que subvertit la mutation culturelle introduite par le libéralisme économique en encourageant un hédonisme débridé. Ce n’et de ce fait, plus une économie psychique organisée par la présentation d’un objet désormais accessible et par l’accomplissement jusqu’à son terme de la jouissance. »
« Cette dite économie ne fait qu’interpeller un consommateur abstrait qui doit s’adapter aux offres - mirobolantes comme nous le savons - qui lui sont faites : ce sont elles qui désormais le subjectivement. Et, d’ainsi tourner autour de l’objet disponible, les créatures elles-mêmes se transforment en objet, ne sont plus que des ectoplasmes auxquels, plus que jamais, s’impose le sentiment d’un vécu virtuel. »
« Comme vous le voyez il s’agit bien avec cette nouvelle économie psychique d’un homme nouveau ! Mais la question est de savoir si cet homme nouveau entrainera la péremption de l’ancien modèle, si cet « homme libéral » assuré du bien-fondé de sa jouissance va définitivement prendre le dessus sur le sujet « parlant - celui que Lacan appelait le parlêtre - toujours contraire de payer le prix de son désir. Autrement dit, le libre cours de la jouissance va-t-il l’emporter sur l’irréductible tourment du désir ?
Ce qui demande à exister, à devenir sujet va-t-il persévérer et finir par trouver sa voie et par là-même retrouver sa voix ? Ou au contraire, cet humain soumis aux lois du langage va-t-il se laisser définitivement noyer dans la recherche de sa jouissance immédiate ? Une telle méprise va-t-elle pouvoir se poursuivre, et peut-être même durer ? Le mutant de la NEP va-t-il devoir trouver de quoi se sustenter autrement ou au contraire ne pouvoir s’accomplir que dans l’auto-destruction ?
Notre joyeuse perversité polymorphe peut-elle durer ? Ou allons-nous en revenir à l’ordre moral et au bâton ? Ou peut-on penser qu’avertis, nous pourrions éviter autant le retour à la névrose freudienne de papa que la fuite en avant dans la perversion généralisée ? On verra bien »
1 note
·
View note
Text
Michel Foucault : la surveillance généralisée expliquée
Michel Foucault est l’essayiste visionnaire, qui a su décortiquer l’histoire de la surveillance au XXème siècle. Et punir.
Dans “Surveiller et Punir“, il explique l’évolution de notre société. Et toujours visionnaire, dans un temps où la surveillance systématique se déploie . En Chine, avec de la reconnaissance faciale, et même en France, avec des projets “en test” aux Jeux Olympiques de…
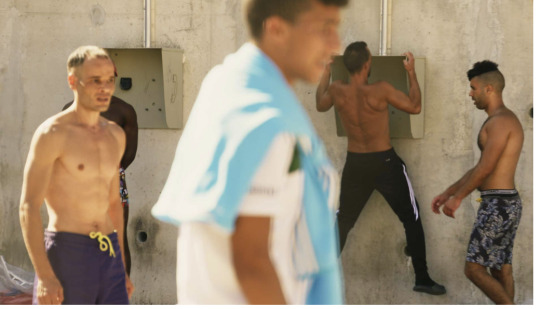
View On WordPress
#histoire de la surveillance et discpline#résumé michel foucault surveiller et punir#surveillance généralisée transfoNum#surveillance michel foucault#surveillance panoptique
0 notes
Video
Tous surveillés : 7 milliards de suspects | ARTE (Canada (Québec) | 2020 | 90 minutes
Un film de Ludovic Gaillard, Sylvain Louvet
Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux technologies de surveillance.
Caméras à reconnaissance faciale, détecteurs à émotions, système de notation des citoyens, drones tueurs autonomes…
De la Chine aux États-Unis, d’Israël à la France, l’enquête nous entraine dans les rouages de cette machine de surveillance mondiale et donne la parole aux premières victimes de ce flicage hors norme.
Une obsession sécuritaire qui dans certains pays, est en train de donner naissance à une nouvelle forme de régime : le totalitarisme numérique. Le cauchemar d’Orwell.
==
Avec “Tous surveillés : sept milliards de suspects”, sa glaçante enquête diffusée sur Arte ce mardi 21 avril, le réalisateur Sylvain Louvet nous met en garde contre le développement de technologies de plus en plus intrusives. Des outils qui mettent en danger nos libertés. Et la pandémie actuelle n’arrange rien. Entretien.
Dans Tous surveillés : sept milliards de suspects, son redoutable documentaire sur la banalisation de dispositifs techniques toujours plus prédateurs de nos libertés, le réalisateur Sylvain Louvet compare le risque sécuritaire, invisible, permanent, alimenté par les politiques et les industriels, à un virus. Alors que le Covid-19 affaiblit les corps en même temps que les défenses immunitaires de nos démocraties, son film devient étrangement prophétique : non seulement la surveillance est partout, mais chacun peut désormais la voir se matérialiser dans son environnement intime, au nom de l’urgence sanitaire.
Cette industrie, dont le poids se chiffre à quarante milliards de dollars, possède une particularité : elle craint la lumière, et à la pénombre, préfère encore l’opacité. Particulièrement prisées par les régimes autoritaires et dictatoriaux, les technologies les plus intrusives se frayent aujourd’hui un chemin jusque dans nos démocraties occidentales, au nom d’une faim jamais rassasiée de sécurité.
Sous nos latitudes, des élus s’en félicitent en répétant les promesses des brochures commerciales dont ils sont abreuvés ; en Chine, nouvel épicentre de l’innovation technologique, ce nouvel arsenal renforce un peu plus un quadrillage policier toujours plus serré. Y compris contre les journalistes un peu trop curieux.
Votre film navigue entre la France et la Chine, en passant par Israël. Comment s’empare-t-on d’un sujet aussi insaisissable que la surveillance ?
Sylvain Louvet : Je m’étais déjà rendu plusieurs fois en Chine, et j’avais pu observer à quel point Xi Jinping cherche à exporter son savoir-faire en matière de contrôle social, à travers notamment cette doctrine des nouvelles routes de la soie, version numérique. Quand il a transformé le Xinjiang, cette région à majorité musulmane, en laboratoire grandeur nature de la surveillance, je me suis dit qu’il y avait matière à un film.
Mais ça m’intéressait de partir de chez nous, pour montrer qu’un véritable mouvement de fond est enclenché au niveau mondial. En voyant fleurir les expérimentations de reconnaissance faciale en France, les détecteurs d’émotions à Nice, les capteurs de sons suspects à Saint-Étienne, j’ai voulu alerter le public sur cette société du tout-sécuritaire qui se dessine. On croit à tort qu’il s’agit d’un horizon lointain, alors que les films de science-fiction des années 90 n’ont jamais semblé aussi proches de la réalité. Dans ce modèle, pas besoin de 300 000 agents derrière des ordinateurs : comme dans le panoptique décrit par le philosophe britannique Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, les gens modifient d’eux-mêmes leur comportement.
Ce qui caractérise ce “marché de la peur”, c’est la vitesse de son expansion, au nom d’une innovation permanente. Où arrêter son enquête ?
J’ai écrit le sujet il y a deux ans, et l’enquête a pris environ un an. Il y a tellement d’exemples qu’on aurait facilement pu tourner deux ou trois films. Dans cette course à l’armement technologique, j’ai choisi de m’arrêter à la Plateforme intégrée d’opérations conjointes (Ijop), l’application utilisée par la police pour surveiller les Ouïgours au Xinjiang, en les classant par degré de suspicion pour les envoyer dans des camps de rééducation. C’est, comme aurait pu le décrire Orwell, le cas d’école d’une population qui disparaît sous l’invasion des technologies de surveillance. À mes yeux, l’Ijop est ce qui se fait de plus intrusif et de plus liberticide aujourd’hui.
Justement, comment avez-vous pu tourner au Xinjiang, qui est probablement la région la plus surveillée au monde ?
La filature a commencé avant. Je tenais à un visa presse, qui nous rendait visibles mais offrait aussi une protection. J’ai dit que je voulais faire un film sur l’intelligence artificielle et son utilisation à des fins sécuritaires. J’ai dû me faire inviter par des entreprises chinoises ; on m’a demandé mon parcours. Au bout de la première semaine de tournage, on a commencé à être suivis par la police, après avoir filmé un bâtiment d’État à Rongcheng, au sud-est de Pékin. On a été pris en photo par des officiels, et, à partir de là, on ne nous a plus lâchés. Des agents dormaient sur le parking et dans le hall de l’hôtel. On a vu des policiers sortir de nos chambres, on a été interpellés dans la rue et on nous a finalement demandé de quitter la région, en nous filochant jusque dans l’avion.
On a repris le tournage dans une autre région, on a de nouveau été suivis, et lorsqu’on est arrivés au Xinjiang, ça s’est resserré. Comme j’avais une petite expérience des terrains sensibles, notamment parce que j’ai enquêté sur les services secrets turcs, j’ai tout de suite mis en place un système de sauvegarde un peu particulier pour protéger nos images. Au Xinjiang, les citoyens ouïghours ont à cœur de parler de ce qui se passe. Un dixième de la population a été déporté dans un camp, c’est un véritable ethnocide culturel, tout le monde a un parent enfermé. Mais, dans le même temps, beaucoup de Chinois ne savent même pas ce qu’il se passe là-bas, puisqu’on leur répète qu’il s’agit d’une politique antiterroriste.
Est-il possible de recueillir des témoignages dans ces conditions ? Dans le film, votre chauffeur disparaît mystérieusement…
Nous pensions être en sécurité à l’intérieur de la voiture. Après sa disparition, on nous a dit qu’il avait été interrogé par la police, mais qu’il allait bien. Pourtant, quelques semaines plus tard, tous nos interlocuteurs nous ont rayés de la liste de leurs contacts sur les réseaux sociaux chinois. Il a fallu s’assurer que les gens qu’on rencontrait avaient bien conscience du risque. On s’est par exemple interdit les rencontres dans des cafés ou d’autres lieux publics, infestés de caméras. On a également minimisé les risques en restant une semaine sur place, afin de ne pas trop attirer l’attention.
Quand on est un journaliste occidental là-bas, on est radioactif, et il a fallu choisir un fixeur sinophone n’ayant pas la nationalité chinoise, pour ne pas le mettre en danger. Cela a été éprouvant jusqu’au bout, puisque les autorités nous ont convoqués au commissariat une heure et demie avant de prendre l’avion. On leur a dit qu’on avait le droit de partir ; j’ai glissé la carte mémoire dans ma chaussette, on a sauté dans un taxi, direction l’aéroport.
“Comme un virus, la peur des attentats se propage”, nous dit la voix off au début du film. Quel regard portez-vous sur la pandémie et le risque qu’elle fait peser sur nos libertés ?
Quand cette image du virus de la surveillance a surgi en salle de montage en octobre, je n’imaginais pas un seul instant vivre une situation comme celle à laquelle nous faisons face aujourd’hui. L’irruption de cette pandémie fait vraiment écho à mon film car il se passe très exactement ce qu’on y décrit.
Le schéma est toujours le même : les États justifient les dispositifs de surveillance par la nécessité de protéger les citoyens d’une menace. Ceux-ci sont déployés à titre dérogatoire ou préventif. Or, dès que surgit un attentat ou un virus, le verrou saute et les technologies sont généralisées. On l’a vu avec le Patriot Act aux États-Unis après le 11 Septembre, ou avec l’état d’urgence chez nous. L’adhésion se fait par la peur, et ce que je trouve terrifiant, c’est que la pandémie est un levier encore plus puissant que le risque terroriste. Il suffit de voir à quel point les Français seraient prêts à accepter l’installation d’une application intrusive pour sortir du confinement.
Source : Télérama
0 notes
Video
youtube
Big Brother n'a rien inventé, en réalité nous sommes observés depuis bien longtemps. En 1791, le philosophe Jeremy Bentham invente une prison appelée le panoptique, il crée ainsi l'ancêtre de la société de surveillance. Culture Prime, l’offre culturelle 100% vidéo, 100% sociale de l’audiovisuel public, à retrouver sur : Facebook : https://facebook.com/cultureprime Twitter : https://twitter.com/culture_prime La newsletter hebdo : https://www.cultureprime.fr Abonnez-vous pour retrouver toutes les vidéos France Culture : https://www.youtube.com/channel/UCd5DKToXYTKAQ6khzewww2g/?sub_confirmation=1 Et retrouvez-nous sur... Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture
0 notes
Text
La soirée jeune bourgeoisie
Chloé lui avait ouvert car dit-elle, la maîtresse de maison était occupé en bas. Vincent croisait parfois sans avoir pu jusqu’ici lier conversation, cette fille jolie et même bonne, dans des soirées où la discussion est toujours interrompue par un événement extérieur. Très vite ce fut quelques bribes, pendant qu'il déposait des bouteilles de bière dans le réfrigérateur. "Tu ressembles à G* C*, tu sais ?" C'est toi qui as cuisiné tout ça? Quel homme!" Vincent eut un haut-le-cœur comme toujours en ce genre de moment, tenta autant que possible de redresser un thorax fébrile, d’avoir l’air d’un quel homme, guetta une place autour du minibar, la trouva, y demeura. C'était le stade premier des prises de contact, le stade des piques pour voir, les tests de début d'apéro entre deux inconnus. Elle se tourna pour saisir l'ouvre-bouteille ; à la dérobée il regarda. Très jolie, les yeux clairs, un type flamand bien tourné mais hélas corrompu d'un bronzage saumon foncé presque fushia (il avait fait très beau temps cette semaine) qui gâchait son teint véritable. A son cou pendait une forme dont il chercha un moment le sens. Il comprit... C'était une carte de l'Afrique. Vincent regarda Chloé comme si elle venait de péter puis se détournant d’elle pour toujours rafla trois bières au frigo, les ouvrit, et partit avec s’affaler près de la fenêtre sur une bergère en toile de Jouy, d’où il pourrait se donner une contenance en examinant les titres des livres alignés dans la bibliothèque contiguë. A peine installé, la sonnette retentit et très vite plusieurs couples d'invités firent effraction ensemble avec des hurlements stridents, les filles fléchissant les genoux comme sur des skis faisaient les yeux ronds, criant et gloussant l'incrédulité qu'elles semblaient éprouver de se retrouver ; les garçons se donnant des bises et des poignées de tennisman, Vincent fut bisé de force par quatre barbes successives pourvues de sourires à dents rétractiles qui s’éloignèrent après avoir prononcé des prénoms. Il lui fallait éviter de biser les filles, aussi siffla-t-il deux bières coup sur coup ; les conversations continuèrent sans lui. Demeuré seul assis sur la bergère en toile de Jouy, il écouta distraitement les nouveaux venus s’expliquer des choses sur un certain Romaric. "très international, Kuala Lumpur, San Francisco, il fait du VTT », « Je veux adopter un petit africain je ne veux pas d'enfant naturel, oui un Haïtien ». Jusqu’à15h on détermina quelle séries Netflix avait fait pleurer chacun, puis quelqu’un demanda « tu fais quoi dans la vie », ce à quoi il fut répondu « veille active, je veux faire complètement autre chose, partir à l’aventure ». Une voix, que Vincent reconnut pour celle de Chloé, évoqua alors l’existence d’un Poste de commercial à Dubaï.« Je vais activer mes réseaux ». Cette perspective rassura tout le monde. « Comment tu n'as pas vu les magnifiques escaliers Buren qu'ils ont mis?», demanda une voix. Vincent perdit le fil. L’examen des titres alignés sur les étagères l'avait arrêté à une édition ancienne des Mémoires de Saint-Simon en quatre volumes reliés cuir, aux tranches ornées de lettrage or, décoré de feuilles de chêne. Se levant, déjà légèrement ivre, il saisit le premier volume. Sans l'ouvrir Vincent scruta la couverture, tourna, retourna l'ouvrage, le soupesa, le respira, le rangea à sa place. Personne ne prêtait attention à lui. Il remarqua à côté du premier volume un format poche plus récent intitulé "Biographie du duc de Saint-Simon". Cette fois, extrayant l'ouvrage, Vincent le feuilleta. Les pages défilèrent sous son doigt comme des cartes à jouer dans une trieuse. Soudain une annotation écrite au stylo rouge dans la marge trancha avec l'uniformité des lignes imprimées. Revenant en arrière dans les pages Vincent trouva le passage incriminé : "Le discours de Saint-Simon sur les jésuites est globalement très négatif dans les mémoires et, à l'inverse, son affection pour les jansénistes dont il est amené à parler saute aux yeux, avec une tendance évidente à les parer de toutes les vertus et à faire des solitaires de Port-Royal des saints et des martyrs." Un lecteur inconnu avait souligné en rouge ce dernier mot et commenté dans la marge "Ce qu'ils furent historiquement, gros con".
- Alors tu trouves ton bonheur?
Une très belle jeune femme sortit Vincent de la lecture. Sans attendre de réponse ni prendre garde à lui elle se baissa pour fouiller dans un sac-à-main déposé là. Un soutif noir affleurait sous le haut blanc transparent. Elle se releva et légère comme une sylphide, sautilla vite vers le groupe d’invités d’où elle venait. Vincent mit un temps à chasser de son esprit ce corps élancé vers le monde, tendu de seins, monté sur des jambes piédestales. Il se rabattit sur l'examen des étagères, avisa un ouvrage titré en gros caractères "Surveiller et Punir". Ouvrant le pavé en son milieu, il tomba sur le cahier des illustrations, où figuraient quatre gravures d'anciennes prisons panoptiques, ainsi que des schémas d'endoctrinement et des planches d'anatomie crées d'après la dissection de corps de détenus décédés. Il rangea "Surveiller et Punir" à sa place, derrière une photo de jeunes mariés. Et il sut, il sut où il avait croisé Chloé la première fois. C’était dans un banquet de mariage au Concert Noble à Bruxelles. Elle avait été occupée jusqu’au banquet à triturer son téléphone, à faire des allers et venues entre les invités et à pousser des hurlements à chaque nouvelle connaissance qui arrivait. Elle allumait tous les garçons, l’un par des œillades, l’autre par des questions sur sa situation maritale, c’était une experte. Rapidement bourrée, elle avait galoché le photographe du mariage sur la piste de danse, puis pour une raison inconnue s’était mise plus tard à pleurer assise à une table vide et ne s’était calmée qu’une fois entourée de quinze ou seize consolatrices, et là, avait vomi par terre. A peu près au même moment, deux garçons qu’elle avait mis en concurrence au cours de la soirée avaient entamé une bagarre qui s’était propagée à trois autres types complètement hors de cause, dont l’un avait finalement reçu un coup de tesson de flûte à champagne à un centimètre de la carotide ; il avait été évacué sur une civière entre la vie et la mort, semant de grosses gouttes de sang noir à chaque mètre sur le marbre du Concert Noble. Personne n’était remonté aux origines du mal. Vincent avait tout vu, n’avait rien dit. Mais cet épisode avait contribué à l’horreur qu’il avait des mariages en général. Qu'est-ce que c'était qu'un mariage finalement? Une fois passé le discours du maire teinté de ce mauvais humour mondain? Ne restait qu'une fête ruineuse qui excite les jalousies, conclue une fois sur deux dans le sang. Le taux de bagarres dans ce type d'évènement frise les 50%, tous les ambulanciers le savent. Le niveau moyen d'effondrement des sociétés se voyait là, dans les mariages, à l'accoutrement des femmes, qu'elles voulaient raffiné : bariolé, criard, mal maîtrisé. Les faces surtout, étaient incroyablement bises. Les filles bronzaient sous banc solaire parfois deux semaines à l'avance en prévision de la soirée, certaines de se « sublimer » par l’unification du teint le moins blanc possible (phénomène de nivellement par le bas). La civilisation des UV remplaçait celle de l'ombrelle. L’obligation du bronzage féminin, phénomène récent, procédait selon Vincent d’une méconnaissance totale des femmes en matière de canons de la beauté féminine. « Il y a une beauté objective. Le hâle ne sied qu’aux filles aux cheveux noirs » prêchait-il parfois. Gavées de vin dès l'apéritif, les filles viraient à partir du hors-d'oeuvre au rouge fushia boucané, pas regardable. Dès lors il s'agissait pour Vincent d'égarer les raseurs et de se préserver des haleines, de montrer de l'enthousiasme pour garder contenance. La population repue de sucres rapides allait bientôt danser sur "Celebration". Il n'aurait pas lieu ce grand sourire de la vie, se disait Vincent avant de plonger dans le romantisme. (Vincent repense à "elle". Les hauts-parleurs passaient "Umbrella"... Hongkong. Les petites Waspies bien élevées du King George V... L'une d'elle le tire par la main qu'elle serre entre ses jambes pour ne plus qu'il parte, elle le serre ainsi, il la serre sur son coeur! Ils se regardent. Ils s'emboîtent encore. C'est fini tout ça.) Le lendemain des mariages il pleut, il faut se réveiller misérable et pourri.
Vincent médita un moment sur les filles du lycée King George V de Hong Kong, puis sur ce titre d'un ouvrage de William Morris, Comment nous vivons et comment nous pourrions vivre, jusqu'à ce que le sentiment d'avoir manqué un destin tout de grâce et de volupté fût trop douloureux. Il pensa se resservir mais la seule idée d'approcher du groupe d'amis de Chloé pour accéder au frigo lui répugna. Mû par un besoin subséquent à la consommation de bière il partit en salle d’eau à l'étage supérieur, après avoir embarqué un livre « La civilisation romaine ». Sur place il s’assit, laissa la lumière éteinte comme il en avait l’habitude et s’éclaira avec la fonction lampe torche du téléphone. Le bruit de la fête lui parvenait en sourdine, il était tout à fait tranquille. L'album comportait une carte des invasions barbares du 5eme au 7eme siècle avec des flèches illustrant les mouvements de population. "Burgondes", "lombards", "vandales" ; ces flux interrompaient le cours normal des échanges commerciaux "pourpre", fourrure", "blé" marqués de fine flèches bleues; en outre l'espace était parsemé de zones hachurées représentant les évènements funestes "destruction de ville", "massacre", "rafles d'esclaves", tandis que deux sabres croisés marquaient les batailles rangées avec l’année et le nombre de milliers de morts.
Vincent ferma le livre, éteint la lampe torche. Méditant sur des visions d'invasions barbares il imagina la même carte représentant les invasions barbares du 21eme siècle. Il visualisa des flèches "PMA", "créolisation grammaticale", "femmes blanches", des zones hachurées "centre de métissage". On verrait les flux d'argent prélevés sur les Européens ("impôts") se diriger en flèches vers les centres de groupement des migrants.Un autre calque indiquerait les flux invisibles mettant en relief les transformations culturelles et spirituelles. On verrait de Californie partir de nombreuses flèches "propagande", "déstabilisant émotionnel", "porno". Il visualise aussi une représentation colorimétrique de l'Europe mise au centre du monde qui mettrrait en évidence la rareté des teintes existant sur le physique des peuples européens, qui soudain mettraient à nu la supercherie : ils étaient eux seuls le peuple de couleur. Ainsi l'Europe apparaitrait toute de neige et de nacre, serie de vert, de bleu, de châtain, de blondeur, de brunerie, de jais et constellée de tâches de rousseur. Elle formerait une île de couleur au milieu d'autres terres toutes monochromes, cantonnées à un marron plus ou moins foncé mais uniforme.
Vincent ferma le livre, alla se laver les mains à une magnifique vasque creusée dans un plan de travail en marbre, en face d'un haut miroir entouré de petits éclairages indirects. Il saisit un savon au jasmin et se frotta longuement, délicieusement les mains sous le filet d'eau tiède. L'assortiment de nettoyage à droite de la vasque était fourni comme dans un hôtel de luxe, il y avait même une pierre ponce comme chez ses grands-parents de l'avenue Mozart, lorsqu'il était enfant. Séchant ses mains à une serviette il constata que le savon laissait la peau agréablement sèche. C'était autre chose que ces crèmes lavantes de distributeurs de station-service qui laissent une couche d’huile inséchable, surtout entre les doigts. En quittant la salle de bains il se sentit purifié presque autant que lorsqu'il quittait l'église avec sa classe de CM1 le samedi matin, le jour reparaissait sur le seuil et c'était comme renaître au monde.
Au moment de regagner le salon Vincent vit par une fenêtre en contrebas dans la rue un jeune couple comme-il-faut, d'un genre très à son goût. Cette lumière de fin d'après-midi dans les feuillages, cette force tranquille des belles pierres de taille, cette puissance d'exister... Ces bourgeois à larges épaules de son enfance, qui eux en vivaient, de cette beauté, qui s'en allaient par les belles rues calmes du seizième dans les beaux soirs de juin.
Au moment de descendre un hurlement féminin monta depuis la salle de séjour, qui exprimait un goût pour une musique quelconque. C’était probablement Chloé. Vincent n’eut plus la force d'affronter le monde. Il s’immobilisa, pris au piège. Que faire ? Et si quelqu’un montait ? Il sortit son téléphone. C’est toujours acepté par la norme, de s’isoler avec son téléphone.
Le fil d’actualité proposait #elleatable Et si le souping était le nouveau juicing d’hiver ? Impatient de connaître la réponse, il cliqua. L’article était illustré de photos suréclairés d’assiettes remplies de liquides verts et rouges, posées sur des tables en verre dépoli. Sa curiosité satisfaite il cliqua sur le nom de l’auteur de l’article. Après deux autres liens il glissa graduellement dans un monde hors du temps où l’angoisse du réel passe en sourdine comme lorsque la sirène des pompiers est atténuée par la fenêtre que l’on ferme, fuite qui ne résoud rien mais qui permet d’oublier. Vincent était en train de se perdre sur internet.
"Il est courant d’opposer militantisme et recherche scientifique. Ces deux champs de l’activité humaine s’excluraient ainsi mutuellement : une démarche scientifique serait neutre, et donc a-partisane, quand le militantisme, idéologique par définition, serait un point de vue fondamentalement a-scientifique, voire anti-scientifique. Une telle affirmation repose explicitement sur une croyance en une neutralité de la science, croyance qui en est bien une, et qui ne repose sur... " Vincent cliqua sur un lien.
« Les vidéos de témoignages non vloguées ont ainsi une place importante, que ce soit chez Léa Bordier (42 k) ou Elles aussi (175k), chaîne créée dans le sillage #metoo. La vidéaste et ancienne journaliste Marinette (20 k) peut même être proche du documentaire transgénérationnel avec ses vidéos sur l’avortement. Ce sont surtout les youtubeuses afroféministes qui, certainement en raison du travail à effectuer, s’adonnent le plus à ce genre: Naya (18 k), La Toile d’Alma (2,7 k), Nadjélika (239k) ou Keysholes & Snapshots (5 k) sont les plus connues, la dernière ayant été nommée par le concours organisé par l’association Les Internettes. Le féminisme islamique est quant à lui représenté, encore timidement, par Foulard et féminisme (15k). La toile francophone afro semble touchée par l’afroféminisme, comme le montrent des vlogueuses bien plus divertissantes (par exemple Leslinha Luberto, 27 k). »
4 notes
·
View notes
Photo


Après l’atelier photo, Lisa, médiatrice au centre d’Art GwinZegal a présenté l’exposition Contrôle +Z sur la surveillance électronique aux élèves.
Ensuite, ceux-ci ont réalisé un Escape Game en équipes en lien avec l’exposition, ils ont résolu des énigmes tout en visitant la prison et en observant les œuvres.
Des notions telle que algorithme et panoptique ont été mises en avant pour permettre aux élèves de s’enrichir et de comprendre ce que les artistes ont voulu exprimer.
0 notes